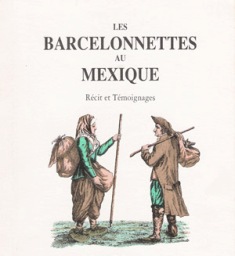
LES «BARCELONNETTES» AU MEXIQUE
tiré de : BULLETIN
DE LA
SOCIÉTÉ SCIENTIFIQUE ET LITTÉRAIRE
DES BASSES-ALPES
TOME V
1891-1892
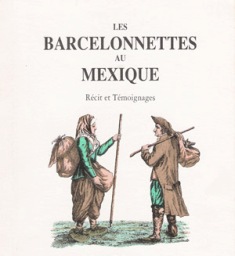
I. Expatriations hivernales antérieures à l'expatriation au Mexique.
L'arrondissement de Barcelonnette, le moins populeux des Basses-Alpes, occupe tout le bassin de l'Ubaye et l'extrémité supérieure de celui du Verdon, où se trouve le minuscule canton d'Allos, composé d'une seule commune. Sa population, 15,477 habitants, est répartie sur une très grande surface et sa densité n'est que de 13 habitants par kilomètre carré ; les rochers incultes et les montagnes pastorales forment les quatre cinquièmes de la superficie totale. Les vallées sont froides; le sol est maigre et produit à peine du blé pour la nourriture de ses habitants. Les vastes pâturages, sa seule richesse, lui permettent de nourrir sur ses montagnes, pendant la saison d'été, près de 30,000 moutons qui vont hiverner en Provence et, pendant toute l'année, 25,000 brebis pour l'élevage. Le canton de Saint-Paul est formé des hautes vallées de l'Ubaye et de l'Ubayette, jusqu'à leur confluent aux Gleizolles Dans la haute vallée de l'Ubaye, à partir du col Longet, on trouve, en descendant, les trois hameaux de Maurin à peu près à 2,000 mètres d'altitude, les Sérennes, Saint-Paul, le Mélezen et Tournoux, sur la rive droite ; Fouillouse et Gleizolles, sur la rive gauche; dans celle de l'Ubayette, à partir du col de Largentière ou de la Magdelaine, Maison-Méane, Larche. Certamussat, Meyronnes, Font-Vive et Saint-Ours. Le canton de Barcelonnette commence à la Condamine-Chatelard. Toute cette partie supérieure, gardée par le fort de Tournoux et les batteries de Viraysse, Roche-la-Croix et Vallon-Clos, portait autrefois le nom de Val-des-Monts et se désigne encore sous le nom de Hauts-Châteaux. Après une gorge de 5 kilomètres, s'ouvre la vallée proprement dite de l'Ubaye, où s'étalent Jausiers et ses hameaux (l'Hubach, la Frâche, Lans, Sanières), Faucon et Barcelonnette (à 1,333 mètres d'altitude), Saint-Pons et les Thuiles ; sur la rive gauche, Enchastrayes et Uvernet et, derrière le Mont Olan, la vallée du Bachelard ou de Fours. Les vallées sont encaissées par des montagnes de 3,000 mètres de hauteur (1), sur les flancs desquelles les cultures atteignent 1,700 mètres, les prés et les bois 2,000 mètres et les pâturages 2,800 mètres d'altitude. Ce sont ces deux cantons de Saint-Paul et de Barcelonnette qui, avec une population de 10,000 âmes seulement, vont, pendant 50 ans, fournir toute l'expatriation au Mexique qui fait l'objet de cette étude. La vallée de Barcelonnette, détachée de la Provence en 1388, a appartenu à la Savoie jusqu'au traité d'Utrech, en 1713. Vers 1300, elle commença à transformer les laines de ses moutons en gros draps, appelés cadis et cordeillats, et en serges, en les mêlant au chanvre.
(1) C'est à cette situation, plus encore qu'à l'altitude, que nos vallées doivent leur renom de froides vallées des Alpes : au solstice d'hiver, au lieu de 8 heures de soleil, qu'on a au bord de la mer ou dans les grandes plaines de nos latitudes, Barcelonnette n'en a que 6 et demie, Jausiers 0, Larche 5, la Condamine 4, Meyronnes 3, Saint-Paul 2. Méolaus ne voit pas le soleil pendant 12 jours.
En 1689, elle produisait, outre sa consommation, 4,000 pièces de cordeillats, que ses habitants allaient vendre en Provence, en Dauphiné et surtout en Piémont (1). Vers la même époque, on commença à filer les cocons de soie à Jausiers, puis à Uvernet. C'est à ce moment que notre vallée posséda l'élément indispensable à la prospérité d'un pays de montagnes, une industrie qui lui permettait d'occuper les bras de ses habitants pendant la longue saison d'hiver et de tirer le meilleur parti de la laine de ses moutons, leur unique produit à cette époque, où la viande ne se vendait pas; c'est alors enfin que, pour trouver la vente de leurs cadis, cordeillats et serges, nos ancêtres commencèrent à parcourir la Provence, le Dauphiné, le Piémont, pénétrèrent jusqu'en Bourgogne et prirent le goût du commerce et l'habitude de cette expatriation hivernale que devait remplacer, 150 ans plus tard, l'expatriation au Mexique. Industrie locale et commerce en hiver remplissaient le bas de laine de nos paysans, qui se retrouvaient tous au printemps pour cultiver le terroir et pousser le défrichement de la vallée jusqu'aux dernières limites de la végétation. Dans le mémoire présenté à Louis XIV en 1713, les habitants de la vallée demandent à être rattachés à la Provence : " Parce qu'ils se proposent de renouer avec les habitants de la Basse-Provence leur ancienne intelligence, correspondance et amitié, de lier avec eux des sociétés de bestiaux, qui pâtureront durant l'hiver dans les plaines de Provence et pendant l'été sur les Alpes du vicariat (2)."
(1) Mémoire de M. Pascalis, prieur de Molanès, official de Mgr l'archevêque
d'Embrun à Barcelonnette, sur les manufactures de laine de la vallée. (Archivi
Piemontese, mazzo 15, n° 57, Torino.)
(2) Le vicariat de Barcelonnette comprenait l'arrondissement actuel, moins les communes de Saint-Vincent, Ubaye, Pontis et la Bréole, qui avaient toujours appartenu à la Provence, et plus les communes d'Entraunes et Saint-Martin d'Entraunes.
"Ce commerce, disent-ils, fut un des moyens dont les anciens comtes de Provence se servirent pour peupler ce pays. L'on voit, dans l'acte d'hommage rendu à Charles III, le 5 juin 1385, que ce prince accorda aux habitants du vicariat la liberté de passer dans toute la Provence avec des troupeaux pour y hiverner et retourner, l'été, sur leurs montagnes, sans payer aucun droit de passages, péages, pulvérages et ramages. Si ce commerce fut l'unique motif qui attira des habitants dans une terre déserte (1), il n'est pas moins nécessaire aujourd'hui pour y rappeler ceux qui l'ont abandonnée.
(1) Ce commerce, en enrichissant la vallée, a pu aider à son peuplement, mais elle était déjà peuplée bien des siècles avant. Dana le traité passé le 21 février 1281, entre Raimond Béranger V, comte de Provence et de Forcalquier, et les syndicts de Faucon et Drolha (Saint-Pons), pour la reconstruction de Barcelonnette, il n'est nullement question de troupeaux transhumants. Ce serait donc entre ces deux dates, 1231 et 1385, qu'il faudrait placer l'origine de ce commerce. Mais, dans le registre 41 de la série B des Archives des Bouches-du-Rhône, se trouve, fas 66 à 82, un très important document, non indiqué dans l'inventaire et dont je réserve la publication prochaine au Bulletin de la Société des Basses-Alpes. Il contient, entre autres documents importants, la copie complète de l'hommage prêté à Charles III par les habitants d'Allos entre les mains de Jean de Grimaldi, baron de Breil, son capitaine, et de Balthazar de Spinolis, son sénéchal, le 12 août 1385. Outre l'exemption des droits de passage, pulverage, péage et ramage pour les troupeaux transhumants: Averia hominum loci de Alosio qui in Provincia, causa estivandi, ire contingerit de redire, causa estivandi, in partibus monteneorium, on y trouve le droit pour les habitants d'Allos de louer librement leurs pâturages, pascua, à qui ils voudraient et de disposer du prix, sans diminution aucune, ... sicut de jure possunt juxta premissum privilegium, comme ils en ont le droit par le privilège susénoncé. Ce privilège susénoncé est celui qui leur avait été accordé par Raymond Berenger V, à Barcelonnette, dans la maison de Guillaume Gastinel, le 27 novembre 1233, en récompense de leur fidélité. C'est donc bien avant le XIIIe siècle qu'il faut reporter l'origine des troupeaux transhumants des Alpes en Provence probablement jusqu'à l'époque romaine, ou tout au moins jusqu'en l'an 500, où Théodoric, roi des Ostrogoths, ordonna à son général Fridibaldus de défendre les troupeaux des Alpes de toute pillerie. (M. Fournier, tome Ier, p. 443, lettre tirée de Cassiodore.)
L'avantage qui reviendra du pâturage des bestiaux, ce sera d'engraisser les terres et de remettre en valeur celles qui sont en friche (1). Cela, joint au produit même des bestiaux, leur fournira de quoi subsister. Le second profit, encore plus considérable, proviendra des laines et des manufactures de cadis et des cordeillats. Le pays et les habitants y sont très propres et ils s'y occuperont durant huit mois de l'hyver... " Louis XIV, en rattachant la vallée de Barcelonnette à la Provence, lui permit de reprendre ses associations de troupeaux et lui donna toutes facilités pour son commerce extérieur : « Les habitants de la vallée de Barcelonnette pourront librement commercer, aller et venir de ladite vallée en Provence et de Provence dans ladite vallée sans payer aucuns droits... ; et, pour ce qui regarde la communication de ladite vallée en Dauphiné, les marchandises venant de Dauphiné dans ladite vallée payeront seulement la douane de Valence, et celles qui sortiront de ladite vallée pour le Dauphiné payeront le droit de la Foraine suivant les tarifs, ainsi qu'il est accoutumé pour les marchandises qui passent de Provence en Dauphiné, et la douane de Valence au premier bureau (2). " Dès lors, les relations avec les bergers provençaux furent reprises ; le mérinos, ou petit mouton d'Arles, à laine fine, remplaça peu à peu dans la vallée la ravate, ou grand mouton à nez busqué et à laine grossière; l'industrie de la manufacture des draps cadis et cordeillats à domicile prospéra,
(1) Notre vallée fut tellement foulée par les guerres de Louis XIV, de 1703 à 1713, que beaucoup d'habitants vaient émigré et abandonné leurs terres. (Mémoires du maréchal de Berwick.)
(2) Déclaration du roi qui règle la juridiction de la vallée de Barcelonnete du 21 février 1716, art. XVII.
et l'expatriation hivernale pour l'écoulement des produits manufacturés devint régulière. Le pays conserva tous ses bras pour les travaux de la terre et se suffit complétement à lui-même. Cette situation se maintint malgré les guerres de la Succession d'Autriche et celles de la République et du premier Empire, à la suite desquelles nos paysans introduisirent chez eux l'hivernage et l'élevage des poulains, mules et mulets, qui remplaça en partie l'hivernage des moutons et amena un courant de voyages : à Valence, pour l'achat des gros mulets ; en Poitou et même en Bretagne, pour l'achat des poulains de printemps, et dans la rivière de Ce commerce, qui dura jusque vers 1860 et développa l'habitude des voyages chez nos montagnards, fut remplacé peu à peu, à cette époque, par celui des moutons gras pour le marché d'Aix, et depuis cette année seulement (1891) pour le marché de Paris (1). Entre temps et dès le commencement de ce siècle, l'expatriation hivernale pour le commerce de colporteurs augmenta considérablement : les habitants de Fours surtout, d'Enchastrayes, d'Uvernet parcouraient, en hiver, la balle sur le dos, la Bourgogne, les Flandres, la Belgique, la Hollande, le Luxembourg. Les habitants du canton de Saint-Paul et ceux de Jausiers exploitèrent surtout la Bourgogne et la ville de Lyon, où ils vendaient à crédit, en automne, aux canuts tout ce dont ils avaient besoin dans leur ménage et se faisaient payer, au printemps, avant de rentrer. Les trois quarts des chefs de maison partaient fin octobre et, je les vois encore, le pantalon noir relevé, la blouse blanche sur l'habit fin, le chapeau monté, coiffé un peu en arrière et le bâton à la main, filant en bande, avec les hirondelles et avec les marchands de cuirs, qui allaient faire à Lyon leurs provisions d'hiver.
(1) Chaque année, l'arrondissement leur expédie environ 15,000 moutons gras, à 30 francs pièce en moyenne, laine enlevée.
Quelques-uns restaient bien en route, se fixaient et faisaient souche. Prenez les annuaires de Bruges, de Bréda, d'Amsterdam, de Dijon, et vous y trouverez, dans les hauts rangs du commerce, les Ricaud, les Arnaud, les Goin, les Jauffred, les Manuel, de Fours ; à Lyon, la plus forte maison de soieries, la maison Bellon, aujourd'hui Jaubert, sort du Sauze-d'Enchastrayes. Nos compatriotes ont fait bonne figure dans toutes les villes où ils ont commercé; mais les quatre-vingt-dix neuf centièmes restaient cultivateurs dans l'âme, attachés au sol natal. Aussi, que d'argent il rentrait au printemps et comme on se disputait alors les terres à coups de sacs d'écus ! Fours tout seul, vers 1855, couvrit deux fois un emprunt départemental ; aujourd'hui, il n'y a plus le sou et les terres y restent incultes. A Maurin, à Fouillouse, ces premières stations en descendant des nues, ensevelies huit mois sous les neiges, les maisons étaient pleines de linge, de meubles de ménage confortables, luxueux même, et pourtant le Mexique n'avait encore rien produit. Mais, peu à peu, la manufacture à domicile des draps grossiers disparaissait devant la concurrence des fabriques et le développement du luxe, qui poussait aux draps plus fins, plus jolis, mais moins solides de beaucoup ; vers 1860, elle agonisait ; les cardes et les métiers étaient relégués sur les armoires, et c'est à peine si ce pays, qui faisait toute la toile et tout le drap nécessaire à son usage et en fournissait les régions voisines, en produit encore pour le dixième de sa consommation. Les filatures de soie avaient sombré : celle d'Uvernet, emportée par le Bachelard, et celle de Jausiers, attendant d'être érigée en caserne de chasseurs des Alpes. L'expatriation au Mexique avait commencé et devait remplacer totalement, vingt ans plus tard, l'expatriation hivernale. Voyons ses débuts.
II.
Expatriation au Mexique.
ORIGINE (1821-1845).
En 1821, après dix ans de luttes, l'indépendance du
Mexique est un fait accompli : les Espagnols se retirent ;
Iturbide est proclamé empereur l'année suivante et ouvre
les portes du Mexique aux étrangers.
Avant cette époque, un seul Français s'était établi au
Mexique, en se faisant naturaliser Espagnol. Il s'appelait
Laborde et avait fait une fortune énorme, dans l'exploitation
des mines d'argent de Tasco. A son enterrement, dit on,
le char passa, de sa maison au cimetière et à l'église,
sur un sol de barres d'argent, tirées de ses mines de Moray-Milagro.
Les premiers pionniers de la vallée sont partis pour le
Mexique en 1821 ; c'étaient les trois frères Arnaud, de la
filature de soie de Jausiers, qui était située dans la maison
Cottier, à droite en sortant de Jausiers vers l'Italie, et qui
s'est fermée à cette époque. Les Arnaud, d'abord petits
fournisseurs de l'armée américaine à la Nouvelle-Orléans,
vinrent s'établir à Mexico et fondèrent le magasin de Las-Sietes-Puertas, rue Porta-Celi. L'un d'eux, Jacques, fut
assassiné en escortant une conduite d'argent à Guanajuato.
Aucun d'eux n'est rentré en France.
Ils ont été suivis, peu de temps après, par Couttolenc, du
Chazelas, près Barcelonnette, qui a exploité une mine de
cuivre clans la gorge profonde de Chalchicomula. Il a eu
d'une mexicaine trois garçons et d'une bourguignonne un
garçon et deux filles, tous naturalisés mexicains. Cette famille
est devenue puissante dans la province de Puebla.
L'un des fils, Pepe, était colonel mexicain et avait donné la sûreté aux routes de la province de Puebla, par sa fermeté
et sa justice un peu sommaire. Comme Tacon, à la Havane,
il pendait haut et court, le long des routes, tous ceux qui,
pris les armes à la main, ne justifiaient pas à l'instant de
leur identité et de leur honorabilité. Il fut chargé de recevoir
les Français et l'amiral Jurien de la Gravière à San-Juan-Tetihuacan, après l'armistice de la Soledad. Il est
devenu général et gouverneur de l'Etat de Puebla, où cette
famille jouit d'une grande considération.
En 1824, la République fédérative fut proclamée au Mexique,
et, en 1829,la victoire de Tampico, sur Ferdinand VII,
assura son indépendance. L'année suivante, Caire Eugène,
de Briançon, Jauffred Alphonse, de Jausiers, et Teissier, de
l'Hubac, allèrent comme employés dans la maison des
Arnaud. Peu après eux, partirent pour le Mexique les deux
frères Jaubert (dit Valambré) et un Allemand, de l'Adroit
de Barcelonnette, qui dirigea une fabrique de mantas
estampadas, à Puebla ; puis Manuel, du Canton, qui fonda
une pharmacie à Zacatecas et qui est rentré en 1849; les
trois frères Carcinier, de Barcelonnette, deux Chaix et
Desdier Jean-Baptiste, de Lans, qui fondèrent une tannerie
à Mexico. Ces trois derniers sont rentrés, petite fortune
faite, et Desdier s'est retiré à la Chaup-Haute, près Barcelonnette.
En 1838, après la prise de Saint-Jean-d'Uloa, les Français
furent expulsés de Mexico et se réfugièrent à la New-Orléans. Au bout de deux mois, ils purent rentrer ; Caire
Eugène, Jauffred Alphonse et Gabriel Derbez, ce charmant
caractère, ce joyeux compagnon que nous avons connu et
aimé, à Barcelonnette, jusqu'à sa mort, en 1886, fondèrent
alors au Portal-de-las-Flores, n° 5, cette maison de commerce
qui a été le port d'arrivée, où tous les expatriés des
années suivantes recevaient l'hospitalité la plus généreuse,
les conseils les plus désintéressés et le crédit qui leur était
nécessaire. C'est là que débarquèrent Joseph Audiffred, de
Lans, et les deux frères Pautrier, de Barcelonnette, Pascal, de Saint-Paul, Aubert, de Lans. Caire, des Buissons, Gassier
Edouard et Caire lphonse. Tous fondèrent, plus tard,
d'autres maisons de commerce, qui, dès lors, attirèrent de
nombreux compatriotes. En 1813, après l'inondation des
deux torrents d'Abriés et du Versant, qui enlevèrent les
terres et une partie des maisons des hameaux des Payans
et ravagèrent les clos de Gueyniers et de la Murette, dix
jeunes gens partirent ensemble pour le Mexique : Fortoul
Jean-Baptiste, de Jausiers, Caire, des Buissons, Plauchud,
de Lans, et Plauchud, de Gueyniers, Eugène Lèbre. de Barcelonnette,
etc.
En 1845, Caire Eugène et Jauffred Alphonse revinrent
avec 200,000 francs environ chacun, fortune énorme pour
le pays, qui hanta dès lors toutes les imaginations. Les
départs devinrent de plus en plus nombreux: en 1847,
Ebrard John, de Jausiers, qui devait fonder la plus riche
maison du Mexique ; en 1848, Caire Calixte, des Buissons,
avec vingt-six camarades et les deux premières jeunes
filles parties pour le Mexique, les deux soeurs Fortoul Elisa
et Virginie, de Jausiers, qui installèrent un magasin de
modes rue Primera-Plateros; en 1849, Cornille Auguste et
trente-six jeunes gens ; en 1850, Gassier Aimé, Caire Fortuné,
Honoré Reynaud, vingt-cinq camarades et deux jeunes
filles.
Il y avait déjà au Mexique neuf maisons de commerce
de détail tenues par des enfants de la vallée de Barcelonnette,
vendant exclusivement les tissus communs pour vêtements
et linges de corps et de maison, savoir :
A Mexico :
1° Caire Alphonse, successeur de son frère Eugène ;
2° Gassier Edouard, Lèbre Dominique et Caire Jaquille ;
3° Audiffred frères, de Lans ;
4° Aubert, de Lans ;
5° Desdier et Fortoul :
6° A Zacatecas, Vinay et Bovis, successeurs de Manuel ;
7° A Guadalajara, Pascal ;
8° A Puebla, Allemand ;9° A Toluca, Fortoul et Ferrand.
Tout le reste du commerce de détail et demi-gros était
aux mains des Espagnols et des Mexicains. Il y avait huit
maisons de gros allemandes, trois anglaises et deux françaises
(Gauthier et Chabert), trois maisons de banque françaises,
Labadie, Cavalier et la banque suisse de Jecker,
dont le nom devait, dix ans plus tard, apparaître dans les
tripotages financiers qui ont laissé une tâche sur les origines
de l'intervention française au Mexique.
Nos nationaux s'approvisionnaient alors exclusivement
dans les maisons de gros de Mexico, où les marchandises
leur étaient livrées à huit mois, avec escompte de 1 % par
mois.
Le change avec la France était 8 %.
On ne vendait alors qu'au comptant, et la plus forte maison
de Barcelonnette, qui faisait près de deux millions
d'affaires, n'avait, à son inventaire, que 10,000piastres de
crédit, demi-gros et détail compris
En même temps qu'un courant d'émigration s'établissait
entre notre pays et le Mexique, un courant semblable partait
de la partie française du pays basque. Pyrénéens et
Alpins s'associèrent ; mais, dès cette époque, tous les Français,
commerçants en nouveauté, commencèrent à porter
le nom générique de Barcelonnettes. Leur réputation de
sécurité commerciale était solidement établie. Le père Chabert,
de Lyon, négociant en gros, avait l'habitude de dire :
« Qu'il m'arrive un âne coiffé d'un chapeau, pourvu qu'il
soit de Barcelonnette, je lui ouvre crédit sans autre renseignement.
»
Ce seul nom de «Barcelonnettes » devint tellement synonime
de Français, à Mexico, qu'une jeune Mexicaine, demandée
en mariage par un de nos compatriotes qui allait
rentrer, posa, comme condition de son acceptation, qu'elle
n'habiterait, en France, que Paris ou Barcelonnette. Son
mari tint parole, mais choisit Barcelonnette. Une fois le premier désenchantement passé, la jeune femme en riait
elle-même, en nous le racontant.
LE VOYAGE.
Il n'était question alors ni de chemins de fer, ni de bateaux
à vapeur. Nos jeunes gens partaient pour Digne, à
cheval, leur valise en croupe, et, de là, par les diligences,
gagnaient Bordeaux en trois jours et trois nuits, par Avignon
et Toulouse, ou par Lyon et Périgueux. Ils s'embarquaient
sur le premier navire de commerce en partance, où
les secondes coûtaient 400 francs et les troisièmes 300 francs,
la légèreté de leur bourse ne leur permettant pas les premières
à 600 francs. Du reste, pour des montagnards peu
habitués aux douceurs, ils n'étaient pas trop mal, du pain à
discrétion (ou la galette en troisième classe), un demi-litre
de vin par jour, la soupe de légumes à chaque repas, du
petit salé ou de la viande en conserve deux fois par semaine
et des haricots en veux-tu en-voilà ; le tout servi dans un
baquet commun, où chacun pêchait à l'aveuglette, avec la
cuillère et la fourchette qu'il avait le droit de s'offrir en
partant. On couchait dans l'entrepont, sous le rouffle, dans
des placards à deux étages, et, quand le temps le permettait,
sous le tropique, on jouait au bouchon sur le pont, à
l'avant du navire ; cinquante jours à trois mois de cette
existence donnaient le pied marin à nos campagnards et
les purgeaient convenablement.
Vera-Cruz ! Vera-Cruz ! Avec quelle joie on mettait enfin
le pied sur cette terre aux mines d'argent, dont on rêvait
depuis des années ! Mais on ne s'y attardait guère, car, à
deux piastres par jour, la maigre escarcelle se vidait rapidement,
et puis le vomito vous guettait et l'on avait hâte
de sortir des terres chaudes. Le temps d'acheter une marmite,
une gamelle et une couverture, de trouver des arrieros,
muletiers qui, moyennant une piastre par aroba (1),
(1) L'aroba (rup du Piémont) est de 25 livres au petit poids de 12 onces, soit d'environ 375 grammes la livre
portaient les malles et servaient de guides jusqu'à Mexico,
et en route, les gros souliers ferrés, soit par la route de
Cordova, soit par celle de Jalapa. On partait à cinq heures
du matin ; on marchait jusqu'à dix, par des chemins peu
fréquentés par les ingénieurs, où l'on retrouvait de temps
à autre les grandes chaussées pavées des Espagnols de la
conquête. On s'arrêtait près d'une source, on ramassait le
bois mort, on dressait la marmite, où, les jours de liesse,
venait cuire quelque lièvre ou quelque paloma fusillés
au passage ; on dormait à la belle étoile, ou sous quelque
hangar ouvert.
Suivons, avec nos futurs millionnaires, la route de Jalapa,
plus ancienne et plus suivie par les chariots du roulage,
importés au Mexique par un Français nommé Faure.
Cette route traverse, en sortant de Vera-Cruz, douze lieues
de sables arides, qui forment comme une ceinture au Mexique,
puis un territoire maigre et de pauvre végétation. En
approchant de Jalapa, les forêts s'élèvent, tout embroussaillées
de grandes lianes et peuplées de colibris. Les
plantes des pays tempérés croissent à côté de celles du tropique, et nos montagnards pouvaient, pour la première
fois, admirer cette richesse de végétation, mêlant les rosiers
et les orangers de Provence aux daturas et aux hibiscus
de l'Afrique, le pêcher au goyavier, le pommier à
l'avocatier. Ils pouvaient s'enivrer en passant des doux
regards des Jalapaises, les plus belles femmes du Mexique,
et contempler ensuite, en suivant, à travers les forêts, la
chaussée pavée de San-Miguel, d'un côté le Coffre de Perote,
de l'autre, le Pic d'Orazaba, qui élève son cratère à
5,295 mètres au-dessus du niveau de la mer. Après quelques
montées, longues et rapides, les pins et les chênes sombres
succèdent aux biguoniers et aux palmiers, les huttes de
terre ou de pierres sèches, aux jolies cases de roseaux, une
population sale et pauvre, aux belles indiennes de Jalapa
aux longues tresses noires et luisantes. On marche avec
appréhension, l'oeil au guet, car on approche de Pérote, de Puebla et de Rio-Frio, fameux par les attaques des brigands.
La chaussée finie, on marche à travers les déjections
et les scories volcaniques, dures aux pieds. En approchant
de Perote, nos amis font la connaissance du
maguey ou agave, cet aloès aux feuilles gigantesques, au
cône droit s'élevant à deux ou trois mètres de hauteur,
dans le coeur duquel, quand il a sept ans, on creuse une
vasque, au temps de la floraison, pour recueillir cette eau
sucrée qui, en fermentant, prend le goût du vin blanc
nouveau et donne ce pulqué qui devra remplacer le vin
généreux des coteaux de France (1). Laissant Perote au
pied de son coffre couronné de neiges, on rattrape la route
qui vient de Vera-Cruz par la Soledad, la longue montée
de Paso-del-Machio à Bocca-del-Monte, par la Baranca
de Cliiquihuité et par Cordova et Orizaba; on gagne rapidement
Puebla, surnommée De-los-Angeles, à cause de
la beauté de son climat, et qui dispute à Guadalajara le
second rang parmi les villes du Mexique. A quatre lieues
de Puebla, en faisant un petit crochet, nos voyageurs peuvent
aller admirer les proportions colossales de la pyramide
tronquée du Téocali de Cholula, plus colossale que
toutes celles d'Egypte, car la pyramide de Chéops n'était
qu'une naine à côté de celle-là (2). Quelle puissance ont dû
atteindre ces peuples primitifs du Mexique, qui avaient
élevé, au-dessus de cette base colossale de briques, le temple immense de leur Dieu sanguinaire, Quetzalcoatl ! ! !
(1) Cette boisson ne se fabrique que dans un rayon de 30 lieues autour de Mexico, ne supporte pas le transport et se boit au bout de quelques jours. Il ne faut pas confondre ce maguey gigantesque avec le petit maguey des environs de Guadalajara et de Tequila, dont la forte racine distillée donne la Tequila, le cognac du Mexique, que l'on boit volontiers à Barcelonnette et que 1e docteur Lautaret, par expérience, déclare souverain contre les plus fortes indigestions. Avec les racines d'un maguey semblable, les Indiens des Terres Chaudes fabriquent le mescal, de qualité bien inférieure.
(2) Elle mesure encore, d'après M. de Humboldt, 54 mètres de hauteur sur 489 mètres de largeur à sa base, le double de celle de Chéops.
Après San-Martin, la route grimpe péniblement à travers
les forêts de pins résineux, rappelant le pays natal, jusqu'au
village, au mauvais renom, de Rio-Frio, cette forêt
de Bondy de là-bas, le point culminant de la route. Nos
voyageurs ont déjà fait une jolie ascension, à peu près
comme de Marseille à la cime du Brec du Chambeyron,
car ils sont à 3,302 mètres au-dessus du golfe du Mexique,
dominés encore par le cône élancé du Popocalepetl, le
point culminant des Cordillières, plus élevé que le Mont
Blanc de 623 mètres (1). Toujours couvert de neige malgré
le feu éternel qui gronde clans ses flancs, il devait tenter
l'audace de nos Alpins. Notre ami Emile Chabrand a voulu
allumer son cigare à ce brasero géant et a passé, au fond
du cratère, du 24 au 25 avril 1883, une nuit à faire oublier
Empédocle et qui, sous Charles-Quint, lui aurait valu,
comme à Ordaz, compagnon de Fernand Cortez, qui ne
put même pas atteindre la cime, un volcan dans ses
armes. Enfin, par une terrible descente, on dévalait dans la
plaine, dans ce marais immense où flotte, à 2,283 mètres
d'altitude (2), comme un gigantesque radeau, la ville de
Mexico, aux maisons à terrasses, que l'on atteint enfin, par
sept kilomètres de chaussées à travers les lagunes.
C'est ainsi qu'au bout d'une vingtaine de jours de marche,
un peu éreintés, on tombait dans les bras des pays,
qui se répartissaient la caravane et vous donnaient le vivre
et le couvert, en attendant que vous ayez trouvé une place
quelconque pour gagner le vivre et le logement pendant
les six premiers mois et quelques piastres ensuite. Dame !
quand, à 3,000 lieues de son pays, on se trouve sans le sou et
les dents longues, il ne faut pas faire le difficile.
(1) Humboldt donne 5,400 mètres.
(2) Dans les Hautes-Alpes, canton de Guillestre, le village de Saint-Véran," lou pu haut pats enté se mandgea pan ,„
n'est qu'à 2,000 mètres d'altitude.
En l'absence de place dans le commerce, l'un deux fut mis dans un restaurant, à plumer de la volaille ; trois mois après, ses protecteurs, qui l'avaient oublié, venant dîner, crurent reconnaître ce bon type de marmiton, le tablier au cou, assis, une oie sur les genoux, devant un immense panier plein de plumes. Il ne se plaignait pas ; cette résignation les toucha. On le tira de là ; on le plaça dans un magasin où il montra le même amour du travail. Il est revenu millionnaire.
A MEXICO.
Les magasins des Barcelonnettes, même ceux où il se
brassait des millions d'affaires, n'étaient pas luxueux: une
enseigne en toile, clouée sur un cadre en bois, tenant tout
le travers de la maison, attirait le chaland; au-dessous, trois,
cinq ou six grandes bées, toutes ouvertes, sans vitrines, ni
étalage, fermées le soir par les portes massives doublées
de fer et solidement maintenues par une grosse poutre, la
barrouira, engagée dans le mur des deux côtés et fortement
assujettie par de gros coins en bois forcés entre elle
et la porte. Le magasin, d'une seule pièce, blanchi à la
chaux, était divisé en deux, comme une salle de bagages
de chemin de fer, par un long comptoir tenant tout le
travers. Devant, la foule bariolée, bruyante, piaillante d'Indiens
et d'Indiennes, la cigarette aux lèvres ; derrière, les commis,
affairés, empressés, l'oeil au guet néanmoins, tout
prêts à franchir d'un bond le comptoir, à ravoir un coupon.
.. oublié dans le compte et à regagner tranquillement
leur poste; toute la journée debout, de sept heures à la
nuit, entre le comptoir sous lequel se trouvait le tiroir pour
la recette et les étagères de bois blanc peint, où s'empilaient
les marchandises. C'était à qui vendrait le plus et le
plus cher, au-dessus des prix fixés par le patron et marqués
en lettres cabalistiques sur les pièces d'étoffes ; car,
dans ces magasins, en face des clients, pas de hiérarchie, pas de spécialisation. Sans d oute, les derniers arrivés
balayaient le magasin, déballaient, emballaient, couchaient
la nuit sur le comptoir et faisaient les travaux les plus
pénibles de la maison ; mais, une fois la vente ouverte,
c'était à qui savait le mieux prendre le client. Le dernier
venu, par sa bonne mine, par son savoir-faire, vendait
comme les anciens, était à même, dès le premier jour, de
faire montre de ses capacités, de mériter une augmentation
de traitement ou une participation aux bénéfices. Le
soir, on empilait le contenu de son tiroir et on le remettait
au patron ou au caissier, s'il y en avait un. Pas de livre
courant de la vente journalière, pas de contrôle, la confiance
la plus complète ; rarement, bien rarement, elle était
trompée.
Derrière les étagères, se trouvaient l'arrière-magasin et la
salle à manger, où commis et patron allaient, les uns après
les autres, prendre le repas de midi et ou, le soir, le magasin
fermé, tous dînaient ensemble à la même table et au
même ordinaire, qui, du reste, était bien suffisant : à sept heures, café au lait; à midi, deux plats et un dessert;
pour boisson, de l'eau, ou de la bière (0 fr. 80 a), le
vin étant trop cher (5 francs), ou encore le pulqué, peu
usité (0 fr. 75 c.)
Le soir, un potage, un bouilli de boeuf, rôti, salade et
dessert.
Et. sur le fourneau, à poste fixe, le fameux pot de tisane,
bien connu de tous !
La nourriture de la maison était généralement donnée à
l'entreprise, moyennant 4 réaux ou 2 fr. 50 c. par jour et
par bouche, à une cuisinière aux appointements de 12 à
15 piastres par mois, qui, avec une laveuse de vaisselle
(à 10 piastres), un concierge commissionnaire, généralement
marié (à 10 piastres), pour balayer le devant du
comptoir et les dégagements, formait tout le personnel indigène
de la maison.
Dans la semaine, les commis ne sortaient pas ou peu et, fatigués, regagnaient volontiers leurs lits, placés à trois ou
quatre dans de petites chambres ; deux au moins d'entre
eux couchaient sur le comptoir. Le dimanche, le magasin
était fermé à la vente et on utilisait la matinée au déballage,
au pointage et à la mise en place des marchandises ;
dans l'après-midi, chacun allait à ses plaisirs, qui, au café,
qui, au boliché (1), qui ailleurs ; à dix heures au plus tard,
tout le monde était rentré. Quelques rares vacances venaient
couper un peu cette vie de travail : le Jeudi et le
Vendredi-Saint, la Toussaint, la Noël, la Fête-Dieu, le jour
de l'an et enfin le 16 et le 27 septembre, anniversaires du
premier cri et du dernier coup de canon de l'indépendance
mexicaine. Ces jours-là, on pouvait se permettre quelque
partie fine à Sant-Anita ou à San-Cosme, quelques tours
de monte (2) à San-Agustin-Clalpam, ou une soirée au
théâtre ; mais c'était tout. Pas de fréquentation de la société
mexicaine ou espagnole, on n'avait pas le temps ; pas
de mariage pour les commis, par crainte des charges de
famille; peu de cafés, pas de cercles, pas de voyages en
Europe ; il ne fallait pas songer alors à venir, comme
aujourd'hui, faire un tour au pays natal, embrasser ses
parents et retourner. Le voyage était trop long. Les nouvelles
du pays étaient même rares, car les lettres coûtaient
2 fr. 50 c. d'affranchissement.
(1) Jeu de boules et quilles sur sol boisé.
(2) Espèce de jeu autorisé par le gouvernement. Le banquier tient un jeu de quarante cartes, composé de quatre couleurs : coupes, bâtons, or et épées, ayant chacune de 1 au 7, le valet, le cheval et le roi. Après avoir fait couper, il tire de dessous le jeu deux cartes qu'il étale. Sur chacune d'elles les pontes déposent leur enjeu à volonté : " Rien ne va plus! „, et le banquier retourne le jeu et tire les cartes l'une après l'autre. Dès qu'arrive une carte de même valeur qu'une des deux cartes étalées, son tableau a gagné et l'autre a perdu. Le banquier empoche ce dernier et double l'enjeu de l'autre. Si la pramière carte tirée est de même valeur que l'une des deux étalées, ce qu'on appelle" à la parte „, le banquier ne paye à ce tableau gagnant que les trois quarts de l'enjeu. C'est son petit bénéfice.
On vivait entre pays, le plus simplement et le plus économiquement possible, car les
traitements des commis variaient de quinze à vingt piastres
par mois et il fallait, sou à sou, se faire là-dessus un magot
pour s'établir un jour patron ; arrivé là, on n'élargissait
guère son existence, et l'un d'eux avouait bravement que,
quoi qu'il eût déjà un capital de 300,000 francs, il ne sortait
pas le dimanche pour ne pas dépenser d'argent; un autre,
qu'associé à un pâtissier et préposé au four, il n'était sorti
que cinq fois pendant les quinze ans qu'il avait mis à ramasser
son magot.
En somme, quinze ou vingt ans d'une vie de cénobitisme,
de travail forcé et d'économie soutenue, pour faire fortune
et revenir en jouir en France, si l'âge et la santé le permettaient.
A L'INTÉRIEUR.
L'existence de ceux qui étaient allés se fixer dans l'intérieur
du Mexique était la même, quoique souvent plus
mouvementée et quelquefois plus dangereuse, à cause des
fréquentes révolutions qui troublaient le pays.
Jusque vers 1864, il y avait toujours quelque part un
pronunciamento, un général révolté, un parti qui le suivait,
exerçant un vrai brigandage sous prétexte de faire
la guerre au gouvernement, arrivant quelquefois au pouvoir
et plus souvent aussi au poteau d'exécution. D'après
la constitution, les pouvoirs du président duraient quatre
ans ; mais bien peu arrivèrent au bout de leur mandat. Il
suffit, pour s'en convaincre, de jeter un coup d'oeil sur la
liste des présidents :
Iturbide, empereur 1822
Vittorio, président 1823-24
Guerrero 1827
Bocanegra (16 jours) 1829
Vêles, Quintana et Alamon 1829
Bustamante 1830
Pedraza et Muzquiz 1882 Sant-Anna et Farias 1833
Barrogan et Corro 1836
Bustamante 1837
Echeveria et Santa-Anna 1841
Santa-Anna, dictateur 1843
Herrero, président 1844
Paredes et Salas 1846
Santa-Anna 1846
Pedro Anaya, Pegna y Pegna 1847
Herrero 1848
Arista, Cevallos,Mugica,Lombardinia 1851
Santa-Anna, dictateur 1853
Carrera, Alvarez et Comonfort 1855
Benito Juarez 1857
Arrivée de la flotte française 1862,7 janvier.
Maximilien, empereur, 1864 au 19 juin 1867
Benito Juarez, jusqu'au 19 juillet 1872
Lerdo de Tejada 18721876
Lerdo de Tejada 1876-1877
Porfirio-Diaz 1877-1880
Manuel Gonzalez 1880-1884
Porfirio Diaz 1884-1888
Porfirio Diaz 1888
Ainsi, de 1824 à 1857, en trente-six ans, de Vittorio à Benito
Juarez, le Mexique a eu trente un présidents effectifs,au lieu
de neuf, sans compter les nombreuses tentatives échouées,
mais qui désolaient une province ou deux pendant quelques
mois. C'était la révolution permanente et si, à 2 kilomètres
de Mexico et dans les rues mêmes de la ville, on pouvait
être enlevé et rançonné, quelle sécurité pouvait-on espérer
dans les provinces sans routes, sans police ? Nos compatriotes,
qui voulurent s'établir dans l'intérieur, durent s'armer
de courage et y vivre sur le qui-vive, comme en pays
ennemi.
Je n'en citerai qu'un exemple : en 1869, après avoir roulé sa bosse dans tout le Mexique et tenté la fortune dans diverses industries, notre excellent
ami, Auguste Co u,
ni charbon et fort peu de blé, le maïs formant la base de la
nourriture de cette contrée. Mais le pays est riche en bois,
pour chauffer la chaudière ; le sol est d'une fertilité exceptionnelle,
et, pendant qu'on installera les machines, on
engagera les Indiens à gratter la terre, à y semer le blé
qu'on leur donnera gratis et on achètera la récolte
d'avance à un prix exceptionnellement rémunérateur, mais
qui enrichira néanmoins les cultivateurs. A l'oeuvre !
D'abord, pour supporter la machine et l'arbre de couche,
un fort massif de maçonnerie. C'est dans ses flancs que
sera cachée, à l'abri de tout soupçon et de tout désastre, la
vaste tirelire où viendront s'engouffrer les piastres, pour
ne les en sortir, comme on pourra, qu'au jour du départ
pour la France. Le moulin est entouré de bonnes murailles;
comme accès, une seule porte massive fermée dès
quatre heures du soir par d'énormes poutres ; six molosses,
enchaînés tout le jour, seront lâchés le soir et ne connaîtront
que les deux patrons, enfermés seuls avec eux jusqu'au
matin et dormant d'un oeil. Pas un Français dans ce
village de 4 à 5,000 âmes ; pas un Français à 30 lieues à la
ronde, jusqu'à Jalapa et à Puebla; la campagne tenue par
des bandes de malandrins et, dans le village, leurs frères
et amis prêts à leur donner la main. Il faudra tâcher
d'être bien avec les chefs, car leur protection seule peut
donner la sécurité. Le hasard d'une rencontre, quelques
politesses, une invitation à dîner, le son du moulin donné
en cadeau pour les chevaux suffisent souvent à gagner
ces irréguliers, qui tiennent loyalement leurs promesses.
Du reste, on n'est que deux pauvres diables, gagnant péniblement
la vie, pleurant toujours misère, bons garçons
cependant, mangeant tout ce qu'ils gagnent, recevant bien,
mais toujours à la veille de faire faillite. Qui passe pour riche est perdu ; un beau jour, il est
enlevé, conduit dans la montagne et rançonné. Qui a fait
le coup ? Tout le monde et personne. Un Espagnol, Pedro
Almendaro, installé à Perote, fait un peu de flafla ; il est
enlevé à deux pas du village, gardé dix-huit jours dans la
montagne et, sous les menaces de mort, rachète sa liberté
moyennant 1,000 onces d'or ou 80,000 francs. Le lendemain,
le voisin de nos deux meuniers, connaissant les
talents de mécanicien de M. Gréfoz, vient tranquillement
le prier de lui arranger la montre de l'Espagnol, échue
dans son lot !
A bon entendeur, salut ! Nos amis ne se montrent plus
que la culotte percée, prennent à crédit dans les magasins,
ne payent plus rien et se laissent saisir pour 25 francs,
tandis que le coffre invisible se remplit, qu'on fait passer
des piastres à Puebla, dans des sacs de farine, trop lourds
pour les détrousseurs de grand chemin, vivant de tortillas
et qu'on fait payer à Jalapa par un ami obligeant, dont tout
le monde plaint l'aveuglement qui le pousse à faire crédit
à de si pauvres diables.
Cependant la charge (14 arobas) de blé s'achète 30 à
35 francs ; la charge de farine se vend de 90 à 100 francs.
Prélevez les frais que vous voudrez. A 35 francs de bénéfice
moyen par charge de blé moulu (et il en passe 3,000 par an
sous les meules), la fortune est faite en quatre ans et peu à
peu exportée à Puebla ou à Jalapa. Il s'agit de filer, car on
en a assez de cette vie de labeur incessant, de nuits et de
jours pleins de terreurs et d'alertes continuelles, et il faut
surtout permettre au successeur d'entretenir les illusions
des habitants sur la position des meuniers. On a déjà deviné
que le successeur est l'ami de Jalapa, ce bon gogo de
Pascal (de Jausiers), qui faisait si facilement crédit. Un
beau jour, il arrive à Perote, désillusionné, furieux, ruiné
par ces meuniers de malheur ; toute sa fortune y a passé ;
il le crie sur les toits. Pour ne pas mourir de faim, il faut
bien qu'il fasse marcher maintenant ce satané moulin, dont il a chassé ses débiteurs insolvables..., à qui cependant il
vient de signer joyeusement une dernière traite de
30,000 francs pour le matériel, certain qu'il est de faire sa
pelote en quelques années, s'il ne lui arrive pas malheur.
Et, de fait, un mois après son installation, en 1873, le gouverneur
de Vera-Cruz, Pancho Landero, envoyait à Perote
quarante hommes bien commandés et une liste à émarger.
.jpg) ----Perote
----Perote
En trois jours, une douzaine de bandits, la terreur du pays,
est fusillée sans jugement : leur chef, sur la porte d'un
café, après lui avoir laissé finir sa partie de billard; l'heureux
possesseur de la montre de l'Espagnol, sur la place
publique ; les autres, partout où on les trouve. Après ces
exécutions, une trentaine d'individus allèrent prudemment
chercher fortune ailleurs, et la sécurité régna dans Perote.
N'allez pas traiter ce récit d'histoire de brigands ; c'est
la pure vérité, et les André Audiffred, Caire Jean-Baptiste
et Victor, Gassier Aimé, Fortolis Félix et tutti quanti,
enlevés et rançonnés, sont là pour l'attester. Je me hâte
d'ajouter qu'il y a bientôt vingt-cinq ans de cela et que,
depuis, les révolutions intérieures ont cessé. Benito Juarez,
le héros de l'indépendance mexicaine, de 1857 à 1872, Lerdo
de Tejada, dans ses deux présidences successives (1872-1877),et surtout Porfirio Diaz dans ses trois présidences,
ont su y mettre bon ordre par les procédés sommaires,
mais efficaces, de Pancho Landero. Le Mexique d'aujourd'hui,
au point de vue de la sécurité, ne ressemble pas
davantage à celui d'avant l'intervention française que
notre France actuelle à celle du XIVe siècle, parcourue par
les bandes de routiers.
PROGRÈS(1845-1868).
Aussi les progrès de nos compatriotes furent-ils d'abord
bien lents. En 1864, dix-huit magasins dans Mexico et
vingt-cinq dans tout le reste du Mexique, tenus par eux, et
c'était tout ; simples magasins de détail, vendant les étoffes
à bas prix, à la partie la plus inférieure de la population, quelques modestes qu'ils fussent, ils méritent d'être
cités (1) :
A Mexico même, dix-neuf magasins :
Au Portal-de-las Flores :
1° Gassier et Raynaud, aux Fabriques françaises ;
2° Aubert et Plauchud, à la Valenciana ;
3° Vinay et Audiffred, au Templo del Commercio ;
4° Rue San-Domingo, Jauffred et Falque, à la Estrella
de San-Domingo ;
5° Rue Tacuba, Lions et Audiffred, à la Reforma del
Commercio ;
A la Primera-Monterilla :
6° Caire et Cie, au Grand-Oriental ;
7° Jauffred et Ollivier, à la Ciudad de Londres ;
8° Ebrard et Fortalis, à la Francia maritima ;
9° Martel et Etcharen, Correo del Commercio ;
10° A la Primera de San-Juan : Cottier Joseph ;
A San-Bernardo :
11° Ebrard et Fortolis, au Puerto de Liverpool;
12° Richaud Isidore.
Rue Plateras :
13° Mlles Fortoul soeurs, modistes ;
14° Plaisant Antoine, pâtissier liquoriste ;
15° Au Refugio : Plaisant Charles, pâtissier ;
Au Portai de Angustino :
16° Borel Charles et Pellotier Théophile, chapeliers;
17° Desdier Louis, courtier ;
18° Gandoulf Eugène, courtier ;
19° Caire frères, entrepreneurs de roulage.
Dans l'intérieur du Mexique, vingt-cinq maisons, savoir :
A Guadalaraja :
1° Léautaud frères ;
2° Lèbre et Gandoulf ;
(1) II y avait bien quelques magasins français pour la clientèle riche, notamment la maison Goupil, mais aucun d'eux tenu par des Barcelonnettes.
3° Richaud:
A Oaxaca :
4° Brès Antoine ;
5° Audiffred François ;
A Puebla :
6° Chaix Jean-Baptiste ;
7° Lions Jean-Baptiste ;
8° Barbaroux Jules ;
A San-Luis-de-Potosi :
9° Michel Antoine;
10° Audiffred et Tron, pâtissiers :
11° Cuzinc Hyppolite, maître d'hôtel ;
A Guanajuato :
12° Clariond et Audiffred ;
13° Fortoul Jacques ;
14° Caire Jean-Baptiste ;
15° A Morelia: James;
16° A San-Juan-Tetiuacan : Fortoul, chapelier ;
17° A Chalco : Audiffred frères ;
18° A Zacatecas : Bovis, pharmacien
19° À Jalmolonga : Caire frères, haciendados ;
20° A Temascaltepec, hacienda de Tenayac : Caire et
Boisson ;
21° A Chalchicomoula : Plauchud Paul, institution d'in
struction;
22° A Pachuca : Julien Auguste
23° A Queretaro : Ventre Honoré ;
24° A Toulancingo : Vinay et Caire ;
25° A Xuchi : Fabre et Fortoul.
En tout, quarante-cinq établissements, employant près de
quatre cents « Barcelonnettes ».
Jusqu'à cette époque, tous ces magasins, simplement de
détail, se fourniront exclusivement dans les maisons de
gros de Mexico, tenues par des Allemands, des Anglais et
des Espagnols. Mais, en 1863, profitant de la ligne des
paquebots nouvellement établie entre Saint-Nazaire et Vera-Cruz, Jauffred et Ollivier d'abord, puis Gassier Aimé,
Ebrard John et Caire Calixte vinrent en France et commencèrent
à s'approvisionner directement en Europe, par
l'entremise des commissionnaires, qui prenaient 5 °/° de
commission. Cessant d'être tributaires des maisons de gros
de Mexico et, tout en continuant à vendre au détail, nos
compatriotes commencèrent à vendre sérieusement en gros
eux-mêmes, et bientôt nous les verrons fonder des maisons
de commission, Gassier et Baume, à Manchester ; Ebrard,
puis Jauffred et Ollivier, à Paris.
.jpg) ---Une succursale de “Las Fabricas de Francia”
---Une succursale de “Las Fabricas de Francia”
LA SOCIÉTÉ DE BIENFAISANCE.
Avant d'exposer les rapides progrès accomplis par nos
compatriotes dans les vingt-cinq années qui vont suivre, il
est juste et il est bon de faire connaître la part importante
prise par eux dans la création d'une des plus belles oeuvres
de prévoyance et de bienfaisance que des Français aient
fondées à l'étranger.
Le 4 septembre 1842, les Français établis à Mexico formèrent
une association portant le nom de « Société française
de prévoyance », ayant pour objet :
« De soulager les malheureux, d'encourager l'union, l'ordre
et l'économie. »
Cette association fonda :
1° Une Société de bienfaisance, où chaque membre payait
une cotisation minimum de cinq francs tous les trois mois,
sans droit d'entrée, et qui donnait aux malheureux des
secours en argent fixés par le comité, payait le médecin (1),
et rapatriait ceux qui n'avaient pas réussi jusqu'à Vera-
Cruz, d'où un navire de l'Etat les ramenait en France ;
2° Une mutuelle, où l'on payait deux piastres de cotisation
par mois et qui donnait à ses membres malades uneindemnité pécuniaire, suivant les ressources de la caisse;
(1) D'abord le docteur François Clément, puis le docteur Jourdanet, qui a épousé la richissime MIle Vestigy, la belle-soeur de notre ministre Dano.
3° Une caisse d'épargne, ouverte à tous les membres de
l'association, qui pouvaient y verser jusqu'à 3,000 piastres.
La caisse d'épargne payait l'intérêt au 7 % (le taux civil
légal était 6 % et le taux commercial 12 %). La caisse
d'épargne opérait une retenue de quinze jours au versement
et quinze jours au retrait des sommes déposées. Ce
boni était versé à la bienfaisance.
Sauf le traitement d'un teneur de livres et d'un garçon
de recettes, toutes les fonctions de l'association étaient
gratuites.
Les fonds de la caisse étaient déposés chez les banquiers
Cavalier, Labadie, Jecker (1) et, plus tard, Martin et Daran.
La Société française de prévoyance, malgré des débuts
difficiles, rendit de grands services et reçut dans son sein
les Suisses établis à Mexico. Le 1er décembre 1848, elle fut
réorganisée sous le nom de: « Société française et suisse
de bienveillance et de prévoyance », et, douze ans plus tard,
ayant annexé les Belges, elle fut de nouveau organisée, le
7 février 1860,sous le nom qu'elle porte encore aujourd'hui
de : «Association française, suisse et belge de bienfaisance
et de prévoyance. » Mais la plus grande part dans l'administration
est réservée aux Français, qui l'ont créée ; le ministre
de France au Mexique est, d'après l'article 3 des
statuts, président honoraire de l'association ; il est invité
à présider toutes les assemblées générales ; enfin, sur douze
membres qui composent le conseil d'administration, dix
sont Français, un Belge et un Suisse (article 22).
Les statuts sont remarquablement conçus et savent concilier
la plus entière liberté, la plus complète publicité,
avec le respect absolu des droits de chaque membre.
(4) Jecker avait en dépôt 113,000 francs de la caisse d'épargne quand il fit faillite, vers 1858. Ce fut une des principales réclamations du gouvernement français, et, pendant l'intervention, Jecker, qui avait repris ses affaires, remboursa intégralement la somme et les intérêts.
Outre les deux assemblées générales annuelles, il y a assemblée
générale extraordinaire sur la demande de vingt cinq
membres (il y en a plus de mille). Peuvent assister aux
assemblées générales tous les citoyens français, suisses
et belges, non sociétaires, sauf à s'abstenir de voter. Le
conseil cherche à procurer du travail aux Français,
Suisses et Belges qui en manquent et s'enquiert des pauvres
honteux et des misères secrètes, pour les secourir.
Tout membre de l'association qui aura publié par la voie
de la presse un article diffamatoire pourra, par ce seul
fait, être exclu de la Société (article 46).
L'association dirige aujourd'hui :
1° Un fonds de bienfaisance ;
2° Une caisse d'épargne ;
3° Une maison de santé ;
4° Un cimetière.
Le fonds de bienfaisance est alimenté par des cotisations
mensuelles, sans obligation de taux, ni de durée, et
par les dons éventuels en argent ou objets divers.
Pendant le siège de Puebla par Forez, Juarez lança un
décret d'expulsion contre les Français habitant Mexico,
qui, sous peine d'être fusillés, devaient apporter leurs
armes et se retirer à quarante lieues en arrière de Mexico;
mais il tenait en telle estime nos nationaux qu'il leur fit
dire que ce décret n'était pris que pour prévoir un mouvement
de l'opinion publique, qu'ils n'avaient qu'à rester
chez eux, à ne pas se montrer et qu'il fermerait les yeux.
Néanmoins, la Société de bienfaisance, prévoyant la misère
pour tous les petits employés, fit une souscription qui,
en deux jours, produisit 19,000 francs. Une faible partie en
fut employée, et le surplus resta à la Société de bienfaisance.
Le maréchal Forez fut si ravi de la réception que lui fit
la Société de bienfaisance française qu'il fit accorder l'amnistie
à tous les insoumis établis au Mexique, moyennant
le paiement de 500 francs pour chaque année restant à faire des sept ans de service, obligatoires à cette époque.
Ceux qui avaient dépassé l'âge du service militaire reçurent
leur quitus ; mais les chefs de maison furent invités à
donner gracieusement 500 francs chacun à la Société de
bienfaisance. Encouragée de toutes parts, elle ne put que
prospérer ; les cotisations ont produit, dans le dernier semestre
de 1889, 4,915 piastres et, dans le premier semestre
de 1890, 4,933 piastres. C'est donc une cinquantaine de mille
francs par an, auxquels viennent s'ajouter les retenues de
la caisse d'épargne, les bénéfices de la vente des terrains
du cimetière français, et qui servent à donner des secours
à nos compatriotes malheureux, des frais de route à ceux
qui sont de passage à Mexico, des frais de route pour rapatrier
des malades et des pensions à des veuves.
Les secours pécuniaires distribués dans les deux semestres
sus-énoncés se sont élevés à 5,191 piastres, plus de
25,000 francs.
La caisse d'épargne, où l'on ne peut déposer de fonds
sans faire partie de la section de bienfaisance, reçoit toute
somme à partir d'une piastre, donne actuellement le 6 %
d'intérêt, ne fait aucune retenue sur les dépôts inférieurs
à 3,000 piastres, pour encourager la petite épargne ; mais,
sur les versements supérieurs, elle retient un pour mille
par mois, au profit de la section de bienfaisance.
Son.capital, au 31 décembre 1889, était de 554,960piastres
et, au 30 juin 1890, de 498,510 piastres. Ce ne sont que les
petites économies accumulées des petits employés, car
patrons et commis intéressés laissent leur argent dans les
affaires. La maison de santé reçoit gratuitement les malades
civils, hommes, femmes et enfants, français, suisses ou
belges, à l'exception des aliénés.
Elle reçoit des malades payants, de toute nationalité,
moyennant 3 piastres par jour pour les sociétaires et
6 piastres pour les non-sociétaires. Les malades payants
ont une chambre particulière. Les visites extraordinaires
du médecin sont tarifées à 1 piastre et les consultations à
8 piastres.
Le directeur, outre son logement, touche 50 piastres
par mois; le médecin en exercice, 25 piastres, pour
sa visite journalière réglementaire.
La maison sert, en outre, de refuge à quelques vieillards
pauvres et incapables de gagner leur vie.
Les dépenses de la maison de santé se sont élevées, pendant
le dernier semestre de 1889, à 4,710 piastres et, pendant
le premier semestre de 1890, à 4,810 piastres.
Le cimetière délivre des terrains gratuits pour tous les
Français, Suisses ou Belges défunts, dont l'indigence est
prouvée, et délivre un terrain de 2m, 50de long sur 1m,25de
large, pour sept années, au prix de 35 piastres pour les sociétaires
et de 100 piastres pour les non-sociétaires, et à
perpétuité, au prix de 160 piastres pour les premiers et de
320 piastres pour les seconds. Le gardien gérant loge dans
le pavillon de garde du cimetière et touche un traitement
de 6,000 francs.
Un ossuaire ou columbarium est édifié dans le cimetière.
Il se compose d'un caveau et de cent vingt niches pour recevoir les cendres des décédès, au prix de 80 piastres
pour les sociétaires et de 100 piastres pour les autres.
On élève en ce moment (1890) une chapelle monumentale,
sur les dessins et sous la direction de l'architecte français
Desormes, dont on fait le plus grand éloge.
Le cimetière a rendu, dans le dernier semestre de 1889,
8,965 piastres et dépensé 7,097 piastres. Dans le premier
semestre de 1890, il a rendu 12,333 piastres et dépensé
7,015 piastres.
Les bénéfices alimentent le fonds de bienfaisance.
L'Association de bienfaisance et de prévoyance comptait
en 1888 1,036 membres, dans la liste desquels nous avons
eu le sincère plaisir de relever 232 noms de Barcelonnette,
près du quart. Nous sommes fiers de voir un de nos compatriotes,
M. Olivier Antoine, vice-président de cette Société
et deux autres, MM. Beraud Honoré et Caire Fortuné,
délégués du conseil d'administration.
Les efforts si remarquables faits par nos nationaux dans
cette grande et belle oeuvre humanitaire ont été royalement récompensés par un riche philanthrope mexicain,
dont le nom doit être connu dans nos montagnes, pour que
les mères de tous nos expatriés puissent le bénir. M. Francisco
Somcra, en 1889, a légué toute sa fortune, atteignant
2,000,000 piastres, treize millions de francs, à cinq sociétés
de bienfaisance :
1° La Société de bienfaisance et de prévoyance française,
suisse et belge;
2° La Société de bienfaisance espagnole ;
3° L'hôpital américain des Etats-Unis ;
4° L'hôpital de Jésus, fondé par Fernand Cortès et le
comte de Monte-Léon ;
5° L'institution de Vadivielso, clinique pour les maladies
des yeux.
D'après les voeux du testateur, sa fortune doit être
employée en achat de rentes 3 % françaises, dont les intérêts
seront employés à l'achat, fait à Paris, de tout ce qui peut être utile ou indispensable à un hôpital et distribué
aux cinq établissements légataires, en proportion du
nombre de lits occupés par chacun d'eux.
Grâce à ce généreux philanthrope, nos compatriotes,
riches et pauvres, sont assurés de trouver dans la maison
de santé française, à trois mille lieues du pays natal, les
soins les plus complets en cas de maladie.
Honneur à Francisco Somera !
L'INTERVENTION FRANÇAISE.
Nous avons laissé nos Barcelonnettes tenant une quarantaine
de magasins, au moment où va commencer l'intervention
française au Mexique.
Cet événement a eu sur l'avenir de la colonie française et
sur celui du Mexique lui-même une influence considérable
et des plus heureuses.
Certes, au moment où notre armée envahissait le pays,
assiégeait ses villes et sa capitale, la situation de nos
nationaux aurait pu devenir des plus critiques. Mais ils
jouissaient de l'estime générale, et l'opinion publique ne les
a jamais considérés comme des ennemis. D'autre part,
leurs sentiments libéraux naturels en faisaient depuis longtemps
les amis des libéraux, représentés au pouvoir par
Juarez. Bien avant l'intervention, tout le temps de l'empire,
seul, le ministre de France à Mexico était l'allié des réactionnaires,
et le marquis de Gabriac a eu longtemps dans
les oreilles le beau charivari que lui firent les Français de
Mexico, tous libéraux. Aussi, Benito Juarez se montra-t-il
toujours l'ami et le protecteur des Français. Leur accord,
leur union leur permirent même de rendre service au pays
qui les avait accueillis. Après la prise de Puebla, le gouvernement
quitta Mexico et la ville se trouva quelques
jours sans force armée. Le Président de la Société française,
M. Gauthier, avait organisé nos nationaux en garde
nationale, qui, pendant quelques jours, fit seule la police de la ville et assura sa tranquillité. Nous avons vu que le
traité d'expulsion contre les Français de Mexico n'a jamais
été exécuté. Marques, seul, étant assiégé à Mexico par
Porfirio-Diaz, tandis que Maximilien l'était à Queretaro,
mit un impôt forcé sur les négociants étrangers. Le premier
acte de Porfirio-Diaz, en rentrant à Mexico, en juin 1867,
fut une proclamation demandant le respect absolu des
étrangers. On peut dire, à l'honneur du peuple mexicain et
des nôtres, qu'aucun de nos nationaux n'a été inquiété un
seul instant pour sa qualité de Français. Aussi, purent-ils
se livrer sans crainte à leurs opérations commerciales et
profiter largement de tous les avantages que leur a procurés
l'intervention française.
Le premier, et non le moins important, a été la création
d'une ligne de paquebots française entre SaintNazaire et
Vera-Cruz, devenue indispensable pour les relations incessantes
de nos armées avec la patrie. Antérieurement, les
paquebots ne faisaient que le service des dépêches et des
voyageurs. Les progrès de la marine à vapeur leur permirent
de faire le service des marchandises en un temps
beaucoup plus court, exigeant dès lors moins de capitaux
et permettant aux négociants d'augmenter leurs commandes
à l'industrie française.
L'intervention, d'autre part, a dépensé au Mexique des
sommes considérables pour les fournitures de l'armée,
qu'elle demandait de préférence aux Français ; les hautes
paies de nos troupes, dépensées en entier dans le pays, ont
mis en circulation une grande quantité d'argent et enrichi
le commerce.
Ces éléments de progrès venaient s'ajouter aux sommes
relativement importantes que nos Barcelonnettes, bien
approvisionnés, avaient gagnées par la hausse considérable
des cotons, amenée par la guerre de sécession. C'est
surtout dans les affaires qu'on a raison de dire que l'argent
fait l'argent ; ayant plus de capitaux, nos Barcelonnettes
se lancèrent, vinrent acheter directement en France et se
livrèrent à bien des opérations fructueuses. Pendant l'année que l'armée française est restée à attendre
des renforts, elle percevait les droits de douane sur
toutes les marchandises qui traversaient ses lignes ; quelques
lieues plus loin, les Mexicains les percevaient à leur
tour, ce qui mettait les marchandises hors de prix. Les
négociants étrangers et français, qui croyaient toujours,
au début, que l'armée française serait à Mexico dans huit
ou quinze jours et qu'ils auraient alors les marchandises
à bon marché, se hâtaient de vendre aux plus avisés,
Ebrard, Gassier, etc., qui firent même acheter dans l'intérieur
les fonds de magasin disponibles et purent ensuite,
pendant un an, vendre au prix qu'ils voulaient et réaliser
d'énormes bénéfices. Ce fut le début des grosses fortunes.
Beaucoup de ceux qui leur avaient vendu leur fonds à bon
prix et qui avaient retiré leur argent vinrent s'approvisionner
directement en Europe, profitant du change très
avantageux de 5 fr. 30 c. la piastre, et, après l'arrivée des
Français à Mexico, réalisèrent à leur tour de gros
bénéfices.
Une des conséquences les plus heureuses de l'intervention
française pour le commerce fut le goût de la dépense
et du luxe du vêtement développé dans des proportions
énormes dans tout le Mexique. Le soldat mexicain, après
avoir vécu avec le soldat français, bien habillé, ne voulut
plus rester dépenaillé ; le ranchero (paysan) lui-même ne
put plus supporter sa demi-nudité: un gros quart de plus
des habitants du Mexique s'habilla ; le commerce de la
ropa grandit d'autant et, avec lui, la fortune de nos Barcelonnettes,
qui tendaient à le monopoliser dans leurs
mains. On le vit bien après la guerre de 1870, quand fut
ouverte au Mexique, parmi les Français, la souscription
pour la rançon de la France. Le président du comité central,
J.-B. Ebrard, le trésorier, Victor Gassier, et le secrétaire,
Auguste Clariond, sont tous trois de Barcelonnette.
La liste des souscriptions de Mexico porte sept cent douze
noms, dont cent quatre vingt de Barcelonnette, qui, sur 37,086 piastres, en ont souscrit 12.327, le tiers. Les Français
établis dans l'intérieur ont souscrit 23,090 piastres. Le
22 décembre 1872, 50,000 piastres ont été embarquées au
change de 5 fr. 411/2, et, comme la souscription pour la
rançon de la France n'a pas été acceptée par le gouvernement,
la somme de 275,000 francs envoyée par les Français
du Mexique a été versée au comité des Alsaciens-Lorrains.
Ceux-ci ne l'ont point oublié et, le village de Jausiers
ayant brûlé en juillet 1873, une souscription s'ouvrit en
Alsace-Lorraine et récolta pour les incendiés une douzaine
de mille francs. Touchant exemple de la solidarité nationale
!
Le Mexique, du reste, marchait à grands pas dans la
voie du progrès. Les capitaux anglais et américains
affluaient; le chemin de fer de Vera-Cruz à Paso del Macho
était fait en 1868; de Mexico à Puebla, il était inauguré le
5 mai 1809, et de Paso del Macho à Apisaco en novembre
1872. Les transports ruineux de Vera-Cruz à Mexico,
qui atteignaient 320 francs les 100 kilos, diminuaient rapidement
et marchaient vers le prix actuel de 20 francs les
100 kilogrammes.
D'autre part, une grande source de richesses fut mise en
circulation, les biens de main-morte. Dès 1868, Benito
Juarez lança de Vera-Cruz ses lois de réformes et, à mesure
que les troupes libérales avançaient dans l'intérieur du
pays, elles prenaient possession des immenses biens du
clergé, aussitôt mis en vente. Le gouvernement compléta
l'opération par la loi du 14 décembre 1873. C'était un quart
de la fortune territoriale qui rentrait dans le courant des
transactions. Plusieurs de nos compatriotes en profitèrent.
La sécurité publique assurée, les moyens de transports
multipliés et rendus dix fois plus rapides, la confiance
rendue au commerce et à l'industrie, la fortune publique
considérablement accrue, tel fut le résultat du triomphe
définitif des libéraux, après l'intervention française. Le
progrès ne s'est pas arrêté sous les gouvernements intelligents de Lerdo, de Gonzalès et de Porfirio. Mexico a vu
sa population s'augmenter de 100,000 âmes (1); le prix
des terrains et des immeubles y a décuplé; les constructions
nouvelles embellissent et agrandissent la capitale; les
villes de l'intérieur ont suivi le mouvement; les lignes de
chemin de fer sillonnent le Mexique et, à Paso del Norte,
viennent se souder aux lignes américaines et mettre
Mexico à sept jours de voiture de New-York; une nouvelle
ligne de Vera-Cruz à Mexico, par Jalapa, Perote et Puebla,
est devenue indispensable et se trouve presque achevée par
les capitaux anglais ; de grandes banques se sont créées,
et la banque nationale de Mexico, fondée au capital de
100 millions de francs par la fusion de la banque nationale
et de la banque mercantile, est considérée comme un établissement
de tout repos.
A TOUTES VOILES (1861-1891).
La prospérité des Barcelonnettes a suivi la même progression
et, avec elle, l'émigration de la vallée pour le
Mexique. Il suffit, pour s'en convaincre, de jeter un coup
d'oeil sur la liste de leurs maisons au Mexique, que je dois
à l'obligeance de M. Eyssautier Melchior. commissionnaire
à Mexico. La voici, en 1890 :
A Mexico (alt. 2,283 m.. 326,591 h.) (2) :
Treize magasins de nouveautés, gros et détail:
1. Joseph Ollivier et Cie. 
2. J.-B. Ebrard et Cie.
3. Jules Tron et Cie.
4. Richaud, Aubert et Cie.
(1) Les chiffres de population et d'altitude sont extraites de la Géographie universelle, d'Elisée Reclus, 1891.
(2) D'après le recensement officiel du 5 novembre 1889, elle est de 320,594 âmes.
5. Garcin, Faudon et Cie.
6. S. Robert et Cie.
7. F. Donnadieu et Cie.
8. Guérin et Auguste Gastinel.
9. Lambert, Reynaud et Cie.
10. N. Bellon et Payan.
11. A. Reynaud et Cie.
12. Signoret, Honnorat et Cie.
13. Meyran frères.
14. Théophile Pellotier et Cie, chapeliers.
15. H. et V. Lions, papetiers.
16. Barbeyer, menuisier.
17. Thomé, boulanger.
18. Barles. id.
19. L. Desdier, id.
20. Désiré Brun, fabrique d'huile.
21. F. Manuel, confections pour hommes.
22. Pons, Gas et Cie, fabrique de bouchons.
23. Martel et Sanche, soieries et confections pour dames.
Courtiers et commissionnaires :
24. V. Desdier et Cie.
25. Melchior Eyssautier.
26. C. Manuel.
27. J.-P. Jacques.
28. Jacques et Eyssautier.
Dans l'Etat de Vera-Cruz :
A Jalapa (11,220 h., ch. de f., ait. 1,450 m.) :
29. E. Manuel, fabrique de toiles écrues imprimées et
magasin de nouveautés.
30. Ferdinand Fortolis, brasserie.
A Perote :
31. Pascal frères, minoterie.
A Paso del Macho :
32. Durand frères, alcools et céréales.
A Vera-Cruz (18,200 h.) :
33. J. Ollivier et Cie, maison de gros de nouveautés. Dans l'Etat de Puebla :
A Puebla (68,635 h., alt. 2,170 m., ch. de f.) :
34. J.-B. Ebrard et Cie, magasin de nouveautés, gros et
détail.
35. Lions frères, magasin de nouveautés, gros et détail.
36. Garcin, Desdier et Sibillot, id
37. Esmenjaud et Couttolenc, chapeliers.
38. Auguste Faure et Couttolenc, restaurant.
39. Antoine Puget, id.
40. X. André, nouveautés et parapluies.
A Thehuacan (9,170 h.) :
41. Gaymard et Spitalier, mag. de nouveautés et céréales.
A San-Andrès Chalchicomula (11,000 h.) :
42. Couttolenc frères, haciendados et minotiers.
43. Pellat. magasin de nouveautés.
Dans l'Etat de Tlascala :
A Apizaco :
44. Frédéric Desdier, restaurant.
45. Victor Desdier, restaurant-buffet.
Dans l'Etat de Hidalgo :
A Tulancingo (9,710 h.) :
46. Louis Proal, magasin de nouveautés.
47. C. Manuel et Cie, magasin de nouveautés.
48. Conche, Pascal et Cie, id.
A Pachuca (11,265 h., ch. de f., ait. 2,246 m.) :
49. Imbert et Garnier, magasin de nouveautés.
50. Jullien frères, id.
51. Joseph Reynaud, cantine et billards.
52. A. Morin, professeur et journaliste.
Dans l'Etat de Oaxaca :
A Oaxaca (ait. 1,550 m., 27,000 h.) :
53. Lèbre et Laugier, magasin de nouveautés.
Dans l'Etat de Queretaro :
A Queretaro (31,380 h., ait. 1,850 m., ch. de f.) :
54. Arnaud, magasin de nouveautés.
55. Manuel Pons, id. Dans l'Etat de Guanajuato :
A Guanajuato (58,250 h., ait. 2,031 m., ch. de f., hôtel des
monnaies frappant 23,650,000 fr.) :
56. Caire et Audiffred, magasin de nouveautés.
57. Béraud frères, id.
58. Brun et James. id.
59. Estreyer et Cie, confiserie, cantine.
A Celaya (28,310 h., ch. de f.) :
60. Louis Blanc, magasin de nouveautés.
01. Jacques frères, id.
62. Gayinard Manuel, cantine et billards.
A Irapuato (27,700 h.) :
63. Nap. Arnaud, magasin de nouveautés.
A Léon de los Aldamas (80,075 h., ch. de f.) :
61. Brun et James, magasin de nouveautés.
65. Barbier, magasin de nouveautés.
06. Laurens Thomé, id.
07. Firmin Gastinel, haciendado, propriétaire.
A Valle de Santiago (21,900 lu) :
68. Joseph Borel. magasin de nouveautés et fabrique de
rebosos.
A San-Francisco del Rincon :
69. L. Béraud, magasin de nouveautés et grains.
Dans l'Etat de Jalisco:
A Guadalajara (105,000 h., alt. 1,552 m., hôtel des monnaies frappant 7 millions de francs, ch. de f.) :
70. E. Lèbre, Barrière et Cie, magasin de nouveautés.
71. Fortoul et Ghapuy, id.
72. Gas et Cogordan, id.
73. Caire et Tiran, id.
74. Garcin et Cie, id.
75. Remy Lions, cantine, restaurant, billards.
76. Aug. Faure, id. id. id.
77. Th. Fortoul, vice-consul.
78. L. Honnorat, chapelier.
A Zapatlan (15,120 h., alt. 1.310 m.) :
79. Pons et Brun, magasin de nouveautés. A Tepic (21,790 h., alt. 900 m.) :
80. Pierre Jacques, magasin de nouveautés.
A Lagos (12,320 h.):
81. Leautaud et Cie, magasin de nouveautés.
Dans l'Etat de Morelos :
A Morelia (38,550 h., ait. 1,910 m., ch. de f.) :
82. Audiffred frères, magasin de nouveautés.
83. Th. Pellotier et Cie, chapellerie, fabrique.
A Patzcuaro (11,130 h., ait. 2,300 m.) :
81. Louis Giraud, magasin de nouveautés.
A Uruapam (11,610 h.) :
85. Joseph .Jaubert, nouveautés.
A Saltillo :
86. Grouès et Signoret, magasin de nouveautés et fabrique
de chapeaux.
Dans l'Etat d'Aguascalientes :
A Aguascalientes (65,860 h., ch. de f.) :
87. Leautaud frères, magasin de nouveautés.
88. Gazon et Cie. id.
89. Jean Gilly. id.
Dans l'Etat de Zacatecas :
A Zacatecas (30,120 h., ait. 2,100, hôtel des monnaies
frappant 28,750,000 fr., ch. de f.) :
90. Pellat et Jean, magasin de nouveautés.
91. Rougon frères, id.
92. Gazon frères, id.
93. Caire et Garnier, id.
91. Garnier frères, cantine et billards.
Dans l'Etat de Durango :
A Durango (28,150 h., ait. 1,926 m., hôtel des monnaies
frappant 5 millions de francs) :
93. Borelly et Cie, magasin de nouveautés.
96. Teissier et Bourillon. id.
Dans l'Etat de Chihuahua :
A Chihuahua (12,120 h., ait. 1.400 m., hôtel des monnaies
frappant 25 millions de fr., ch. de f.) : 97. Gras et Signoret, magasin de nouveautés.
98. Chaix frères, id.
99. Pinoncely et Margaillan. id.
A Las Palomas :
100. Nicolas Charpenel, magas. de nouveautés et planteur.
Dans l'Etat de San Luis de Potosi :
A San Luis de Potosi (69,900 h., ait. 1.890 m., hôtel des
monnaies frappant 3 millions de fr., ch. de f.) :
101. J. Signoret et Cie, magasin de nouveautés.
102. Caire et Michel, id.
103. Joseph Caire, id.
101. Clare, cantine et pâtisserie.
105. Clotilde Leautaud, billards et cantine.
Dans l'Etat de Nouveau-Léon :
A Monterey (35,400 h., ait. 480 m., ch. de f.) :
106. Maurel et Cie, magasin de nouveautés.
107. J. Ollivier, haciendado, propriétaire.
108. Gotier et Cie, magasin de nouveautés.
A Tampico (11,680 h., port, ch. de f.) :
109. Reynaud frères, magasin de nouveautés.
Dans la colonie de San Rafaël :
110. Proal Joachim.
Au total, cent dix maisons de commerce, dont soixante dix
magasins de nouveautés, sur lesquels une trentaine
sont des maisons de gros. Plusieurs d'entre elles font des
millions d'affaires par an, avec un capital énorme, car
aujourd'hui les crédits à ouvrir sont nombreux et, comme
me disait un chef de maison, il faut avoir trois capitaux :
un en route, un autre en existence en magasin et un troisième en crédits de vente en gros (1). Mais les capitaux ne
manquent pas car la plupart de ceux qui se retirent des
affaires laissent les trois quarts de leurs capitaux au Mexique, dans les maisons des Barcelonnettes.
(1) Toute vente en gros se fait à six ou huit mois de terme, escomptable à 1 % par mois.
Depuis 1870, les maisons de gros des Barcelonnettes se sont acharnées après les maisons de gros allemandes et sont arrivées à les chasser complètement du Mexique. Bravo, amis! M. Bianconi, ingénieur, a rendu justice à notre colonie, dans son intéressant ouvrage sur le Mexique : « L'émigration française au Mexique, dit-il, provient de tous les points de la France ; nous devons cependant faire une mention spéciale de celle qui est fournie par l'arrondissement de Barcelonnette. « Les Barcelonnettes », comme on les appelle, ont presque monopolisé le commerce de la ropa (lingerie, draperie, nouveautés, etc.) ; ils forment, au sein de la colonie française, un groupe d'hommes honorables, de travailleurs infatigables et de commerçants habiles, qui fait honneur à son pays d'origine. Un grand nombre de Barcelonnettes ont fait des fortunes considérables. »
LE CERCLE FRANÇAIS.
Avec la fortune est venu le désir bien naturel d'agrémenter
un peu sa vie, de donner aliment à l'esprit de
sociabilité qui distingue notre nation, De là, en 1870, la
création d'un Cercle français, où les Français seuls peuvent
être membres propriétaires, versent un droit d'entrée de
25 piastres et composent seuls l'assemblée générale, mais
où l'on admet des membres souscripteurs français, versant
5 piastres, et des membres souscripteurs étrangers, versant
10 piastres d'entrée. Tous les membres du Cercle payent
indistinctement une cotisation de 3 piastres par mois. Il est
administré par sept membres, et nous y trouvons trois
Barcelonnettes : le président, Fortuné Caire, et deux commissaires,
Antoine Proal et Melchior Eyssautier. Tous
Français de passage à Mexico, présenté par un membre
propriétaire, peut fréquenter le Cercle gratuitement pendant
un mois. C'est le Cercle qui a contribué puissamment à la célébration
à Mexico de notre Fête nationale du 11 juillet. Nos
nationaux ont été si aimables, si vifs, si entraînants que,
peu à peu, Mexico en a fait une fête à elle, fermant ce
jour-là ses magasins, s'enflammant au souvenir de la prise
de la Bastille, dont elle a appris à connaître toute la portée,
et fraternisant de tout coeur avec la colonie française. Une
coïncidence a aidé à ce résultat : le 11 juillet 1807, le grand
patriote Juarez, à la foi indomptable, enveloppé du drapeau
national, recevait les clefs de Mexico et célébrait, après
cinq années de luttes sanglantes, le triompbe de l'indépendance
nationale et de la liberté.
Puis vient la création, en 1878, de la Société philharmonique
et dramatique française, qui, outre les répétitions
hebdomadaires, organise, tous les deux mois, de fort
agréables soirées.
Parmi les neuf membres du comité, je ne trouve qu'un
Barcelonnette. Dame ! L'air vif de nos âpres montagnes
n'assouplit pas nos gosiers !
Enfin, en 1883, naquit la Société hippique française, ayant
pour but de développer à Mexico le goût de l'équitation à
l'européenne, d'installer pour ses membres un manège, avec
cours réguliers, un champ de manoeuvres, d'organiser
courses plates, courses d'obstacles, rally-papers, carrousels,
etc. Droits d'entrée : 25 piastres; cotisation mensuelle :
2 piastres. Président: Elisée Martel; trésorier: D. Ollivier:
encore deux Barcelonnettes. Il ne s'agit pas ici d'améliorer
la race chevaline, mais de procurer aux commis de
magasin et aux ouvriers français, par un exercice hygiénique,
force et santé. Les courses organisées par la Société
font courir tout Mexico. Des prix sont offerts aux officiers
de la cavalerie mexicaine et de la gendarmerie rurale, si
pittoresque et si populaire. Le Président de la République
française a offert, l'an dernier, une coupe de Sèvres, et, le
14 juillet 1890, a eu lieu un concours d'attelages.
Partout et toujours, l'union fait la force, et ces deux Sociétés, le comprenant, ont fusionné avec le Cercle français.
C'est aujourd'hui un des plus beaux établissements de
Mexico. Installé dans le splendide hôtel de Lerdo de
Tejada, rue de la Palma, n° 11, moyennant un loyer de
6,000 piastres, il a deux entrées ; au rez-de-chaussée, grand
salon de soirées, boliche, salle de gymnase, salle d'armes,
services ; au premier étage, grand salon de lecture, riche
en journaux et revues de toutes sortes, bibliothèque, salle
des réunions générales, deux grandes salles de billards,
salon des jeux de cartes, où le baccara et la roulette sont
formellement interdits, salle à manger, buvette, salon pour
dames et même cabinets particuliers ; au deuxième étage,
grande salle de musique et de représentation.
Grandeur oblige, et le Cercle français l'a compris en
créant la section des expositions, pour organiser un salon
annuel pour les arts et une section philotechnique, qui a
créé des cours gratuits d'adultes pour le soir, où nos
ouvriers et nos jeunes commis, partis généralement avec
un assez mince bagage d'instruction, peuvent venir compléter
leur éducation et apprendre la grammaire, le calcul
commercial et la tenue des livres, l'histoire de France, la
géographie du monde et un peu d'économie politique et
sociale.
C'est de tout coeur que nous applaudissons à ces nobles
efforts, pour agrandir le rôle de notre patrie à l'étranger, et
que nous rendons hommage au dévouement des organisateurs
de toutes ces créations philanthropiques.
CONCLUSION.
Nous pouvons maintenant embrasser d'un coup d'oeil le
chemin parcouru par nos Barcelonnettes au Mexique,
depuis le départ des trois frères Arnaud : honnêtes et laborieux
entre tous, mais absolument dépourvus, au départ
d'éducation commerciale, ils sont parvenus, après des
débuts longs et pénibles, à des situations modestes, où ils ont trouvé l'aisance, et quelques-uns, la fortune. Comme
l'Auvergnat à Paris, qui débute par un recoin où tiennent
à peine quelques bûches et quelques bennes de charbon,
puis loue un petit magasin, l'agrandit peu à peu et finit
par avoir de grands entrepôts, ils ont peu à peu étendu
leur commerce de la nouveauté et des étoffes, passé progressivement
à la vente en gros des mêmes articles ; mais
néanmoins leur destinée jusqu'ici semble être pour la
plupart d'appartenir à la classe estimable, mais modeste, des
détaillants. Leurs aspirations, du reste, se bornent à « se
faire un magot » pour rentrer en France, et rarement on
les voit se livrer à des entreprises considérables et de
longue haleine. Dans leur pensée, leur absence du toit
paternel n'est que provisoire ; ils vivent comme sous la
tente, prêts à lever le camp lorsque l'heure aura sonné.
Nous avons vu des maisons, puissantes par leurs capitaux
et l'étendue de leurs relations, qui auraient pu devenir
colossales en quelques lustres et dont les chefs se sont
brusquement retirés en quelques mois, laissant à leurs
successeurs, avec quelques capitaux, le soin de recommencer
l'édifice par la base. C'est le défaut général de
toutes les expatriations françaises. On campe à l'étranger :
on ne s'implante pas. Verrons-nous jamais au Mexique des
maisons centenaires, comme les Anglais en ont à Calcutta
et dans le monde entier ? Notre pays d'origine est trop beau,
et l'on veut y revenir. Le Mexique, du reste, jusqu'à ces
derniers temps, n'offrait pas assez de sécurité pour tenter
ceux qui ne demandaient qu'à jouir en paix de la fortune
acquise. Depuis quelques années cependant il a fait tant de
progrès sous ce rapport que nos compatriotes paraissent
moins éloignés de l'idée d'y foncier des établissements
durables et de s'y fixer. Plusieurs d'entre eux se risquent
à immobiliser des capitaux importants dans l'installation
de magasins luxueux, et l'un d'eux, M. Joseph Tron, est en
train d'édifier, dans des immeubles acquis par lui. d'immenses
magasins dans le genre des grandes maisons de Paris et de fonder, avec quelques autres, une fabrique à
Orizaba, au capital de 10 millions.
Peu à peu, ils s'élèvent jusqu'aux régions supérieures du
haut négoce, soit séparément, soit en se syndiquant. Ainsi,
depuis quelques années, plusieurs maisons de Barcelonnettes
syndiquées ont acheté le produit de toutes les fabriques
de « mantas et d'estampados » ou indiennes imprimées
du Mexique, suivant un tant pour cent, qui n'exprime pas
toujours l'importance relative des maisons, mais leur cote
pour la vente de cet article. Pour cette année, le syndicat
se compose de :
J. Ollivier 14,10 %
J. Tron 14,40
J.-B. Ebrard 12,80
Richaud 12,80
Signoret 10,40
A. Reynaud 8,60
S. Robert 7,80
Lambert 7,20
Bellon-Payan 5,80
Garcin-Faudon 5,80
100
Il s'agit pour cette seule affaire de quarante à quarante trois
mille pièces par semaine, d'une valeur approximative
de 2 dollars 1/2 ou de 12 francs, soit environ 500,000 francs
par semaine, ce qui est déjà joli pour un seul article et
promet pour l'avenir.
Mais combien leur marche ascensionnelle serait plus
rapide, maintenant qu'ils disposent de grands capitaux, si
la plupart d'entre eux avaient reçu, avant leur départ, une
instruction plus solide, un enseignemeni commercial supérieur
! Ils auraient pu trouver cela, en partie au collège de
Barcelonnette, où l'on enseigne l'anglais, aujourd'hui
indispensable à un commerçant d'un rang élevé, et en partie
dans les écoles de commerce supérieures; mais ils partent trop jeunes, et leurs parents n'ont pas encore assez compris
l'importance de l'éducation et de l'instruction. Ce qu'il
faudrait, ce seraient des jeunes gens instruits, parlant l'anglais,
outre l'espagnol, et en état de frayer avec les couches
supérieures des populations ; en d'autres termes, des
négociants doublés d'hommes du monde, afin que l'agent
qui développe le commerce de la France pût en même temps
propager son influence sociale. Avec leur ardeur au travail
et leur ténacité, nous les verrions bientôt prendre pied
dans les plus hautes sphères du négoce du Mexique, dans
les grandes banques, dans les grandes entreprises de l'outillage
national, où jusqu'ici ils sont restés étrangers.
Cela viendra avec le temps ; des indices précieux nous en
donnent l'assurance. Déjà, quelques uns des plus riches font
faire à leurs enfants des études spéciales en France et un
stage en Angleterre, avant de les rappeler auprès d'eux au
Mexique, et ces jeunes gens, mieux armés, pourront franchir
les derniers échelons.
Dans les maisons de commerce françaises actuelles, la
rudesse ancienne des patrons et des commis intéressés, visa-vis des commis inférieurs, va en disparaissant; la politesse
et le savoir-vivre font des progrès ; les commis sont
plus libres, montent à cheval, fréquentent un peu plus le
monde ; un plus grand nombre de patrons et d'employés
supérieurs sont mariés, et la présence de dames françaises
dans la colonie oblige à plus de retenue et à plus d'égards
dans les rapports quotidiens. Nos compatriotes ne vivent
plus, comme dans le temps, exclusivement entre eux et
entre hommes; leur éducation s'affine et leur permet de plus
hautes visées.
Ce qui manque encore au développement complet de l'influence
commerciale et industrielle française au Mexique,
c'est une représentation nationale plus sérieuse. Là, comme
ailleurs, la France a toujours été représentée par une
brillante aristocratie, dont les capacités diplomatiques
peuvent ne pas être contestées, mais peu accessible au populaire et traitant de haut la question commerciale;
tandis que les autres nations le sont par des négociants
hors pair, des représentants de grandes sociétés commerciales,
industrielles ou financières, très versés dans tous
les détails des besoins du pays qu'ils habitent, qu'ils savent
faire connaître à la métropole, à qui ils préparent et assurent
les débouchés pour leurs produits. Ils connaissent le
prix du temps en affaires et les expédient rondement, en
parlant haut et ferme, à la moindre injustice faite à leurs
nationaux. Il est triste d'avouer que souvent les Français,
rebutés ou ajournés toujours à plus tard par nos représentants,
regrettent le temps où la France était représentée à
Mexico par le ministre des Etats-Unis. La Chambre de
commerce française, organisée par l'initiative de M. de G.,
se divise en sections, nomme ses rapporteurs, qui remettent
le résumé de leurs travaux à notre consul, pour en faire
un travail d'ensemble. Ce dernier, félicité par tous les
journaux, est nommé à Buda-Pesth, emporte le tout avec
lui, et l'on n'a plus entendu parler de rien à Mexico. Il
serait grand temps que la France encourageât de tout son
pouvoir les efforts de ses enfants au Mexique, où se trouve
le noyau le plus important de toute l'expatriation française,
en nommant vice-consul, dans tous les centres un peu
importants, le négociant français le plus digne et en
doublant au besoin notre consul général d'un agent commercial
spécial (1).
Quel a été pour la France d'abord et pour notre vallée
ensuite le résultat de l'expatriation des Barcelonnettes au
Mexique ?
(1) Nous n'avons qu'un consul à Vera-Cruz, un vice-consul à Tampico et des
agents consulaires à Acapulco, Carmen, Guanajuato, San-Rafael, Mzatlan
San-Luis de Potosi, Tehuantepec, Tonala et Tuxpam. Nous n'avons aucun
consul dans les Etats du Nord de la République, qui font de si rapides progrès
dans l'industrie et dans l'agriculture et où les Anglais et les Américains ont
engagé d'énormes capitaux.
Pour la France, il n'y a pas de doute, elle a contribué à l'enrichir un petit peu, d'abord par les fortunes faites, qui rentrent en France et que, depuis dix ans, on peut évaluer à près d'un million par an; ensuite, en augmentant le chiffre de ses exportations au Mexique. Le Mexique a exporté, en 1887, dans le monde entier : pour 35,560,503 piastres de métaux précieux; pour 15,631,427 piastres de marchandises (hennequem, peaux, bois, tabac, vanille, etc.), au total, pour 49,191,930 piastres. Sur ce chiffre, les exportations en France ne sont que de 5,112,521 piastres, un cinquième environ. Sur ces 25 millions de francs, exportés en France, il y a environ 83 % de métaux précieux et 17 % seulement de marchandises, soit 4,315,000 francs. Les exportations de la France au Mexique consistent en tissus, confections, articles de mode, articles de Paris, vins et liqueurs ; mais les tissus en font les cinq sixièmes. Voici les moyennes annuelles, en francs, de trois périodes décennales que j'ai établies sur les chiffres officiels français :
Périodes. Soie. Coton. Laine. Lin Chanvre Total des
tissus.
1854 à 1863 3536810 1748081 2519251 193100 8027417
1804 à 1873 2895754 2557089 5626293 376220 11455356
1871 à 1883 1384762 4917725 3502484 413375 10218820
On remarquera d'abord la diminution constante et rapide
de nos exportations en soieries, qui ne se sont pas relevées
dans les années suivantes; ensuite l'augmentation de nos
exportations dans la période 1864 à 1873, due à l'intervention
française au Mexique. Dans le détail des années, elle
saute aux yeux: de 1803 à 1864, nos soies passent brusquement
de 2,959,329 à 9,653,999 ; nos cotonnades, de 1,823,047 à 4,782,177; nos lainages, de 2,855,318 à 15,309,351,et les lins,
de 155,083 à 310,916. C'est aussi le moment des progrès
rapides de nos Barcelonnettes au Mexique ; mais, à partir
de 1886, les chiffres s'abaissent rapidement et, quoique le
commerce des tissus ait triplé au Mexique, la France n'a
pas vu, loin de là, ses exportations grandir en proportion.
Nos Barcelonnettes, qui vendent certainement pour
150 millions de marchandises annuellement, en tirent à
peine le vingtième de France.
En 1886,comme l'a annoncé dernièrement M. Ribot, notre
ministre des affaires étrangères, à la tribune, le Mexique
nous a accordé le traitement complet et général de
la nation la plus favorisée, qu'il avait toujours refusé aux
nations européennes. Certainement, nous devons en grande
partie cette faveur à l'importance exceptionnelle de la
colonie française au Mexique. Dès lors, nos exportations
vont grandir de deux millions par an en moyenne, comme
le montrent les chiffres suivants :
Période. Soie. Coton. Laine. Totaux.
1886 696025 5696118 5160151 11862294
1887 709440 4464146 5762788 10936424
1888 993076 8264910 7641601 16899587
1889 1993931 15253934 7906239 25154104
Moyenne de ces 4 années : 1098130 8419774 6692691 16210602
Mais il ne faut pas oublier que l'administration des douanes
mexicaines fixe la provenance des marchandises
importées d'après le pavillon du navire qui les a apportées,
de même que l'administration française les fixe à la sortie
de nos ports. Or, nos lignes de vapeurs emportent, chaque mois, au Mexique, une grande quantité de marchandises
d'origine belge, suisse, italienne cl même allemande, et
notre industrie nationale est loin de fournir toute cette
augmentation de notre exportation au Mexique. Elle y a
sa part, outre ses bénéfices de commission ou de transit, et
tout progrès de nos Barcelonnettes au Mexique assure à
l'industrie française un bénéfice appréciable, jusqu'ici peu
important, mais qui décuplerait bien vite, si l'industrie
française, mieux éclairée sur les besoins et sur les goûts
particuliers des populations du Mexique, s'étudiait à les
mieux satisfaire, surtout dans les articles à bon marché.
Quelle a été l'influence de l'expatriation au Mexique sur
la vallée de Barcelonnette ?
Il faut d'abord se rendre un compte exact de l'importance
relative du nombre des expatriés. Ils sont fournis par deux
cantons seulement et par les deux moins pauvres : Barcelonnette
et Saint-Paul. J'ai relevé depuis dix ans sur les
listes des conseils de revision, le nombre de conscrits de
ces deux cantons et celui des conscrits résidant déjà au
Mexique. En voici le tableau :
1881 70 18 20 5 90 23
1882 72 28 34 8 106 36
1883 75 24 21 7 96 31
1881 52 13 21 7 73 20
1885 62 15 20 5 82 20
1886 65 18 22 5 87 23
1887 55 22 25 14 80 30
1888 53 15 22 8 75 23
1889 61 15 20 7 81 22
1890 61 17 24 11 85 28
Totaux.... 626 185 229 77 855 262
Ainsi, pendant ces dix dernières années, plus des trois dixièmes des hommes de 21 ans étaient déjà partis pour le Mexique. En y ajoutant ceux qui partent après cet âge, il faudrait doubler ce chiffre et arriver à cinquante-deux par an ; mettons quarante trois seulement, et tout le monde sait ici que ce chiffre n'a rien d'exagéré . Puisqu'il n' y a que quatre-vingt-six conscrits en moyenne par an, c'est donc la moitié des hommes que le Minotaure du Mexique nous enlève chaque année, et certainement la moitié la plus saine et la plus valide, car on n'envoie là-bas ni les maladifs, ni les infirmes. Que vouliez-vous que devinssent les jeunes filles du canton de Saint-Paul en 1887, quand, sur vingt-cinq jeunes gens à marier, le Mexique leur en avait déjà pris quatorze? Elles n'avaient fait que suivre, et c'est ce qu'elles ont commencé à faire. Du reste, elles ont raison, car il est rare qu'après six mois ou un an de bonne conduite elles ne soient pas demandées en mariage par quelque compatriote ayant fait sa fortune. La plupart cependant rentrent garçons vers quarante ans, et les trois quarts se marient au pays, dans l'année de leur retour, trop souvent avec une nièce, ce qui leur évite bien des démarches et l'ennui de faire leur cour, mais présente bien quelque inconvénients aussi : non pas au point de vue de la fidélité, car elles sont exemplaires pour cela, mais au point de vue de la descendance. Est-ce l'effet du climat du Mexique ? On l'ignore; mais un bon nombre des unions retour du Mexique sont stériles (1). Toutes ces causes s'ajoutent entre elles pour diminuer rapidement la population. Par cette sélection continue à rebours, par cette émasculation annuelle, qui enlève au pays ses enfants les plus forts et les plus intelligents, le niveau physique et intellectuel de la population restante s'abaisse rapidement et tout le monde reconnaît qu'on manque d'hommes. On le voit bien quand il faut trouver un maire et dix conseillers par commune. Presque partout, en France, l'agriculture souffre de la cherté de la main-d'oeuvre. Dans les régions en plaine, dans les vastes exploitations rurales, l'emploi des machines agricoles a pu permettre à notre agriculture de rester rémunératrice ; mais dans les pays de montagnes, où la propriété est forcément divisée, où les terrains cultivés atteignent des pentes de 15 %, où les chemins carrossables sont très rares, l'emploi des machines agricoles est impossible.
(1) Sur vingt-deux ménages de Mexicains établis à Barcelonnette, huit n'ont pas eu d'enfants. Plus du tiers : 30 %, tandis que la moyenne, en France, n'atteint pas le 10 %
Seuls, les câbles porteurs métalliques, sous l'impulsion intelligente et désintéressée de M. l'ingénieur Delpit, ont permis le transport rapide et à bon marché des fourrages des hauts plateaux jusqu'aux fermes, où ils doivent être consommés. Eu quelques minutes, arrive la trousse de foin qu'un mulet et un homme mettaient généralement six heures à apporter, dépensant en transport la moitié de la valeur du fourrage. Malgré ce remarquable progrès, toutes les autres parties de l'exploitation rurale souffrent de la cherté de la main-d'oeuvre, du manque de bras ; notre vallée succombe sous cette cause, et le prix de la propriété rurale s'y est avili des trois quarts en quarante ans. Dans l'Amérique du Nord, on estime à 4,500 francs tout émigrant adulte qui arrive. Si l'Amérique gagne cette somme en le recevant, le pays qui le lui envoie perd bien la même somme, à laquelle il faut ajouter un millier de francs pour le voyage. Pour une cinquantaine d'émigrants annuels, nos deux petits cantons (1) perdent donc un quart de million par an. Cette somme rentre-t-elle ? En France, largement; dans notre vallée, j'en doute. Tous ceux qui rentrent, fortune faite, ne s'établissent pas à Barcelonnette ou n'y vivent qu'une partie de l'année ; en tous cas, ils achèteront un verger aux abords de la ville, y construiront une maison d'habitation,

mais ne voudront jamais se donner le souci d'une exploitation agricole. Le résultat serait donc quelques riches maisons, au milieu de campagnes agonisantes. Tout autre était le résultat des expatriations hivernales de la première moitié de ce siècle, que celle du Mexique a remplacées : celle des Fourniers en Hollande et en Bourgogne, celle des Hauts-Chàteaux à Lyon.
(1) Canton de Barcelonnette: 7,500 habitants; canton de Saint-Paul :2,627,
Nos
cultivateurs occupaient les loisirs de l'hiver à gagner quelque argent comme colporteurs et revenaient au printemps,
l'escarcelle pleine, cultiver leurs terres, élever leur
nombreuse famille et arrondir le domaine paternel. Tout
était profit et le pays prospérait ; aujourd'hui, malgré la
perte de son agriculture, il se soutient d'une façon anormale,
grâce aux petites sommes envoyées chaque année à
la maison paternelle par le fils émigré, qui, dans les premières
années, n'a qu'un souci, de rembourser au père les
lourds sacrifices qu'il s'est imposés pour son éducation et
pour son voyage, et ensuite n'a qu'une satisfaction, de
l'aider de son argent à supporter les misères de la vie. Puis
de temps en temps un décès survient, et le capital amassé
s'éparpille chez les parents du pays natal ; mais tout cet
argent, qui n'est plus péniblement acquis par le travail de
celui qui le reçoit, n'est plus ménagé ; on le dépense plus
facilement ; le luxe et les besoins augmentent ; l'amour du
travail diminue et l'agriculture ne se relève pas, et l'on
n'est pas plus riche. Aussi que de terres incultes ! Que de
maisons fermées ! Sans les Piémontais, qui viennent remplacer
nos émigrants, le pays, au train dont cela va, serait
inculte avant un siècle. Les exemples abondent : au petit
hameau de Saint-Ours, il y avait, il y a trente ans, deux
maisons importantes: Ollivier Joseph, dit Comte, et Ollivier
Marcelin. Marcelin avait dix garçons et une fille;
ils sont tous au Mexique et la maison est fermée. Joseph
avait eu douze enfants, il reste cinq garçons et trois filles ;
les cinq garçons sont au Mexique et le domaine est loué à
un Piémontais, pour les impositions. Henriette, la soeur de
Joseph, épouse Manuel, a eu treize enfants; six sont en
Amérique et les autres grandissent pour les rejoindre. Quel
pays, exclusivement agricole et pastoral comme le nôtre,
peut tenir à un pareil régime ? Certes, nous sommes loin de
blâmer nos jeunes gens d'aller chercher au loin une condition
meilleure ; c'est la lutte pour la vie, vaillamment soutenue;
c'est le progrès individuel obtenu par le travail
honnête et persévérant, et on ne peut que les approuver, tout en constatant avec tristesse ce résultat fatal pour le pays
natal de la désertion de ses enfants, la perte de son
agriculture, seule base solide de son existence. Cette désertion
ne fera que s'accélérer, à mesure que nos Barcelonnettes
étendront leurs affaires dans tout le Mexique, et
surtout depuis que la loi du 15 juillet 1889 a régularisé la
position des expatriés au point de vue du service militaire
en temps de paix, et fait disparaître la dernière barrière
qui pouvait les retenir jusqu'à vingt cinq ans en France,
la crainte de la flétrissure des insoumis. L'expatriation
avant l'âge de dix-neuf ans va augmenter rapidement :
l'article 50 dispense, en effet, du service militaire les jeunes
gens qui, avant dix-neuf ans révolus, ont établi leur
résidence hors d'Europe, y occupent une situation régulière
et en justifient chaque année. S'ils rentrent en France
avant trente ans, ils devront accomplir le service actif
jusqu'à cet âge et seront ensuite soumis à toutes les obligations
de leur classe, et, s'ils rentrent après trente ans, ils
ne seront soumis qu'aux obligations de leur classe.
Pendant la durée de leur établissement à l'étranger, ils
peuvent même séjourner accidentellement trois mois en
France, en avisant le consul de leur absence.
Le législateur a voulu favoriser l'expatriation sérieuse,
qui enrichit la mère patrie. Il a eu raison, car, comme
l'écrivait une plume autorisée, dans la République française
:
« Aider au développement de la richesse nationale, c'est
faire oeuvre de patriotisme; la France industrielle, pas plus
que la France des beaux-arts, ne doit finir aux limites de
ses frontières ; de son rayonnement au dehors, dépend sa
future grandeur; propager au loin ses intérêts, son
influence, sa civilisation, c'est remplir, dans un autre ordre
d'idées, une mission aussi nécessaire que celle du soldat
sur les champs de bataille ! »
Mais, après avoir applaudi, comme Français, aux succès
de nos compariotes au Mexique, après avoir rendu hommage à cet individualisme à outrance qui est la caractéristique
de notre siècle et qui veut justifier tout ce que peut
inspirer aux hommes le soin exclusif et personnel de leurs
intérêts, qu'il soit permis à un enfant de Barcelonnette de
regretter que ces brillants résultats ne soient obtenus qu'au
prix de la décadence du pays natal, de la perte d'un arrondissement
frontière, dont le maintien et la prospérité sont
indispensables à la patrie.
La plupart des domaines éloignés des agglomérations
sont aux mains des Piémontais ; dans les villages, à
Barcelonnette même, ils exploitent une grande partie des
petites industries locales ; ils s'implantent partout et
quoique fixés depuis plusieurs générations, ne se font pas
naturaliser Français. Il en est de même dans le Queyras,
où l'émigration exagérée pour la Californie et pour la
République Argentine leur cède la place. Bientôt une zone
de soixante kilomètres de notre frontière sera occupée par
une population fixe où l'élément italien sera prépondérant
et habitée, en outre, pendant la belle saison, par la multitude
de domestiques et d'ouvriers piémontais qui viennent
faire les travaux publics et les travaux agricoles que nos
compatriotes ont désertés. Il y a là, en cas de guerre, un
danger sérieux et certain, qu'un Français ne peut voir
grandir avec indifférence.
Mais ceux qui s'expatrient ne font pas toutes ces
réflexions ; trop jeunes, comme hypnotisés par les quelques
fortunes qui rentrent, entraînés dans le courant, ils
partent en hàte, certains de réussir.
Jeunes gens, vous ne voyez que le succès, et il vous
éblouit! Mais, sur cent jeunes hommes partis à vingt ans,
d'après les tables de la mortalité en France de Deparcieux,
soixante-dix-sept vivent encore à quarante-cinq ans. D'où
vient qu'il n'en rentre que dix ? Que sont devenus les
soixante-sept autres ? Les uns sont morts prématurément ;
les autres, vaincus de la lutte, traînent misérablement leur
existence, à trois mille lieues de leur pays natal, et n'osent y revenir. Ah ! ceux-là, si vous pouviez les interroger, ils
vous diraient: " Enfants, la vie est dure partout, mais surtout à l'étranger,
loin du foyer paternel, loin des parents, loin des amis
du premier âge ! Avec le travail acharné qu'il faut pour réussir au
Mexique, cultivez le sol natal ; il a nourri vos pères et, au
prix où on vous le laisse actuellement, non seulement il
saura vous nourrir, mais il vous donnera l'aisance, si vous
voulez secouer la routine séculaire, suivre les progrès de
la science agricole, améliorer vos terres, vos cultures, vos
semences, vos troupeaux surtout, et devenir des agriculteurs
et des éleveurs éclairés et persévérants. La vie
au grand air, au grand soleil, est plus saine et plus gaie
qu'au fond d'un magasin humide.
Mariez-vous jeunes, à l'âge où la nature le demande ;
vous aurez des enfants robustes et vous les verrez grandir.
Si l'un d'eux veut aller chercher fortune, ne le retenez pas,
mais n'y poussez pas les autres ; gardez-les auprès de vous.
Faites-en de bons citoyens, de bons républicains, de bons
soldats. Vous aurez eu les joies saines de la famille et ses
fortifiantes douleurs aussi. La fièvre de l'or n'aura pas
brûlé votre vie ; votre vieillesse sera plus heureuse au
milieu de vos petits-enfants, et croyez bien qu'il ne faut pas
tant d'argent pour vivre heureux et que, pour mourir, les
deux bras d'une fille adorée et aimante sont un plus doux
oreiller qu'un sac de piastres. "
F. ARNAUD
Texte numérisé par Jean-Paul Audibert
![]()