
Tiré de LA FRANCE PONTIFICALE (GALLIA CHRISTIANA).
DIOSESE DE SISTERON

On n'a qu'à regarder avec quelque attention un plan de la ville de Sisteron, pour se dire aussitôt , qu'une telle situation a dû lui donner, dès les temps les plus anciens, une impor tance militaire et politique considérable. C'est , en effet , de par la topographie, la clé de la Provence, comme une limite posée par la nature aux invasions et aux incursions. Ce rôle naturel a été signalé par des événements qui ne sont pas loin de nous, vers la fin du premier Empire. Mais d'où vient et que signifie le nom Sisteron? On en a cherché l'origine dans l'ancienne langue des Celtes. Cette langue si peu connue, et par-là même si facile à se prêter aux étymologies de parti-pris, dirait que Sisteron vient de Ceg et de Stoer, dont la réunion aurait produit d'abord Segustero , puis Sisteron , et d'après Bullet (Mém. sur la langue celtique, tome I,page 84), cette double racine signifierait bien des choses : elle indiquerait la nature et l'aspect des lieux , un pas sage renfermé entre des montagnes, et une rivière torrentueuse qui coule dans ce passage. C'est le cas de dire ici avec Molière : Quelle belle chose que l'alphabet (celtique) ! Dirons-nous après cela, que d'autres font de Sisteron une ville isiaque, pour ce motif peu concluant, que les Egyptiens, dans les Mystères d'Isis, faisaient usage d'un instrument de musique, appelé seistron? Dirons-nous encore que, d'après certaine hypothèse, un prince ligurien du nom de Segustus ou Sextus, aurait fondé cette ville quelques mille ans avant notre ère, et lui au rait laissé son nom un peu varié par les siècles suivants? Non, il nous convient mieux d'avouer que le premier monument authentique qui fasse mention de Sisteron, sous le nom de Secustro, c'est YItinéraire d'Antonin. Ce nom se changea peu à peu en Segesterica, de manière que les évêques de Sisteron , qui ont assisté aux conciles de France , depuis celui d'Epaône, en 517, prennent tous le titre d'évêques Civitatis Segestericse. Plus tard encore, ce nom a été par corruption changé en celui de Sistarica, plus rapproché]de la dénomination actuelle. Après cet aveu , il n'est plus nécessaire de réfuter l'opinion des auteurs qui ont confondu Segustero avec Cessero : c'est en ce dernier lieu que s'éleva plus tard l'abbaye de Saint-Thibéry, au diocèse d'Agde, aujourd'hui de Montpellier. Les his toriens latins ont assez clairement désigné Sisteron , pour qu'il fût impossible de faire cette confusion : nous voulons parler de Pline, de Silius Italicus et de Tite-Live. Ce dernier place nettement Sisteron sur la Durance, celle de toutes les rivières de la Gaule la plus difficile à traverser, et qui, malgré le volume de ses eaux, ne souffre point la navigation. Ce serait nous écarter de notre plan que de faire ici de longues dissertations sur le peuple celtique ou gaulois , auquel Sisteron appartint avant la conquête romaine par César. Encore ce grand capi taine est-il très-bref sur la Gaule Narbonnaise; probablement parce que ce pays, étant déjà soumis , échappait aux descrip tions et aux commentaires militaires du célèbre général. Pline l'Ancien et Strabon ne sont guère plus explicites, et nous permettraient à peine de conjecturer que Sisteron appartenait aux Vocontii, dont les places s'étendaient de proche en proche jusqu'aux Caturiges (Chorges). Nous n'en aurions jamais fini avec les variantes du nom de Sisteron ; mais il nous en faut citer au moins quelques-unes, d'après le savant historien de cette ville , M. Ed. de la Plane. « On lit Segusterone dans l'Itinéraire et dans la Table théodosienne. Ailleurs, on lit Segosterone, Secusterone, Setusiterone, Regusterone. La Notice des Gaules, exécutée, à ce que l'on croit , sous Honorius, marque Civitas Segesteriorum. Le Martyrologe romain dit que, vers l'an 500, saint Donat arriva in pago Sigisterico. L'évêque Valère, au concile d'Epaône (517), Avolus, au IV0 concile d'Orléans (541) ; Genest, au IVe concile de Paris (573), et Pologronius, au IIe concile de Màcon (585), souscrivent : Episcopi Civitatis Segestericse. Abbon , dans son testament, qui est du VIIIe siècle, et le cardinal d'Ostie, dans son Itinéraire, qui est du milieu du XIVe siècle, écrivent, l'un, Pagus Sigistericus , l'autre, Civitas Cistericensis ; enfin, un document du XVe siècle, tiré depuis peu de la bibliothèque du roi , nous transforme en Civitas Sergestrocorum. On disait d'abord Segesterium , Segusterum; on a dit depuis Sistericum et Sistaricum : ce dernier nom a prévalu dans le moyen-âge.» En 374, Sisteron fut comprise dans la seconde Narbonnaise, et occupa le sixième rang parmi les cités de cette province, probablement avec les droits de municipe. Bientôt arrivent les Barbares, se jetant comme une meute affamée sur l'empire romain expirant. Ce sont d'abord les Vandales (408) qui pas sent et disparaissent comme un ouragan ; puis , les Visigoths et les Bourguignons ; ces derniers prirent toute la Provence sous leur domination qu'ils étendirent jusqu'aux rives de la Durance. Sisteron y était comprise, et nous en avons la preuve dans le consentement donné par le roi Gondebaud à l'élection de Marius comme abbé du Val-Benoît, et dans la présence de plusieurs des évêques de cette ville à des conciles tenus dans les États des rois de Bourgogne. Nous empruntons en passant une remarque importante à l'historien de Sisteron déjà cité. « Pendant que saint Marius bâtissait son monastère au pied de la montagne de Lure (autrefois diocèse de Sisteron, maintenant sur celui de Valence), vers l'an 500, saint Donat , natif comme lui d'Orléans, vint également se vouer à la solitude dans l'étroite vallée de nos environs , appelée depuis Combe Saint-Donat. » Aux Bourguignons succèdent les Ostrogoths ou Goths d'Italie appelés en Gaule par le roi Clovis et bientôt vainqueurs, en 534, pour le compte des Francs. Dans le partage que firent de la Provence les enfants de Clotaire Ier, la ville de Sisteron dut échoir d'abord à Caribert , puis à Gontran son frère, roi d'Orléans. Ce malheureux pays était alors ravagé par les Lom bards et les Saxons. Les plaies étaient sans doute à peine cica trisées, lorsque les Sarrasins (l'an 93 de l'Hégire et l'an 711 de notre ère) franchirent les frontières d'Espagne, inondant la Provence et le Languedoc. Charles-Martel leur ôta pour jamais à Poitiers l'envie de prétendre au nord de la France ; mais le midi demeura exposé à leurs fréquentes déprédations. Ils réussirent à s'établir à la Garde-Frainet, d'où on ne put les déloger qu'en 942. C'est alors que se distingua Bevons, né au village de Noyers, à 13 kilomètres ouest de Sisteron. Son père Adelfred et sa mère Odilinde, nobles et riches, lui avaient donné l'exemple des plus pures et des plus hautes vertus ; il ne faillit pas à cette éducation , et devenu maître d'une grande fortune, il ne voulut l'employer, ainsi que ses talents et sa vie, qu'au devoir de purger son pays de la présence des Musulmans. Il les battit en effet à Pierre-Impie (Peyrimpi), puis rentra dans la solitude, d'où il ne sortit que pour faire de pieux pèlerinages à travers la chrétienté, et mourir à Voghera (Lombardie), le 22 mai 986. L'immense empire de Charlemagne s'étant fondu comme la neige aux feux d'un soleil d'août ; des chacals déchirèrent la peau du lion, et Bozon devint ainsi roi de Provence. Nous ne voyons pas que l'évêque de Sisteron ait concouru à sa nomi nation en 879 ; on ne trouve point en effet sa souscription aux actes de l'assemblée de Mantaille tenue à cette occasion. Son absence fut-elle fortuite ou son abstention volontaire? nous ne savons. Sisteron eut de bonne heure le titre de comté. Il est ainsi désigné dans une charte de 812 que rapporte Mabillon (De re diplom.). Dans le XI0 siècle, nous y trouvons des vicomtes. Bérenger, assiste avec cette qualité, en 1035, à une donation faite à l'abbaye de Saint-Victor de Marseille. Vers l'an 997 mourut Miron ; sa veuve Odile se remaria bientôt après avec Léogérius ou Ligier, et de cette nouvelle union naquirent plusieurs enfants dont deux, Pierre et Raimbaud, soulevèrent de grands désordres dans Sisteron, de l'an 1030 à l'an 1070; les détails à ce sujet trouveront mieux leur place dans la nomenclature historique des évêques. Après Miron et ses fils, on ne voit plus de vicomtes à Sisteron. C'est ici qu'intervient dans la monographie de Sisteron celle des comtes de Forcalquier. Cette dernière maison ne dura guère que cent cinquante-quatre ans ; mais les maux que causa au pays sa guerre avec les comtes de Provence exigeraient dans un ouvrage autre que celui-ci , d'assez longs développements. Il nous suffit de dire que le comté de Forcalquier prit naissance vers 1054, et comprit , sans contestation, la ville de Sisteron, jusqu'en 1162. A cette époque , l'empereur Frédéric Barberousse inféoda cette ville aux Etats du comte de Provence. Le comte |de Forcalquier, Guillaume IV, regarda cet acte d'autorité comme nul et non avenu. L'empereur n'était guère en mesure alors d'en prouver la validité , même par les armes ; toutefois , par politique ou par amour de la paix , le comte de Provence ayant renoncé au bénéfice de la donation à lui faite , Guillaume suivit son exemple, en rendant hommage à l'empereur, et fut ainsi réintégré ; mais sa fille Garsinde, fut fiancée en 1193 à Alphonse, héritier présomptif du comté de Provence , et reçut en dot le comté de Forcalquier, sauf quelques terres réservées par son père. Alphonse ne gar dant pas , aux yeux de son beau-père, assez de mesure dans la prise de possession de ses nouveaux Etats , Guillaume fit épouser sa seconde fille Béatrix au dauphin Guigues-André de Viennois, et lui assigna les comtés de Gap et d'Embrun, déjà compris dans la dot de Garsinde. Alphonse s'était rendu maître de la ville et du château de Sisteron , tandis que Guillaume avait réuni une armée considérable sur la rive gauche du Buech, d'où il partait pour ravager impitoyablement le terri toire de Sisteron. La tradition parle même d'une sanglante bataille livrée entre les deux belligérants dans la plaine de Servoules. Alphonse fit intervenir dans le débat son frère Pierre, roi d'Aragon. Ce monarque rapprocha les antagonistes ; la ville et le château de Sisteron furent mis en dépôt dans ses mains, avec clause de retour au comte de Forcal quier, dans le cas -où Alphonse et Garsinde mourraient sans postérité. Pierre en se retirant , laissa à Gérard de Villeneuve le soin de garder, aux termes du traité , la place en litige. La guerre renaquit aussitôt plus violente , au grand dommage des malheureux habitants. Alors, intervint un troisième larron (qu'on nous passe cette expression) , Guillaume de Sabran, qui, malgré le pape, malgré l'empereur Othon, assit son autorité sur Sisteron , en lui laissant son droit municipal et la justice civile. Or, Raimond-Bérenger, fils d'Alphonse, comte de Provence et son héritier légitime (Guillaume IV et Alphonse étaient morts tous deux), revint d'Espagne après la mort du roi d'Aragon, son tuteur ; Guillaume de Sabran n'osant ou ne pouvant s'opposer à sa revendication, consentit à une transaction (29 juin 1202) : Raimond-Bérenger obtint Forcalquier ainsi que tout le territoire, s'étendant au nord, y compris Sisteron, devenant ainsi le premier comte de Provence et de Forcalquier. Ce prince se plut à passer à Sisteron, une partie de l'été de chaque année. Plusieurs de ses actes en sont datés , entre autres les statuts du bailliage de Sisteron (1237) , et son testament qu'il y fit le 20 juin 1238, dans l'église des Cordeliers, et par lequel il institue sa quatrième fille Béatrix , héritière de ses Etats de Provence, au préjudice de ses deux gendres, les rois de France et d'Angleterre. Béatrix épousa en 1246, Charles d'Anjou, qui prit dès lors en main le gouvernement des Etats que sa femme lui apportait en dot ; et leur fit sentir le poids de sa domination. Sisteron cependant éprouva les effets de sa clémence dans une occasion mémorable. Une sédition dont les principales victimes furent les Juifs, avait ensanglanté ses rues et détruit le château. Bientôt pris de crainte et de repentir, les habitants envoyèrent des députés auprès du comte et de la comtesse de Provence , pour lors à Saint-Remi, afin de solliciter leur pardon et le main tien de leurs priviléges municipaux. Une amnistie fut la suite de cette ambassade (1259), et, en furent seuls exclus, ceux qui avaient directement pris part aux excès. Les députés rapportèrent en outre une volumineuse charte, dont M. de la Plane a reproduit le texte, et que M. l'abbé Feraud analyse, pour terminer ainsi : « Ces faveurs ne furent pas tout à fait gra tuites de la part du souverain ; car le contingent militaire que la ville devait fournir, et qui n'était auparavant que de cent fantassins et de cinq cavaliers, fut élevé à deux cents hommes, parmi lesquels un quart d'arbalétriers. On sait aussi que l'évêque de Sisteron fut soumis au serment d'hommage pour sa principauté de Lure. » Hélas ! le pays à peine pacifié devait subir une surcharge que l'ambition de Charles d'Anjou, futur roi de Naples, rendait nécessaire. Charles d'Anjou, roi de Naples et de Sicile, fut vaincu par le roi d'Aragon, Pierre III, et mourut en 1285. Son fils, le comte de Salernes, connu depuis sous le nom de Charles II , était retenu captif. Les Etats de Provence s'assemblèrent à Sisteron, le 24 mai 1286, et conclurent à prier le roi d'Angleterre de se charger de faire mettre en liberté le comte de Provence. Le monarque anglais accepta la mission, et parvint, après trois ans de peines infinies, à rendre à la Provence son comte Charles II d'Anjou. Ce prince fut encore plus malheureux dans ses entreprises que ne l'avait été son père ; mais nous devons à la vérité de dire que ses mécomptes ne l'empêchèrent pas de veiller avec sollicitude à la réforme et à l'amélioration de l'administration de ses Etats de Provence. Il statua en diverses occasions sur les réclamations de Sisteron , et toujours en faveur de ses priviléges. Il mourut, laissant pour successeur Robert, duc de Calabre, son fils, qui fut couronné le 13 août 1309, par Clément V, alors tout nouvellement établi à Avignon. Le nouveau souverain poursuivit les desseins de son père en Italie et en Sicile : l'escarcelle des habitants de Sisteron dut être la mesure de ses succès ou de ses revers. L'expédition de Robert fut un échec; son fils, le duc de Calabre, y périt, et il ne lui survécut que peu, laissant son héritage certain ou éventuel à ses petites-filles, dont l'une surtout, Jeanne acquit une si triste célébrité. De là encore de nombreuses et calamiteuses contestations. Rien n'arrêtait néanmoins les progrès du régime municipal qui se développait à Sisteron à l'instar des républiques italiennes. Jusqu'au commencement du XIVe siècle on avait eu les parlements publics, espèce de forum où les habitants se réunissaient à son de trompe; dès 1307, on créa deux, puis quatre syndics qui centralisaient le gouvernement de la cité ; en 1315, fut établi un conseil composé d'autant de membres que la ville avait de quartiers et de classes de citoyens, lequel conseil fut bientôt limité à huit membres , présidés par un jurisconsulte. Cette dernière forme subit bien des modifications dans les années qui suivirent 1333. En 1352, la reine Jeanne accorda à Sisteron des statuts remarquables , et que des gou vernements d'aujourd'hui trouveraient trop avancés. « Il est défendu au juge de recevoir ni or ni argent, sous peine de restituer le double. Le juge est passible d'une amende de cent livres, s'il rend une sentence sur le dire d'un seul témoin, et d'une amende de vingt-cinq livres, si , à l'expiration de sa magistrature, il n'a point terminé les procès commencés , et cela sans préjudice du droit que conserve la partie lésée de le poursuivre en dommages-intérêts. Tout habitant emprisonné peut obtenir son élargissement , moyennant une caution, sauf le cas où il est poursuivi pour crime emportant la peine capitale ou la mutilation des membres. » La reine Jeanne concéda pareillement une déclaration portant que : la ville et son territoire, avec ses juridictions et franchises sont à jamais inalié nables du domaine comtal, autorisant au besoin chaque habitant à repousser par les armes toute tentative contraire... La reine Marie de Blois concéda, en outre, par charte du 29 juillet 1386, l'inviolabilité du domicile de chaque citoyen. Il n'était permis aux officiers de la cour d'y pénétrer pendant la nuit , quand leur charge l'exigeait, qu'accompagnés de deux ou trois personnes prises parmi les plus probes du voisinage (1). Nous ne voulons pas, et pour cause, suivre la tragique histoire de la reine Jeanne ; mais nous devons mentionner la révolte de Robert de Duras, qui vint porter la guerre en Provence. Il y eut à cette occasion une assemblée à Sisteron. On peut juger, dit M. de La Plane, de la disposition où étaient les esprits par la prière que l'on fit au capitaine général du comté de Forcalquier, Guillaume Augier, seigneur de Viens, d'y assister sans armes ; il est à remarquer que l'évêque de Gap reçut la même invitation. Cette rébellion étouffée, un terrible aventurier, Arnaud de Cervole, surnommé l'archiprêtre, tomba sur la Provence, comme une trombe. Le pape traita avec lui ; Sisteron résolut de lui résister (1356), et se mit aussitôt en mesure d'exécuter sa résolution. Rien ne coûta aux courageux citoyens : taxes , corvées , abandon de biens qui ne pouvaient être défendus sans compromettre la place : ils subirent tout plutôt que d'accepter lâchement la loi et les conditions d'un féroce vainqueur. La ville avait été mise en bon état , la garnison renforcée ; tout ce qui pouvait servir à l'ennemi, détruit ; quelques portes murées, les autres fortifiées. Les brigands s'approchaient, lorsque, pour des raisons qui ne nous sont pas connues , le seigneur de Viens quitta la direction générale de la résistance : aussitôt on lui donna pour succes seur Raimond de Venterol , qui compléta les mesures prises par de Viens. « La terreur était si grande dans nos murailles, dit M. de La Plane, que craignant que des cris d'alarme ne l'augmentassent encore, l'autorité ne crut pas aller trop loin en frappant d'une amende de vingt-cinq livres (625 francs), ou à défaut de la perte de la langue, tous ceux qui, par imprudentes clameurs, viendraient à troubler l'ordre. Enfin, l'ennemi ne vint pas : Cervole s'éloigna des environs de Sisteron et passa plus tard au service du roi de France. Il ne faudrait pas cependant rire à la légère de ces préparatifs inutiles;
(1) Histoire géographique et statistique des Basses-Alpes , par M. l'abbé Feraud
car il est à présumer que l'attitude de notre cité dût être pour beaucoup dans la retraite de l'aventurier. » En 1400 et en 1401, saint Vincent Ferrier évangélisa Sisteron et y produisit des fruits salutaires. Le clergé surtout subit l'influence des prédications du missionnaire. Le chapitre de la cathédrale ne comptait alors que deux chanoines résidents : tous les autres habitaient Avignon, auprès de la cour pontificale, où ils possédaient des bénéfices. L'église était dé labrée, ses revenus dilapidés, le service divin abandonné. Cet état de choses cessa en 1431, par une sentence que rendirent, le 14 décembre , l'archevêque d'Aix et l'évêque de Digne , commissaires délégués du pape Eugène IV. Nous aurons occa sion de revenir plus amplement sur cette réforme , ainsi que sur les rivalités de l'Église de Sisteron et de la cocathédrale de Forcalquier. En 1402, maître Girardin le Petit, qualifié magister relogii, appelé à Sisteron, dans ce but, livra à la ville une horloge son nante du poids de cinq quintaux , moyennant soixante-dix florins (1,400 francs). La machine installée au haut du château , un argentier ou orfèvre , ou mécanicien (comme nous dirions maintenant), fut chargé de la diriger de manière qu'elle son nât régulièrement toutes les heures du jour et de la nuit, au nombre de vingt-quatre. En cette même année (1402), le frère du roi , prince de Tarente , de son nom Charles du Maine , qui gouvernait alors la Provence pour le roi Louis II , son frère , vint à Sisteron. Trois ans après , le roi Louis vint en personne visiter sa bonne ville. Une magnifique réception lui fut faite, magnifique pour le temps , car la pièce qu'il habita avait un lit de paille fraîche en guise de tapis. Sa table fut servie en vaisselle d'étain , que la ville avait louée ; mais il s'en montra fort satisfait (1408). Ce prince mourut en 1417, laissant ses Etats à son fils aîné, Louis III, sous la tutelle et la régence de la reine Yolande. Celle-ci signala son passage au pouvoir en confirmant et même en étendant les franchises de ses peuples. En 1425, par suite de la guerre que se faisaient pour la succession du royaume de Naples, Alphonse, roi d'Aragon, et Louis d'Anjou, une flotte aragonnaise parut sur les côtes provençales de la Méditerranée. Sisteron envoya aussitôt des arbalétriers pour renforcer les corps réunis à Toulon ; mais en même temps on découvre un complot ourdi dans le sein même de la ville pour la livrer à l'Espagnol : il était temps. L'autorité fit si bonne garde que l'honneur de Sisteron resta sauf. Louis III d'Anjou mourut en Italie comme son père, et eut pour successeur, en 1431, son frère René. Le nouveau roi de Provence se montra aussitôt généreux envers les habitants de Sisteron , en réduisant les feux et en leur accordant le droit de basse juridiction sur Consonauves; mais ce ne fut pas sans exiger de compensation , car Sisteron dut payer pour sa part , dans la rançon de son désiré roi de Sicile, 1,374 florins 8 gros 10 deniers (27,488 fr. 02 cent., selon l'évaluation de M. de La Plane). On sait que René ne put pas plus que ses prédéces seurs, conserver Naples et la Sicile ; il en fut chassé et se retira en Provence avec sa famille. A cette époque , son fils , le duc de Calabre , vint à Sisteron et logea dans la maisqn des Antonins, à la Baume, pendant huit jours. Le règne de René, sur nommé de son vivant et jusqu'à nos jours le bon roi René, fut signalé par la fréquente invasion du plus terrible des fléaux , la peste. Sisteron eut son épouvantable visite en 1451, 1458, 1467, 1474, 1479 et en 1482, et vit sa population diminuée des deux tiers. De nouveau, en 1503, son apparition fit fuir les habitants, et le chapitre, dit l'abbé Feraud, se fixa à Aubignosc, où il résidait encore en 1508. Il est inutile de dire que la. famine ne tarda guère à joindre ses horreurs à celles de l'épidémie ; les insectes eux-mêmes conspiraient à affamer les infortunés Sisteronnais. En 1511, l'officialité fut saisie d'une plainte contre les vers , chenilles et charançons qui ruinaient les récoltes de Saint-Michel , près Forcalquier. « Les habitants de cette petite paroisse, dit M. de La Plane, fatigués de faire la guerre à ces redoutables ennemis, se pourvurent par voie canonique par devant l'official du diocèse , à l'effet de pour suivre ces animaux suivant les formes juridiques. » Pareilles procédures n'étaient pas rares à cette époque. Le roi François Ier revenant de la conquête du Milanais , entrait dans Sisteron le 16 janvier 1515, et y séjournait quatre jours avec la reine-mère, la reine son épouse et la duchesse d'Alençon, sa sœur. Il y revint encore en 1524 et 1527, et pendant tout son règne , les registres de la ville ne sont remplis que des mouvements de troupes qui la traversent et l'encombrent. Le fameux chevalier Bayard y tint garnison avec ses gendarmes pendant trois mois. Le souvenir de François Ier rappelle nécessairement celui de la prétendue Réforme religieuse et des troubles sanglants qu'elle causa en Europe. Sisteron, par sa situation et par ses fortifications, Sisteron, clé à la fois de la Haute-Provence et du Dauphiné, devait jouer et joua en effet un rôle important dans ces guerres : pour son malheur, cela va sans dire. C'est en avril 1560 que l'on aperçoit dans la ville les premiers mouvements occasionnés, suivant les archives, par aucuns mal sentants de la foi dont le parti y comptait déjà bon nombre de prosélytes. Survint un édit royal du 15 janvier 1561 qui accordait aux Huguenots le libre exercice de leur culte. Cet édit, le parlement de Provence refusa de l'enregistrer ; mais dès le mois de novembre, les sectaires tinrent dans Sisteron un prêche auquel assistèrent le procureur du roi , le lieutenant du gouverneur, Gabriel Piolle , et le gouverneur lui-même , Caius de Virailh. Une sédition eut lieu. Le parlement eut beau décréter de prise de corps (30 novembre 1561) les personnages sus-nommés; les élections arrivèrent, et le premier et le troisième consuls furent des protestants qui eurent en même temps la majorité dans le conseil : « le prêche fut maintenu, et le chapitre se vit assigner, dit ici M. de La Plane, pour avoir à doter un ministre et un maître d'école protestants au moyen de deux prébendes que l'on affecterait à leur entretien. » Sur ces entrefaites, le comte de Tende, gouverneur de la province, et son fils, le comte de Sommerive , entrèrent en hostilités : le vieillard, poursuivi de poste en poste par les troupes de son fils, se réfugie dans Sisteron (juin 1562); à leur suite y arrivent un grand nombre de familles calvinistes pour trouver un asile contre les armes des catholiques. On se hâta de réparer tant bien que mal les fortifications de la ville; le comte de Tende en renforça la garnison et fit demander des secours au baron des Adrets. Sommerive investit la place et la pressa vivement dès le 10 juillet; le 11 au soir, les catholiques montèrent à l'assaut et furent repoussés. Les opérations languirent ensuite jusqu'aux derniers jours d'août. Le 3 septembre, la place fut battue sans relâche par le canon, pendant que les secours attendus par les assiégés du côté du Dauphiné se faisaient écraser à Lagrand. Le lendemain, les vainqueurs de la veille avaient repris leurs positions devant la place : la brèche était alors praticable ; les catholiques s'y élancent avec ardeur; cinq fois repoussés par la résistance désespérée des Huguenots, cinq fois ils reviennent à la charge ; une mêlée affreuse à l'arme blanche ou corps à corps (les munitions manquaient), dure jusqu'à sept heures du soir. Alors la nuit prématurée, à cause d'une pluie torrentielle, sépare les combattants : les réformés se retirent dans l'intérieur, puis s'évadent dans l'obscurité, et si habilement que les catholiques ne s'en aperçurent que le lendemain, lorsqu'il n'était plus temps de les pour suivre. Sisteron était donc au pouvoir de Sommerive et des catholiques ; mais la guerre n'était pas finie ; la ville pouvait redevenir une place forte pour les religionnaires : c'est pourquoi, en juin 1564, par ordre du gouverneur de Provence, elle fut désarmée et son artillerie transportée à Aix. Vaines précautions! Les Huguenots en étaient de nouveau maîtres en 1567; Sommerive dut venir l'investir encore. Le siége dura plusieurs mois à travers des phases diverses, et se termina par l'édit de pacification donné, et le 7 mai 1568, Sommerive, devenu comte de Tende par la mort de son père , entra dans Sisteron dont il prit possession au nom du roi. Les fortifications étaient en fort mauvais état : elles furent réparées et munies de canon. Les habitants ne gagnèrent pas la tranquillité à ces combats et à ces nouvelles précautions; ils étaient toujours divisés entre eux ; toutefois comme les catholiques étaient les plus forts et se sentaient plus soutenus par l'autorité, ils forcèrent par leurs exigences un grand nombre de familles à abandonner leurs foyers et leurs biens et à s'expatrier (1570). Nous voilà à la nuit trop fameuse de la Saint-Barthélemi (24 août 1572), et il n'est pas inutile de constater que les comtes de Tende et de Carces refusèrent d'obtempérer à l'ordre d'une cour déloyale, et de faire massacrer traîtreusement leurs concitoyens égarés. Vers le même temps, Dupuy-Saint-Martin quitta le gouver nement de Sisteron ; il fut grandement regretté , ainsi que son lieutenant , le capitaine Tressans de Vauréas, par tous les habitants, de quelque religion qu'ils fussent : ce n'est pas un mince éloge, vu la difficulté des temps. Le comte de Tende étant mort à Avignon le 2 octobre 1572 , le maréchal de Retz fut nommé pour le remplacer ; profondément blessé de ne pas lui avoir été préféré, à raison des grands services par lui rendus à la cause catholique, le comte de Carces devint le chef d'un parti puissant, dont le personnage le plus marquant fut Hubert Garde, seigneur de Vins, et neveu de de Carces. Tout naturellement ce parti se donna à la ligue contre la cour, et Sisteron, objectif des carcistes et des protestants qui ne le perdaient pas de vue , fut douloureusement tiraillé de part et d'autre. De Vins le Matinier, tenta de prendre par trahison la ville et le château , en corrompant quelques sous-officiers des trois compagnies du régiment d'Ornano qui y étaient en gar nison. Le complot avorta, et Sisteron parut embrasser fran chement la cause royale ; mais « avoit ung chacun l'entendement esblouy par les troubles d'alors; ce sont les expressions d'un des acteurs de ces querelles fratricides, Scipion du Virailh, fils de Caius du Virailh. De Vins agit alors ouvertement et vint prendre position aux Mées, où, ne pouvant tenir, il résolut de gagner Sisteron ; le grand-prieur, duc d'Angoulème, le fit poursuivre et le poussa par sa cavalerie jusqu'à Gap, trouvant inutile d'aller plus loin. De Vins fit un crochet, et revenant en Provence , par les montagnes de Thoard et de Digne, prêt à saisir une meilleure occasion. En 1585, le roi cédant trop facilement aux insinuations des catholiques exaltés, défendit à tous ses sujets, par une publication faite dans les derniers jours de juillet, à Sisteron, tous actes d'hostilités et rassemblements en faveur des cardinaux de Bourbon et de Guise, etc. Il interdit aussi l'exercice de toute autre religion que la catholique, accordant un délai de six mois pour se con former à cette disposition : les désobéissants devront sortir du royaume, sous peine de mort et confiscation de biens. Les protestants, qui avaient pris quelque répit pendant les dissensions des orthodoxes, relevèrent aussitôt la tête; le roi de Navarre écrivit aux chefs de son parti en Provence , se plai gnant amèrement de ce qu'on l'appelle hérétique, et de ce qu'on veut plutôt détruire qu'instruire les réformés. Le baron d'Allemagne était un de ces chefs ; il se fait aussitôt élire chef des églises calvinistes en Provence ; en même temps Lesdiguières prenait les armes dans le Dauphiné. Sisteron pouvant être pris entre les deux, et devenir, s'il tombait en leur pouvoir, une base d'opération, crut avoir tout à redouter. Ses craintes ne furent pas justifiées, pour des raisons qu'il est trop long de rapporter ici. Le duc d'Epernon remplaça le grand-prieur comme gouverneur de Provence (1586), et Sisteron envoya aussitôt son troisième consul, Blaise Penchinat, à Aix, pour lui baiser les mains. Le nouveau gouverneur mena si rigoureusement ses opérations contre les opposants au roi , que la guerre civile proprement dite fut terminée dans la Haute-Provence en cette même année. D'Epernon renouvela alors la garnison de Sisteron , et partit pour la cour en laissant ses pouvoirs au duc de Lavalette , son frère. Les Gascons étaient les maîtres de la Provence et y semaient de violentes haines en vexant à tout propos les habitants. Néanmoins , Sisteron , ou moins tourmenté ou moins contenu , resta soumis à d'Epernon jusqu'en 1594. Mais alors toute la Provence était de cœur à la ligue, pour ne pas être aux Gascons , et Lesdiguières étant venu se présenter devant la ville , le baron de Ramefort , qui la gou vernait , profita de cette circonstance pour éloigner une partie de la garnison gasconne : il put alors envoyer sa commission et celle de la ville au duc de Guise, que le roi avait, depuis peu, nommé gouverneur de Provence à la place de d'Epernon. « Quarante années de guerres, de luttes intestines, devaient laisser des traces profondes. La ville, écrasée sous le poids de ses dettes , ne put en alléger le fardeau qu'en faisant imposer d'autorité une réduction à ses créanciers et des sur taxes aux habitants » (M. l'abbé Feraud, Hist. des BassesAlpes). A cela M. de La Plane ajoute et prouve que la dette de Sisteron s'élevait alors à 16,600 écus d'or, de 60 sols pièce d'intérêt ; ce capital représenterait aujourd'hui deux millions. Ce n'était pas là cependant la plus douloureuse plaie laissée par les troubles civils : l'ignorance avait encore marché plus vite que la misère. Il fut décidé qu'on établirait un collége dirigé par les Jésuites ; mais les constructions furent concédées à des entrepreneurs, à des conditions si ruineuses, qu'elles durent être abandonnées ainsi que le projet de collége depuis la rhétorique jusqu'en bas. Plus heureux que les Jésuites, les Pères Capucins établirent, en 1613, une maison de leur ordre à Sisteron. « Le 21 mars, vendredi avant les Rameaux, après un sermon prêché par Basile de Salon , la croix des Capucins fut solennellement plantée dans le champ de François Sigoin, à la Burlière (depuis Plus-Basse-Croix). Les mémoires du temps ajoutent que ce même Père Basile prêcha ensuite les Quarante-Heures sur un théâtre, à côté du grand autel de la cathédrale , et qu'il prêcha jour et nuit sans interruption à genoux (1). » On dut encore au Père Basile l'introduction, â Sisteron, de la confrérie des Pénitents-Gris, dont l'évêque
(1) De La Plane, Histoire de Sisteron.
Toussaint de Glandèves approuva les statuts le 5 avril 1614 , en lui donnant l'ancienne église Saint-Martin. Le 14 juillet 1617, une sédition sanglante éclatait dans les rues de Sisteron, à l'occasion de la traite foraine (taxes établies sur les marchandises venant de la Provence comme sur celles qui venaient de l'étranger). Les commissaires chargés de l'établir au nom de la chambre des comptes, furent reçus par des huées et des coups de pierres; l'un d'eux est traîné, accablé de coups, dans un cloaque où il est laissé pour mort. Les consuls ne voulurent ou ne purent rien faire pour empêcher ces attentats. La cour des comptes désigna deux de ses membres pour informer contre les coupables mutins jusqu'à « sentence de tortures exclusivement. » En se rendant à Sisteron , ces nouveaux commissaires arrivés à Peypin , apprirent qu'un nouveau soulèvement avait éclaté plus terrible que le premier. Alors ils s'établirent à Volonne, et de là décrétèrent d'ajournement les consuls, le capitaine du guet et le procureur du roi. Ceux-ci et bien d'autres prirent la fuite, si bien que lorsque deux présidents, neuf conseillers et le procureur général de la cour, soutenus par des troupes, entrèrent dans la ville et rendirent leur arrêt le 7 octobre 1617, vingt-huit seulement sur soixante-deux compromis purent être arrêtés. Les soixante deux néanmoins furent condamnés ou à mort ou aux galères avec amende honorable et le fouet, ou à de fortes amendes. L'arrêt portait en outre que la ville serait désarmée , dépouillée de ses priviléges et paierait 58,800 livres d'amende. Nous dirons en son lieu l'admirable conduite de l'évêque Toussaint de Glandèves en cette conjoncture déplorable. En 1630, la peste enlevait à Sisteron près de 4,000 personnes, selon une relation contemporaine. Le 25 janvier 1640, les officiers de la sénéchaussée furent établis dans la ville. L'année précédente , le château avait été transformé en une prison, que le frère de Ladislas VIII, Jean-Casimir de Pologne, occupa quelques mois en 1679. La ville, déjà si obérée, dut payer les frais de cette détention. En 1642 ,pour faire de l'argent, en vendant de nouvelles charges , le roi établit un double parlement , destiné à rendre alternativement avec l'ancien et pendant six mois, les arrêts de la justice : c'est ce qu'on appelle le semestre. De là des divisions entre l'ancien parlement et le gouverneur. Sisteron prit le parti de ce dernier : ce dont le roi lui fit compliment par une lettre adressée par l'entremise du comte d'Alais aux consuls. Mais le comte d'Alais ayant été remplacé au poste de gouverneur de la ville par le duc de Mercœur, Sisteron refusa de reconnaître ce dernier; il fallut l'y forcer : ce qui ne fut ni long ni difficile. Vers cette époque fut établie une congrégation de prêtres sous le nom de Missionnaires de la Croix, avec la faveur de M. de Thomassin alors évêque de Sisteron. Nous y revien drons à propos de ce prélat. Un Te Deum, suivi de réjouissances publiques, fut chanté à Sisteron en 1714 à la nouvelle de la paix d'Utrecht. Les soldats de la garnison tombèrent sur la foule réunie , le commandant , sieur de Marignan, se distingua par sa brutalité. Plainte fut portée au roi qui réprimanda sévèrement le commandant. Le comte de Cambis-Velleron , alors gouverneur de la ville , con tribua beaucoup à l'heureuse solution de cette affaire : aussi les Sisteronnais lui en témoignèrent-ils leur reconnaissance par un présent de deux beaux mulets du prix de 700 livres. Les embarras financiers de la ville la forcèrent, en 1725, à aliéner le droit du Piquet, la montagne et la bastide de Chapaige, les huit fours et les moulins bannaux; et la masse des biens imposables diminuait si rapidement qu'il fallut réduire à cinquante-cinq feux l'affouage de la ville. La peste avait, comme on sait, désolé Marseille en 1720 : Sisteron trembla de recevoir bientôt la visite du fléau ; la mu nicipalité et le clergé prirent des précautions pour s'en pré server; les soins de l'une ou les prières de l'autre furent heu reusement couronnés de succès. Mais en 1744, l'armée de l'infant don Philippe ,d'Espagne, refoulée de l'Italie, vint prendre ses cantons dans la cité, apportant avec elle un typhus presque aussi meurtrier que la peste. Les soldats mou rurent par centaines : on ne savait où placer les malades, où . inhumer les morts : 141 habitants furent victimes de l'épidé mie, en deux mois et demi qu'elle dura (novembre et décembre 1744 et janvier 1745). En 1750, passage à Sisteron du duc de Savoie qui allait, en grande pompe de carrosses et de chevaux, épouser à Madrid une princesse espagnole. Il nous faudrait placer en 1767, l'horrible drame dont furent acteurs deux des trois Cordeliers qui composaient tout le couvent de Sisteron, Touche et Laloubière ; mais nous avons hâte de passer à l'objet principal de cet ouvrage. Ce ne sera pas toutefois avant d'avoir mentionné un premier projet de canal d'arrosage dérivant du Buech (1771) : ce projet abandonné fut repris après modifications en 1777, et l'évêque de Sisteron, Mgr de Saint-Tropez, en fut le principal instigateur et le fit réussir. En 1787, une somme de 137,000 livres est affectée au rachat des moulins et du Piquet : preuve sans réplique de la restauration des finances de la ville ; du reste la Révolution y trouva 30,000 francs en caisse. Tout ce qui concerne Sisteron après 1789 n'appartient pas à cette histoire. La cathédrale de Sisteron, dédiée sous l'invocation de la sainte Vierge, dite Notre-Dame de Pomiers, a été, dit-on, bâtie par Charlemagne. Reconstruite dans le XIe siècle, cette église, qui n'est plus aujourd'hui que paroissiale, ne fut termi née que dans les siècles suivants. On le reconnaît aisément à la variété des cintres, des pilastres et de la porte principale. Les chapelles latérales du midi appartiennent à une époque trèspostérieure. Nonobstant les ravages du temps et les violences des protestants, ce bel et majestueux édifice peut être classé parmi les monuments du sud de la France. On y trouve encore quelques bons tableaux échappés au vandalisme de 1793. Le chapitre de Sisteron était composé d'un prévôt, d'un ar chidiacre, d'un capiscol, d'un sacristain et de huit autres cha noines, dont l'un était théologal. Outre les chanoines, il y avait encore douze bénéficiers dont deux remplissaient les fonctions de curé. Les dignités et les canonicats étaient à là collation du chapitre qui portait pour armoiries : d'azur, à une Notre ogival et de plein cintre. Les quatre piliers formant les angles du sanctuaire et supportant la voûte de ce dernier et la tour du clocher, sont formés de faisceaux de colonnettes sveltes et gracieuses, couronnées de chapiteaux ornés de feuilles de chêne et d'acanthe. Le chœur de forme trilatérale, a sa voûte ornée de trois beaux pendentifs d'où partent d'élégantes nervures qui ont leur point de jonction à un autre ornement du même genre. Trois grandes ouvertures, garnies de vitraux, hautes de 12 mètres et larges de 0,70 centimètres, répandent des flots de lumière dans toute l'enceinte. Les deux chapelles des nefs latérales présentent dans tout leur pourtour des arcades ogivales et des colonnettes couronnées par des chapiteaux à feuillages très délicatement sculptés. La porte principale répond à la majesté de l'édifice. Elle est de forme ogivale, avec colonnettes dans les renforcements. Une belle rosace en pierre, garnie de vitraux coloriés, la surmonte. A côté de la porte, s'élève l'élégante tourelle de l'horloge. La noble simplicité de l'architecture de la nef principale , toute construite en pierres de taille , et la couleur noirâtre que le temps lui a donnée, offrent un tel cachet de grandeur, que l'on se sent porté au recueillement en y entrant. Le sanctuaire vient d'être embelli d'un magnifique autel en marbre, en parfait rapport avec l'ensemble de l'édifice. Les statues des douze apôtres ornent sa façade extérieure. » (Feraud , Hist. géogr. et statistique des Basses-Alpes.) Avant 1789, l'Eglise de Forcalquier était composée d'un prévôt , d'un sacristain , d'un capiscol, de dix chanoines, de neuf bénéficiers et de deux curés. Les chanoines de Sisteron, dispersés par les Barbares, furent rassemblés et rétablis par Frondon, vers le commencement du 3e siècle. Ce fut le même prélat qui, en 1015, voulant augmenter le lustre de la seconde ville de son diocèse, érigea l'Eglise de Forcalquier pour des chanoines , qui ne formèrent qu'un seul et même corps avec ceux de Sisteron. Voici ce qu'on lit dans des lettres de l'évêque Bertrand II : Forcalqueriensis et Sistaricensis Ecclesise una fuerunt Ecclesia et ab episcopo Frondono sexdecim canonici in utraque Ecclesia fuerunt constituti. Ces deux Eglises furent d'abord desservies alternativement par les mêmes chanoines, mais Géraud II Chevrier les sépara, et établit dans chacune un prévôt, des dignités et des canonicats : c'est depuis ce temps que l'Eglise de Forcalquier avait le titre de con-cathédrale, titre confirmé par Adrien IV et par Alexandre III, et reconnu par plusieurs arrêts. Le chapitre de Forcalquier portait pour armoiries : de gueules, à un saint Mary, abbé, la mitre en tête, la main dextre appuyée sur la poitrine, et tenant de la senestre, une crosse, le tout d'argent. Les anciennes communautés religieuses qu'on trouvait à Sisteron, étaient : 1- les Cordeliers, qu'avait, dit-on, fondés Raimond-Bérenger IV, comte de Provence, qui les dota en mourant d'une rente annuelle et perpétuelle sur la claverie de la ville. Deux chapitres généraux de l'ordre avaient été tenus dans ce monastère en 1408 et en 1487, mais le nombre des religieux qui s'était, à une certaine époque , élevé jusqu'à dix-huit, était toujours allé en décroissant depuis les guerres du XVIe siècle; 2- les Dominicains, fondés en 1248, à la Baume, par Béatrix de Savoie. Le chapitre général de l'ordre avait été tenu en juin 4329, dans ce couvent, où l'on comptait quatorze religieux au XVe siècle, mais où la révolution de 1790 n'en trouva plus que trois; 3- les Antonins, qui, dès les premières années du XIIIe siècle, desservaient déjà l'hospice de la Baume, destiné aux malades atteints du feu-sacré, et que ruinèrent les protestants; 4- les Capucins, appelés à Sisteron en 1613; 5- les Missionnaires de la Croix, fondés en 1694, par André Tyranni, chanoine de Sisteron, reconnus par lettres patentes de 1698, et qui, vers 1712, se fusionnèrent avec les prêtres de Notre-Dame de la Sainte-Garde; 6- les chanoines réguliers de Notre-Dame de Chardavon, transférés à la Baume en 1385, après la destruction de leur premier monastère. Le prévôt de Chardavon fut à la nomination du roi depuis le milieu du XVe siècle. Le chapitre, composé en 1319 de quarante deux membres, ne comptait plus que quatre chanoines à la fin du XVIe siècle; 7- les Visitandines, établies en 1631 sur l'emplacement de l'ancien palais épiscopal, par les soins de Ma dame de Gariscan, femme du gouverneur de Sisteron ; 8- les Ursulines, dont le couvent était bâti dans l'ancien faubourg de Foralpra, et dont les lettres de fondation étaient datées du 26 mai 1642; 9- la maison de la Providence, desservie par une congrégation vouée à l'éducation des filles, fondée en 1749 par Mme Beau et Triffault, et approuvée en 1782.

Les abbayes déjà supprimées ou encore existantes en 1790, et dont nous parlerons plus loin, étaient celles du Val-Benoit, de Notre-Dame de Lure, de Sainte-Claire de Sisteron. Depuis 1456, les deux menses abbatiale et conventuelle de l'abbaye de Cruys étaient unies à la mense épiscopale. Le séminaire de Sisteron était gouverné par des prêtres de la Mission ou Lazaristes ; il y avait dans le diocèse deux autres séminaires, l'un à Manosque, l'autre à Lurs. L'évêque se qualifiait prince de Lurs, payait en cour de Rome 800 florins pour ses bulles, et jouissait d'environ 15,000 livres de rente. Enfin le diocèse comptait 74 paroisses ou annexes, dont 46 en Provence, 16 en Dauphiné et 2 dans le Comtat Venaissin. Sisteron et ses évêques ont eu déjà plusieurs historiens, nous mentionnerons surtout Laurent Bureau, mort évêque de cette ville le 5 juillet 1504, et qui fit rédiger toutes les chartes de son Eglise en un recueil aujourd'hui perdu, appelé le Livre vert, à la tête duquel il mit la succession chronologique des évêques ses prédécesseurs ; le P. Jean Columbi, de la Compagnie de Jésus, né à Manosque en 1592, et mort à Lyon le 11 décembre 1679, auteur d'un volume intitulé : De rebus gestis episcoporum Sistaricensium libri quatuor, qu'on trouve dans le volume de ses œuvres publié sous le titre Opuscula varia, Lyon, 1668, in-folio; Gaspard Gastinel, chanoine et grand vicaire de Sisteron, né le 19 septembre 1634, en cette ville, où il mourut subitement dans la sacristie de la cathédrale le 8 octobre 1715, ne laissant que des manuscrits où se trouvent copiés bon nombre de documents authentiques, aujourd'hui pour la plupart perdus. Le dernier et le plus complet historien est M. Edouard de la Plane, membre de plusieurs sociétés savantes et correspondant du ministère de l'instruction publique pour les travaux historiques, mort le 2 janvier 1870, à qui l'on doit l'Histoire de Sisteron, tirée de ses archives, Digne, 1843, 2 vol. in-8e avec cartes et plans , ouvrage qui complète celui qu'il avait publié sous le titre : Essai sur l'histoire municipale de la ville de Sisteron, Digne, 1839, in-8.
ÉVÊQUES DE SISTERON.
1. — CHRYSAPHIUS (vers 452). « Du jour où les villes de la seconde Narbonnaise reconnaissent une métropole (317), dès ce jour il n'y a pas de doute, on peut considérer ces villes comme les conquêtes avouées du christianisme. » Ces paroles sont d'un sens historique très sain, et M. de la Plane a raison d'y ajouter celles-ci : « Là, Sisteron doit rattacher le premier anneau de sa chaîne épiscopale. » Mais quels furent ses premiers prélats ? mystère qu'il ne sera jamais donné d'éclaircir. Celui qui, pour nous, commence la série de quatre-vingts évêques, qui pendant quatorze siècles gouvernèrent cette Eglise, est Chrysaphius, siégeant en 451, d'après Jean Columbi. Cet auteur s'appuie dans cette affirmation sur un manuscrit des actes du concile tenu à Arles, sous Ravennius, métropolitain de cette ville, et sur la lettre synodique des évêques des Gaules, écrite, en 45I , au pape saint Léon, qui y répondit la même année. Jean Columbi tenait ces faits de Jean Savaron, et Honoré Bouche les affirme à son tour, comme les tenant de Polycarpe de la Rivière, lequel assure avoir vu lui-même le manuscrit entre les mains de Savaron ! Nous avons beaucoup de peine à croire que Chrysaphius soit le premier évêque de Sisteron. La religion chrétienne était au IVe siècle généralement répandue dans la Provence, et Sisteron tenait le cinquième rang parmi les villes dépendantes de la métropole d'Aix. Nous croyons donc qu'elle avait alors un évêque, puisque tous les autres siéges de la seconde Narbonnaise étaient érigés à cette époque. Mais on ne doit pas donner à celui de Sisteron une antiquité plus grande que la fin du IVe siècle.
2. — JEAN I (vers l'an 500) . Dans la Vie de saint Mary, abbé du Val-Benoît , par le patrice Dyname, on voit que Jean, évêque de Sisteron, confirma l'élection de cet abbé faite du consentement de Gondebaud, roi des Bourguignons. Comme ce prince mourut en 509 , il faut croire que Jean Ier siégeait avant cette année. Il est dit d'autre part que cet évêque était de race sénatoriale , ennobli encore par ses œuvres et par sa vertu, et qu'il supporta pendant quarante-sept ans la charge de l'épiscopat : ce dernier point donne à penser qu'il s'agit de Jean II et non de Jean Ier.
3. — VALÈRE (517). Valère souscrivit en 517 aux actes et canons du concile d'Epaône (ou d'Albon) , avec les autres évêques du royaume de Bourgogne. Sa souscription est accompagnée de ces mots : Episcopus urbis Sigestericœ.
4. — AVOLE (541). Avole est connu par les deux conciles d'Orléans, tenus dans l'espace de neuf ans. Au premier, assemblé en 541, il assista et souscrivit au même titre que le précédent, comme Episcopus Segestericss civitatis; au deuxième; classé le cinquième parmi ceux de la ville d'Orléans, il se fit représenter par le prêtre Agecius (549). M. l'abbé Feraud nous dit bien qu'Avole fut député à Arles, en 554 ; mais nous regrettons de ne pas savoir sur quoi il s'appuie.
5. — GENIEZ (573). Le 4e concile de Paris, tenu en 573, nous offre deux fois la souscription de cet évêque, une fois au bas de la constitution des évêques, et une autre fois au bas de la lettre synodale, adressée au roi ; toujours avec ce titre : Ecclesiae Segestericse Episcopus.
6. — POLOGRONE on POLYCRONE (584). En 584, par ordre du roi Gontran, s'assembla le second concile de Valence. Le roi et son épouse y confirmèrent toutes les donations et concessions par eux faites à la basilique de Saint-Marcel ou de Saint-Symphorien, et à d'autres églises. Parmi les Pères du concile est nommé Poligroneus Episcopus civitatis Sigestericse. L'année suivante, il se contenta d'en voyer un député au concile de Mâcon (585). Ajoutons à cela, que Pierre de la Lande , dans le supplément aux Conciles de la Gaule, rapporte une lettre de quelques clercs à un évêque nommé Pologronius, qu'on croit être celui de Sisteron. Après cet évêque, Jean Columbi et Charles le Cointe, d'après Bureau, placent jusqu'au Xe siècle une série de prélats sur lesquels rien n'est certain. Nous emprunterons à ces auteurs ce qui est vraisemblable et négligerons le reste.
7. — SECONDENT (619-657). Ce prélat, d'après les auteurs ci-dessus cités, aurait occupé le siége épiscopal de Sisteron pendant trente-huit ans : de l'an 619 à l'an 657.
8. — MAGNIBERT (657-718). Celui-ci aurait siégé soixante et un ans ! Ce n'est pas encore tout à fait impossible; toutefois le fait nous paraît d'autant plus difficile à croire, qu'à cette époque l'élection tombait ordinairement sur des personnes d'un âge mûr, dont les jours étaient encore abrégés par les travaux du ministère.
9. — AMANT (718-729). Il occupa, dit-on, onze ans, de 718 à729 ou 730, et mourut avant que les Sarrasins ne fissent irruption en Gaule, pour ravager, d'abord la seconde Narbonnaise, puis la Gaule méridionale presque entière.
10. — VIRMAGNE (730-750). Virmagne, d'après les conjectures de nos auteurs, siégea pendant vingt ans : de 729 ou 730 à 750.
11.— BON I (750-803). On peut appliquer à son long épiscopat ce que nous avons dit de celui de Magnibert.
12. — JEAN II (803-850). Sous son épiscopat, Charlemagne donna, concéda et livra en vertu de son privilége impérial, à Dieu, à la bienheureuse Marie, à saint Thyrse, glorieux martyr, et au saint-siége de Sisteron, la terre de Lure, avec son entier honneur et toutes ses dépendances. Le même Jean, du conseil et avec l'aide du très glorieux, très magnifique et très pieux empereur fonda un monastère dans un lieu de son diocèse appelé Volx, et y établit l'abbé Audemar avec douze religieux, lesquels devaient s'y livrer au service de Dieu selon la règle de saint Benoît. D'après Mabillon (Diplomat. p. 614), il faut placer à l'année 812 la fondation du monastère de Volx; et cet auteur rappelle en cette même année d'autres monastères et églises, pour les quels notre prélat fut un généreux bienfaiteur. L'abbaye de Volx n'eut pas une longue durée. Le même évêque restaura , plutôt qu'il ne fonda , un autre monastère dans son diocèse : c'est celui du Val-Benoît, dont nous avons vu un abbé appelé Mary, Marius ou May. Tous les auteurs s'accordent sur ces deux faits : la destruction de cette maison après la mort de saint Mary, et sa restauration par Jean II, évêque de Sisteron. Le Val-Benoît subsista depuis jusqu'au Xe siècle : d'abbaye, elle devint alors un prieuré dépendant du monastère de l'Ile-Barbe, dans l'archidiocèse de Lyon. Son nom latin , Vallis Bodonensis a été traduit à tort par Beuvons, Bodane ou Bevons. Bevons (Beontium), petit village aux portes de Sisteron , n'a rien de commun avec le Val-Benoît autrefois du diocèse de Sisteron , et aujourd'hui de celui de Valence , où se trouve l'ancien prieuré de Saint-May, débris lui-même de l'antique abbaye fondée par Marius.
13. — BON II (850-854). Les auteurs de la Gallia christiana placent entre Jean II et Bon II un évêque du nom de Campanus, qui, suivant Papon, de la Plane et M. l'abbé Feraud, fut au contraire le successeur de Bon. Bon est connu par un échange de terres et de vignes qu'il fit avec Paul, évêque de la sainte Eglise d'Apt, le 4 des nones de juillet, la huitième année du règne de Lothaire, indiction XV, c'est-à-dire le 4 de juillet 852. On a cru qu'il s'agissait ici de Lothaire , fils de l'empereur de ce nom ; mais ce prince , après la mort de son père , ne régna que sur la Lorraine et les deux Bourgognes. Il n'aurait donc pu avoir la Provence qu'après le décès de Charles , son frère , décédé sans postérité en 863. Mais d'abord cette province, et par consé quent la ville de Sisteron , passa toute entière sous la domina tion de son frère Louis, roi d'Italie. Ensuite, quand même Lothaire aurait eu la ville de Sisteron dans son partage , ce qui est contre toute vraisemblance , ce n'eut été qu'en 863 , et on n'aurait commencé de compter les années de son règne que cette année-là. Or, la huitième année ne tombait qu'en 871, ce qui ne s'accorde ni avec l'indiction XV, qui répond à l'année 867, ni avec l'histoire, puisque ce prince mourut au mois d'août 869. C'est donc de l'empereur Lothaire, roi d'Italie, qu'il faut entendre les termes de l'acte ci-dessus mentionné. Lothaire eut en partage la Provence au mois d'août 843 ; on comptait donc dans cette province la huitième année de son règne du mois de septembre 851 au mois de septembre 852. Ces erreurs , que les Bénédictins qui ont écrit sur les évêques de Sisteron n'ont point relevées , sont cause qu'ils ont trans posé l'épiscopat de Bon, qu'il faut mettre en 852, avant celui de Campanus. Il est à remarquer aussi qu'il n'est point possible de placer en 867, indiction XV, l'acte passé entre Bon et Paul, évêque d'Apt, puisque, dès 857, ce dernier prélat avait un succes seur en la personne de Teutbert. L'épiscopat de Bon II ne dépassa pas, d'ailleurs, l'année 854.
14— CAMPANUS (855-869). Campanus ne commença à siéger qu'en 855. Il est mentionné l'année suivante dans une inscription rapportée en ces termes, par un historien de Sisteron : «En l'honneur de Notre Seigneur Jésus-Christ, ce monument a été bâti, grâce aux soins du prélat Campanus, évêque de Sisteron, la douzième année du règne de Lothaire, fils de Charles. Le P. Columbi, en citant cette inscription trouvée dans l'église cathédrale, devant l'autel de la chapelle dédiée à saint Jean, ne pense pas que Campanus ait jamais été évêque de Sisteron. La qualification de prélat qui lui est donnée lui fait croire que Campanus fut abbé du Val -Benoît. Cette hypothèse nous semble d'autant moins admissible qu'à cette époque il n'était point d'usage de donner aux abbés le titre de prélat. La douzième année du règne de Lothaire, le même que celui dont nous avons parlé ci-dessus, est bien l'année 856. Sous l'épiscopat de Campanus, et en 859, dix évêques s'assemblèrent à Sisteron , et y accordèrent un privilége d'exemption au monastère de Sessieu, fondé dans le diocèse de Lyon, par Aurélien, alors abbé d'Ainay, et depuis archevêque de Lyon. Les historiens ne nous ont pas fait connaître l'époque du décès de Campanus, mais, comme on sait que Vivence ou, Vincent, son successeur, mourut en 881, après un épiscopat de onze années, il est très probable qu'il faut fixer à 869, auplus tôt , la mort de ce prélat.
15. — VIVENCE ou VINCENT (870-881). Un fait sur lequel les auteurs s'accordent tous, c'est que Vivence ou Vincent décéda en 881 , après avoir, pendant onze années , gouverné comme premier pasteur, l'Eglise de Siste ron. Le premier évêque qui souscrivit à la charte de fondation ' du monastère de Volx , par Jean II, est nommé Vincent , et Mabillon estime que les évêques dont la signature se trouve après celle du fondateur, sont les successeurs de Jean, lesquels , cha cun à son tour, à mesure qu'ils se chargeaient de l'évêché de Sisteron , venaient spontanément confirmer ce qu'avait fait Jean, leur pieux prédécesseur. Après Vincent, on trouve dans la charte de fondation , Amant , Secondin et Virmagne ; aussi tous les catalogues ont-ils donné , dans cet ordre , ces prélats comme successeurs de Jean. Il paraîtrait donc naturel de conclure, que nous devrions placer Amant , Secondin et Virmagne , après Jean II , et non pas avant cet évêque, comme nous l'avons fait , avec d'autant plus de raison, que l'on s'explique fort difficilement leur si gnature sur un titre qui leur est de beaucoup postérieur. Mais nous avons suivi' le sentiment des PP. Columbi et Lecointe, qui, depuis Polycrone jusqu'à Jean, c'est-à-dire de 584 à 800, trouvant une lacune de 216 ans dans la série des évêques de Sisteron, ont cru devoir la remplir, en mettant l'épiscopat de Secondin, d'Amant et de Virmagne, dans cet intervalle de temps. Il faut cependant convenir que l'histoire est bien peu digne de foi, quand elle n'est fondée que sur de pareilles raisons. Columbi et Charles Lecointe ne peuvent avoir eu que deux motifs pour opérer cette interversion, que la critique n'en juge pas moins arbitraire. Ce serait 1e de supprimer la longue laeune qui suit l'épiscopat de Polycrone jusqu'à Jean II ; 2e de remplir le nombre d'années assigné à l'administration de ces évêques, par l'historien Laurent Bureau. Jean II , suivant ce dernier auteur, siégea jusqu'en 850, et de cette date jusqu'à l'épiscopat d'Humbert, en 966, il s'est écoulé 116 ans. Or, l'addition des années d'épiscopat, attribuées à chaque évêque, par Bureau, donnerait 282 années. Columbi, et après lui, Le cointe, ont donc cru bien faire en établissant les évêques, dont il est question, avant Jean II et après Polycrone. Là l'espace de 282 ans était encore à son aise. D'autre part, l'hypothèse de Mabillon ne s'appuie sur aucun commencement de preuve ; car, rien ne dit même que les évê ques soussignés dans la charte de fondation du monastère de Volx, après Jean II, aient été évêques de Sisteron. C'est donc bien gratuitement que Columbi s'est mis à la torture pour leur donner une place dans son catalogue. Rien aussi ne prouve qu'ils ne l'aient pas été. Vincent surtout ne rencontre aucune contradiction, et nous pouvons admettre avec Mabillon, qu'il occupa pendant onze ans, après Jean II, et mourut en 881 ; sous le bénéfice toutefois, des observations qui précèdent.
16. — KUSTORGE (881-925). Eustorge , selon Bureau , gouverna l'Eglise de Sisteron pendant 44 ans. (La durée inusitée de ces épiscopats suffirait à les rendre suspects : l'auteur taillait en plein drap, si l'on nous permet cette expression triviale.) Bureau ajoute que, «pendant qu'Eustorge siégeait, l'Eglise de Dieu souffrit une violente persécution de la part des Goths et des Vandales, hérétiques ariens. » Il eut été plus exact, en attribuant cette persécution aux Sarrasins qui, s'établissant à la Garde-Frainet, entre l'Italie et la Provence, ravagèrent nos côtes depuis le règne d'Arnoul jusqu'à celui de l'empereur Othon le Grand. « A la même époque, vers 924, les Hongrois, dit Flodoard, traversèrent les cols escarpés des Alpes, et répandirent la consternation en Gaule. La terreur qu'ils inspiraient fut cause que l'évêque de Sisteron résolut de transférer les reliques de saint Mary, pour les mettre à l'abri de leurs profanations. »
17. — ARNOUL (925-962). Eustorge avait été remplacé par Arnoul , lorsque le corps du saint confesseur Mary fut transféré du Val-Benoît , comté de Sisteron , dans la ville de Forcalquier. L'église où les reliques de saint Mary furent alors déposées, prit le nom du vénérable abbé de Val-Benoît. Elle se reliait aux fortifications qui protégeaient l'enceinte de la ville. Après avoir longtemps servi de cathédrale, cette église fut abandonnée, et l'on n'y célébrait que rarement l'office divin. Il n'en reste plus aujourd'hui que quelques vestiges. C'est à tort que certains auteurs ont désigné cette église sous le vocable de Notre-Dame et de saint Thyrse, martyr. Ce vocable était celui de la cathédrale de Sisteron. Nous avons dit plus haut que cette translation eut pour cause la terreur des Barbares. « Ceux-ci, en effet, alors que Raoul régnait sur la Gaule Cisalpine et Hugues sur le Viennois, forcèrent les portes des Alpes, se jetèrent sur Forcalquier, Sisteron et Apt, et arrivèrent dans la Gothie. » Ainsi s'exprime la Chronique de Verdun. Les moines de Saint-Gilles, dans leur Bréviaire, déplorent d'avoir subi les déprédations de ces hordes, vers 925. De ce fait, que les habitants de Sisteron cherchèrent un refuge à Forcalquier, en y emportant les reliques de saint Mary, comme dans un lieu capable de résister à une attaque, nous pouvons induire que Forcalquier était déjà une ville importante. C'est sans doute pour cette cause, et pour d'autres analogues, que cette ville devint bientôt la capitale d'un comté fort puissant, qui eut d'immenses possessions dans l'Embrunais, le Gapençais, le Sisteronnais, le pays d'Apt, et au delà de la Durance jusqu'au Rhône. Suivant Bureau, l'évêque Arnoul mourut en 962; après avoir siégé pendant quarante et un ans.
18. — URSK ou OURS (963). Urse, par la grâce de Dieu, humble évêque en Christ du saint siège de Sisteron, dit l'historien que nous avons souvent occasion de mentionner, donna à l'église de Ganagobie (Ecclesia de Podio Conoguoriensi), du conseil de ses chanoines, les dîmes de Peyruis, avec l'église de Saint-Pierre construite au même lieu, et qui appartenait à son évêché; il donna en même temps et sur le même territoire, les hameaux d'Aris et de Abuse, et semblablement l'église de Saint-Michel. Cette donation fut faite sous le règne de Conrad, roi très pieux des Allemands et des Provençaux. Cet évêque obtint un privilége du même empereur. Le Livre vert de l'évêché place l'octroi de ce privilége à l'an de l'Incarnation 967, et le 27e du règne de Conrad ; mais ces deux dates ne concordent pas : la 27e année du règne de Conrad est l'an 963 de notre ère et non l'an 967, comme le prouvent les auteurs de la Gallia christiana, par une charte de cet empereur en faveur de l'abbaye de Montmajour, et également donnée la 27e année de son règne, et du Christ 963. (Voir du reste Mabillon, Annales sous 963, n. 72.) L'erreur s'expliquera facilement ainsi : Bureau aura seulement lu dans l'acte authentique Fait la 27e année du règne de Con rad, sans désignation de l'an de l'Incarnation , et de son chef, il aura ajouté 967. S'il fallait encore s'en rapporter au Livre vert de l'évêché de Sisteron, un évêque appelé Jean donna les terres qu'il possédait à Ganagobie à Dieu et à Saint-Pierre de Cluny, et y éleva deux églises, l'une à la Vierge, l'autre à saint Jean-Baptiste dans laquelle il voulut être enseveli. Mais nous ne connaissons que deux évêques de ce nom, dont le dernier fut contemporain de Charlemagne. Columbi en suppose un troisième qu'il place vers 965, après Arnoul, époque à laquelle, selon lui, il faudrait rapporter la fondation de Ganagobie. Les archives du monastère lui donnent une origine plus reculée, et il est certain que cette communauté était florissante en 963. A ce propos la Gallia n'hésite pas à s'exprimer ainsi : « Ce ne sont là que pures conjectures auxquelles nous ne pouvons nous rallier, malgré l'estime que nous professons pour le très savant auteur. »
19.— HUMBERT Ier (966-980). Un document authentique du chapitre d'Arles nomme l'archevêque d'Aix, Silvestre, avec tous les évêques de la province, ses suffragants en 966. Parmi eux aucun n'est appelé Urse, d'où il suit que l' évêque de ce nom ne siégeait plus; mais un Humbert apparaît le sixième, et , dès lors , il n'y a pas de témérité à le dire évèque de Sisteron, les titulaires de ce siége avaient en effet le sixième et dernier rang dans la province d'Aix ; il y aurait même un autre motif pour qu'il fut placé le dernier, c'est qu'il était récemment promu en remplacement d'Urse.
20. — RODOLPHE on RAOUL (981-1012). Il est nommé dans le plaid général que le comte Guillaume tint à Manosque, au sujet de la restitution de la terre de Camargue au monastère de Saint-Victor de Marseille, le 2 janvier, la quarante-quatrième année du règne de Conrad , d'après le trésor des archives de Saint-Victor. Antoine Ruffi (Histoire de Marseille), prouve très bien que cette année correspond à l'an de l'Incarnation 981. Columbi ne mentionne pas cet évêque. Ne l'a-t-il pas connu? A-t-il cru devoir l'omettre? Nous ne savons.
23. - FRONTON oc FRONDON (1013-1030). Frondon ou Fronton, que Jean Columbi prétend mal à propos avoir été transféré à l'archevêché d'Aix, gouverna l'Eglise de Sisteron, à partir de l'an 1013 environ. Deux ans après, il fonda un chapitre à Forcalquier, témoin la lettre de Bertrand II, où on lit : les Eglises de Sisteron et de Forcalquier devinrent une même Eglise, et l'évêque Frondon institua, dans chacune d'elles, un collège de seize chanoines. Ces chanoines ne formaient qu'un seul et même corps capitulaire , uni au chef du diocèse. Nous verrons bientôt que cette unité ne dura pas longtemps. Par une charte du 15 janvier 1016, le même évêque avait donné aux chanoines de Notre-Dame et de Saint-Mary de Forcalquier la dîme d'un quartier du territoire de Mane, nommé Salayon ou Salagon. La charte de cette donation a été vue dans les archives capitulaires , par Columbi, et établit que le chapitre de Forcalquier existait déjà en 1015. Le même annaliste pense que notre Frondon est le même que celui auquel le pape Serge IV écrivit en même temps qu'à d'autres évêques et à Amaury archevêque d'Aix. Mabillon, de son côté, soupçonne que notre Frondon est cet évêque qui, avec Pons, évèque de Glandèves, consacra une église soumise au monastère de Psalmodi, en 1029, en accordant des indulgences aux fidèles pénitents qui la visiteraient. Enfin, les auteurs de la Gallia christiana hasardent cette conjecture : Le Frondon, évêque de Sisteron, ne serait-il pas ce lui qui, en 999, fut témoin d'une donation faite à Miron et à Odile, selon que le rapporte Geoffroi dans sa Nicsea. Du reste, Columbi est seul à transférer ce prélat sur le siége archiépiscopal d'Aix : il affirme cette translation sans preuves, et quelque confiance que mérite l'opinion de ce docte écrivain, elle ne saurait suffire ici. Sous les épiscopats d'Arnoul et d'Urse, les Sarrasins avaient inondé le diocèse; nous avons vu les habitants de Sis teron et sans doute de beaucoup d'autres lieux chercher un asile dans Forcalquier. La cathédrale de Saint-Thyrse avait été détruite. «En vain, dit M. de la Plane, le roi de la Bourgogne transjurane intervient et prend l'Eglise de Sisteron sous sa sauvegarde (964). Ursus ne verra pas le grand événement qui se prépare ; il succombera à la peine, avant que les échos de Pierre-Impie (Peyrempie) aient répété le dernier cri des infidèles (975); il n'aura à léguer à ses successeurs que des ruines. Frondon arrive, fait déblayer le terrain, et jette les fondements de la magnifique cathédrale qui, après avoir vu passer plus de trente générations s'élève encore si majestueuse au milieu de nous. L'illustre prélat n'eut pas la gloire d'achever son œuvre, il mourut en 1030.
22. — DURAND (1030). Dans l'année même de la mort de Frondon, ce prélat eut pour successeur Durand, comme le constate une charte reproduite par Papon (tome II, preuves, p. 4), et portée dans le nouveau cartulaire de Saint-Victor de Marseille, sous le numéro 76. La voici : « Nous, Aribert, Lenthilde son épouse et leurs enfants, Géraud, Gautier, Pierre et Pons, sur l'invitation des évêques Fronton et Durand, avons fait bâtir, au-dessous du château de Forcalquier, une église en l'honneur des saints Promasse, Maurice et Romain : et voulant arriver sans retard au but qu'on nous a indiqué et que nous désirons atteindre, avons fixé la consécration de cette église au 15 des calendes de décembre. Et de l 'alleu que nous possédons dans le comté de Sisteron, au-dessous du château de Forcalquier, nous donnons à cette Église la moitié d'une vigne et une autre terre, et au milieu les chemins publics qui nous appartiennent : nous donnons cela pour Dieu et pour délivrer nos âmes de tout lien du péché. Fait cette promesse en cette année du Seigneur 1030, indiction 13e. » L'église de Saint-Promasse existe encore, contre l'affirmation de Papon qui assure que ce fut sur son emplacement qu'on éleva, au XIIIe siècle, l'église qui servit de cocathédrale. Elle fut plus tard cédée avec ses dépendances à l'abbaye de Saint-Victor de Marseille qui l'érigea en prieuré. Vendue, lors de la Révolution, elle a passé entre les mains de la famille Arnaud, et, de nos jours, il n'en subsiste plus que l'église proprement dite et un corps-de-logis qui y est attenant perpendiculairement. On aura observé que dans la charte ci-dessus, il est fait mention de deux évêques, de Frondon qui venait de mourir et de Durand son successeur. Les deux prélats avaient tous deux engagé les donataires à accomplir leur œuvre pie. Comment a-t-on pu voir là une raison de soutenir que Frondon fut en 1030 transféré à Aix? Après la période d'obscurités, nous allons entrer dans une autre pleine de désordres d'autant plus regrettables, qu'ils proviendront des déchirements de notre Eglise elle-même.
23. — PIERRE Ier (1030-1045). Nous avons dit, dans la notice préliminaire sur Sisteron, que Pierre Ier, évêque de Sisteron , était de la famille vicomtale de cette ville, comme issu du second mariage d'Odile, qu'on croit fille de Guillaume Ier, comte de Provence, avec Ligier. Ce fut en 1030 qu'il obtint l'évêché de Sisteron, mais un compétiteur qui s'éleva presque en même temps et qui lui survécut, l'empêcha constamment d'en être paisible possesseur. Ce compétiteur était Géraud, homme décrié pour sa conduite, et qui était , dit-on, marié, ainsi que l'assure le Livre vert. Ce qui est certain , et ce que nous apprend Bertrand, un de ses successeurs, c'est que de son temps tout le clergé de Sisteron, à l'exemple de celui qui se donnait pour son premier pasteur, avait oublié la loi du célibat. Géraud était appuyé dans ses prétentions par Bérenger, alors vicomte de Sisteron, et paraît n'avoir été reconnu qu'à Forcalquier, où, sans doute, ainsi que Bérenger, il faisait sa résidence. En 1030, la première année de son épiscopat, indiction XIIIe, Pierre, d'après le cartulaire de Saint-Victor de Marseille, donna à Izarn, abbé de ce monastère, le hameau d'Orbazac, situé dans le comté de Nice. Raimbaud et Rostaing confirmèrent cette donation, et Pierre, leur frère, y est qualifié évêque de Sisteron. Au même acte, il dit formellement que les biens qu'il cède lui viennent du comte Guillaume et de la comtesse Atalis (lisez Adélaïde, comtesse de Forcalquier, femme de Guillaume Bertrand, premier souverain de ce petit Etat). En 1037, Pierre souscrivit à une charte de Geoffroi et de Bertrand, comtes de Provence, en faveur de l'abbaye de Cluny (d'après le cartulaire de cette même abbaye). Enfin en 1040, le 15 octobre, l'église de Saint-Victor de Marseille, précédemment détruite par les Barbares, ayant été rebâtie, nous voyons Pierre, évêque de Sisteron, assister à sa consécration. Ce fait suffirait seul à établir que les évêques de la province et le Pape lui-même reconnaissaient la légitimité de ses droits. C'étaient là en effet ses juges naturels. A la cérémonie dont nous parlons, le pape Benoît IX officia; on y compta vingt trois évêques dont on a les noms dans la bulle que le pontife consécrateur fit expédier à cette occasion. Cette bulle a échappé en partie aux outrages du temps ; et parmi les figures qui ornent cette vénérable relique, Pierre, évêque de Sisteron, est du petit nombre de prélats dont on aperçoit encore distinctement le portrait et la légende. Géraud fut le seul évêque, absolument le seul de la province, qui ne se présenta point dans une assemblée aussi solennelle. En n'osant ou en ne voulant pas paraître au milieu de tant d'évêques, ayant le chef de l'Eglise à leur tête, Géraud se condamne lui-même par son absence, et la noble confiance de Pierre, son compétiteur, est une preuve que le bon droit était de son côté. Nous n'oublions pas que Columbi veut attribuer à deux évêques du nom de Pierre ce que nous attribuons à un seul ; il lui faudra donc aussi admettre deux Géraud : car il est incontestable qu'en 1031 un Géraud était évêque de Sisteron, comme nous le prouverons tout à l'heure par une charte de Saint-Victor. N'est-ce donc pas assez de deux prélats pour le même siége sans en imaginer d'autres ? L'un, Pierre, dont l'histoire ne dit rien qui ne soit conforme au caractère saint dont il était revêtu, était apparemment reconnu à Sisteron et dans le reste du diocèse , sauf à Forcalquier ; l'autre n'était reconnu qu'à Forcalquier ; l'un était pasteur légitime , l'autre un mercenaire déshonoré par le crime de simonie, comme il apparaîtra bientôt. Le Livre vert de l'évêché dit nettement en propres termes que Raimbaud frère, de Pierre, lui acheta (emit) plus tard, pour son fils Pierre II , ses prétendus droits au trône épiscopal. Il est donc malheureusement vrai que deux évêques à la fois portèrent le titre d'évêques de Sisteron : Pierre Ier et Géraud Ier.
24. — GÉRAUD I (1031-10i5). Columbi avoue lui-même que Géraud fut le compétiteur et non le successeur de Pierre Ier. Le nier serait du reste parfaitement inutile, puisque nous voyons Géraud être témoin en 1031, comme évêque de Sisteron, d'une donation faite aux moines de Saint-Victor de Marseille par Guillaume Bertrand , comte de Provence. Lui-même, en 1035, cède et donne au monastère de Saint-Victor l'église de Saint-Pierre, nommée de Fontelance, et ce de l'avis et volonté du même Guillaume Bertrand et de Bérenger, fils de Bérenger, vicomte de Siste ron, et de l'épouse de ce dernier Accleline (Mabillon, Annales, ad an. 1035, Ne 61). En 1044, Bertrand, comte de Provence, le même certainement que Guillaume Bertrand, rend et donne à Dieu tout-puissant, et à saint Victor, martyr, et à son monastère, l'église de Saint-Promasse avec le bourg et les terres y appartenant : donation faite, Van de l'Incarnation 1044, indiction XII, sous le règne du roi Henri. Ont signé : Ber trand, comte de Provence; Raimbaud, archevêque d'Arles; Pierre, archevêque d'Aix; Etienne, évêque d'Apt; Udalric, évêque de Saint-Paul-Trois-Châteaux ; Géraud, évêque de Sisteron, etc. Dans un autre diplôme du même comte Bertrand et de la même année 1044, diplôme qui ne nous paraît pas différent du précédent , il appert que ce prince, voulant restaurer un lieu situé dans le comté de Sisteron, dans le territoire du château qu'on appelle Forcalquier, lieu consacré en l'honneur de saint Promasse, il le donne au susdit monastère avec l'église, le bourg et les terres de sa possession. De cette autre donation furent témoins Ismidon, archevêque d'Embrun; Pierre , archevêque d'Aix ; Etienne, évêque d'Apt ; Francon, évêque de Carpentras; Pierre, évêque de Vaison; Udalric, évêque de Saint-Paul-Trois-Châteaux ; Géraud, évêque de Sisteron, etc. On ne sait plus rien de Géraud, sinon qu'il mourut vers 1045, à peu près au même temps que son compétiteur. Leur disparition presque simultanée de ce monde ne ramena pas la paix dans le malheureux diocèse; mais avant d'aller plus loin, nous dira-t-on peut-être, de Pierre Ier ou de Géraud Ier, lequel avait les meilleurs droits à se dire évêque de Sisteron? — Columbi , après avoir reconnu que l'évêché fut disputé, fait cette remarque qui a certes sa valeur : Dans toutes les chartes que j'ai pu voir, écrites hors du diocèse de Sisteron, c'est Pierre qui est reconnu; dans celles données à l'intérieur du diocèse, c'est Géraud. Qu'en conclure? — Quoique nous inclinions du côté de Pierre, nous n'osons nous prononcer. — Nous n'avons vu jusqu'à présent aucune prise à l'accusation de simonie lancée contre Géraud; à quoi la rattache-t-on? —Cette accusation, c'est la Gallia christiana qui la formule ; nous verrons dans la notice suivante si elle est fondée.
25. — PIERRE II (1045). La simonie n'était pas un cas rare à cette époque. Dans un concile tenu dans la Lyonnaise, in Lugdunensi Gallia, et probablement à Tours, en 1056, sous la présidence du célèbre Hildebrand, depuis Grégoire VII, quarante-cinq évêques et vingt-trois autres ecclésiastiques se reconnurent simoniaques et renoncèrent à leurs dignités : « pénitence aussi rare, disent Mezerai et Velly, que la faute était commune alors ! » Après la mort de Pierre Ier, Raimbaud, son père, miles valde dives et potens, ainsi que le qualifie le Livre vert, voulut prouver qu'il était l'un et l'autre : riche, en désintéressant à prix d'argent le compétiteur Géraud ; puissant, en faisant valoir par les armes les droits qu'il croyait avoir payés. A la place de son frère, il mit donc son propre fils encore enfant, et le fit proclamer, malgré les protestations des deux chapitres qui crièrent au trafic sacrilége. Nous avons dit que la comtesse Adélaïde l'appuya de son influence. Raimbaud, de plus, acheta des partisans à son fils, comme il avait acheté pour lui le siége épiscopal : à ces partisans il abandonna les biens et revenus de l'évêché, si bien, dit le Livre vert, par une expression pittoresque, qu'il n'y resta pas même une poule. Miron, frère utérin de Raimbaud par leur mère Odile, et pour lors vicomte de Sisteron, apporta encore le poids de son autorité sur le plateau de la balance où était son neveu. La résistance des chapitres ne céda pas cependant ; il fallut employer la force : le chevalier; et, dit l'historien de Sisteron, Bureau, le père, aidé de ses soldats, et soutenu par Adélaïde, comtesse de Forcalquier, envahit tous les domaines de l'évêché et les réduisit en un tel état de ruine, que l'évêque ne pût s'y reposer même une seule nuit. Ce ne fut là, dit l'abbé Feraud, que le commencement d'une longue et douloureuse série de violences, de persécutions et de rapines ; la comtesse Adélaïde en profita pour s'approprier la terre de Lurs. Ce triste état de choses durait encore en 1060. Bertrand, évêque de Sisteron, en 1102, racontant ces tristes événements, dit que le jeune fils de Raimbaud renonça à l'évêché et fut plus tard fait évêque de Vaison, tandis que l'Église de Sisteron restait dix-sept ans sans pasteur : enfin, ajoute-il, il y fut nommé le seigneur Géraud. En résumé, Pierre II, sans être coupable, vu son âge, fut un intrus et un simoniaque.
26. — GÉRAUD II CHEVRIER (1060-1074). Géraud Chevrier (Caprerius), était né à Oulx, bourg autrefois du Dauphiné , aujourd'hui dans le diocèse de Pignerol en Pié mont , et où se trouvait une communauté importante de cha noines réguliers sous le titre de Saint-Laurent , martyr, d'où sont issues plusieurs communautés du même institut. Honoré Bouche qualifie en divers endroits Géraud du titre de saint ou de bienheureux, nous ne savons sur quel fondement. Le pape Nicolas II , voulant mettre un terme aux calamités de l'Eglise de Sisteron , chargea son légat , Hugues , abbé de Cluny, de réunir un concile à Avignon ; le plus grand nombre des évêques de la province s'y rendirent, et le prévôt d'Oulx, Géraud Chevrier y fut élu évêque de Sisteron , et contraint d'accepter cette charge que son humilité plutôt que la crainte des difficultés lui faisait refuser. Le concile l'envoya aussitôt à Rome où le Pape le sacra de ses mains, pour le plus grand bien de l'Eglise de Sisteron, alors penchant vers sa ruine. Les actes de ce concile d'Avignon n'ont pas été insérés dans les grandes collections. Bouche dit qu'ils étaient autrefois dans les archives de Forcalquier d'où ils disparurent ; mais qu'il en a vu lui-même un extrait dans la chartreuse de Bompas, entre les mains du R. P. de la Rivière, qui devait l'insérer dans son Histoire de la Ville d'Avignon, histoire qui n'a pas paru. « Je ne me rendis pas ni curieux ni importun , à un temps où je ne pensais à rien moins qu'à ce que je fais maintenant, pour en avoir un extrait ou un sommaire de ce qu'il contenait. » Le même auteur prouve très bien que la date de ce concile est à peu près 1060 ou 1061, époque où mourut Nicolas II, par ordre de qui il fut assemblé. De plus, de l'an 1044, année où l'Eglise de Sisteron commença à être sans pasteur, jusqu'à l'année 1061, il y a place pour les 17 ans de ravages et de calamités dont parle Bertrand Ier. Ce point éclairci, revenons à notre Géraud. Le Pape le congédia avec une bulle adressée au clergé et aux habitants de Sisteron. Nous la donnons ici d'après le texte de Bouche, y compris les parenthèses dont il l'a entremêlée. « Nicolas, serviteur des serviteurs de Dieu, au clergé de tout ordre, et aux simples fidèles habitant la ville de Sisteron, salut et bénédiction apostolique s'ils obéissent (ce mot si obedierint nous fait voir la mauvaise estime que ce pontife avait de l'état de la ville). Etant de notre devoir de prendre soin de l'Eglise universelle , il nous faut appliquer à être utile à tous et partout. Donc, pour votre salut, nous vous avons ordonné évêque notre frère et coévêque, Géraud , élu par des hommes religieux de votre pays de France , c'est-à-dire par le vénérable frère Hugues, abbé de Cluny et notre légat, par l'archevêque d'Arles, par l'évêque d'Avignon, par les évêques de Cavaillon, d'Apt, de Vaison, de Digne et de Die, tous témoins dont la vie ne nous est pas suspecte. Nous lui avons prescrit impérativement de ne jamais admettre aux ordres celui qui avait épousé une femme non vierge , les illettrés , ceux qui ont quelque vice du corps, qui ont fait pénitence publique, ceux qui sont soumis à la curse (ou curise, c'est-à-dire ceux à qui il compète le soin des autres personnes nécessaires, comme la nourriture de leur père et mère ; ou bien ceux qui sont soumis aux obligations des cours et juridictions pour raison de quel ques crimes ou dettes). S'il sait quelqu'un dans ces cas, qu'il se garde bien de l'ordonner. Quant aux Africains prétendant çà et là aux ordres ecclésiastiques , qu'il ne les admette sous aucun prétexte ; parce qu'il est prouvé qu'un grand nombre d'entre eux sont ou Manichéens ou rebaptisés. Sur les ministères et l'ornement de l'Eglise et tout ce qui en constitue le patrimoine, qu'il s'applique à l'accroître et non à le diminuer. Quant aux revenus de l'Eglise et aux offrandes des fidèles, qu'il en fasse quatre parts dont il retiendra la première ; qu'il distribue la seconde aux clercs suivant leur assiduité et zèle aux offices ; la troisième sera pour les pauvres et les étrangers voyageurs; la quatrième enfin pour la fabrique de l'église. De tout, qu'il le sache bien, il rendra compte au jugement de Dieu. Les ordinations à la prêtrise ou au diaconat n'auront lieu qu'au 4% au 7e ou au 10e mois de l'année, ou encore à l'entrée du carême, et le samedi soir de la mi-carême. Qu'il se souvienne de ne point administrer le baptême hors les fêtes de Pâques et de la Pentecôte, excepté à ceux qui, en danger de mort, ont besoin de ce divin remède pour ne pas périr éternellement. Il vous faudra être dévotement soumis à ce pasteur obéissant lui-même aux ordres de notre Siége apostolique, afin que le corps de l'Eglise soit en paix et irrépréhensible par Notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec Dieu le Père tout-puissant et le Saint-Esprit dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. » Nous nous trompons fort, si les préceptes contenus dans cette bulle ne furent pas pour beaucoup dans la réception qui fut faite à Géraud Chevrier; il est vrai aussi que le chapitre devait être peu disposé à trouver bonne une élection qu'il n'avait pas faite. Quoi qu'il en soit, les portes de Sisteron lui furent fermées, et il dut se rendre à Forcalquier où un accueil honorable l'attendait. Là, ainsi qu'il en témoigne lui-même, il trouva les fils de son obéissance assemblés, et il se donna lui-même et son corps à Dieu, à sainte Marie du Marché, au saint confesseur Mary et à saint Thyrse martyr. Installé dans la seconde ville du diocèse, l'évêque se mit en devoir de remplir sa mission pastorale , et guidé sans doute en partie par la reconnaissance, il désunit le corps capitulaire de Forcalquier de celui de Sisteron, voulant qu'il en fût tout à fait distinct, qu'il jouit des mêmes prérogatives, en partageât les dignités sous son prévôt particulier. Cet état de choses, presque unique dans l'Eglise de France, ne tarda guère à devenir une source de longues et tristes dissensions. Bertrand II, successeur de Géraud en 1170, dit encore plus formellement : « J'approuve tout ce qu'a fait Géraud, et j'ajoute que l'évêque de Sisteron ne pourra, sans l'aveu et le consentement de l'Eglise de Forcalquier, faire aucune aliénation pour laquelle l'aveu des chanoines de Sisteron lui serait nécessaire ; car l'une et l'autre Eglise a été tenue pour cathédrale et pour siége épiscopal par nos prédécesseurs, et toutes deux avaient ce droit quand elles n'en formaient qu'une. » Vers l'an 1070, la contestation entre Géraud et la famille de Pierre II se termina enfin. Raimbaud et Miron étaient morts. Les frères de Pierre, Pons et Rostang, comprirent, sur les représentations de Géraud, le mal qu'ils avaient causé en ruinant la maison épiscopale de Sisteron et la basilique de Sainte Marie, en s'emparant des revenus du diocèse et en empêchant le pasteur légitime de donner ses soins également à tout son troupeau. Ils vinrent à résipiscence et firent une réparation éclatante de leurs torts en consentant pour eux et leurs succes seurs à reconnaître désormais l'évêque pour leur suzerain et à tenir de lui en fief leur seigneurie et leur château (castrum quod habemus in Sextirone). « C'est la première fois, dit ici M. de la Plane, qu'il est fait mention du château de Sisteron. Cet hommage des vicomtes ne rendit pas nos évêques plus grands seigneurs. On n'en trouve, du reste, plus de traces dans les siècles suivants, et il y a apparence qu'il ne fut pas renouvelé. La comtesse de Forcalquier, Adélaïde, fut un peu plus tardive à reconnaître ses torts et à donner des marques réelles de son repentir. La restitution du bien mal acquis fut, de tout temps, ce qui coûta le plus au pécheur converti. Adélaïde ne se détermina que le plus tard qu'elle put à rendre la moitié de la terre de Lurs dont elle s'était emparée. Ce ne fut qu'en 1110, après l'avoir gardée plus de cinquante ans, et lorsqu'elle se vit au bout de sa car rière. » Nous avons déjà rapporté que le jeune Pierre avait été fait évêque de Vaison, vers 1054; ceci nous fait faire cette réflexion que nous n'avons vue nulle part : l'évêque de Vaison assistait, en 1060, au concile d'Avignon, qui élut Géraud Chevrier et lui donna sa voix ou dut subir la loi de la majorité ; sa famille ne continua donc à faire de l'opposition au nouveau prélat que par méchanceté, à moins, et nous le croirions facilement, que l'opposition ne provint depuis ce temps, que de la part du chapitre de Sisteron. Dans ce dernier cas, une induction toute naturelle se présente : les chanoines avaient peur d'un prélat qui les ramenât aux bonnes mœurs et à la discipline ; les invectives de Bertrand II seraient alors justifiées : Erant omnes uxorati (Livre vert). L'historien de Sisteron, Bureau, se plaint en maints endroits que Géraud II fit autant de bien qu'il le put à l'Eglise de Forcalquier, et autant de mal que possible à celle de Sisteron, en opprimant cette dernière. Le motif principal de ces récri minations est sans doute l'élévation de Forcalquier à la cocathédralité , en souvenir de l'accueil qu'il en avait reçu, tandis que sa ville épiscopale l'exilait. Bertrand II nous fournit des détails, entre autres celui-ci : Géraud donna au chapitre de Forcalquier l'église de Saint-Martin de Manosque avec toutes les autres églises qui étaient dans cette vallée. Comme cet évêque sortait d'un institut de chanoines réguliers dont il avait même été le supérieur, on a voulu en conclure qu'il en établit la règle dans son chapitre de Sisteron ou de Forcalquier; mais cette conclusion manque absolument de preuves. Tout ce que l'on sait à ce sujet, c'est que l'église de Saint-Laurent de plebe martyrum ayant été renversée par les Sarrasins, il la fit res taurer, y fonda une célèbre prévôté de chanoines réguliers qu'il gouverna lui-même jusqu'à son élévation à l'épiscopat, et où il eut pour successeur Nantelme, à qui Cunibert, évêque de Turin , confirma, en 1065, les donations faites par le comte de Savoie. Géraud vivait encore en 1074, au temps du célèbre pape Grégoire VII. Ce pontife lui écrivit en cette année une lettre où il le réprimande vivement d'avoir usurpé l'église de Cruis qui appartenait à la Chaire de Saint-Pierre. Pour cela il le compare à Ananie et à Saphire et le menace de l'excommunication, s'il ne donne pas satisfaction. Il est à penser que l'évêque réprimandé se soumit, le grand Hildebrand ne rencontra guère de résistance sans la briser, même quand elle lui venait des empereurs d'Allemagne. L'année où Géraud mourut est fort incertaine ; quant au lieu de sa sépulture , il est permis de la placer à Forcalquier dans l'église de Saint-Thyrse, d'après ces paroles de Bertrand II que nous avons citées ci-dessus : Il donna soi-même et son corps... à saint Mary, confesseur, et à saint Thyrse , martyr. Les auteurs qui ont dressé des catalogues des évêques de Sisteron ne s'accordent pas sur les successeurs de Géraud. Bertrand II place immédiatement après lui Charles, puis Ber trand I, Géraud III , Raimbaud et Pierre de Sabran ; Bureau met après Charles un Pierre ou Pétrone, ancien évêque, Frodon, Bertrand, Raimbaud et Pierre de Sabran. Il n'y a pas à hésiter : c'est la série de Bertrand II qu'il faut suivre, parce qu'il était tout à fait voisin du temps où ces évêques vécurent.
27. — CHARLES (1080?). Charles succéda à Géraud Chevrier, de l'avis de tous les annalistes de l'Eglise de Sisteron. Il se trouve mentionné dans une charte de Bertrand, évêque de Sisteron en 1173, et dont nous donnons ici la traduction : « Charte de Bertrand , évêque de Sisteron , en faveur de l'Eglise de Forcalquier, dans laquelle il certifie que Pierre de Sabran , son prédécesseur, de bonne mémoire , siégea 26 ans et deux mois. Attendu que tout d'abord Sisteron et Forcalquier furent une seule et même Église, attendu que Géraud Chevrier partagea les dignités entre les deux Églises , attendu qu'avant lui , un certain Raimbaud acheta l'évêché pour son jeune enfant qui fut plus tard évêque de Vaison; attendu qu'ensuite l'Eglise de Sisteron demeura 17 années sans évêque, attendu que Monseigneur Géraud fut ensuite élu dans le concile d'Avignon, consacré par le pape Nicolas, et qu'il eut pour successeurs Charles, Bertrand , Géraud , Raimbaud et Pierre, par ces motifs, Bertrand , évêque, accorda divers priviléges à ladite Eglise de Forcalquier, etc. Fait le 3 avril 1170 , sous le pontificat d'Alexandre, et l'an premier déjà accompli de l'épiscopat de Bertrand. » On n'en sait pas davantage sur son compte.
28. — BERTRAND I (1102-1105). Cet évêque, en 1102, fit une donation à l'église et aux chanoines de Saint-Mary de Forcalquier : cette donation, faite en présence et de l'avis d'Adélaïde, comtesse de Provence, fut confirmée par Pierre, archevêque d'Aix. Il siégeait encore en 1105, puisqu'il fit en cette année plusieurs concessions aux chanoines de Forcalquier ; mais nous ignorons ses autres actes et la date de sa mort. Nous supprimons ici un évêque du nom de Nitard, que n'a pas catalogué Bertrand II qui ne pouvait s'y tromper : c'est Bureau qui a voulu l'introduire par ineptie. Si le mot que nous soulignons paraît trop fort au lecteur, nous le prierons de s'en prendre aux auteurs de la Gallia christiana qui ont toujours passé pour des critiques très courtois.
29. — GÉRAUD III (1110-1126). Ainsi que nous l'avons dit, en 1110, la comtesse Adélaïde restitua au siége épiscopal de Sisteron le château de Lurs ; or, c'était Géraud III qui occupait alors ce siége. L'acte de cette restitution est intégralement rapporté par Columbi, et en extrait par les frères de Sainte-Marthe. Géraud vivait encore en 1124, et assista au concile de Vienne qui se tint cette année. Jaloux de procurer dans son diocèse un établissement aux religieux hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, il leur donna l'église de Saint-Pierre dans la vallée de Manosque. Le titre de cette donation a été perdu, peut-être aussi fut-elle seulement verbale ; mais Pierre de Sabran , l'un des successeurs de Géraud, la confirma en 1155. Nous ne pouvons fixer d'une façon précise la date de la mort de ce prélat. Nous pensons toutefois que ce dut être en 1126. Dans une charte de 1112, citée par Columbi qui l'avait lue en entier, il est question d'un nommé Pierre Martin , lequel est donné en gage, pour la somme de cent vingt sous, à Géraud, évêque de Sisteron, par Ripert, du lieu de Revest, près de Forcalquier. Ce Pierre Martin était un serf. Géraud assista, en 1110, Pierre, son métropolitain, dans la cérémonie de la consécration de l'autel de l'église de NotreDame de la Résurrection, auprès de l'église de Saint-Sauveur, à Aix.
30. — RAIMBAUD (1126-1143). C'est la congrégation de Cluny, de l'ordre de Saint-Benoît, qui donna cet évêque au diocèse de Sisteron. Il était prieur de Saint-André de Ganagobie, alors au diocèse de Gap, lorsque l'élection l'appela à l'épiscopat, en 1126, suivant divers historiens. L'histoire ne nous a transmis que ce fait : il acheta, pour 500 sous, tous les droits que Tiburge, comtesse d'Orange, avait sur Lurs, ainsi que le domaine rural de Pierrerue. Notons que Tiburge ne possédait pas seulement le comté d'Orange; son testament, fait en 1150, prouve qu'elle avait en outre d'immenses propriétés dans les évêchés d'Apt, de Sisteron, de Vence et de Nice- Il est établi dans la notice suivante que Raimbaud siégea jusqu'en 1143.
31. — PIERRE III DE SABRAN (1163-1169). Pierre était de la noble maison de Sabran ; mais sa vertu le rendit plus illustre encore que sa naissance. Il succéda à Raimbaud (1143), car Bertrand II son successeur immédiat, qui, par conséquent, ne peut se tromper, nous apprend que Pierre de Sabran avait siégé avant lui pendant 26 ans et 2 mois. Or, Bertrand fut fait évêque de Sisteron en 1169. La charte où nous prenons ce renseignement est datée du 3 avril 1170, avant la fin de la première année de l'épiscopat de Bertrand. Nous l'avons rapportée ci-dessus dans la notice de l'évêque Charles. En 1149, il signa et confirma de son autorité la charte datée du 30 mai de cette année, par laquelle Guigues, comte de Forcalquier, voulant acquérir les biens éternels par les biens temporels, les richesses durables par les richesses périssables, donna, à perpétuité, à Dieu, à l'hôpital de Saint Jean de Jérusalem et aux pauvres, Manosque, c'est-à-dire le Bourg , le Château et Toutes-Aures , avec tout son territoire et ses dépendances, savoir, tout le pays compris entre les territoires de Sainte-Tulle, de Pierrevert, de Mont-Furon, de Saint Martin , de Dauphin, de Volx et la rivière de la Durance. Un titre tiré de l'abbaye de Boscaudon en date de 1168, nous montre une seconde fois notre prélat Pierre réuni à Hugues, archevêque d'Aix, et à Pierre, évêque d'Apt, pour confirmer une charte par laquelle Bertrand III , comte de Forcalquier, qui, pendant plusieurs années avait contesté aux hospitaliers la donation de son frère Guigues, leur donne à son tour tout ce qu'il a et peut posséder dans le château de Manosque et à Toutes-Aures. En 1150, Pierre échangea avec les Templiers l'église de Notre-Dame de Volonne contre le château de la Brillanne. En 1152, il reçut du pape Eugène III, des lettres de protection que lui confirma, en 1157, le pape Adrien. En 1164, il avait donné à Pierre, abbé de Montmajour, l'église de Gajan; mais l'abbé lui céda en compensation les églises de Semproniac. En 1166, il approuva la donation faite à Guigues de Revel, abbé de Boscaudon, de la terre de Lurs, au pied du mont Lauthière, où Foulque des Orgues, Guillaume de Montlaur et quelques autres seigneurs du voisinage avaient relevé les ruines de l'ancienne abbaye construite sur le tombeau de saint Donat. Pierre de Sabran fit par dévotion le voyage de la Terre sainte et enrichit son église des reliques qu'il en apporta. Sa mort arriva en 1169. Ses armoiries étaient : de gueules, au lion d'argent.
32. — BERTRAND II (1169-1178). Cet évêque est déjà suffisamment connu par ce que nous avons été obligé d'en dire précédemment : c'est lui , en effet , qui nous a laissé la relation la plus complète des troubles qui agitèrent l'Eglise de Sisteron pendant tout le XIe siècle , c'est-à-dire depuis la mort de l'évêque Durand jusqu'à Bertrand I. Cette pièce, que l'on trouve dans Bouche et dans le Livre vert de l'évêché, est écrite d'un style véhément et indigné, qui part d'une âme chrétienne, offensée de ces longs et pitoyables scandales : les laïques Raimbaud , Miron et ses enfants, y sont traités d'impies, dont le nom est effacé du livre de vie; le clergé de Sisteron est flagellé pour la corruption de ses mœurs. En faisant même la part grande à l'exagération, le tableau n'en reste pas moins affligeant. Elevé à Durbon , abbaye de Chartreux nouvellement fondée, et par conséquent encore dans la ferveur primitive, Bertrand a le zèle un peu amer contre les désordres incroyables d'un siècle corrompu; mais nous pensons qu'il n'a pas dépassé les bornes que recommande le Psalmiste : Irascimini et nolite peccare : le Maître n'a-t-il pas lui-même chassé à coups de fouet les vendeurs de l'enceinte du temple? Et il y avait du courage dans cette relation. A l'époque où Bertrand l'écrivait, le petit-fils de la comtesse de Forcalquier était son souverain temporel, et la comtesse n'est pas plus ménagée que les autres publicains dont la rapacité impie dépouillait l'Eglise. Bertrand était donc prieur à la chartreuse de Durbon (actuellement au diocèse de Gap), lorsqu'il fut appelé, sans l'a voir brigué, sans doute, à l'évêché de Sisteron. Ce fut en 1169, car, le 3 avril 1170, en donnant aux chanoines de Forcalquier la charte dont il a été parlé, il dit lui-même que la première année de son épiscopat est accomplie. Devenu un des grands de l'Eglise, il n'oublia pas son couvent de Durbon, et il voulut être présent à une donation faite, en 1172 , au prieur son successeur. L'année suivante, d'après le cartulaire de Boscaudon, il fut juge-arbitre de la contestation soulevée entre la chartreuse de Durbon et les Templiers. Sa vie ne se prolongea guère au delà. Les archives de l'évêché nous le représentent comme un prélat d'une piété exemplaire. Nous avons dit précédemment comment il avait voulu que le chapitre de Forcalquier intervint de droit dans toute aliénation ou distraction de biens pour laquelle serait nécessaire le consentement du corps capitulaire de Sisteron. Voici la raison qu'il donne de ce règlement : Cum, dit-il, utraque Ecclesia sitcathedralis, et pro sede episcopi habita ab antecessoribus nostris, nam et hoc insimul habebant commune quando una erant Ecclesia.
33. — BERMOND D'ANDUZE (1174-1183). D'une grande beauté de corps et d'une illustre naissance, dit l'ancienne Gallia christiana, Bermond, chanoine de Maguelone, est qualifié évêque élu de Sisteron le 2 novembre 1174, dans la charte donnée à Manosque, en présence de Hugues, abbé de Lure, et de Chabert, prieur de Durbon : acte par lequel Guillaume, comte de Forcalquier, donne aux frères de Durbon certains droits sur toute sa terre. Ce titre est inséré dans le Cartulaire de Boscaudon. La même année, il garde encore le titre d'évêque élu dans une transaction avec les chevaliers du Temple. En 1179, nous le voyons au concile de Latran. En 1180, il est mentionné dans les archives de Saint-Victor, et, trois ans après, il consent à l'union de l'abbaye de Lure avec celle de Boscaudon. Si nous en croyons l'historien Bureau, notre prélat aurait cédé, en 1207, l'église d'Ybourgues (1) à l'église, au prévôt et aux chanoines de Saint-Martin de Cruis ; mais il y a des pièces authentiques établissant qu'en 1207 Pons occupait le siége de Sisteron. Bermond d'Anduze portait pour armoiries : de gueules, à trois étoiles d'or.
(1) Hameau dépendant aujourd'hui de la commune de Limans, à neuf kilomètres N. 0. de Forcalquier.
34. — PONS DE SABRAN (1203). La date que nous venons d'écrire n'est pas positivement certaine, mais elle se rapproche certainement beaucoup de la vérité, comme nous allons le prouver. Humbert ou Ymbert, évêque de Sisteron, que nous trouverons bientôt, scella en 1245 la transcription des lettres patentes de Guillaume, comte de Forcalquier, promulguant, le 7 juin 1206, des statuts pour le comté de Forcalquier. Humbert, en les scellant, certifie qu'elles sont entières et sans corruption. Or, elles portent formellement qu'elles ont été écrites en présence de Guillaume de Bénévent, archevêque d'Embrun; de Pierre de Saint-Paul, évêque d'Apt, et de Pons de Sabran, évêque de Sisteron. Ce dernier était donc évêque de Sisteron avant l'année où furent promulgués les statuts du comté. Certains auteurs veulent qu'un Bernard ait succédé à Bermond d'Anduze, et ils apportent, à l'appui de leur sentiment, la charte d'union de Lurs avec Boscaudon , où ils lisent Bernardum au lieu de Bermundum : ce n'est qu'un lapsus de copiste : l'original porte clairement Bermond. Poris de Sabran , dont nous ne pouvons préciser le décès , portait pour armoiries : de gueules, au lion d'argent. 35. — V (1212). Ce prélat n'est point mentionné par la Gallia christiana, ni par aucun des auteurs qui ont écrit sur les évêques de Siste ron, à l'exception du dernier historien de cette ville, M. de la Plane. Quel était son nom, nous ne pouvons le dire, tout en présumant qu'il pouvait bien s'appeler Véran. Ce qui est cer tain, c'est qu'il figure avec son initiale comme témoin, en 1212, dans la charte de confirmation des priviléges de la ville de Sisteron. Nous ne pouvons donc le passer sous silence.
36. — RODOLPHE ou RAOUL (1216-1241). Il avait été élevé dans l'abbaye de Notre-Dame de Florey ou du Toronet, de l'ordre de Citeaux, dans le diocèse de Fréjus, et ses mérites lui avaient valu d'en devenir abbé en 1209. Le Livre vert de l'évêché de Sisteron s'exprime ainsi sur son compte : « Le seigneur Rodolphe, évêque, a gouverné l'Eglise de Sisteron vingt-cinq ans et trois mois. Il appartenait à l'ordre de Citeaux et fut abbé de Florey, vulgairement le Toronet. Sa sépulture est dans l'église de Sisteron. Il augmenta les revenus épiscopaux dans le lieu de Lurs et acheta pour 16,000 sols, de Raimond Bérenger, très illustre et très pieux comte de Provence et de Forcalquier, les bourgs du Revest et d'Auzet (acte passé dans une chambre du palais comtal donnant sur le marché au poisson). Ledit évêque Raoul, d'une grande sainteté, ferma les yeux pour toujours l'an du Seigneur 1241, et fut inhumé dans l'église de Sisteron, sous l'autel placé dans l'escalier de pierre à l'entrée du chœur. De son vivant et après sa mort, de grands et nombreux miracles eurent lieu par son intercession auprès du Dieu tout puissant : des morts furent ressuscités, des infortunés affligés du mal-caduc furent guéris , des aveugles rendus à la lumière, des boiteux et des impotents redressés. » Nous pouvons appuyer de témoignages positifs les dates qui précèdent. On voit que Raoul siégea depuis 1216. En effet, Ruffi, qui a laborieusement compulsé le cartulaire de SaintVictor, y a trouvé la mention d'un R., évêque de Sisteron sous cette année. La même année et le 20 septembre, nous le trouvons juge-arbitre en tiers avec Bermond, archevêque d'Aix, et Bertrand, évêque de Cavaillon, pour terminer le différend du prieur de Saint-Marian et des Hospitaliers, au sujet des droits sur Manosque. En 1220, il est présent à la confirmation faite par Garsinde, comtesse de Provence, de tous les dons que le couvent de Ganagobie avait reçus de son grand-père et de son père Guillaume. En 1221, il tranche par arbitrage et de concert avec Bermond , archevêque d'Aix, une contestation qui divisait Gaucher, évêque d'Apt, d'une part, et Rostaing d'Agoult et Bertrand de Simiane, d'autre part. En 1227, il pactisa avec G. et R. de Raillane, seigneurs de la Salle, au sujet d'une meunerie qu'ils avaient bâtie sur la Durance près de Lurs. En 1229, Raimond Bérenger, comte de Provence, qui résidait fort souvent à Sisteron, lui abandonna les droits d'albergue du Revest et de Fontienne, et, en 1234, il renonça, moyennant la somme de 12,000 sous que lui paya Raoul, à la seigneurie entière du Revest. Ce dernier acte est passé in camera Guillelmi de Ravennœ, et parmi les témoins figure un Pierre de la Motte, juge royal à Sisteron. C'est la première fois qu'il est fait mention de ce magistrat. L'année suivante, par acte passé dans une chambre de son palais, donnant sur le marché au poisson, Raimond Bérenger céda à notre évêque les bourgs de Revest et d'Auzet. Enfin, le 10 février 1239, Raoul termina la longue contestation qui régnait entre lui, d'une part, et de l'autre R. de Villemus et ses deux frères. La même année, R , prévôt de Forcalquier, élu juge-arbitre, adjugea à notre prélat la terre de Mauzerangue. Nos lecteurs voudront bien nous pardonner d'avoir mentionné deux fois les mêmes faits : il nous a paru nécessaire de ne pas accepter de confiance les affirmations du Livre vert de Sisteron, qui, ainsi que le dit un historien moderne de cette ville, n'est guère fort sur la critique.
37.— HENRI DE BARTHOLOMÉIS DE SUZE (1241-1250). Henri de Bartholoméis de Suze naquit vers 1200, à Suze, en Piémont, et, suivant quelques auteurs, appartenait à la famille de Suze, en Dauphiné. Après avoir fait ses études à Bologne, il professa le droit canon à Paris, et en 1238, il accompagna en Angleterre Eudes Leblanc, cardinal de Montferrat. Il y fut bien accueilli du roi Henri III , qui le députa à Rome pour demander la déposition de l'évêque de Winchester. Comme cette négociation n'eut aucun succès, Henri se démit du prieuré de l'hôpital de Sainte-Croix, dont le roi l'avait pourvu, et retourna en France. Il devint alors prévôt de Grasse, archidiacre d'Embrun et enfin, en 1241, évêque de Sisteron, où il obtint, pour lui seulement, par acte du 10 septembre 1246, le droit de suffrage dans les assemblées capitulaires. L'année suivante, Pierre, abbé de l'Ile-Barbe, ayant prouvé par des documents irréfutables que le monastère de SaintMary était situé dans le diocèse de Sisteron et non dans celui de Digne, Henri de Suze voulut que cette décision fut sanctionnée par des lettres de Hugues de Saint-Cher, cardinal de Sainte-Sabine, et ces mêmes lettres furent, en 1247, confirmées par le pape Innocent IV. Cette même année, il se trouva présent à la fondation d'un couvent de Dominicains, faite à la Baume-les-Sisteron, par Béatrix de Savoie, comtesse de Provence. Le 2 décembre 1249, il était à Lyon lorsque les chanoines de Sisteron et ceux de Forcalquier se disputant le droit d'élire l'évêque, s'en rapportèrent à sa décision. Henri prononça en faveur du chapitre de Forcalquier. Peu après, il fut transféré à l'archevêché d'Embrun. Depuis son élévation à l'épiscopat, Henri de Suze avait été chargé, soit par le Saint-Siége, soit par l'empereur, de diverses missions diplomatiques dont il s'était acquitté avec distinction. Envoyé comme légat en Lombardie et en Piémont, il réussit, par son éloquence persuasive, à obtenir de nombreux secours pour le Pape. Aussi Innocent IV, en reconnaissance des services qu'il lui avait rendus, renouvela en 1250, en sa faveur, le privilége et la dépendance immédiate que l'Eglise d'Embrun avait du Saint-Siége. Le Pape veut et entend que tout ce qui sera établi canoniquement par lui ou par ses suc cesseurs , avec le consentement commun de son chapitre ou de la plus saine partie de l'assemblée de son diocèse, demeure ferme et immuable. Il déclare que ceux que l'archevêque aura excommuniés ou interdits ne pourront être reçus par aucun autre, aux offices ou à la communion ecclésiastique, sans son consentement, que nul ne pourra s'opposer à un jugement qu'il aura prononcé en la forme canonique, que nul archevêque ou évêque ne pourra tenir aucune assemblée dans son diocèse sans son approbation, ni entreprendre d'y exercer aucun acte de juridiction et y traiter d'affaires ecclésiastiques, à moins qu'il en eût l'ordre du souverain Pontife ou de ses légats. Le Pape termine sa bulle en prononçant une rigoureuse excommunication contre ceux qui feraient quelque insulte à l'Eglise d'Embrun, ou violeraient ses priviléges. De son côté, l'empereur Guillaume de Hollande décerne dans ses lettres les éloges les plus pompeux à Henri de Suze. Il le félicite de la manière dont il s'est acquitté de la mission qui lui avait été confiée, il loue sa prudence, sa fidélité, et daigne l'appeler son prince bien-aimé, dilectus princeps noster. Nous avons cru, dit l'empereur, qu'il conviendrait à Notre Majesté de nous attacher efficacement et avec ardeur à l'élévation des Eglises de Dieu, et à augmenter et étendre leurs libertés. Et comme en cette occasion, il n'y a point de meilleure mesure que celle de faire agir la libéralité de la bonté royale avec toute sorte de prodigalité et d'affluence, nous avons jugé à propos de faire savoir à tous présents et à venir, en général et en particulier, comme notre bien-aimé prince Henri, vénérable archevêque de la sainte Eglise d'Embrun, ayant, par ordre de notre Très-Saint-Père le Pape, In nocent IV, abandonné son Église d'Embrun et toutes les autres affaires, fit un voyage pour le service de l'Église, notre sainte Mère, et pour celui de notre Empire, il y a quelque temps, et qu'il y travailla avec une extrême prudence et une grande fidélité, ce qui nous oblige de lui donner, accorder et confirmer la ville d'Embrun avec les châteaux, les villes, les villages, les biens, fiefs, cens, pensions, tributs, droits, domaines, et tous les autres biens corporels et incorporels, avec toutes les appartenances que ce même archevêque ou ses prédécesseurs ont acquis dans les diocèses d'Embrun, de Gap et de Turin, par droit d'institution, de mortuaire, legs, donation, achat échange ou en quelque autre nom, titre ou manière que ce soit, ou entre vifs ou entre morts, et que ce même archevêque ou ses successeurs pourraient acquérir à l'avenir, avec l'aide de Dieu, et dont ils justifieraient par témoins, ou par lettres authentiques ensemble tous les priviléges, franchises et libertés de l'Église d'Embrun que nos prédécesseurs, empereurs, rois ou autres ont donnés aux prédécesseurs du même archevêque , et de celles dont ils ont usé jusqu'à présent , et outre , l'empire pur et mixte avec la juridiction totale » Dans cette même bulle, Guillaume de Hollande ajouté un autre privilége que les prédécesseurs de Henri de Suze ne paraissent pas avoir connu. « Nous accordons encore au même archevêque et à ses successeurs , continue le prince , de pouvoir créer et établir des tabellions publics et authentiques, dont les actes auront une foi aussi pleine et aussi entière dans tout l'empire que les actes signés du sceau de l'archevêque, de ses successeurs , de sa cour, ou du sceau du chapitre , le siége vacant. Défendons à toutes les personnes de la ville d'Embrun, des châteaux et lieux appartenant ou qui pourront appartenir à l'archevêque et à son Église, de se servir d'autres instruments , sous peine de les voir de nul effet et sans valeur. Nous accordons en outre à l'archevêque et à ses successeurs de pouvoir exercer avec toute sorte de liberté et de plénitude , une juridiction volontaire dans tout le royaume d'Arles et de Vienne, par eux ou par autrui. » La bulle se termine par les anathèmes suivants : « Nous mandons en conséquence et ordonnons très strictement à tous en général et en particulier, à peine d'être déchu de nos bonnes grâces , de veiller à l'observation exacte et à l'accomplissement efficace de tout ce qui est contenu dans ces lettres , sans que personne ose venir s'opposer à ce que Notre Sérénité y a si libéralement accordé en tout ou en partie, ni entreprendre, donner aucun trouble et dommage à l'archevêque , à ses successeurs , à son Église, en la possession de leurs biens , héritages et autres choses ci-devant exprimées : que si quel qu'un avait assez de présomption pour le faire, qu'il sache bien qu'il offense Notre Grandeur, et qu'il encourra l'indignation de Notre Majesté, et il sera en outre condamné même pour ce seul attentat , et pour peine de son crime , à cent livres d'or, applicables moitié à notre chambre , et moitié aux offensés , suivant la coutume de l'Empire. » Cette bulle impériale fut donnée à Cologne , et porte la date du 14 décembre 1251. Les terres qui, à cette époque, étaient comprises dans la principauté d'Embrun , se trouvent énumérées par Jacques Gelu , archevêque d'Embrun , en son Traité des Prééminences de l'archevesché d'Embrun. On y lit que cette principauté renfermait le château et le lieu de Sauze , le lieu de Beaufort, le village de Rochebrune, le château et le lieu de Bréziers, le château de Crévoux, avec ses dépendances, le château et le lieu de Châteauroux avec ses dépendances , de Saint-Aubin , de Sainte-Croix et de Sainte-Catherine , le château et le lieu de Saint-Clément avec ses dépendances, le château et le lieu de Saint-Crépin avec ses dépendances , de Combettes , de Chantelouve , de la Roche , de Champcelle et d'Aigliers, le château et le lieu de Guillestre, avec Bramousse, Chalme, la montagne de Gravissons qui sont de sa dépendance , le château et le lieu de Risoul , avec ses dépendances qui sont les Traverses , Chalvet , Ceillac , Vars , les hameaux qui dépendent de ces diverses paroisses ; la montagne où se trouvait le château de Barben , avec la plaine du même nom qui est celle du Plan-de-Phasy, renommée par la défaite des Lombards. L'archevêque d'Embrun avait en outre des droits seigneuriaux dans plusieurs paroisses de la vallée des Monts, aujourd'hui de Barcelonnette , à Barcelonnette, à Jausiers, à Faucon, à Saint-Pons, à Sixfours. Il existait de plus dans le Dauphiné un certain nombre de terres et de paroisses dont la seigneurie appartenait par moitié à l'archevêque et au Dauphin ou à quelque autre seigneur, telles que la ville d'Embrun et son territoire , dont le Dauphin était comte , et qu'il tenait en fief de l'archevêque , Réotier, Chorges , Saint-André , Saint-Sau veur, Montgardin , Espinasses , Rousset , etc. Les seigneurs ou le Dauphin faisaient simplement hommage à l'archevêque comme à leur suzerain , pour les terres qui se trouvaient en clavées dans l'Embrunois, et qui leur appartenaient en propre. C'étaient celles de la Bastie, de Remollon, d'Avançon, de Théus, de Réallon, de Savines, des Orres, de Baratier, des Crottes , de l'Argentière , de Freyssinières , de Vallouise , etc. L'archevêque, enfin, avait encore le droit de nommer des gouverneurs et d'entretenir des garnisons dans un très-grand nombre de châteaux et places fortes, notamment à Guillestre ,à Bréziers , à Beaufort , lieux dont il était comte , à Crévoux ,Vars, Réallon, Châteauroux, Chorges, et plusieurs autres. Les consuls d'Embrun voulurent soumettre les ecclésias tiques de la ville à des redevances auxquelles ils n'étaient point tenus. Henri de Suze avertit ces magistrats, et leur de manda de mettre un terme à leurs vexations.
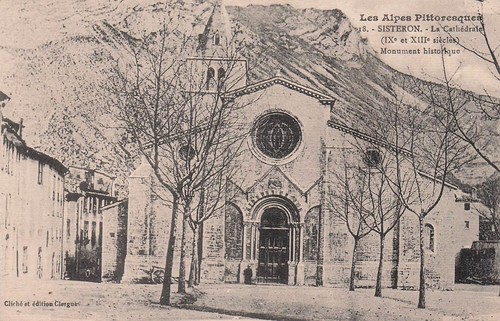
Non-seulement il n'obtint rien, mais au contraire, les esprits s'aigrirent de plus en plus , et les habitants , sous la conduite de Raimond Thioud et de Pierre Ferrière , leurs principaux chefs , prirent les armes, et, le jour de l'Assomption de la Sainte Vierge, tandis que le prélat officiait pontificalement dans sa cathédrale, les habitants d'Embrun s'attroupèrent en grand nombre sur la place située au devant de cet édifice, et ils commirent des irrévérences et des insolences très grandes ; ils poussaient des cris si bruyants sur le seuil de l'église, qu'ils interrompirent le sacrifice de la messe et obligèrent les assistants à sortir, en les forçant alors à se mettre avec eux pour se révolter contre l'archevêque. Henri de Suze qui, au témoignage du docteur Albert, dans son Histoire ecclésiastique du diocèse d'Embrun, tome II, page 137, réunissait dans sa personne toutes les vertus et toutes les belles qualités, avait un esprit pénétrant, une prudence consommée, une fermeté inébranlable, une patience à toute épreuve, une charité dont les effets se manifestaient chaque jour, une piété tendre, un mérite distingué que les gens de bien admiraient, que les méchants craignaient, que les dévots aimaient et que les savants ont loué, comme Bellarmin, Canisius, Browig, etc. Aussi employa-t-il tous les moyens de douceur pour ramener à lui la population égarée. Il lui écrivit de Chorges, où il s'était retiré ; lui donna du temps pour réfléchir, et n'ayant rien pu gagner, il usa des censures ecclésiastiques contre les rebelles et appela le Dauphin pour les soumettre. En voyant sous leurs murs les troupes du Dauphin, disposées à en venir à une attaque, les Embrunais se rendirent presque sans condition. L'archevêque et le Dauphin accordèrent à la ville et aux habitants une amnistie générale de tout le passé ; ils défendirent de faire aucune recherche des discours séditieux et scandaleux qui avaient été prononcés, à l'exception de ce qui avait été proféré dans l'église ou en présence du juge et du bailli, ou en mépris des officiers. Toutefois , les maisons des deux principaux coupables furent rasées, eux-mêmes furent bannis à perpétuité, et il fut réglé que, sous forme d'amende honorable, les chefs de famille seraient tenus à l'avenir d'assister, chaque année, à la grand'messe de l'Assomption , et d'y offrir à l'officiant le tribut d'un denier. Après tout cela, nous ne comprenons pas comment l'historien Chorier a pu écrire que cette violente insurrection était venue de la trop grande autorité que Henri de Suze avait cru pouvoir s'arroger sur ses sujets en vertu des bulles impériales; et qu'il prit pour étouffer cette révolte des mesures qui font peu d'honneur à l'esprit de douceur et de modération de notre cardinal. Il est vrai que cet historien manque bien souvent d'exactitude, et ses appréciations sont entachées d'injustice et de partialité. Henri de Suze reçut le serment de fidélité de Hugues le Dau phin, en 1254; plus tard une vive lutte s'engagea entre eux deux à ce sujet, et parce qu'il avait soulevé les habitants d'Embrun contre lui, l'archevêque, en 1259, lui demanda la réparation des dommages qu'il lui avait causés , et il obtint d'Alexandre IV une bulle qui le confirmait dans tous ses droits. Il demanda aussi à Urbain IV, en 1262 , un bref contre le Dauphin, qui lui avait refusé le serment d'hommage, et la faculté de donner à un autre bénéficier le comté d'Embrun. Très estimé par ce souverain Pontife, il fut créé cardinal le 27 mai 1262, et évêque d'Ostie et de Velletri, au mois de décembre 1263. Mais Henri de Suze avait une telle tendresse paternelle pour son peuple, et le séjour des pauvres montagnes de l'Embrunais était pour lui si plein de charme, qu'a près avoir été nommé cardinal et évêque d'Ostie, dignité qui lui conférait le droit de sacrer le Pape, au lieu d'aller habiter l'Italie et recevoir les honneurs qui l'attendaient, il continua à résider au milieu de ce climat rude des montagnes, administrant avec le plus grand zèle le diocèse qui lui avait été confié. Ce fut avant de quitter le diocèse d'Embrun que notre ar chevêque convoqua , à Seyne , un concile provincial. A cette époque, Seyne appartenait au diocèse d'Embrun, et Digne relevait de cette métropole. Boniface , évêque de Digne , avait usé vis-à-vis d'un chanoine de son Église, nommé Audibert de Vaucluse, de procédés un peu violents, et il ne voulait pas permettre à l'offensé de se pourvoir auprès du métropolitain. L'archevêque, informé de ce qui se passait, avertit avec beaucoup de douceur son suffragant, qui ne voulut tenir aucun compte de ses remontrances. Cette résistance inconvenante de Boniface obligea Henri de Suze à convoquer, le 3 novembre 1267, un concile auquel furent appelés tous les évêques de la province. Ce concile se réunit à Seyne , et l'on y vit accourir les évêques de Nice, de Sénez, de Glandèves, de Grasse, de Vence , ainsi que celui de Digne. Dans cette réunion , l'affaire du chanoine Audibert fut examinée, mais on s'occupa surtout de la discipline ecclésiastique, et l'on fit douze statuts, que de l'avis des autres prélats, le métropolitain voulut être inviolablement observés tant dans la ville d'Embrun que par tout le diocèse et dans toute la province. Ces statuts font la gloire du cardinal d'Ostie, au dire de Gassendi et de dom Martène. 1er canon. Les évêques s'occuperont avec soin de rechercher et de punir les hérétiques, les excommuniés et les pécheurs notoires, selon les canons et les règlements, et suivant les instructions données par les légats dans ces contrées. 2e canon. Chaque évêque fera par lui-même ou par d'autres la recherche de ces instructions données par les légats, ainsi que des statuts des conciles provinciaux d'Embrun , et fera transcrire le tout avec netteté, en sorte que chacun ait un exemplaire qu'il devra apporter avec soi au concile prochain, ayant soin d'en observer et d'en faire observer par ses peuples, toutes les prescriptions. Il fera mettre à ce livre, un titre, avec l'indication des auteurs des statuts et des livres où ils ont été publiés. 3e canon. Chaque évêque observera et fera observer les sentences d'excommunication portées par quelqu'un de ses conrères, ou décrétées par les conciles, du moment où elles lui auront été notifiées, suivant ce qui a été ordonné par le concile de Valence. Il en sera de même de toutes les sentences comprises sous le nom général de censures. 4e canon. Les clercs ne porteront point de coutelas ou d'autres armes offensives ; si quelqu'un d'entre eux le fait à l'avenir, on le tiendra pour incorrigible. 5e canon. Les chanoines dans les ordres mineurs n'auront point voix au chapitre. S'ils en ont la prétention, ou que, sommés de se retirer par quelqu'un d'entre les chanoines, ils n'obtempèrent pas sur-le-champ à cette sommation, ils seront privés de leur prébende par le droit et par le fait, et l'évêque qui aura été trouvé négligent sur ce point sera frappé de peines, soit spirituelles, soit temporelles, au gré du métropolitain, aussi bien que le chanoine qui se sera rendu coupable, et nous entendons qu'on use de la même rigueur à l'égard de tous ceux qui , quoique avertis par leur évêque, ne se seront pas fait promouvoir au diaconat ou au sacerdoce, selon les besoins de l'Église. 6e canon. Là où les biens seront divisés par prébendes, les prébendiers seront tenus à la résidence personnelle et canonique ; autrement tous les revenus qu'ils auraient à percevoir seront séquestrés et distribués aux ministres inférieurs, ou partagés entre les autres prébendiers, et le prélat négligent sur cet article ou qui y contreviendra, sera puni au gré de son supérieur, aussi bien que le délinquant, par la privation ou la suspension de son office, ou par d'autres peines temporelles ou spirituelles ; et nous entendons qu'il en soit de même de tous les dignitaires ou ecclésiastiques en place , soit que les revenus qu'ils auraient à percevoir se divisent par prébendes , soit qu'ils se touchent en commun. 7e canon. Aucun laïque , de quelque dignité ou condition qu'il soit, ne pourra citer ou faire citer, ou retenir malgré lui, ou punir en aucune façon , un clerc , pour aucune cause criminelle ou personnelle , sous peine d'excommunication. 8e canon. Aucun laïque , de quelque dignité ou condition qu'il puisse être , ne pourra sous la même peine , sans l'agrément de l'évêque , occuper ou usurper , ou retenir des dîmes ou d'autres biens appartenant à des églises ou à des ecclésiastiques, soit qu'il s'agisse de biens meubles ou immeubles, soit d'autres droits quelconques. 9e canon. Aucun laïque ne pourra entraver ni troubler la juridiction épiscopale, sous peine d'être excommunié, s'il ne fait satisfaction, quinze jours après avoir été averti. 10e canon (Ce canon dit à peu près la même chose que les deux précédents). 11e canon. Défense, sous peine d'excommunication, de s'ingérer dans l'administration d'une église ou d'un bénéfice ecclésiastique, sans y être autorisé par l'archevêque ou par le prélat diocésain. 12e canon. Défense à qui que ce soit de porter des plaintes contre un clerc ou une personne d'Église, pour une cause spirituelle ou ecclésiastique, civile ou criminelle, devant un tribunal séculier ou quelque laïque que ce soit, pour en obtenir justice, ou de traiter avec eux pour les mêmes causes, sans le consentement de l'Ordinaire, sous peine de perdre son droit en justice et par le fait , et de demeurer dans l'excommunication jusqu'à ce qu'il ait donné les satisfactions convenables. Le cardinal Henri de Suze écrivit aussi , la même année , une admirable lettre à Melchior, son successeur, au sujet de la conduite que ce prélat devait tenir dans la querelle des Guelfes et des Gibelins. Ces terribles factions, qui désolèrent l'Italie pendant tout le moyen-âge, étaient alors au plus fort de leur lutte, surtout dans le royaume de Naples, où la maison de France, dans la personne de Charles d'Anjou, comte de Provence, venait de triompher par la victoire et par la cruauté. Le retentissement de ces événements était parvenu jusque dans Embrun, ville impériale, toujours attachée aux princes allemands, à qui les Dauphins et les archevêques rendaient encore hommage. Charles d'Anjou, devenu comte de Provence et de Forcalquier, par suite de son mariage avec Béatrix, fille et héritière du dernier Raimond Bérenger, mort sans enfants mâles, réclama du Dauphin et de l'archevêque l'hommage des comtés d'Embrunais et du Gapençais , comme anciennes dépendances du comté de Forcalquier. Guigues VII se soumit, mais Henri de Suze invoqua les bulles des princes allemands, et surtout celle de Guillaume de Hollande, qui ne donnait pour suzerain, à l'archevêque d'Embrun, que l'empereur lui-même. Charles d'Anjou n'insista pas davantage. Malgré son caractère fier et indépendant, il n'aurait pas encore osé prétendre que l'empereur n'avait pas le droit de distribuer des prérogatives dans des pays qui ne devaient plus faire partie, à aucun titre, de l'empire d'Occident. Henri remplit aussi les fonctions de légat du Saint-Siége , auprès des ducs de Milan ; mais ce que le P. Fournier, dans son Histoire des Alpes-Maritimes , admire surtout dans le cardinal d'Ostie , c'est que dans cette élévation et dans sa grande science, il avait toujours conservé une humilité très profonde et une modestie extraordinaire, ce qui paraît d'une manière toute particulière dans la Préface de sa Somme, où il témoigne , outre les sentiments de piété qu'il y fait connaître à tous les papes, une grande défiance de ses propres forces et de son savoir. Il y demande pardon à ses disciples pour les fautes qu'il a pu commettre, comme s'il n'avait pas été l'un des plus savants maîtres du monde ; il s'y expose à la correction, comme s'il n'eût pas été plutôt en droit de corriger les autres. Le P. Fournier ajoute : « J'ai eu en main plus de quarante de ses actes , où il se qualifie, non par la grâce ou la mi séricorde de Dieu, mais Henri, par la patience de Dieu, archevêque d'Embrun. Cette expression singulière fait voir la profession qu'il faisait de cette vertu, et il y fut si attaché , qu'il ne souffrait pas même que ceux qui lui écrivaient ou qui parlaient de lui dans des lettres le qualifiassent d'une autre manière. » Le cardinal d'Ostie mourut à Lyon le 6 novembre 1271 , il avait fait son testament à Viterbe le 3 octobre précédent, et y manifestait le désir d'être inhumé dans l'église des Dominicains la plus voisine, ou bien dans l'église métropolitaine de la province où il viendrait à décéder. Il laissait à Bologne son Commentaire sur les décrétales qu'il y avait envoyé pour le recopier, à l'Église d'Embrun il léguait l'exemplaire du même Commentaire que Molinaire avait copié. Il fut inhumé dans l'église des Dominicains de Lyon. Henri de Suze, dit Fournier, était doué d'une prudence clairvoyante, d'une force d'esprit inébranlable, d'une patience invincible, d'une autorité généreuse, d'une dévotion et d'une charité pleines de tendresse Tritheim , Bellarmin , Ciaconius, Onufre, le nomenclateur des cardinaux, Claude Robert , et un grand nombre de canonistes et d'autres auteurs très célèbres ont considéré Henri comme un oracle, et lui ont donné des éloges et des louanges qui, malgré tout, seront toujours au-dessous de son rare mérite. Il s'était acquis une immense réputation par ses connaissances en droit, par son éloquence et par son habileté dans les affaires. Dante le désigne, dans la Divine Comédie sous le nom de l'Ostiense, dans ces vers où saint Bonaventure dit de saint Dominique : « Il ne se passionna pas pour le monde, comme quiconque étudie celui d'Ostie et Thadée , mais il chercha la manne véritable. » Les ouvrages de Henri de Suze qu'il composa en partie dans la solitude du château de Crévoux, jouirent d'une grande célébrité du XIIIe au XVIIe siècle, et lui valurent les surnoms de fons et de splendor juris ; originaux en leur genre, ils ont été d'une grande ressource pour les canonistes venus depuis ; ce sont : Ostiensis Summa aurea , Rome, 1470, in-folio, Bâle, 1537, 1573, Lyon, 1588, 1597, in-folio; Commentarius in Epistolas decretates, Rome, 1470, 1473, in-folio, Venise, 1478, 1581 , in-folio. Les archevêques d'Embrun conservèrent pendant cinq cents ans avec un religieux respect la chaire ou stalle que cet illustre prélat avait occupée dans l'église métropolitaine, se faisant un honneur de s'y placer, quoiqu'elle fut des plus simples et sans aucune trace de sculptures. On ne la remplaça qu'au XVIIIe siècle sous le cardinal de Tencin, parce qu'elle tombait de vétusté. Henri de Suze portait pour armoiries : parti de gueules et d'azur, à un lion d'or brochant sur le tout.
38. — HUMBERT II ou YMBERT (1251-1257). Humbert sortait de l'ordre des Frères Prêcheurs, quand il fut promu à l'évêché de Sisteron, au mois de juillet 1251. Le 25 de ce même mois, il passa une convention avec les Hospitaliers de Manosque, et cela du consentement des chanoines de Sisteron. Le 20 août suivant, il obtint de Guillaume, roi des Romains, la confirmation de tous les priviléges de son évêché, notamment sur Lurs et Lincel, lesquels lieux, dit la charte, sont dans le diocèse de Sisteron et sont tenus par son évêque en domaine immédiat depuis un temps antique et immémorial. On voit que l'empereur d'Allemagne, roi des Romains, disposait des biens en Provence, comme si le roi de Sicile et comte de Provence, Charles d'Anjou, n'eut pas existé; mais presque aussitôt, Charles revint de la croisade et tint pour non avenues les dérogations à ses droits faites pendant son absence. Aussi Humbert, évêque de Sisteron, dut-il lui rendre hommage et renoncer au privilége qu'il tenait de l'empereur. C'est sans doute à cette circonstance que fait allusion l'écrivain de Sisteron (Livre vert) en disant : Cet évêque, opprimé par la cour du roi, au temps du très illustre Charles Ier, roi de Sicile , comte de Provence et de Forcalquier, sous le poids d'ennuis de plus en plus graves, se démit librement de l'évêché de Sisteron et se retira à Lyon, où il vécut quelque temps et où il mourut ensuite. Béatrix de Provence, femme de Charles d'Anjou, avait ce pendant à gré notre évêque et lui en donna des preuves. Par les ordres de la comtesse-reine, Humbert fut chargé avec Faucon de Puy-Ricard, Geoffroi de Tarascon , Artaud , seigneur de Venelles , Robert de Lérins , de décider la question de la garde des portes, dans le comté de Forcalquier (1253). Plus tard, Lambert de Lincel , refusant à l'évêque le serment et l'hommage, des juges nommés et délégués à cet effet par la comtesse-reine, le forcèrent à s'acquitter de ses devoirs (1256). En 1257, il acheta de Rostaing et de Gautier du Revest , certains immeubles ruraux qu'il céda lui-même à d'autres. C'est aussi , vers ce même temps que Philippe, archevêque d'Aix, réunit au siége épiscopal de Sisteron les églises de Lurs, du Revest, de Sahune et de Saint-Martin de Brieux. N'oublions pas qu'en 1254, le 12 mai , Humbert munit de son sceau et confirma de son autorité la transcription des lettres patentes de Guillaume, comte de Forcalquier, lettres datées du 7 juin 1206, et par lesquelles le comte Guillaume déclarait les habitants de sa ville comtale et leurs biens exempts de toute espèce de droits dans l'étendue entière du comté : le tout est déclaré par Humbert, exactement conforme à l'original. Nous avons déjà dit que les témoins de cette charte étaient, Guillaume de Bénévent, archevêque d'Embrun, Pierre de Saint-Paul, évêque d'Apt, et Pons de Sabran, évêque de Sisteron. Il a été dit également, que Humbert se démit de son évêché en 1257, probablement à l'époque où Charles d'Anjou, qui avait besoin d'un contingent militaire plus considérable , amnistia Sisteron pour les crimes de sédition commis contre les Juifs, mais où il exigea que les seigneurs ecclésiastiques pliassent devant lui. Alors l'évêque de Sisteron , « renonçant aux droits qu'il tenait des anciens rois de Bourgogne , lui fit hommage de sa terre de Lurs. L'abbé de l'Isle-Barbe, près de Lyon , fut traité avec moins de ménagement encore. Les religieux de ce monastère possédaient des terres dans la vallée de Cornillon et du Val-Benoît. Ils furent contraints d'en céder la souveraineté pour une pension annuelle de cinquante livres de couronnats provençaux, ne se réservant que quelques droits utiles; mais ne pouvant même en jouir paisiblement, ils finirent par en faire l'abandon au comte de Provence, moyennant une somme dont l'intérêt réuni aux cinquante livres précédentes , forma , en faveur de l'abbaye , une rente perpétuelle de cent vingt livres. « Mais à quoi bon , dira-t-on ici peut-être , les affaires de l'Isle-Barbe ? — C'est que ces affaires sont aussi malheureusement les nôtres. La ville de Sisteron, on ne sait comment, mais à coup sûr, au mépris de ses priviléges, se trouva chargée de cette pension qui fut spécialement affectée sur le droit de Cosses; droit qui consistait à percevoir à son profit, le vingt-cinquième de tous les grains vendus sur le marché. Après la destruction de l'abbaye de l'Isle-Barbe (1562), la pension passa au chapitre de Saint-Jean de Lyon, qui en jouit jusqu'au jour où Cosses, pension et le chapitre lui-même, tout disparut dans le gouffre de 89 (1). » Nous avons voulu prendre cette citation un peu longue dans le livre de M. Ed. de la Plane pour qu'il fût une bonne fois entendu quelles relations existaient entre l'évêché de Sisteron et l'abbaye de l'Isle-Barbe.
(1) La Plane, Hist. de Sisteron , tome 1er.
39. — ALAIN on JEAN D'ALAIN (1257-1277). Alain, comme le dit son épitaphe, était né à Paris ; une confirmation des priviléges de Marseille , le nomme comme évêque de Sisteron en 1257; il ne tarda donc guère à remplir le siége laissé vacant par la démission de Humbert II. Deux ans après, en 1259, et le 30 décembre, il donna au chapitre de Sisteron les églises de Saint-Gervais de Bevons et de Saint-Vincent. Le 4 septembre de cette même année, il donna des statuts à son chapitre. Nous ne les connaissons que par un procès dont nous aurons à parler en 1431, sous l'épiscopat de Robert Dufour, et qui se trouva conservé dans les écritures de Raimond Raimundi , notaire apostolique. Longtemps , ces statuts jouirent d'une grande autorité dans l'Eglise de Sisteron. Si ceux qu'avait publiés, en 1246, le cardinal d'Ostie, n'eurent pas le même sort, c'est que sans doute, moins distrait par la science et plus occupé de son diocèse , que son illustre prédécesseur, mieux que lui aussi , Alain pendant les vingt années de son épiscopat, put tenir la main à l'observation de la règle et travailler plus efficacement à en perpétuer les traditions. Découverts au commencement du siècle dernier en Italie, au fond d'un monastère, les statuts de 1246, ont trouvé place dans le Thesaurus anecdotarum de dom Martène , t. IV, folio 1079; il était juste que ceux de 1259, sortissent aussi de la poussière, et c'est pour les arracher à l'oubli , que le savant Ed. de la Plane les a recueillis dans son Appendice à l'Histoire de Sisteron , pièce 1 , page 537 , tome IL L'année suivante, Raimond d'Ardit , prévôt de Forcalquier, et Imbert des Orgues , jugèrent une contestation qu'avait notre prélat au sujet des droits sur Ybourgues. En 1261, il concéda au chapitre de Forcalquier toutes les églises de Manosque qui n'appartenaient pas aux Hospitaliers ni à l'abbaye de SaintVictor de Marseille. Géraud Chevrier, nous l'avons dit précédemment, avait transféré ou cédé au chapitre de Forcalquier la collation de ces églises qui lui appartenait, en sa qualité de collateur ordinaire. Alain fit mieux encore, il ajouta à ce droit de collation, la jouissance et la propriété des fruits et des revenus de la plupart de ces églises. Voici comment il s'exprime dans l'acte de donation : « Il nous a paru que l'ordre et la division des prébendes ne pouvaient être entièrement et définitivement arrêtés, si les églises de Montaigut, de Saint-Maxime, du Saint-Sépulcre , de Toutes-Aures et de Saint-Sauveur dont le chapitre est seulement collateur, n'étaient unies et annexées audit chapitre de l'Eglise de Forcalquier. Et nous nous unissons d'abord , annexons et voulons que l'on réputeunie et annexée pour toujours la susdite église de Toutes-Aures, à la dite église de Saint-Sauveur du bourg de Manosque. De plus, en vertu de notre autorité épiscopale, nous unissons et annexons pour toujours au chapitre de l'Eglise de Forcalquier, et voulons qu'on regarde comme unies et annexées à perpétuité, toutes et chacune des dites églises avec tous leurs droits, appartenances et dépendances, savoir : l'église de Saint-Sauveur avec celle de Toutes-Aures qui lui est déjà annexée , l'église de Saint-Maxime avec celle de Montaigut qui lui sont pareillement annexées, et enfin celle du Saint-Sépulcre de la vallée de Manosque , sauf les droits des prieurs ou curés des dites églises de Saint-Sauveur, de Toutes-Aures , du Saint-Sépulcre et de Montaigut, leur vie durant. » Par cet acte , l'évêque Alain unit cinq églises ou paroisses au chapitre de Forcalquier. En avait-il le droit? c'est ce que nous n'osons ni assurer ni décider, mais ce qui est constant, c'est qu'en faisant un pareil acte d'omnipotence, il ne prit conseil que des chanoines de Forcalquier, trop intéressés pour ne pas approuver, et qu'il ne daigna pas même consulter ni les curés de ces églises, ni les habitants de Manosque. Ce qui est constant encore, c'est que ces derniers protestèrent plus d'une fois contre ces annexions. En 1264, il acheta à Aix pour trois mille sous tournois l'usage d'une maison et d'un jardin comme lieu de son séjour dans cette ville, En 1265, il échangea les procures (cela s'appelait alors ainsi), qu'il avait à Forcalquier, ensemble quelques mesures de froment et d'orge qui lui revenaient des terroirs de Lincel et de Niozelles, avec l'église de Pierrerue. Parmi les documents qui ont servi à la Gallia christiana des frères de Sainte-Marthe ; il en existe un fort important ; c'est celui où Béatrix, fille de Raimond , comte de Provence, épouse de Charles de France, comte d'Anjou et de Provence, etc. , confirme son testament, l'an de l'Incarnation 1265, et le 9 mai, en la présence de Guillaume, archevêque d'Aix, et d'Alain, évêque de Sisteron : ces prélats scellèrent l'acte de leur sceau particulier. Alain , vers le même temps , instituait une vicairie perpétuelle dans l'église de Saint-Julien de Ferrassières, sise dans son diocèse, mais dépendante du monastère de Saint-André d'Avignon. Rostaing, alors abbé de ce monastère, s'unit à son chapitre conventuel, pour prier notre prélat d'annexer cette même église à la chambrerie du monastère : ce qui fut fait le 2 février 1267. En 1271 , notre évêque est témoin à un acte de compromis passé à Aix, entre Odon, évêque de Gap agissant au nom de son Église, et le sénéchal du roi de Sicile. C'est en juin 1273 que le prévôt et le chapitre de l'Église d'Aix, gagnés sans doute par ses mérites et ses vertus , demandèrent Alain pour archevêque ; mais, témoignage plus flatteur encore ! Grégoire X voulut laisser à Sisteron son excellent pasteur, et nômma Grimier au siége métropolitain vacant. Ce fait résulte de la lettre écrite, le 13 janvier 1274, à Grimier par ce Pontife. Le 15 mars 1272, Alain fut d'accord avec Adélaïde, dame de Mevolhon et avec les consuls de Sisteron , pour élever dans la ville un monastère de Clarisses. Toutefois, ce ne fut qu'en 1285 que les fondements de la sainte maison furent jetés, extra muros, près de celle des Frères-Mineurs. Remarquons ici que la commune de Sisteron était d'ores et déjà constituée sur des bases larges et profondes; les maisons conventuelles elles-mêmes font partie de la cité considérée comme personne morale, et tous les membres qui la composent sont appelés à accomplir les actes qui l'intéressent tout entière. A l'occasion de l'établissement des Clarisses, tous les habitants se réunissent au son de la trompe du crieur, en assemblée générale (in parlamento publico), pour délibérer sur l'utilité de cette pieuse fondation (V. Gallia christiana, tome I, Preuves, folio 92). Dans l'acte que nous citons, Adélaïde, épouse d'Amiel d'Agoût est nommée, seule femme, admise au conseil général de la communauté qui élut pour première abbesse Gérarde de Sabran : c'est sans doute à titre de bienfaitrice qu'elle dut. cet honneur, peut-être même à ses vertus, quoique Nostradamus et d'autres chroniqueurs aient conté ses romanesques et coupables aventures avec Raimond-Feraud de Glandèves. En 1273, ou environ, Guillaume de Gonesse, sénéchal du roi Charles, et Robert, évêque d'Avignon , remirent à Alain le jugement d'une contestation qui les divisait , et s'en tinrent à sa sentence. En 1275, le 30 août, notre prélat approuva les statuts du chapitre de Forcalquier, et fut nommé exécuteur testamentaire de Béatrix, reine de Sicile, comtesse de Pro vence , etc. (V. ce titre , tome IV du Spicilège).Deux ans après, il mourut (septembre 1277) ; voici comment s'exprime le Livre vert : Alain, évêque de Sisteron, né à Paris, gouverna l'Église de Sisteron 19 ans. Il fit élever plusieurs édifices dans son diocèse, c'est-à-dire une église et des maisons à Authon, des maisons à Ybourgues et à Sisteron. A l'Église de Sisteron, en l'honneur de Dieu, de la glorieuse Vierge sa mère et du glorieux martyr saint Thyrse, il légua une croix d'argent avec un large pied, plus des religues des saints Cosme et Damien. C'est dans cette église qu'il fut enseveli, à gauche, près de l'autel de Sainte-Marie de Sisteron. Ses entrailles furent transportées et inhumées à Aix dans l'église métropolitaine, et sur la pierre qui les recouvre on a gravé cette inscription : L'an du Seigneur 1277, et le 10 des calendes d'octobre, furent ensevelis ici les intestins et les autres viscères de Jean d'Alain, évêque de Sisteron. Il a laissé pour son anniversaire trente sous annuels à prendre ici sur sa maison. Priez pour lui. Jean d'Alain portait pour armoiries : d'azur, au chevron d'argent.
40. — PIERRE IV GIRARD DE PUIMICHEL (1277-1291). Pierre Girard de Puimichel était prévôt de Riez , lorsque le 30 octobre 1275, il fut élu évêque de Sisteron. Le 20 février de l'année suivante, il passa une convention avec Isnard Justacio, seigneur de Peipin; le 20 janvier 1279, il acheta de Guillaume de Cornut, totum affare, c'est-à-dire le domaine, la juridiction et la seigneurie que ce damoiseau de Forcalquier avait sur les lieux de Lurs et de la Brillane. Le 25 mai 1281, nous le voyons assister à la translation du corps de sainte Marie-Madeleine , qu'avait découvert deux ans auparavant, Charles, prince de Salerne, successeur de son père sur le trône de Sicile et dans le comté de Provence. En 1285, année où, comme il a été dit ci-devant, furent jetés les fondements de la maison des Clarisses, notre prélat pactisa sur quelques points avec son prévôt capitulaire, Jacques Bueymondi, et avec ses chanoines. La même année, ou bien (si l'on compte à la manière romaine), le 14 février 1286, Rostaing, archevêque d'Aix, célébra, dans la ville de Riez, un concile provincial, auquel prit part l'évêque de Sisteron. Pierre Girard de Puimichel quitta cette vie mortelle en 1291 , comme le constate le livre de l'évêché en ces termes : Après lui (Jean Alain), le très sage Pierre Girard de Puimichel, évêque de Sisteron, gouverna notre Église pendant 14 ans; il fit construire le palais et les fortifications de Lurs , après avoir acheté ou autrement acquis les domaines (affaria) , et biens que certains nobles avaient en ce lieu. Il fut, en d'autres choses, le bienfaiteur du diocèse et augmenta de beaucoup les revenus de l'évêché. Il légua à son Église de Sisteron une belle mitre et une crosse d'argent. Son corps repose devant le grand autel de la cathédrale. Il était mort en l'an 1291.
41. — PIERRE V DE LAMANON (1292-1303). Après la mort de Pierre Girard de Puimichel , la Providence donna pour premier pasteur, à l'Église de Sisteron, Pierre de Lamanon, issu de noble famille, agrégé à l'ordre des Dominicains, homme instruit et exercé dans la pratique de toutes les vertus. Son attachement à Charles, fils du roi de Sicile et comte de Provence, lorsque ce prince était dans les fers du roi d'Aragon , était profond et dévoué, et ce fut sans doute la reconnaissance qui engagea Charles II le Boiteux à lui donner la mitre. Rapportons chronologiquement ceux de ses actes que l'histoire nous a transmis. En 1293, il acheta la moitié d'Ybourgues, moyennant la permission que lui en avait donnée le roi Charles II. En vertu d'une bulle du 8 février 1295, de Boniface VIII, il alla installer des Dominicains à cette grotte célèbre qu'on appelle la Sainte-Baume, près Saint-Maximin. C'est par erreur que dans cette bulle, imprimée dans le Recueil des bulles des souverains Pontifes, on désigne l'évêque de Sisteron sous le nom de Poncius, au lieu de celui de Petrus. Le roi de Sicile établit, en 1297, des juges choisis par notre évêque et chargés de conserver à ce prélat les droits qu'il pos sédait, avec défense aux juges et exécuteurs royaux d'y em piéter. De plus, en compensation du domaine sur Lincel et de quelques autres droits que l'évêque répétait sur le lieu de la Brillane, il lui continua en rente annuelle trente livres de couronnats provençaux à prendre sur la Brillane et Peyruis : de là il faudrait conclure que le prince avait racheté de l'évêque la seigneurie de ces lieux. Le Livre vert dit à propos de Pierre de Lamanon : « Après lui (Pierre Girard), un très saint homme, Pierre de Lamanon, évêque de Sisteron, gouverna notre Eglise pendant 13 ans. Il avait appartenu à l'ordre des Prêcheurs. Ce fut un évêque d'une grande piété, très charitable et prodigue de ses biens en l'honneur de Dieu, à ce point qu'il dépensait presque la moitié de ses revenus en pieuses aumônes distribuées aux pauvres, aux veuves et aux orphelins. Il fit bâtir des ponts et plusieurs hôpitaux dans son diocèse. Il acquit la moitié du lieu d'Ybourgues et 30 livres de revenus sur la Brillane, en l'honneur de Dieu, de la glorieuse Vierge sa Mère et du très glorieux martyr saint Thyrse. Il mourut le 1er août 1303, et fut enseveli dans le couvent des Prêcheurs de la ville d'Aix. » La maison de Lamanon ou d'Allamanon, l'une des plus anciennes de la Provence, tirait son nom de la terre et seigneurie de Lamanon, viguerie de Tarascon, qu'elle possédait dès le XIe siècle , temps auquel les noms commencèrent à être fixes dans les familles. Elle parut avec honneur sous les comtes de Provence de la maison de Barcelone , et aussi sous ceux de la première maison d'Anjou à laquelle elle fat toujours dévouée. Bertrand de Lamanon, qui fut peut-être le frère de l'évêque de Sisteron, avait accompagné Charles d'Anjou lorsque ce prince était allé faire la conquête du royaume de Naples ; Imbert de Lamanon, son fils, suivit la cour de Charles II en 1293, et Aicard de Lamanon était amiral de Provence en 1297. M. de la Plane, dans la nomenclature des évêques de cette ville, place la mort de Pierre V au 1er avril 1303 ou 1304 ; d'après la Gallia christiana qui suit le Livre vert, il faut la placer au 1er août 1303. Toutefois, la difficulté la plus grande n'est pas là. En effet, Bernard de la Guionie , évêque de Lodève , parle, sous l'année 1298, d'un évêque de Sisteron, nommé Pierre de Roy (Petrus de Rex), qui se trouvait à Aix lorsque Charles II, roi de Sicile et comte de Provence, donna aux Dominicains, dont le couvent venait d'être achevé à ses frais , une châsse ornée de pierreries et contenant des reliques de saints. Pour expliquer ceci, on répond que Pierre V a bien pu s'appeler à la fois de Lamanon, du nom d'une terre héréditaire dans sa famille, et de Roy, de son nom de famille, ce serait donc le même personnage ; et pour nous, cette identité ne fait pas l'objet d'un doute. A ceux que cette explication ne satisferait pas, on pourrait accorder qu'à Pierre de Lamanon décédé vers 1298, succéda un autre Pierre de Roy, lequel ne mourut qu'en 1303; et alors ce sera à ce dernier qu'il faudra rapporter le fait suivant : Un évêque de Sisteron, du nom de Pierre, assista à la prestation du serment par Renaud de Porcellet, évêque de Digne, en 1303, à Charles, roi de Sicile et comte de Provence, qui, précédemment, lui avait accordé trente livres de rente annuelle sur la Brillane et Peyruis. En cette occasion, comme dans toutes celles qui lui ressemblent, nous préférons laisser subsister le doute que de nous avancer sans bonnes preuves. Pierre de Lamanon portait pour armoiries : tranché d'ar gent et de sable, diapré de l'un en Vautre.
42. — JACQUES DE GANTELMI (1303-1310). Frère de Pierre de Gantelmi, évêque de Riez Jacques était fils de Pierre de Gantelmi , viguier d'Aix. La famille Gantelmi subsiste encore à Naples où depuis longtemps, elle possède le duché de Popoli. Un rameau de la branche de Provence avait fort dégénéré de son ancien lustre , puisqu'on assure que son dernier rejeton qui vivait au commencement du XVIIIe siècle, était un pauvre savetier duquel le duc de Popoli acheta les titres originaux de la maison de Gantelmi , que cet artisan pos sédait encore. Le premier acte que nous connaissions de cet évêque est du mois de mars 1307, indiction Ve : à cette date, sur la présen tation de Bertrand, abbé de Saint-André et en présence d'Isnard, abbé de Lure, il admit frère Guillaume de Beaumont, moine de Saint-André , comme prieur ou recteur de l'église de Saint-Michel. Il est cependant certain que son élection à l'évêché de Sisteron eut lieu avant la fin de 1303. Ce prélat montra des qualités moins conformes que celles de son prédécesseur à la sainteté de son ministère. Le 22 avril 1308, il obtint du roi Charles, père de Robert, que les juges royaux de Sisteron et de Forcalquier n'informeraient pas sur les sujets de l'évêque, avant que les juges de l'évêque lui-même ne les eussent provoqués à l'information : c'est le même privilége que Pierre de Lamanon avait obtenu, onze ans auparavant. Bientôt notre prélat voulut donner à son souverain une preuve peu ordinaire, chez un évêque, de sa reconnaissance et de son dévouement. Robert, duc de Calabre, venait de succéder à son père, Charles II, et avait été couronné à Avignon le 13 août 1309. De graves intérêts l'appelaient en Italie, où les affaires de la maison d'Anjou périclitaient rapidement. Il s'y rendit en effet. Jacques de Gantelmi demanda aux habitants de Manosque six mille tournois d'argent; il réclama sans doute d'autres sommes à d'autres communautés ou personnes dépendant de son évêché, et les employa à équiper des troupes à la tête des quelles il alla rejoindre le roi Robert en Lombardie. Le Livre vert dit ici ce qui est nécessaire à ce propos, nous le traduisons : «Jacques Gantelmi, de la noble famille provençale de ce nom, fut évêque de Sisteron et régit notre Eglise pendant six ans. Ayant armé seize cavaliers et bon nombre de fantassins, il se mit à leur tête et rejoignit, en Lombardie, l'armée que commandait le très-illustre seigneur Robert, roi de Jérusalem et de Sicile , comte de Provence , de Forcalquier et de Piémont. Il mourut dans cette expédition à Albe, l'année 1310. Plus tard, ses restes furent rapportés dans notre ville et inhumés dans la cathédrale, au tombeau d'Alain, son prédécesseur. En l'honneur de la bienheureuse Marie, glorieuse vierge , il a légué à l'Eglise de Sisteron une chape d'or ornée de magnifiques dessins. » Signalons en passant que Hugues Dutems, suivi en cela par M. de la Plane, par suite d'une coquille d'imprimerie, appelle Albi et non Albe la ville où mourut Jacques Gantelmi; puis disons que c'est aussi à tort que la plupart des auteurs ont placé sa mort en 1309. Les armoiries de Jacques de Gantelmi étaient : d'or, à un lion de gueules et un lambel de trois pendants de sable brochant sur le tout. On les trouve quelquefois aussi écartelées : d'azur, au demi-vol d'or. Un évêque de Sisteron que l'on nomme Rostaing et qu'on prétend n'avoir siégé qu'un an, disent certains historiens, apposa son sceau avec Geoffroi de Lincel, évêque de Gap, à l'acte de prestation de foi et hommage rendu au roi Robert, par Bertrand de Baux , prince d'Orange, le 24 juin 1309. Cet acte, dit Bouche, est conservé dans les archives royales d'Aix, registre en parchemin , fol. 84 , sous le roi Robert. Columbi n'admet pas ce Rostaing , et croit que ceux qui ont lu l'acte dont il s'agit ont à tort terminé par Rostaing le nom que commence la lettre R; c'est Raimond qu'ils auraient dû lire, puisque, ajoute-t-il, Rostaing ne siégea qu'en 1328. Où Columbi prend cette conjecturé, nous ne le savons guère; bien plus , il n'est pas d'accord avec lui-même : car il dit que Raimond d'Oppède ne fut élu qu'en 1310 ; la lettre R ne pouvait donc le désigner en 1309. L'acte d'élection de Raimond d'Op pède lève, ce nous semble, toute difficulté, en déclarant que le siège est vacant par suite de la mort de Jacques Gantelmi. Il nous paraît donc évident que Bouche, suivi par les Bénédictins, dans la Gallia christiana, a fait erreur, et que le nom de Rostaing doit être éliminé des dyptiques de l'Eglise de Sisteron.
43. — RAIMOND D'OPPÈDE (1310-1326). Il nous semble intéressant de rapporter ici, au moins par extraits, une pièce dont l'original en parchemin a échappé aux désastres révolutionnaires. M. de la Plane l'a insérée dans l'Appendice de son Histoire de Sisteron. Comme le dit très bien cet excellent monographe, cette pièce montre avec précision la forme observée par les chapitres dans les élections épiscopales, avant que le concordat de 1516, au préjudice de leur droit, aussi ancien que l'Eglise même, les eût réduits à ne plus avoir d'évêques de leur choix. « Que le Christ soit à mes côtés, afin que je n'écrive que selon la justice et la vérité. L'an de l'Incarnation 1310, le 2 du mois d'août, indiction VIIIe. Ce jour était assigné par le vénérable frère Jacques Bueymondi, prévôt de Sisteron, et par les seigneurs chanoines de cette même Eglise , alors présents dans la ville ; au nom du chapitre de Sisteron et de celui de Forcalquier, pour traiter de l'élection d'un futur pasteur dans l'Eglise de Sisteron, vacante par la mort de Monseigneur Jacques Gantelmi de bonne mémoire, évêque de cette Eglise; ainsi que le tout résulte de la lettre dont la teneur suit : « Jacques Bueymondi, prévôt, Raimond de la Mure, Mevolhon de Justas et Bertrand de Villemus, chanoines de l'Eglise de Sisteron, présents dans la ville et composant le chapitre, aux vénérables seigneurs, le prévôt et les chanoines de l'Eglise de Forcalquier, salut en Celui qui est le véritable Seigneur de toutes choses. Que par la teneur de la présente , il vous soit connu que Jacques , d'heureuse mémoire , autrefois évêque de Sisteron , a pris , comme il a plu au Seigneur, la voie finale de tout mortel. A cause de ce décès , il nous faut , sous la faveur de Dieu , procéder à l'élection d'un futur pasteur, et nous, par la présente, nous fixons et désignons , pour l'élection du nouveau pasteur, le 2 du mois d'août, et jours suivants, s'il en est besoin. Que si vous ne vous rendiez pas au jour fixé, nous procéderons en votre absence à la susdite élection , sous l'inspiration de Dieu.— Donné à Sisteron, le 24 juillet 1310 , in diction VIIIe. Rendez, nous vous prions , cette lettre au porteur, après en avoir gardé copie, si vous voulez vous y tenir.» Autre lettre : « Aux vénérables hommes et très-illustres amis , les chanoines de l'Eglise de Sisteron , à qui la présente parviendra , Nous, Jacques Bueymondi, prévôt , Raimond de la Mure, Mevolhon de Justas et Bertrand de Villemus, chanoines de Sisteron et présents dans cette ville, salut en Notre Seigneur Jésus-Christ. La présente est pour vous informer que, en suite de la mort de Monseigneur Jacques, évêque de Sisteron, nous vous assignons le jour du 2 août pour procéder à l'élection de son successeur, etc. Nous vous intimons et signi fions qu'au cas de votre absence , nous entendons procéder à la susdite élection. —Donné à Sisteron, le 24 juillet 1210, etc. Rendez sans retard cette lettre au porteur » Au jour fixé, les chanoines de Forcalquier, au nombre de huit, savoir : Pierre de Saint-Maime , Bertrand Brochier, Bertrand Raimondi, Bertrand et Geoffroi de Lincel, Isnard Gasqui, Bertrand Levert et maître Jean de Sambuc, furent exacts au rendez-vous ; mais ce fut pour protester contre un vice de forme dans la convocation qui leur était faite. Six chanoines de Sisteron, seulement, savoir : le prévôt Jacques Bueymondi , le sacristain Bertrand Gantelmi , le précenteur Raimond Dauphin , Raimond d'Oppède, Guillaume du Pouchet et Bertrand de Villemus , se trouvèrent à cette première séance ; mais pendant le cours des débats qui durèrent huit jours et furent très animés, paraissent en outre les chanoines Bertrand de Saint-Marc, Renaud Fabri et les deux frères Justas ; en tout dix voix de Sisteron qui prirent part à l'élection ; ce qui explique tout naturellement le succès obtenu par le chapitre de Sisteron dans cette circonstance. Enfin le débat de la protestation vidé, le droit des chanoines de Forcalquier réservé et divers autres préliminaires remplis, l'assemblée capitulaire continue ainsi : « Après ce qui précède , les prévôt et chanoines de Siste ron et de Forcalquier continuèrent leur délibération ce jour-là et jusqu'au lendemain matin à l'heure du chapitre. Ce lendemain, ces mêmes prévôt et chanoines, assemblés dans le chœur de l'église de Sisteron, protestèrent en commun et chacun en particulier, que dans l'élection qu'ils allaient faire, ils n'entendent se trouver en contact avec aucun excommunié, suspens ou interdit, ni élire quelqu'un frappé d'empêchement, suivant le droit , la coutume ou le règlement, et par suite, requièrent quiconque se trouverait dans pareil cas, ou serait pour autre motif, étranger aux deux colléges électoraux, de sortir du chœur et de ne point participer à l'élection dont il s'agissait. Cela fait, les sieurs membres des susdits chapitres continuèrent dès ce jour et cette heure à délibérer, puis ren voyèrent la séance au lendemain et à la même heure. Alors la messe dite , il fut résolu entre eux , et d'une commune voix, que l'élection se ferait par voie de compromis, ce qui eut lieu de la manière suivante : « L'an du Seigneur 1310, et le 9 août, indiction VIIIe, dans le chœur de l'église de Sisteron, s'assemblèrent les susdits prévôt et chanoines tant de Sisteron que de Forcalquier, et l'on procéda à l'élection de la manière que voici : » Au nom du Seigneur. Ainsi soit-il ! L'an du Seigneur 1310, le 9 du mois d'août, VIIIe indiction. A tous faisons savoir que le siége de Sisteron étant vacant par la mort de Révérend Père en Christ , Jacques , de bonne mémoire , évêque de Sisteron , tous et chacun les prévôt et chanoines de Sisteron et de For calquier, durent , selon le droit et la coutume, être appelés pour élire aujourd'hui dans cette même église un évêque et pasteur. Lesdits prévôt et chanoines des Eglises de Sisteron et de Forcalquier, furent les soussignés : Messire Jacques Bueymondi , prévôt de Sisteron et messire Bertrand Gantelmi , sacristain de Sisteron , et les chanoines de Forcalquier, Pierre de Saint-Maime , sacristain de Forcalquier ; Raimond Dauphin , précenteur de Sisteron ; Bertrand Brochier, précenteur de Forcalquier ; Raimond de la Mure , chanoine de Siste ron; Bertrand de Raimond, chanoine de Forcalquier; Mevolhon de Justas , chanoine de Sisteron , en son nom et au nom de messire Guigues de Justas , chanfine de Sisteron , son frère, dont il a la voix ; Bertrand de Lincel , chanoine de Forcal quier ; Raimond Fabri , chanoine de Sisteron ; Isnard Gasqui , chanoine de Forcalquier; Raimond d'Oppède, chanoine de Sisteron ; Guillaume du Pouchet , chanoine de Sisteron et de For calquier ; Bertrand de Villemus , chanoine de Sisteron et de Forcalquier; Geoffroi de Lincel, chanoine de Forcalquier; Bertrand de Saint-Marc , chanoine de Sisteron ; Bertrand Levert et maître Jean de Sambuc , chanoines de Forcalquier, se sont assemblés dans le chœur de l'église de Sisteron , et trai tant entre eux aux fins de l'élection à laquelle il devait être procédé, il a plu aux susdits prévôt et chanoines de Sisteron et de Forcalquier, à tous et à chacun, à l'unanimité des suffrages, de procéder à ladite élection par voie de compromis. Ce mode d'élection ayant été accepté par tous, ils ont d'une voix unanime, nommé pour compromissaires, vénérables et discrètes personnes Jacques Bueymondi, prévôt de Sisteron, Bertrand Gantelmi , sacristain de la même Eglise, Pierre de Saint-Maime, sacristain de Forcalquier, et Bertrand de Lincel, chanoine de Forcalquier, tous ici présents et acceptants, les susnommés leur donnant et concédant d'un commun accord , le plein , général et libre pouvoir d'élire en leur nom et en ce lui de leurs commettants, une personne idoine et digne pour pasteur et évêque, prise toutefois au sein des chapitres de Sisteron ou de Forcalquier, promettant les chanoines susnommés de regarder et tenir pour évêque et pasteur, celui que les susdits mandataires auront élu en la forme susdite. Et pourra, l'un des commissaires, en son nom et au nom des autres mandataires et des chanoines de Sisteron et de Forcalquier, faire connaître publiquement au clergé et au peuple les résultats de l'élection, que les autres commissaires approuveront, ratifie ront et homologueront sans difficulté. Il est expressément dit et convenu entre le prévôt et les chanoines susnommés, que le présent mandat et pouvoir desdits arbitres compromissaires ne durera qu'un jour, celui d'aujourd'hui. » Furent témoins appelés et requis dans le chœur de la cathédrale de Sisteron, messire Pierre de Brémond, messire Sauveur Garcin , messire Reybaud Columbi , prêtres de ladite Eglise, et Bertrand Guarembert ,notaire à Sisteron. » Incontinent, les commissaires arbitres se retirèrent à part, et après mûre et approfondie délibération et discussion, ils élirent d'une voix unanime pour évêque et pasteur de Sisteron, vénérable personne, messire Raimond d'Oppède, chanoine de Sisteron, confiant lesdits commissaires à vénérable personne messire Bertrand de Lincel, chanoine de Forcalquier, le soin de faire connaître à son tour au clergé et aux fidèles ladite élection, de la publier solennellement, et de pourvoir de la vacance du siége de Sisteron la personne dudit messire Raimond d'Oppède, tant en son propre et privé nom qu'au nom de tous ceux et chacun lesdits chanoines de Sisteron et de Forcalquier et des chapitres desdites Eglises. » En conséquence , il fut procédé comme il suit à l'élection solennelle de Raimond d'Oppède : — Au nom du Père , du Fils, et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. L'Eglise de Sisteron étant vacante par la mort de monseigneur Jacques Gantelmi , de bonne mémoire, nous les chanoines de Sisteron et de Forcalquier, avons donné nos pouvoirs aux compromissaires de nommer un évêque mais leur pouvoir ne devant durer qu'un jour. Finalement, après plusieurs entretiens avec diverses personnes, nous tous, sous l'inspiration de la grâce divine, avons dirigé nos voix sur vénérable personne, messire Raimond d'Oppède , chanoine de Sisteron , homme prudent et savant, recommandable par sa vie et ses bonnes mœurs, élevé à l'ordre de la prêtrise, né de légitime mariage, habile administrateur des choses spirituelles et temporelles. En conséquence, moi , Bertrand de Lincel , chanoine de Forcalquier, en mon nom, au nom de mes collègues, chanoines de Sisteron et de Forcalquier, dont je suis le mandataire durant le temps par eux préfixé, je nomme et choisis Raimond d'Oppède, évêque et pasteur de l'Eglise de Sisteron. Le prévôt et tous les chanoines de l'Eglise de Sisteron et de Forcalquier, ont loué et approuvé cette élection et ont solennellement entonné le Te Deum. Le Te Deum fini , ledit Bertrand de Lincel , de par les pouvoirs ci-dessus à lui remis , publia en grande pompe l'élec tion faite dans l'église de Sisteron pour qu'elle fût notifiée au clergé et aux laïques » Fait à Sisteron, le jour, mois et an susdits et ont signé, comme témoins, les sieurs Reybaud Columbi, Etienne d'Amphoux, etc., etc. Moi, Bertrand Boursier, notaire public dans le comté de Provence et de Forcalquier, ayant assisté à tout ce qui précède, et de ce requis, ai dressé le présent instrument et l'ai revêtu de mon cachet accoutumé. » Ou nous sommes bien trompé, ou cette pièce valait la place que nous lui avons faite : elle jette un jour rétrospectif sur les vieilles querelles qui ont si longtemps déchiré l'Eglise de Sisteron. Disons maintenant ce que l'histoire rapporte des actes épiscopaux de Raimond d'Oppède. L'année qui suivit son élection, il reçut le serment d'hommage et de fidélité que les habitants d'Ybourgues lui prêtèrent, genoux fléchis et mains jointes. Le 14 septembre 1314, eut lieu entre lui et Béatrix, veuve de Justas, seigneur de Peipin, une convention au sujet d'une meunerie sur la Durance. Frère Guillaume de Bérenger, moine de Saint-André, lui est présenté le 2 octobre 1316, par l'abbé Bérenger, pour l'église de Saint-Michel. On croit avec beaucoup de raison que ce prélat, au mois de juin 1326 accompagna son métropolitain, Jacques, archevêque d'Aix, se rendant au concile de Saint-Ruf à Avignon. Les statuts de ce concile, longtemps peu connus, ont été publiés d'après les archives de l'évêché de Digne, par Pierre Gassendi, à la suite de son opuscule : Noti fia Ecclesise Diniensis. On ignore la date de la mort de Raimond d'Oppède : elle eut lieu du moins avant 1330. Il portait pour armoiries : d'azur, à deux chevrons rompus d'argent.
44. — ROSTAING (1330-1346). Rostaing succéda à Raimond d'Oppède, de qui on ne sait plus rien depuis le concile de Saint-Ruf (1326). L'année où il commença d'occuper est incertaine, car le premier acte que nous connaissons de lui, c'est sa reconnaissance et son hommage au roi Robert d'Anjou, en 1330 ; d'après le livre ou registre en parchemin, folio 278. En 1336, il obtint la confirmation du don que Raimond Bérenger, comte de Provence, avait fait jadis à son Église du bourg de Revest, et voulut que le titre de la donation fût copié de la main du secrétaire du roi et fût remis en ses mains. Le 13 septembre 1337, il fut présent avec son métropolitain et les évêques ses comprovinciaux à un concile des trois provinces qui se tint à Saint-Ruf. Enfin, en 1346, nous voyons que son official a une difficulté avec celui d'Aix. Quand nous aurons dit que Rostaing était en même temps évêque de Sisteron et abbé de Cruis, nous aurons épuisé tout ce que les annalistes ont écrit sur son compte.
45. — PIERRE AVOGRADO (1349-1360). Pierre était issu de l'une des plus anciennes familles de Lombardie, établie depuis plusieurs siècles dans le Verceillois. Elle reçut le nom d'Avogadro {avocat) parce qu'elle était, dès le XIIe siècle, chargée des affaires contentieuses du clergé et qu'elle descendait de Gualonus de advocatis. Jusqu'à nos jours, elle a fourni à la jurisprudence et à la littérature italienne plusieurs personnages remarquables. Né à Verceil, Pierre Avogrado embrassa d'abord l'institut des Prêcheurs, d'où il fut tiré pour occuper le siége d'Albe, en Italie, le 7 février 1337, d'après Ughelli, tome IV de son Italia sacra. Douze ans après, il fut transféré à Sisteron (1349), d'après les registres du Vatican. Combien de temps gouverna-t-il cette Eglise? On l'ignore. Rien ne s'oppose à ce qu'il l'ait occupée jusqu'en 1360, puisque, jusqu'à cette date, il n'a pas de successeur connu.
46. — GÉRAUD IV (1363). Lorsque Urbain V voulut canoniser et proposer comme modèle aux fidèles, Delphine, épouse d'Elzéar, comte d'Arian, il choisit quelques prélats parmi ceux que recommandaient le plus leur piété et leur prudence, pour informer de la vie et des miracles de la sainte femme , qui avait gardé la virginité même en mariage. Du nombre de ces prélats fut Géraud , de Sisteron. Selon Jean Columbi , il déclina cette mission dans les termes que voici : « Je suis très fâché de ce qu'il ne m'est pas possible, dans une mission si honorable, de me joindre à vous (il écrit à l'archevêque d'Aix et à l'évêque de Vaison). Depuis quelque temps je travaille à mettre de l'ordre dans mon diocèse et à y rétablir la discipline, bien déchue par suite de l'absence des évêques. Pour y parvenir, il me faut encore beaucoup de temps, et je ne saurais interrompre ce travail qu'au grand détriment des âmes que Dieu a confiées à ma sollicitude ; tout ce que j'ai déjà heureusement accompli croulerait et serait inutile, si je ne l'achève. Donné en notre château de Lurs, le 18 mars 1363. Ces paroles, certes, donnent une haute idée de l'estime que faisait notre prélat de ses devoirs pastoraux; la forme latine en est très belle et prouve que Géraud était un des lettrés de son temps. On peut aussi conclure du texte de cette lettre que Géraud occupait déjà depuis quelques années le siége épiscopal de Sisteron. Columbi , que nous suivons ici, ne permet pas de supposer que ce digne pasteur ait siégé longtemps, et lui donne un successeur dès l'année suivante. N'ayant pas de preuves, nous donnons cette succession pour ce qu'elle vaut. Ce qui est certain, c'est que la présence d'un Géraud , évêque de Sisteron , est mentionnée dans les actes du concile qui se tint à Apt du 14 au 30 mai 1365, et où se trouvèrent avec leurs métropolitains les évêques des provinces d'Aix, d'Arles et d'Embrun. Ce Géraud n'est-il pas le même que celui qui est indiqué plus loin sous le nom de Géraud V. Nous serions tentés de le croire, car les deux évêques suivants méritent peu de confiance.
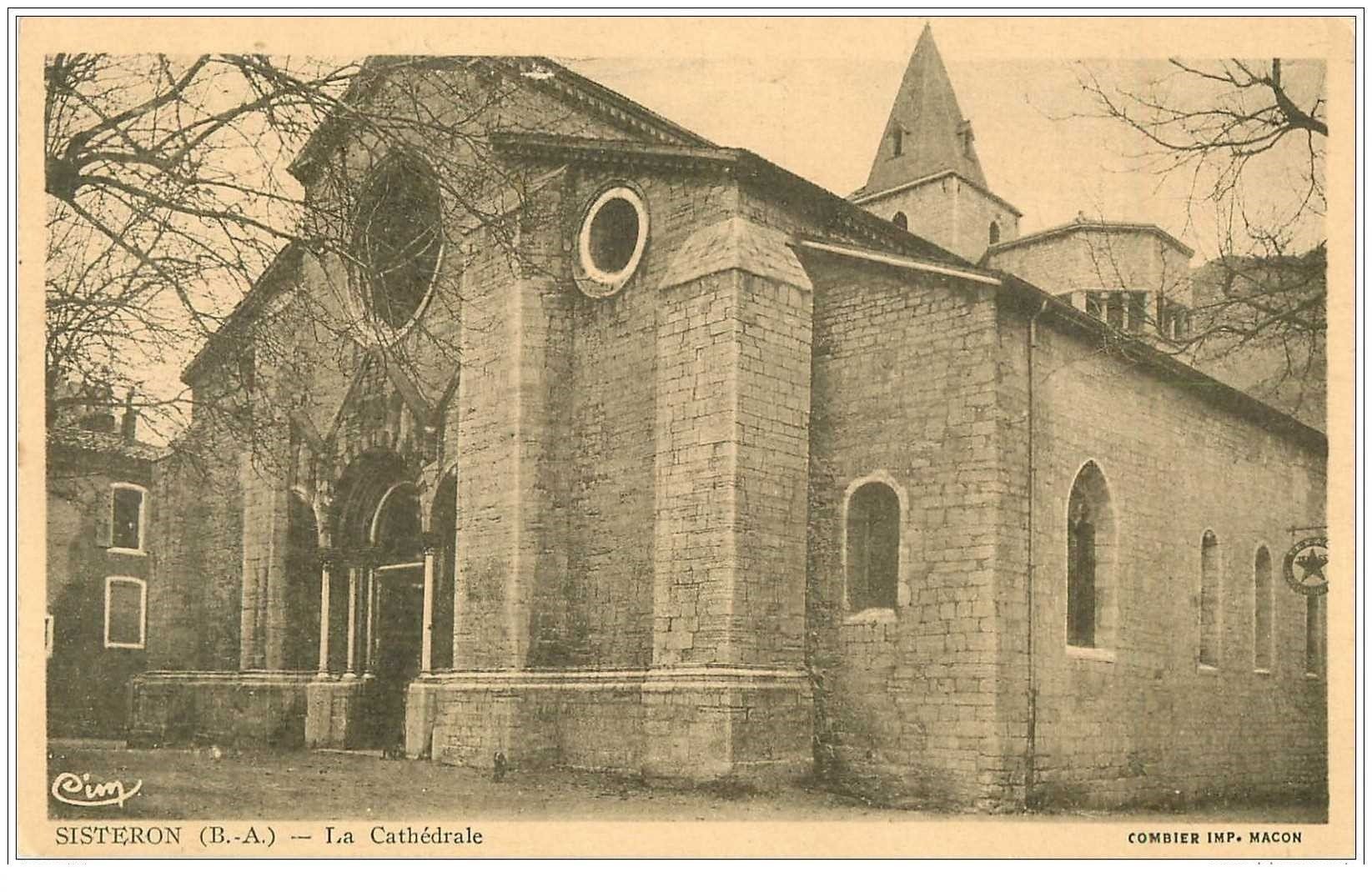
47. — PIERRE VII (1364). Cet évêque est mentionné sous l'année 1364, dans les chartes des Carmes de Manosque : ceci toujours d'après Columbi, qui, non-seulement a écrit l'Histoire de l'évêché de Sisteron, mais a fait aussi la monographie de Manosque, sa ville natale.
48. — BERTOLD (1365). Dans la bulle d'or de l'empereur Charles IV , Bertold , évêque de Sisteron, est qualifié chancelier de la cour impériale, à la place de Conon de Falkenstein, archevêque de Trêves. Nous devons avouer que ces deux derniers évêques, qui n'ont pas siégé un an entier chacun , nous paraissent fort suspects. Bertold surtout nous paraît être, par son nom, d'origine allemande, et nous ne nous expliquons pas comment un allemand serait, à cette époque, devenu évêque de Sisteron.
49. — GÉRAUD V (1365-1367). On voit par les notices des quatre évêques qui précèdent combien peu sont abondants les documents de l'Eglise de Sisteron à cette époque. Cependant de graves événements se pasaient : les troubles occasionnés par la reine Jeanne de Naples et comtesse de Provence ; une invasion de la peste ; l'irruption des compagnies de pillards aventuriers commandés par Arnaud de Cervole (Varchiprêtre) ; la translation du Saint-Siége à Avignon ; les Malandrins , Brabançons , Tard-venus ; tout cela n'a pu arriver en Provence sans que l'évêque de Sisteron y ait été mêlé plus ou moins directement : la mission divine du premier pasteur était alors de protéger, de combattre et de consoler; espérons que Pierre VI, Géraud IV, Pierre VII et Bertold n'y auront pas manqué. A cette espérance joignons le regret de ne pouvoir, faute de documents, payer à leur mémoire le tribut de reconnaissance qu'ils méritèrent. Géraud V assista, du 14 au 30 mai 1365, au concile d'Apt, dont les actes ont été publiés par dom Martène, et imprimés avec quelques variantes à la fin du tome Ier du Clergé de France, par Hugues Dutems. Cette assemblée comprit, avec les métropolitains d'Aix, d'Arles et d'Embrun , les évêques de ces trois provinces. D'après Columbi, notre prélat ne survécut guère à ce concile, car, dit-il, j'ai lu dans le journal des consuls de Manosque qu'il mourut en 1367, et que quatre membres du conseil se rendirent à Lurs pour assister, au nom de toute la ville, aux obsèques de leur évêque : honneur que nous ne voyons pas avoir été rendu à nos prélats avant lui. C'était justice toutefois. Alors que des aventuriers serraient les remparts de Sisteron , l'évêque et tout son clergé contri buèrent de leurs deniers à réparer les fossés et les murailles (peut-être les ennemis étaient-ils les corps commandés par le prince d'Orange de la maison des Baux). Maintenant , ce Géraud est-il différent de celui qui siégeait en 1363? Question insoluble. Si on répond négativement, Pierre VII et Bertold seraient éliminés.
50. — RENOUL ou RAINULFE DE SELVE DE MONTRUC (1370-1382). Renoul , né dans le Limousin et fils d'Etienne de Montruc et peut-être de Montrol , qui avait épousé une sœur du pape Innocent VI, avait pour oncle le cardinal Pierre de Montruc, évêque de Pampelune. C'est le 26 janvier 1370 qu'il fut élevé à l'épiscopat, d'après le registre d'Urbain V, où nous lisons que l'Eglise de Sisteron vaquait par la mort de Géraud. Est-il dès lors croyable que l'on eut laissé le siége de Sisteron sans titulaire depuis 1367 jusqu'en 1370? Non , il est à croire que Columbi a placé trop tôt la mort de Géraud , qui a dû vivre jusque tout près de 1370. Le nouveau prélat, que ses bulles qualifient de chanoine de Tournay et de docteur en dé crets, fit, en 1372, à Manosque, la consécration solennelle de l'église Saint-Sauveur, que l'on venait de reconstruire de fond en comble. Il est nommé, en 1371, dans les actes publics de Rostaing Bonnet. Le 18 septembre 1378, le pape Urbain VI le fit cardinal du titre de Sainte-Pudentienne et le nomma régent de la chancellerie pontificale pour suppléer son oncle , Pierre de Montruc, qu'il ne voulut pas dépouiller de sa dignité , quoique celui-ci eût embrassé le parti de son compétititeur à la tiare. Urbain VI était guidé en cette circonstance par la vieille amitié qui le liait à Pierre de Selve de Montruc, avec lequel il avait étudié à Avignon , comme l'indique Baluze dans la Vie des Papes d'Avignon. Le nouveau cardinal fit alors le voyage de Rome et passa à Pise, car les partisans de Clément VII lui fermaient la voie de mer. La Chronique de cette ville le marque d'une façon toute particulière. Renoul ou Rainulfe institua des religieux dans son église cardinalice. Renoul mourut à Rome le 15 août 1382, et fut enseveli près de la porte de l'église de Sainte-Pudentienne, sous un tombeau de marbre avec cette inscription : Hic jacet Reveren. Pater dominus Rainulphus, tit. S. Pudentianse presb. card. natione Lemovicen. de genere D. Innocen. PP. VI, qui in hoc titulo suo monachos constituit... an MCCCLXXXII, die XV mensis augusti. « Ici gît Révérend Père seigneur Renoul , cardinal-prêtre du titre de Sainte-Pudentienne , limousin de nation et de la famille du souverain Pontife Innocent VI, qui établit des moines dans cette Eglise, de son titre... 15 août 1382. » Jean Columbi , dans son Appendice aux Nuits de Blanchelande, fait observer que Renoul est appelé Borse , et non pas Selve. Cela n'empêche pas que dans les archives de Sisteron il soit nommé de Montruc, et que dans son testament il ne soit appelé de Cruc. Nous devons dire aussi que la plupart des auteurs le nomment Renoul de la Gorze, du nom d'un hameau dépendant aujourd'hui de la commune de Château-Ponsat, ar rondissement de Bellac (Haute-Vienne). Renoul de Selve de Montruc portait pour armoiries : mi- parti, au 1er d'or, au chevron de gueules accompagné en chef de deux étoiles de sable , et en pointe d'une montagne à six coupeaux du même, au 2% de gueules, à un rameau d'or.
51. — JACQUES ARTAUD DE (MEZEL (1383-1403). Jacques Artaud, appelé de Mezel parce qu'il avait pris naissance dans ce bourg, situé à quinze kilomètres de Digne, appartenait à une bonne famille de la province de Dauphiné, établie à Apt. Evêque de Saint-Paul-Trois-Châteaux depuis le 30 juillet 1364, il avait à ce titre assisté en personne au concile provincial, tenu à Apt en mai 1365. Il fut, à la fin de cette année, appelé à l'évêché de Gap ; mais, après sa translation, les chanoines de Saint-Paul-Trois-Châteaux ne pouvant pas s'accorder sur le choix du successeur à lui donner, le pape Urbain V chargea Jacques de gouverner cette Eglise en qualité d'administrateur; et Jacques conserva ce titre jusqu'à la fin de 1367, ainsi qu'il résulte des lettres données par lui, le 18 octobre de cette année, à Pierre de Robin, prêtre et hebdomadier de Saint-Paul-Trois-Châteaux, qui avait été chargé de la chancellerie de l'évêché , pour certifier que cet ecclésiastique avait rendu un bon et légal compte de sa gestion. Cette même année, Jacques avait transigé avec les bourgeois sur les priviléges municipaux, et les avait confirmés. A peine avait-il pris possession du siége épiscopal de Gap, que de graves différends s'étaient élevés entre lui et les habi tants de cette ville, au sujet d'une somme de trente mille florins qu'il disait avoir avancés pour éloigner du diocèse des bandes armées qui voulaient le traverser pour se rendre en Provence. Les Gapençais, d'accord avec les autres vassaux du prélat, soutinrent que jamais pareille somme n'était sortie de la bourse de Jacques, dont l'official, n'osant comparaître devant les commissaires délégués par Urbain V, fut condamné par défaut le 13 mars 1367. A cette même époque, il eut à défendre ses terres contre les prétentions d'Arnaud de Trian, neveu du pape Jean XXII, et depuis peu seigneur de la vicomté de Tallard , mais grâce à la médiation de Rodolphe de Colmiers, seigneur de la Bâtie de Champrond, les contendants et leurs vassaux signèrent un traité de paix le 28 avril 1369. Ses démêlés avec les habitants de Gap durèrent malheureu sement plus longtemps , ils ne prirent un terme que par les soins de François de Borelli , frère Mineur et grand inquisiteur de la foi dans les provinces d'Arles, d'Aix, d'Embrun et de Vienne. Par une transaction qui devint sa grande charte, et qui fut signée le 7 mai 1378 , la ville de Gap fut maintenue dans ses libertés et priviléges, et surtout dans son droit de s'imposer sans être tenue de soumettre à l'approbation d'au cune autorité , les rôles de ses contributions. Le seigneur évêque déchargea, sans avoir égard à ces priviléges, la noble dame Françoise de la Bréoulle, de la part qui lui incombait dans une contribution pour les fortifications de la ville. Les consuls protestèrent contre la dispense accordée par l'évêque, la regardèrent comme nulle et non avenue, et persistèrent à exiger la contribution de la dame. Après de longs débats, la transaction du 7 mai 1378 régla les droits des uns et des autres. Jacques Artaud jura sur les saints Evangiles, tant pour lui que pour ses successeurs, de respecter et d'observer inviolablement toutes les conditions de ce traité, ce qui prouve que la souveraineté temporelle des évêques de Gap était alors fort limitée ; il retira à Françoise de la Bréoulle l'exemption qu'il lui avait donnée, et la noble dame, replacée sous la loi de l'égalité, se vit obligée, comme les bourgeois et les manants, de contribuer à l'entretien des murailles de la ville. Malgré cet acte, de nouvelles difficultés s'élevèrent entre le prélat et les bourgeois de Gap, qui chassèrent, en 1382, quelques-uns de ses officiers pour ne pas en avoir exécuté les dispositions. Jacques transféra alors sa cour de justice à Lazer; mais enfin, grâce encore au frère Borelli, un traité de paix fut signé le 15 mai 1483 au château de Tallard-le-Vieux, et Jacques, par l'ordre du souverain Pontife lui-même, Clément VII, fut obligé de rétablir à Gap le siége de sa juridiction. Fatigué de tant de luttes, Jacques Artaud demanda à passer dans un nouveau diocèse, et celui de Sisteron étant vacant par la mort du cardinal Renoul de Selve ou de la Gorze, depuis le 15 août 1382, il lui fut donné au mois de juillet de l'année 1383. Jacques gouverna cette Eglise avec un peu plus de tran quillité. Le premier acte qu'on a de lui est une ordonnance pour la promulgation d'un bref pontifical qui soumettait les prêtres et les clercs à diverses taxes destinées à la restaura tion des murailles de Manosque. On le trouve mentionné comme présent à une charte donnée, le 10 décembre 1385, en faveur de la ville d'Arles, par Louis, roi de Sicile et comte de Provence. Les autres personnages , dont la présence est marquée dans cet acte, sont Jean le Fèvre, évêque de Chartres, chancelier de ce prince; Raimond d'Agoult, seigneur du Sault, grand-chambellan; Foulque d'Agoult, vicomte de Reillane, sénéchal de Provence; Robert de Dreux, Lionel de Coësme, chevaliers français, chambellans du roi ; Elzéar, seigneur d'Oraison; François, seigneur de Baux; Foulque de Pontevez, seigneur de Vaux, de Cotignac, de Carcès et de Barrème ; Blacas de Pontevez , seigneur de Château-Renard ; Gui de Simiane, seigneur de Caseneuve, et plusieurs autres nobles gentilshommes. Les Observantins de Manosque avaient vu leur couvent détruit en 1358, par les bandes dévastatrices de l'archiprêtre Arnaud de Cervolle. Ces religieux, voulant se mettre à l'abri de nouvelles incursions, s'étaient réfugiés dans l'enceinte même de la ville, avec l'approbation du Saint-Siége. En juin 1360, les consuls, au nom de la communauté, et Donando, bailli de Manosque, leur concédèrent un emplacement vers l'ancienne rue des Juifs, pour la construction de leur nouveau monastère. Plusieurs années s'écoulèrent avant que les religieux pussent être mis en possession du terrain qui leur avait été concédé. Le chapitre de Forcalquier et l'évêque de Sisteron avaient suscité divers obstacles ; le premier leur refusait une place ou cour pour le couvent, le second persistait à ne pas vouloir leur accorder un cimetière particulier. Artaud de Mezel finit cependant par entendre raison, et, en 1387, il bénit en personne le cimetière de cette communauté. Cette même année, par suite d'un violent incendie qui avait consumé une grande partie de la ville de Sisteron, les rentes que les ecclésiastiques avaient sur les maisons incendiées ne pouvaient plus leur être payées intégralement par les habitants : il résulta de cet état de choses de vifs et longs débats dont le premier effet était d'empêcher la reconstruction. Sur la plainte du conseil de ville, la reine Marie en écrivit au pape Clément. Celui-ci délégua, pour faire droit, le cardinal de Sainte-Suzanne. Une bulle adressée à l'official de Sisteron et au prieur de Gigors, enjoignit aux ecclésiastiques de consentir, sous peine d'excommunication, telle réduction sur leurs créances qu'une amiable composition déciderait. La part que l'évêque prit à cette affaire nous est totalement inconnue, ainsi que son rôle pendant que le comte de Savoie, Amédée VII , menaçait le pays. Le 7 juillet 1389, il assista Marie, reine de Sicile, dans un compromis qu'elle conclut, avec Jean le Meingre, maréchal de France. Artaud de Mezel fut appelé, en 1403, à l'archevêché d'Arles, gar les soins de Louis II, roi de Sicile et comte de Provence. Installé sur ce siége métropolitain en février 1404, il posa, au nom du pape Benoît XIII, le 22 février de l'année suivante, la première pierre de l'église cathédrale de Carpentras, et, le 5 mars suivant, son nom figure sur un acte passé dans son palais en faveur de Michel Martin, maître apothicaire. Cette même année, il fit exécuter, pour y déposer le chef glorieux de saint Etienne, premier martyr, une châsse en vermeil qu'il enrichit de pierreries. Artaud paraît encore dans les hommages que lui rendirent, le 3 et le 27 septembre, Nicolas de Montfaucon et Bertrand du Puget, fils de Villebe de Foz. On le trouve également mentionné dans un acte du 19 septembre 1406, et dans une sentence arbitrale rendue le 15 janvier 1409, au château de Salon, sur un procès qu'il avait relativement à la terre de Saliers, avec les chevaliers hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Il y est qualifié d'archevêque d'Arles et de prince. Les actes du concile de Pise, publiés au tome VI du Spicilège de dom d'Achéry, page 362, comptent Arnaud au nombre des prélats qui se firent représenter à cette assemblée par des ecclésiastiques de leur diocèse. Benoît XIII, en considération des dommages que le diocèse de Toulon avait soufferts pendant le schisme, lui remit, par une bulle, une portion des dîmes, et Artaud, en qualité de métropolitain, donna, pour la promulgation de cet acte pontifical, des lettres scellées de son sceau, représentant d'un côté les figures de saint Etienne et de saint Trophime, et de l'autre ses armoiries, dont on ne peut, toutefois, préciser l'émail. Par un acte passé, en 1409, devant le notaire Pierre Bertrandi, le sacristain de la cathédrale d'Arles fut tenu de restituer, sur le prix de sa pension annuelle de 30 florins d'or, le prix de vases sacrés en argent, perdus par sa négligence, et ce jusqu'à concurrence de 20 marcs d'argent. Il était également fait mention de Jacques dans des actes reçus, le 10 juillet 1410, par Antoine Olivari ou Olivier, notaire à Arles; mais ce prélat mourut le samedi, 1er novembre de cette même année. Jacques Artaud de Mezel portait pour armoiries : d'azur, à trois chevrons d'argent, surmonté d'un lambel à trois pendants du même.
52. — ROBERT DUFOUR (1403-1437). Après Artaud, quelques auteurs placent un évêque du nom de Nicolas; mais comme ils n'en prononcent que le nom, et ne peuvent dire la moindre chose de son épiscopat, nous le leur laisserons pour arriver à Robert Dufour. Ce prélat, né à Courpière en Auvergne, ou selon d'autres historiens, à Craponne, dans le Vélay, occupait le siége de Sisteron en 1403, comme il appert de la collation d'une chapellenie faite par lui cette année dans l'église de Manosque. En 1404, il unit le prieuré de Saint-Martin d'Aigremont au prieuré de la Tour de Bevons. Le silence l'enveloppe ensuite jusqu'en 1414; alors, lui siégeant, les chanoines de Sisteron font une transaction avec les Frères Mineurs. Le 14 avril de l'année suivante , Louis II, roi de Sicile, confirma à Robert les priviléges de Lurs ; la charte de cette confirmation existe encore dans les archives d'Aix (Armoire, p. 283). Une petite communauté de religieux de Saint-Victor de Marseille, dont le supérieur prenait le titre de prieur, desservait à cette époque l'église de Notre-Dame de Manosque. Mais le prieur, au lieu de prendre lui-même le soin de sa paroisse, se substituait assez souvent un prêtre avec qui il traitait et à qui il donnait le moins possible. Robert Dufour voulut remédier à ces abus : il rendit, le 22 avril 1415, une sentence par laquelle, du consentement de Bertrand de Brancas, alors prieur, il établit dans cette église une vicairie perpétuelle, et sur la présentation que lui en fit le prieur, il en pourvut Antoine Fabri. Cette sentence ne fut pas longtemps exécutée, et l'on en revint bientôt aux vicaires amovibles qui coûtaient beaucoup moins. Robert Dufour, en 1417, unit à la prévôté de Forcalquier les revenus de l'église de Saint-Martin de Manosque : « Nous nous sommes assuré, dit-il, en parlant aux chanoines de sa ville cathédrale, par les priviléges et les concessions qui vous ont été faites, et par les actes publics que vous nous avez exhibés, que lorsque le village de Saint-Martin de Manosque était habité , et qu'il y avait par conséquent charge d'âmes, un certain Rostaing de Cabassole, alors prévôt de l'Eglise de Forcalquier, fit donation et concession à vous et à l'église de Saint-Mary de Forcalquier, de tous les droits et des dîmes de l'église de Saint-Martin. Mais comme le prieuré avait charge d'âmes, il y avait établi et fondé une vicairie perpétuelle, en assignant audit vicaire sur les droits et le produit des biens de cette église, un revenu fixe, pour qu'il pût vivre honnêtement, ainsi qu'il est indiqué plus au long dans l'acte de la susdite fondation. Présentement, nous avons été informé juridiquement et par la notoriété du fait, que depuis soixante ans et plus, ce village est totalement dépeuplé, et que par suite , il n'y a plus charge d'âmes, ni apparence qu'il y en ait jamais à l'avenir. Par ces motifs, considérant que la cause pour la quelle on avait fondé cette vicairie cessant, l'effet de ladite vicairie doit aussi cesser, nous annulons et la vicairie et son effet, nous l'unissons, l'incorporons et l'annexons à perpétuité, à la susdite prévôté de Forcalquier, incorporant aussi ladite église à la même prévôté, et cela par la teneur des présentes. » Robert confirma en outre la cession des cinq églises de Manosque faite au chapitre de Forcalquier par Jean d'Alain, l'un de ses prédécesseurs, quand il dit : « Les églises de Saint-Martin , de Saint-Sauveur de Manosque, de Saint-Jean du même lieu de Notre-Dame de Toutes-Aures hors des murs de la ville, celle de Montaigut et beaucoup d'autres, bâties dans la vallée de Manosque, ont été données et concédées à l'église de Saint-Mary avec tous leurs droits et leurs dîmes. » Le 14 janvier 1418, Andouin Giraudi, abbé de Lurs, lui jure obéissance; en 1423, il confirme la donation faite au chapitre de Forcalquier, par Bertrand II, et y ajoute d'autres concessions. Le 26 octobre de cette année , Robert donna de nouveaux statuts à son clergé , qui , paraît-il , en avait grand besoin ; en voici quelques-uns : « Nous statuons et ordonnons que les prêtres et autres ecclésiastiques ne portent que des vêtements honnêtes , ni trop longs ni trop courts ; qu'ils portent le chaperon à petit bec ou cornette, à moins qu'ils ne soient en voyage. Celui qui y manquera paiera 60 sous... Item. Nous défendons à tout clerc et à toute personne ecclésiastique de porter des épées ou des couteaux plus longs que ceux en usage chez les laïques... Item. Nous leur défendons de boire dans les cabarets, de jouer aux dés et à la paume avec les laïques sur les places publiques, de fréquenter les jongleurs et les baladins, de quitter les divins offices pour aller se promener en compagnie de femmes, de ne pas danser avec des hommes et des femmes dans les rues... Le saint synode, en approuvant ces statuts, peut cependant retenir ce qui est permis, c'est-à-dire les douze ecclésiastiques dans l'église, le jour de leur première messe. » Une autre réforme importante eut pour objet le chapitre de la cathédrale. Depuis longtemps, dit l'historien que nous aimons à citer, ce corps n'existait guère que de nom. Les chanoines, tous étrangers, à l'exception de deux, résidaient constamment à Avignon, où ils avaient d'autres bénéfices; quelques-uns même d'entre eux n'avaient jamais mis les pieds à Sisteron. Le service divin était abandonné, l'église ruinée, tout le mobilier délabré ou mis en gage, les biens du chapitre avaient été vendus ou détournés de leur destination. La maison épiscopale, celles du prévôt et des chanoines n'étaient plus habitables. Ce scandale avait donné lieu à de fréquentes et vives plaintes de la part de l'administration municipale. Vainement, sur les remontrances des députés envoyés à Rome à cet effet, le souverain Pontife avait chargé l'évêque de Marseille de remédier à ces désordres. Enfin, le 17 avril 1431, le pape Eugène IV délégua Aimon, archevêque d'Aix, et Bertrand Raoul , évêque de Digne, pour opérer cette réforme tant dans le chef que dans ses membres, par tous les moyens de droit, et à l'aide du bras séculier, si besoin était. Cités tous à comparaître à Sisteron, le 1er août suivant, évêque, prévôt, chanoines, bénéficiers, la plupart ne répondirent point à l'assignation : quelques-uns seulement s'adressèrent par voie d'appel à la chambre apostolique d'Avignon, se fondant sur ce que la réforme qu'on veut opérer n'est nullement l'effet du zèle, mais bien de la haine des commissaires et des syndics de la ville. Ceux-ci, selon eux, n'ont d'autre but que de les expulser de leurs places, pour y faire nommer des personnes du pays, leurs créatures, quoique gens de mauvaise vie et mœurs. Le choix du Saint-Père n'a pu tomber que par surprise sur deux prélats qui ignorent également la théologie et le droit canonique. En outre, l'évêque de Digne, à raison de certains démêlés entre le chapitre et les Cordeliers (l'évêque de Digne appartenait à cet ordre), avait pris en aversion l'Eglise de Sisteron, et avait plusieurs fois manifesté le désir de la voir détruire. A cela, les appelants ajoutent que la première chose pour un évêque dont la propre église tombe en ruines, serait de se réformer lui-même, avant de s'ingérer de réformer les autres. Mais un grief plus sensible touchait les opposants. C'était l'arrêtement des fruits de leurs prébendes et de la dîme dont ils accusent les syndics de disposer à leur gré. A les entendre, « c'est une horreur que le traitement qu'on leur fait subir; ils sont sous l'oppression, et l'assignation qu'on leur donne n'est qu'un véritable guet-apens, où ils courent risque de la vie. » Sans trop croire à ces craintes, Bertrand Chais, l'un des deux chanoines résidants, et le syndic Guillaume d'Aigremont, cherchent pourtant à les dissiper. Ils disent aux appelants que, malgré leur résistance à se soumettre, il est impossible qu'au fond du cœur, ils ne s'avouent coupables et ne reconnaissent leurs torts envers l'Eglise , « l'Eglise , cette tendre mère qui les a cependant si longtemps nourris de sa propre substance , dans l'espoir d'élever des enfants dignes d'elle , espoir, hélas ! auquel ils ont si mal répondu. » L'absence des chanoines fut facilement établie par un grand nombre de témoins. Il ne fut pas plus difficile de constater le délabrement du mobilier de la cathédrale, la dilapidation du temporel et surtout les ruines qui, de toutes parts, envahis saient la cathédrale, « ce vénérable monument que la tradition recommandait à la piété des fidèles , comme l'œuvre de Charlemagne. » L'inventaire du mobilier à réparer offre vingt-sept orne ments de soie et plusieurs objets en argent, tels que croix, re liquaires , crosses , ciboires , deux paires de burettes , et quatorze calices. Un des témoins parle d'une figure de sainte Marthe, de même métal, récemment fabriquée et que noble Dominique Bourgogne, marchand de Sisteron, retient en gage pour sûreté de quelques avances faites par lui à l'église. Parmi les livres inventoriés, la plupart déchirés et sans couvertures, on distingue une Bible en deux volumes, un grand Bréviaire , sept Missels , deux Légendaires , plusieurs Processionnaux et un seul Psautier, en si mauvais état, qu'il n'est presque plus possible de s'en servir pour psalmodier. Du reste, les experts font observer que le défaut d'un emplace ment convenable pour la librairie, est cause qu'une quantité de bons livres appartenant à l'église, ont été ou vendus ou dé truits. Il est dit que l'orgue manque de volets ou au moins de rideaux nécessaires à sa conservation. Les revenus du chapitre sont évalués à cent charges de blé de toutes qualités (valant aujourd'hui 3,000 francs), à 1,800 coupes de vin valant alors 2 sous la coupe (2 fr. 50 d'aujour d'hui, soit 4,500 francs), à 235 florins (soit 4,700 francs) et 70 livres d'argent (1 ,750 francs), au total, 13,950 francs de notre monnaie, sans compter ce que le casuel venait ensuite ajouter à cette somme. Le procès durait depuis plusieurs mois , sans que l'évêque de Sisteron eût comparu. La sentence rendue l'année précédente par l'évêque de Marseille, le rappelait à l'obligation de célébrer au moins les jours de grandes solennités dans sa cathédrale, suivant une transaction de 1285. Cette obligation résulte en effet de la transaction ; mais l'évêque d'alors ne s'y était soumis qu'en retour de l'abandon que le chapitre lui fit de certains droits, et comme la sentence privait l'évêque actuel de ces mêmes droits pour en investir de nouveau le chapitre, Robert Dufour refusa constamment son adhésion à la réforme ; toutefois , nonobstant son opposition , il fut passé outre. L'évêque, le prévôt, les chanoines absents furent tous déclarés contumaces, et le 14 décembre 1431, l'évêque de Digne prononça la sentence définitive de réforme, qu'il signa le 26 du même mois. Les nouveaux statuts qu'elle consacre , basés en grande partie sur ceux de 1259, renferment soixante-dix ar ticles, dont voici quelques-uns. La transaction de 1285 est remise en vigueur quant à l'obli gation imposée à l'évêque de célébrer les jours de grandes fêtes à Sisteron , le dispensant néanmoins de payer comme au paravant 25 sous (31 fr. 25 c.) au chapitre, chaque fois qu'il négligeait d'y paraître. La cour ou juridiction épiscopale qui se tenait à Lurs , sera transférée à Sisteron. Le nombre des bénéfices sera porté de huit à douze, y compris les deux curés , au traitement annuel de dix livres et leur part dans la distribution des revenus du chapitre. Il y aura aussi quatre enfants de chœur, lesquels , selon l'usage , seront payés du produit des anniversaires. La moitié des prébendes des membres du chapitre non résidants appartiendra désormais à la fabrique et à ceux des membres qui résideront. Nul ne pourra, à l'avenir, être bénéficier, s'il n'est ordonné prêtre. Le prévôt et les chanoines absents sont condamnés à abandonner à la fabrique une année de leur revenu, et à donner chacun un ornement de la valeur de 12 livres (300 francs) au moins, attendu le triste état où se trouve le mobilier de l'église. Dans le délai de cinq ans, le prévôt sera tenu d'acheter ou de faire construire dans les limites du cloître, une maison appropriée à sa dignité. Aucun membre du chapitre n'entrera dans l'église , s'il n'est décemment vêtu et chaussé, et avec la robe affectée à chaque saison, sous peine de 5 livres d'amende (125 francs). Hors de l'église, les ecclésiastiques porteront également des habits convenables, descendant au moins jusqu'à mi-jambes; ils ne fréquenteront ni les bals, ni les cabarets, et ne joueront point aux dés, sous peine de 25 sous d'amende payables au chapitre. Dès la Toussaint, le sacristain veillera à ce que le chœur soit suffisamment garni de paille, et pendant la rigueur de l'hiver, il allumera du charbon pour qu'on puisse s'y réchauffer. Les jours de fête et la semaine où ils seront de service, les prêtres , diacres et sous-diacres se feront raser la barbe et la tonsure, sous peine de perdre la rétribution de ces jours-là. Le chapitre retirera, sous peine d'excommunication, l'image de sainte Marthe qui est en gage entre les mains de noble Dominique Bourgogne. L'avant-dernier de ces statuts porte que les commissaires réformateurs instruits de ce que la plupart des personnes attachées à l'église, même les enfants de chœur, n'ont aucune connaissance de la musique, sans laquelle le culte divin ne saurait être dignement représenté, il est enjoint à tous ceux qui ignorent cet art, de l'apprendre dans le délai qui doit s'é couler, depuis le jour de la publication du présent statut, jusqu'à la fête de la Pentecôte prochaine, sous une peine qui sera fixée par l'évêque. Ce statut, nous dit M. de la Plane, donna souvent lieu à des contestations où la justice fut obligée d'intervenir. La plus singulière est celle qui s'éleva vers la fin du XVIIe siècle, entre l'économe du chapitre qui , dans les termes du statut de 1431 , voyait la musique proprement dite, dans toute la rigueur de l'acception et les bénéficiers qu'en conséquence de cette interprétation, on voulait contraindre à chanter « la musique mensurale, figurée, à chœur réglé à quatre parties. » Les bénéficiers prétendaient n'être tenus qu'à la connaissance du chant grégorien ou plain-chant, soutenant que la musique, telle qu'on entendait la leur imposer, inconnue à l'époque de la réforme de 1431 , ne datait que du règne de Louis XII , « où elle fut trouvée par deux célèbres musiciens du temps, Josquin des Prez et Mouton ; » à quoi l'économe répond : « que sans doute, Josquin a été un fameux musicien, comme Orlande, comme Brumel, mais qu'il n'est point l'auteur de la musique figurée ; cet art depuis l'invention de la gamme, par l'abbé Guido d'Arezzo, dans le XIe siècle, étant toujours allé en se perfectionnant jusqu'à Josquin qui n'a fait que renchérir, comme de nos jours, poursuit l'économe, on vient d'ajouter à l'ancienne gamme, la note du si qui rend la musique si facile.» Malgré la merveilleuse découverte du si, malgré tous les avantages qu'elle offre pour l'étude de la musique, les bénéficiera n'en continuèrent pas moins à résister aux prétentions de l'économe, et à nier avec quelque raison, il faut le dire , la possibilité d'apprendre cet art dans le court espace de temps fixé par la réforme; mais rien n'y fit, et force leur fut de devenir musiciens malgré eux. Le parlement, devant qui l'affaire fut portée, donna gain de cause à leur adversaire. Millin, à qui le président Fauris de Saint-Vincens avait communiqué les pièces de ce curieux procès, y trouve la preuve de l'ancienneté de la musique travaillée en France; « ce qui est incontestable, puisque , dit-il , les bénéficiera de Sisteron qui se soumettent à apprendre le plain-chant furent déclarés, par arrêt de parlement, dans l'obligation de savoir la musique, suivant ce qui se pratiquait avant 1431 {Dict. des Beaux-Arts, article Plain-chant). Après la sentence de Bertrand Raoul, évêque de Digne, Robert Dufour, évêque de Sisteron, ne se tint pas pour battu. Il appela en cour de Rome de la décision de son collègue. Mais la ville , craignant que de nouvelles lenteurs ne vinssent aggraver le mal , lui fit proposer un accommodement. Le pré lat se montra difficile, exigeant, et il ne fallut rien moins, pour le radoucir, que mettre à sa disposition un nouveau palais épiscopal. A ce prix, il renonça à son appel, et souscrivit à la réforme (1431 , Ecritures de Raimond Raimondi, notaire apostolique). Robert vint alors à Sisteron, où il fut accueilli avec tous les égards dus à son rang. On lui offrit même deux repas, dont les comptes du clavaire de la ville nous ont con servé le menu. En janvier et février 1432, l'évêque de Digne compléta, toujours sans doute en qualité de commissaire apostolique, les statuts du chapitre de Sisteron. Nous pensons bien que la question si ardue et si délicate de la cocathédralité de Forcalquier, vint compliquer encore celle de la réforme capitulaire ; mais les documents nous font complètement défaut pour dire quelle en fut l'influence. Bertrand Raoul mourut d'ailleurs en ce même mois. Par une transaction passée le 25 avril 1436, dans le chœur de l'église de Cruis , et signée par les deux syndics, noble An toine Bermond , seigneur de Claret , et Jean Guibert, assistés d'un jurisconsulte et de deux notaires, Jean de Quinson et Prioret Laydet , la terre de Consonauves et la forêt de Bosc Crompat qui en dépendait, furent, du consentement de Robert Dufour, adjugées en toute propriété à la ville de Sisteron, moyennant une redevance annuelle de 50 florins (1,000 francs de notre monnaie). Les auteurs de la Gallia christiana ont ignoré la date précise de la mort de ce prélat. Ainsi que le constate la notification officielle de son décès, faite au chapitre par le chanoine secrétaire de l'évêché, Antoine Arnoux , l'évêque Robert Du four mourut dans son .château de Lurs le dimanche, 24 février 1437, suivant notre manière actuelle de compter. Robert Dufour portait pour armoiries : d'azur, à trois flammes d'or.
53. — MITRE GASTINEL (1437-1440). Quelques jours après le décès de Robert Dufour, et le 4 mars 14-37, les deux chapitres de Forcalquier et de Sisteron se réunirent , suivant l'usage , pour lui donner un successeur. Cette fois , les chanoines de Sisteron se trouvèrent en minorité et durent se résigner à subir la loi. Sur dix-huit voix , Raimond Talon, prévôt de Forcalquier, en obtint douze. Les autres suffrages se partagèrent entre Mitre Gastinel ou Gastinelli , abbé de Fosseneuve , Gaucher de Forcalquier, protonotaire apostolique, et Louis de Francegiis, chanoine de Sisteron, qui en eut un. Les auteurs de la Gallia christiana ne connaissaient pas le procès verbal de l'élection de Raimond Talon, puisqu'ils l'ont traitée d'imaginaire {fictitia). On ne saurait toutefois aujourd'hui la contester; mais comme on n'a aucune preuve qu'il ait pris possession du siége épiscopal, et comme d'ailleurs, ainsi que le constate Jean Columbi, on le retrouve encore deux ans après prévôt de Forcalquier, sous l'épiscopat de Mitre Gastinel , il faut en conclure que son élection demeura sans effet, soit que le Pape l'ait cassée, comme empiétant sur ses droits, soit que devant une opposition quelconque, le prévôt de Forcalquier, par amour de la paix, ait renoncé, pour le moment, à faire valoir les droits que lui avait conférés le chapitre. Quoi qu'il en soit, le successeur immédiat que la suite chronologique des évêques de Sisteron donne à Robert Dufour, est Mitre Gastinel, le même qui réunit trois suffrages dans l'élection du 4 mars. Mitre Gastinel ou Gastinelli était certainement né en Provence, et probablement dans le diocèse d'Aix; c'est du moins ce que l'on peut conjecturer de son prénom. Une lettre de René, roi de Sicile et de Jérusalem, duc d'Anjou, de Lorraine et de Bar, comte de Provence, etc., datée du 20 janvier 1439, prouve surabondamment que Mitre Gastinel était, à cette époque, évêque de Sisteron. Un extrait de ce document en fera comprendre l'objet et l'importance : « Nous faisons savoir que plein d'une confiance justifiée en la prudence, en la science, en la probité, dans les vertus et les mérites de Révérends Pères en Dieu et nobles personnes Bertrand, évêque d'Orange, Mitre, évêque de Sisteron, Jean de Cossa, de Naples, sénéchal de notre hôtel..., etc., nous les avons nommés nos ambassadeurs et orateurs spéciaux, avec mission de se présenter en notre nom devant Sa Sainteté Eugène, souverain Pontife de l'Eglise universelle, comme aussi de se présenter pour nous et en notre nom dans le saint concile universel de l'Eglise catholique, qui va se tenir à Ferrare. » C'est le seul fait que nous connaissions de cet épiscopat, qui n'eut, du reste, qu'une durée de trois ans à peine, Mitre Gastinelli étant mort vers le mois de novembre 1440. La famille de ce prélat, originaire d'Italie, paraît être venue en Provence avec les princes de la maison d'Anjou. Mitre, avant son élévation à l'épiscopat, était, nous l'avons dit, abbé de Fosseneuve , monastère situé dans le diocèse de Terracine (Etats de l'Eglise). Les armoiries de Mitre Gastinel ou Gastinelli étaient : d'azur à trois colonnes d'or.
54. — GAUCHER DE FORCALQUIER (141-142). Gaucher, issu en ligne directe des anciens comtes de Forcalquier et de la branche de Céreste, était le deuxième fils de Raimond, baron de Céreste, qui, le 12 février 1407, avait épousé Angélique de Brancas, sœur de Pierre -Nicolas de Brancas, archevêque de Cosenza, puis cardinal, évêque d'Albano, mort à Florence le 1er juillet 1412. Né vers 1410 , Gaucher fut pourvu de bonne heure de nombreux bénéfices; fut successivement chanoine de l'Eglise métropolitaine d'Aix, prieur de Mayrargues, prévôt de la cathé drale de Marseille en 1438, archidiacre de Fréjus, protonotaire apostolique et référendaire du Pape. Nommé, en 1440, administrateur de l'évêché de Sisteron, Gaucher, qui déjà le 4 mars 1437 avait obtenu deux suffrages, prit, comme titulaire, possession de ce siége le 5 février 1441, et fut transféré à Gap vers le mois d'octobre de l'année suivante. A cette époque, il se trouvait à Florence, et donna, par un acte du 18 décembre de cette même année, pouvoir de prendre possession du siége en son nom , à Barthélemi de Brancas, seigneur de Céreste, son oncle; à Jacques de Forcalquier de Céreste, son frère; à Pierre Villon, prévôt de Barjols; à Palamède de Carette, prévôt de Saint-Didier d'Avignon, et à plusieurs autres seigneurs tant ecclésiastiques que laïques. De tous ces illustres personnages, deux seulement, Jacques de Forcalquier et Pierre Villon, se présentèrent, le 9 février 1443, pour remplir les intentions du prélat. Les consuls de Gap, nobles Raimond le Vieux et Jacques d'Obverche , ainsi que Pierre Gruel , licencié en droit et avocat de la ville, reçurent les fondés de pouvoir de l'évêque dans la nouvelle chapelle de la Trinité de l'église des Cordeliers, où, suivant la coutume, ils jurèrent, au nom du prélat, de maintenir et observer les priviléges, immunités et franchises de la communauté de Gap. Peu de temps après avoir fait son entrée solennelle à Gap , Gaucher eut quelques démêlés avec le dauphin Louis II , depuis Louis XI , qui fit saisir son temporel et mit garnison dans ses châteaux et dans ses terres. Gaucher fut alors obligé de sortir du diocèse et ne se réconcilia avec le prince que par la médiation du souverain Pontife Nicolas V, en 1447. L'année suivante, en décembre 1448, il assista à la translation des reliques des saintes Marie. Rétabli dans sa juridiction, il exigea des habitants de Gap, le 19 avril 1452, une reconnaissance générale de tous ses droits et priviléges comme souverain temporel , que lui disputaient sourdement le dauphin et René d'Anjou, comte de Provence et roi de Sicile. Gaucher assista au concile qui fut célébré à deux reprises à Avignon, savoir, le 7 septembre 1457 et le 23 mars 1458. Pierre, cardinal de Foix, de l'ordre des frères Mineurs, archevêque d'Arles et légat du Saint-Siége , présida la première assemblée ; on y confirma ce qui s'était fait en la trente-sixième session du concile de Bâle, touchant l'opinion de l'Immaculée Conception de la Sainte Vierge; on y défendit, sous peine d'excommunication, de prêcher le contraire; on ne permit pas même d'en disputer en public, et l'on enjoignit encore aux curés de publier le décret qui contenait ces dispositions. L'année suivante commencèrent à Gap des troubles suscités par les prétentions exorbitantes de Gaucher, et qui ne finirent qu'à la mort du prélat. L'histoire ne mentionne pas d'une manière précise quelles étaient les exigences de Gaucher, mais peu après les habitants de Gap les repoussèrent, jaloux de leurs droits et de leurs priviléges. Le peuple avait manqué au respect et à l'obéissance qu'il devait à son évêque et seigneur. Gaucher de Forcalquier ne put souffrir cette insolence, et résolut d'infliger aux rebelles le châtiment qu'ils méritaient. En conséquence, il appela les lieutenants de Dauphiné et de Provence, qui se rendirent à Gap avec des troupes ; les habitants, de leur côté, prirent les armes; on livra plusieurs combats sans résultat définitif, et les parties belligérantes remirent aux mains d'arbitres choisis par elles la solution de leurs diffé rends. Les habitants de Gap furent condamnés à une amende de douze mille florins d'or, envers l'évêque , payables par la saisie de leurs biens et de leurs personnes, à la réserve de trente ou trente-six, au choix de l'évêque ; et que , de plus , quatorze ou quinze des principaux de la ville seraient mis au pouvoir de Gaucher, pour en disposer à vie ou à mort selon sa volonté. Au lieu de pardonner, le terrible pasteur fait élever des potences aux cinq portes de la ville, et dresser un échafaud devant l'église de Saint-Jean-de-Jérusalem, où Jean de Montorcier, chevalier, docteur ès-lois et citoyen de Gap , s'é tait réfugié avec plusieurs autres nobles personnages, condamnés à mort par le prélat , appuyé du concours des soldats qu'il avait fait venir de Provence. Vainement le pape Pie II, auquel les habitants de Gap avaient eu recours, confirma, par la bulle du 15 mai 1461, conservée aux archives de l'hôtel-de-ville, les priviléges , libertés et franchises de la ville ; vainement le souverain Pontife nomma, l'année suivante, des commissaires pour connaître des plaintes portées par les Gapençais, contre des clercs et des laïques qui les avaient sérieusement outragés, Gaucher n'en continua pas moins d'attenter aux franchises et aux libertés de la ville épiscopale, devenue presque déserte, et où il ne restait que les malheureux retenus dans les prisons ou qui avaient trouvé un refuge dans les immunités de l'Eglise. On vit alors, pendant les rigueurs de l'hiver, sept cents familles errer misérablement dans la vallée du Champsaur, où plusieurs de ces fugitifs périrent dans les neiges. Jean de Montorcier avait cependant trouvé le moyen de faire parvenir ses plaintes au parlement de Grenoble . nouvellement institué, qui fit défense à Gaucher de poursuivre l'exécution de l'inique sentence qu'il avait obtenue. Un commissaire, député par le parlement, entra ensuite dans la ville avec les fugitifs. Gaucher déclina ses pouvoirs et lui déclara fièrement qu'il ne reconnais sait d'autre suzerain que le roi René, comte de Provence. Le dauphin fit saisir aussitôt le temporel du prélat, qui est assigné à comparaître devant la cour, et les habitants de Gap recouvrent leur liberté, à l'exception de Jean de Montorcier, qui cherche un refuge dans l'église de Cordeliers, Gaucher fait aussitôt élever un échafaud devant cette église, mais le commissaire du parlement, Jean de Marcoux, parvient à enlever Jean de Montorcier, qu'il emmena avec lui à Grenoble. A peine ont-ils quitté la ville, que Gaucher exige de nouveau le paiement des douze mille florins d'or ; alors les syndics eurent re cours à Louis XI, et lui demandèrent de vouloir bien intervenir entre les habitants et leur évêque. Ce prince, par lettres patentes, expédiées de Toulouse, en date du 11 juin 1463, donna commission à Guillaume de Vernac, bailli des montagnes, de se rendre à Gap, pour voir, modérer ou réformer la fameuse sentence, et satisfaire d'une autre manière à l'évêque, en cas que sa plainte serait trouvée juste ; défendant néanmoins très expressément de comprendre en cette amende les vassaux du dauphin et ses sujets de la rue droite de la ville, aujourd'hui rue de Provence et rue de France, jusqu'à l'entrée de la rue Pérolière, et ceux de Montalquier. Le bailli arriva à Gap au mois d'août, et fit immédiatement signifier à l'évêque la commission qu'il avait reçue. Celui-ci protesta d'abord lui-même; puis, il envoya à Guillaume de Vernac , un bachelier en droit nommé Bertrand Chaix, pour renouveler ses protestations, et exposer avec détail tout ce qui s'était passé. Bertrand Chaix remontra au bailli les injures que les habitants de Gap avaient faites à l'évêque, de quelle manière ils avaient pris les armes et s'étaient soulevés contre lui, il dit ensuite que Gaucher avait été obligé de recourir au cardinal de Foix, légat du Saint-Siége, qui avait commis l'évêque d'Amasie pour juger cette affaire; que le roi avait été mal informé , que les lettres qu'il avait données étaient contre le droit et la justice, parce qu'il n'avait nulle juridiction ni sur lui , ni dans Gap. Le bailli ne crut pas devoir s'arrêter à ces raisons, et , nonobstant tout ce que put dire Bertrand Chaix , il fit sa procédure. Puis, ne pouvant obtenir que de bonne volonté on ouvrît les portes , il les fit forcer, et ordonna qu'on abattît les poten ces qui avaient été dressées pour la punition des coupables. En 1464 , on voit encore le prélat et la ville s'adresser ce pendant de mutuels reproches au sujet des troubles qui continuent, bien que les uns et les autres, eussent consenti à prendre le Pape pour arbitre de leurs différends. L'année suivante, le dauphin cédait au comte de Provence ses droits sur la ville et sur Montalquier en échange de la terre de Vandolle, puis il rompit le traité, faisant arborer son étendard sur la plus haute tour épiscopale, malgré les droits du roi René, et l'opposition de Gaucher, à qui, indépendamment des droits utiles, il ne restait guère que la haute, la moyenne et la basse justice. Toutefois René d'Anjou, comte de Provence, étant mort le 10 juillet 1480, Gaucher, sans s'inquiéter de la vengeance qu'en pourrait tirer Louis XI , fit hommage le 20 du même mois à Charles d'Anjou , comte du Maine et suc cesseur de René, pour toutes les terres possédées par l'Eglise de Gap dans l'étendue de l'ancien comté de Forcalquier. Heureusement pour lui, Louis XI hérita, le 12 décembre 1481, de Charles d'Anjou, et prit possession du comté de Provence. Le testament de Gaucher de Forcalquier, daté du jour de la fête de sainte Madeleine, 22 juillet 1483, et dans lequel il se qualifie d'évêque de Gap et de seigneur de Céreste, nous apprend qu'il était, depuis 1440, abbé de Saint-Eusèbe au diocèse d'Apt , abbé du Thoronet au diocèse de Fréjus , prieur de Notre-Dame de Moustiers , prieur de Chardavon au diocèse deSisteron, et prieur de Montfavet près d'Avignon. Il légua diverses terres à Gaucher de Brancas , fils de Barthélemi de Brancas, et frère d'Angélique de Brancas, sa mère. Il institua pour son héritier son neveu , Georges de Castellane , fils de sa sœur Alix de Forcalquier, avec charge de substitution , en faveur de diverses tiges de la maison de Brancas, dans l'ordre désigné par lui. Si ces deux branches venaient à s'éteindre , son autre cousin, Roux de Brancas, leur était substitué. Mais dans le cas où tous ses héritiers viendraient à disparaître sans laisser de postérité, les biens de Gaucher passeraient par égales portions à son église cathédrale et à la chapelle de Sainte-Marie-Madeleine fondée par lui en la même église. Gaucher de Forcalquier mourut fort âgé, le lundi 5 avril 1484, et fut inhumé selon ses désirs, dans la chapelle de Sainte-Marie-Madeleine , après un épiscopat agité d'environ quarante-deux ans. Il portait pour armoiries : et azur, au,pal d'argent chargé de trois tours de gueules, soutenu par quatre jambes de lion d'or mouvantes des deux flancs de l'écu.
55. — RAIMOND TALON (142-146). Enfin Raimond Talon , qui avait réuni, le 4 mars 1437 , la majorité des suffrages des chanoines, arriva à son tour sur le siége épiscopal en 1442. Les faveurs du roi René l'y suivirent. Ce prince le désigna pour le représenter au concile de Bâle. Voici ce que raconte à propos de cette mission Augustin Patrice (V. t. XIII des Conciles, chap. 133) : « Au mois de décembre 1442, Ferdinand, duc de Calabre, fils d'Alphonse, roi d'Aragon, envoya à Bâle un député pour faire, en son nom, acte d'obéissance et de respect au concile , en toutes les choses qui ne seraient pas contraires aux droits de son père. Mais le dé puté ayant qualifié son maître de duc de Calabre , Raimond , évêque de Sisteron, protesta, au nom du roi René, que le fils d'Alphonse n'était pas duc de Calabre ; en effet , dit-il , le royaume de Naples appartient à René et non à Alphonse, et le duché de Calabre appartient à Jean, fils de René; Ferdinand, n'est, aux yeux de Raimond, qu'un bâtard, sans droit aucun sur le royaume de Sicile. Le député de Palerme argumenta contre ces affirmations et accusa l'évêque de Sisteron d'agir sans mandat au nom de René et de faire ce qui lui était défendu, c'est-à-dire d'attaquer Alphonse et son fils, fauteurs du concile pour couvrir l'ami de l'adversaire du concile. » L'adversaire du concile est ici le pape Eugène IV, en effet, lié d'amitié et même d'intérêts avec le roi René. Pas n'est besoin de rappeler ici les faits historiques auxquels le passage précité fait allusion. Ajoutons cependant que la revendication faite par notre prélat n'empêcha pas la maison d'Anjou de perdre définitivement la couronne de Sicile. On ne sait rien de plus sur Raimond Talon, issu d'une famille de la province d'Ile de France. Ce prélat avait pour armoiries : d'azur, au chevron, accompagné de trois épis, sortant chacun d'un croissant, le tout d'or.
56. — CHARLES DE BORNAS ou mieux DE BOUSAS (l446-vers l452). Ce prélat, issu d'une famille originaire de la province de Languedoc, ne figure dans aucun acte avant l'année 1446. A cette époque, la population de Manosque augmentait de jour en jour par suite de la désertion des villages de la vallée : le nombre des prêtres fut dès lors jugé insuffisant. De nouvelles contestations surgirent donc entre la communauté de Manosque et le chapitre de Forcalquier, à qui la communauté refusait de payer les dîmes. Dans ces circonstances, Charles de Bousas apaisa la dispute, en ordonnant par sa sentence du 29 avril 1448, que « outre les susdits vicaire, secondaire et prêtre de Saint-Lazare , il serait établi deux nouveaux prêtres dans l'église paroissiale de Saint-Sauveur, afin que le culte divin et le service du peuple fussent plus exactement remplis. » Cette sentence fut enregistrée par Nicolas Bomet, notaire à Manosque, et par Antoine Araudi, notaire à Forcalquier. Les titulaires de ces nouvelles places furent toujours appelés, coouvriers et ensuite choristes. Nous ignorons jusqu'à quelle époque Charles de Bousas siégea à Sisteron. Ce dut être vers 1452. Il portait pour armoiries : de gueules à la bande d'or, chargée d'un croissant de sable.
57. — MITRE II GASTINEL ou GASTINELLI (vers 1452-1456). Neveu du précédent évêque de ce nom, Mitre Gastinel naquit à Aix, suivant l'annaliste Bureau qui écrivait peu de temps après cette époque. Cet historien dit qu'il ne garda que quelques années le siége de Sisteron. Tout ce que l'on sait de lui, c'est qu'abbé commendataire de Cruis, il sollicita auprès du pape Calixte III, et obtint la réunion de cette abbaye à la mense épiscopale de Sisteron. Cette union eut lieu en 1456. Mitre Gastinel portait pour armoiries : d'azur, à trois colonnes d'or.
58. — JACQUES DUPONT (1457-1463). Né en Lorraine, Jacques Dupont, écolâtre de l'Eglise de Toul, obtint, en 1457, l'évêché de Sisteron, par la faveur et la protection de René d'Anjou, roi de Sicile, qui, par son mariage avec Isabelle de Lorraine, avait des droits sur ce duché et en traitait les habitants comme ses sujets. Nous ne savons s'il vint dans son diocèse où son épiscopat n'a pas laissé de grandes traces. A sa mort , il légua, à l'Eglise de Toul, par son testament, une somme de 100 florins d'or. De diverses lettres que nous a conservées le savant Antoine Pagi et de certains actes authentiques reçus par le tabellion Etienne Chaloin, il résulte que Jacques Dupont siégea au moins de 1457 à 1463. Ce prélat portait pour armoiries : de sable, au levrier courant d'argent, accolé d'or.
59. — ANDRÉ DE PLAISANCE (1464-1477). André était Piémontais, les auteurs lui donnent pour surnom de Plaisance, ou de Place, ou encore de Fontana. Quoi qu'il en soit de ce détail peu important, André avait été élu en 1447, abbé de Lérins après la déposition de Guillaume Vaysier, par Nicolas V. Lorsque cet abbé eut été rétabli, en 1455, par Calixte III , André exerça concurremment avec lui diverses fonctions abbatiales jusqu'à sa promotion à l'évêché de Sisteron, en 1464. Barralis {Chronol. Lirinensis), dit sous cette année : Le révérend abbé André, d'abbé et de moine à Lérins, a été promu à la dignité épiscopale de l'Eglise de Sisteron par le très saint Père en Christ et Seigneur Pie, pape par la Providence divine. En 1470, ce prélat fit hommage au roi, comte de Provence, pour le château de Lurs et pour les autres lieux de sa juridic tion temporelle. Il fit décorer, en 1480 , le maître-autel de Lérins de peintures représentant la vie de saint Honorat. Après avoir rapporté ce fait, Barralis ajoute : l'abbaye de Lérins, en reconnaissance de ce bienfait et d'autres qu'elle avait reçus de lui, a fixé son anniversaire au 11e jour des calendes de mai. Ces mots indiquent suffisamment que notre prélat est mort le jour susdit, 21 avril. André de Plaisance s'était démis de son siége quelques années avant sa mort. Les auteurs ne mentionnent point l'année de son décès. Les armoiries de ce prélat étaient : d'azur, au chevron d'or, chargé d'une petite croix potencée de gueules.
60. — JEAN II ECHART on ESQUENART (1477-1492). « Au nom du roi, en présence du seigneur Jean Esquenart, évêque de Sisteron, et devant d'autres témoins... » Ainsi se termine une lettre du roi René que d'Hozier communiqua à dom Denys de Sainte-Marthe ; et dans laquelle il s'agit de la collation de la noblesse aux frères Albin et Pierre de Saurin. La date en est le 14 avril 1477, et cette année-là, Pâques tombait le 6 avril. De quoi il faut conclure que Jean d'Esquenart était évêque de Sisteron au commencement de l'année 1477. Né à Arquenay, village du canton actuel de Meslay, alors du diocèse du Mans, et aujourd'hui de Laval, Jean Echart ou Esquenart ou même Eschivart, car on le trouve sous ces trois noms, était docteur en médecine,et chanoine de la cathédrale du Mans, lorsque vers 1462, il fonda dans la paroisse où il était né, un hôpital qu'il plaça sous l'invocation de saint Sulpice. Il en réserva l'administration à Jean Echart, son neveu, et à tous les aînés de sa famille, les obligeant à une exacte résidence. Le décret de cette fondation ne fut néanmoins consenti que le 2 novembre 1465, parThibaud de Luxembourg, évêque du Mans. Ce décret nous apprend que Jean était alors sénéchal de Saint-Martin de Tours. La faveur du roi René lui fit obtenir l'évêché de Sisteron dès que André de Plaisance l'eut résigné. Cette promotion fut une bonne fortune que Dieu ménageait à l'Eglise de Sisteron. Le 30 avril 1481, et le 24 octobre 1482 , il transigea comme seigneur temporel avec les habitants de Lurs. En 1487, nous le voyons assister aux Etats de Provence tenus à Aix. Il écrit, en 1491, aux consuls de Manosque, au sujet de la cession à faire aux hospitaliers du Saint-Esprit de l'ancien couvent des Clarisses dans la Saunerie. Le 3 janvier de la même année, il fait avec les chanoines de Cruis, une convention que le chapitre de Sisteron approuva, le 2 janvier 1492. Le palais épiscopal lui dut de nombreuses réparations et augmentations, ainsi que l'abbaye de Cruis; il n'oublia pas d'embellir et de fortifier son château de Lurs. Ce fut un prélat d'une grande piété, un modèle pour son peuple et pour son clergé; il mourut au Mans, en juin 1492 , plein de bonnes œuvres, et voulut être inhumé sans cénotaphe, dans l'église paroissiale de la Couture. Nous ne saurions préciser le jour de son trépas; mais le fait suivant ne permet pas de s'égarer beaucoup sur ce point : le 4 juillet 1492, Guillaume de Nogaret fut élu vicaire général pour administrer le diocèse de Sisteron, le siége étant vacant. Sous son épiscopat, la peste avait fait de grandes et fréquentes invasions dans Sisteron : on y était venu à un tel point de désolation, que les affaires publiques semblaient abandonnées... les notaires publiaient les testaments hors des murs de la cité; la famine sévissait en même temps. Le pasteur exemplaire dut trouver dans ces désastreuses circonstances, ample matière à son zèle et à sa charité. Il portait pour armoiries : d'azur, à une croix trèflée d'or.
61. — THIBAUD DE LA TOUR (1492-1499). Thibaud était un fils naturel de Bertrand V, seigneur de la Tour, comte d'Auvergne et de Boulogne. Le roi Louis XI qui s'intéressait à lui avait écrit à son ambassadeur en cour romaine pour lui faire obtenir l'abbaye du Bouchet au diocèse de Clermont (Baluze , Preuves de l'histoire de la maison d'Auvergne). Jean Columbi n'a point connu ces faits, mais il nous apprend que Thibaud fut élu évêque de Sisteron en 1492, par les chanoines de Sisteron seuls ; ceux de Forcalquier protestèrent contre cette élection, comme ayant droit d'y avoir été appelés. Cependant, après quelques oppositions et, nous l'espérons, pour faire un sacrifice à la concorde, ils reconnurent l'évêque élu qui put dès lors jouir paisiblement de son siége. Ce ne fut pas longtemps; car, quoique jeune encore, il passa de ce monde dans un meilleur, au mois de juillet 1499. Thibaud de la Tour portait pour armoiries : et azur, semé de fleurs de lis d'or, à la tour d'argent maçonnée de sable , brochante, un bâton péri en barre d'or.
62. — LAURENT BUREAU (1499-1504). Laurent Bureau, né à Dijon, ou, suivant quelques biographes , à Liernais près de Saulieu , entra comme profès au couvent des Carmes de Dijon, et fut reçu docteur en théologie de l'Université de Paris. Quoique d'une extraction obscure, il devint un des personnages remarquables de son temps ; et dut surtout son élévation à ses talents de prédicateur. Les rois Charles VIII et Louis XII l'eurent pour confesseur, et cet emploi lui ménagea l'accès des hautes dignités. Ainsi, le 11 juillet 1499, il est élu à l'évêché de Sisteron et un acte du 15 octobre suivant le qualifie provincial de Narbonne et évêque de Sisteron. L'année suivante, il vient prendre possession de son siége et fait confirmer les priviléges des habitants de Lurs ; son peuple et son clergé reçoivent de nombreux témoignages de sa sollicitude et de son amour pour le bien. En 1501, sur la demande de Louis XII, le pape Alexandre VI le chargea d'aller avec Thomas Pascal, official d'Orléans, informer dans le Dauphiné sur la vie, les dogmes et les mœurs des Vaudois. Dès qu'il jugea sa mission remplie, il fit sur les principes de cette secte un rapport au parlement de Grenoble. Ses prédications éloquentes et persuasives convertirent un grand nombre de ces malheureux égarés ; il obtint d'eux , un Credo sur toutes les propositions de foi contestées, et rapporta au chancelier toutes les procédures qui avaient été faites. Ces faits nous sont appris par Jean d'Authon, historiographe du roi. C'est encore en 1501 qu'il se démit de son office de provincial par cette lettre qui fait le plus grand honneur à sa vertu et à son caractère. « Nous , frère Laurent Bureau, Carme de Dijon, docteur de l'Université de Paris, provincial de Narbonne, confesseur de Sa Majesté très-chrétienne le roi de France, Louis XII, et évêque de Sisteron, reconnaissons par la présente que le souverain Pontife Alexandre VI , nous avait accordé, par privilége et par faveur décrétée en consistoire, de garder, avec l'épiscopat , notre charge de provincial, avec le rang y attaché, ensemble voix active et passive, de manière à pouvoir même être élevé par l'élection au généralat; mais que ce privilége nous paraissant aller contre la liberté de l'ordre et contre les statuts sacrés de la profession, quoique le souverain Pontife nous en eût dispensé ; ayant Dieu devant les yeux, voulant que maintenant et désormais la province de Narbonne jouisse de sa liberté , nous nous démettons du provincialat entre les mains de Gilles Borgès , provincial de Provence et vicaire du très révérend maître et général Odon. Nous avons scellé cette démission de notre sceau, le 5 mai de l'an du Seigneur 1501.» L'année suivante, et le 31 mars, des occupations continuelles auprès de la personne et dans les intérêts du roi, le forcèrent de s'absenter de son diocèse ; il en confia l'administration spirituelle et temporelle à l'évêque de Digne. Deux ans après, le Pape l'envoya comme légat auprès de l'empereur Maximilien : les détails nous manquent sur cette mission. En cette même année 1504, Christophe de Uttenheim, évêque de Bâle , écrivit aux chanoines de Lyon pour leur demander si ce qu'il avait appris des miracles de Jean Gerson était vrai , et surtout si le bruit qui courait d'un châtiment divin infligé au confesseur du roi (c'est notre Laurent), qui avait méprisé Jean Gerson, avait quelque fondement. Les chanoines répondirent sur le premier point en exaltant la sainteté de Gerson, et sur le second en affirmant que loin d'en être le contempteur, le confesseur du roi en avait toujours été le panégyriste. Ils ajoutèrent ces paroles : « Frère Laurent , théologien , docteur de Paris, de l'ordre des Carmes, a écrit, à la louange de Gerson, un poème transcrit sur son tombeau dans l'église de Saint Paul. Ce frère, maintenant évêque de Sisteron, a prêché pendant six carêmes devant les rois, et s'est souvent fait entendre en chaire par le clergé et le peuple de Lyon. », Dans le cours du XVe siècle, le pont sur lequel on traverse la Durance, à Sisteron, avait éprouvé de fortes avaries. En 1501 , il fallut songer à arrêter les dégradations. Malheureuse ment , l'état des finances de la ville s'accordait mal avec cette nécessité. Laurent Bureau permit de commencer les réparations avec le montant d'un legs pie fait par la veuve de Jean Laydet. La somme était modique, elle n'offrit qu'une faible ressource et les travaux s'en ressentirent. Quelques années après, le pont était encore dans le plus grand délabrement, et sur le touchant et triste exposé qu'on lui fit de cette situation dangereuse, le roi Louis XII n'hésita point à se charger de la moitié de la dépense. L'illustre prélat mourut à Blois, le 5 juillet 1504. La biographie Michaud dit à son sujet : « Quelques-uns ont cru qu'il fut empoisonné. Nous avouons ignorer complétement sur quoi repose ce soupçon. » Son corps fut inhumé chez les Carmes d'Orléans; mais son cœur fut réservé à Dijon, sa ville natale. « C'était un homme, dit Lucius le Belge, dans Trithême, très versé dans les saintes Ecritures, et d'une profonde érudition dans les sciences et lettres profanes ; son esprit était supérieur et son éloquence célèbre ; il écrivait fort bien en vers et en prose : il a laissé un certain nombre d'ouvrages estimés. » Nous ne citerons que deux de ses ouvrages : 1 l'Héliade. C'est un panégyrique du prophète et patriarche Elie, à qui remonte, croit-on, l'ordre du Carmel. Notons que Laurent fit transcrire son travail sur les murs du cloître des Carmes de Paris. 2 De Viris illustribus sut ordinis. L'Eglise de Sisteron lui doit son fameux Livre vert, qui a tant servi à Jean Columbi et aux Bénédictins pour dresser la liste et élucider l'histoire des évêques de cette ville. C'est le recueil des chartes concernant cette Eglise, précédé d'une nomenclature des évêques. La critique n'y était pas forte, mais du moins était-ce là un précieux recueil de documents. Son nom lui venait de la couleur de sa reliure. Il est aujourd'hui perdu. Heureusement qu'on en trouve un bon extrait dans les Mémoires du chanoine Gaspard Gastinel. Laurent Bureau avait pour armoiries : d'azur, au chevron potence et contrepotencé d'or, rempli de sable, accompagné de trois buires d'or, 2 et 1 .
63. — PIERRE VIII LE FILLEUL (1504-1506). Né en 1438, à Gannat en Bourbonnais, Pierre le Filleul que Pitton appelle Pierre Filholi, et assure originaire d'Aix, était premier président en la Chambre des comptes de Paris, lors qu'à la mort de Laurent Bureau, le roi Louis XII l'appela à succéder à ce prélat sur le siége de Sisteron. Pierre avait déjà le titre d'évêque de ce diocèse, au mois de septembre 1504, époque où il se trouva comme délégué du pape Jules II, avec Charles de Carretto, marquis de Final, à la conférence qui se tint à Blois, entre Maximilien Ier, empereur d'Allemagne, et le roi Louis XII, et de laquelle résulta un traité, qui, destiné à rester provisoirement secret , devait enlever à la république de Venise, tous les territoires qu'elle avait arrachés à la Hongrie, à l'Autriche, au Milanais, au Saint-Siége et au royaume de Naples. Mais le roi Louis, dit François Beaucaire de Péguilhon (Histoire de France, liv. 10, nes 13 et suiv.), « bien qu'il fût quelque peu fâché contre Jules, lui envoya l'évêque de Sisteron pour lui offrir, en son nom, son amitié et du secours contre les Vénitiens. » Et cet historien ajoute un peu plus bas : « L'évêque de Sisteron, pour prix de ses nombreuses courses de Jules à Louis et de Louis à Jules , fut gratifié de l'archevêché d'Aix. » Le P. Jean Columbi, dans ses Nuits de Blanchelande , a prétendu que c'était Laurent Bureau, prédécesseur de Pierre en l'évêché de Sisteron, qui assista à la conférence de Blois. Mais outre que l'on sait positivement que Laurent Bureau mourut à Blois, le 5 juillet 1504, le P. Daniel, dans son Histoire de France, en parlant du traité conclu à Blois le 22 septembre 1504, dit sans aucune hésitation que l'évêque de Sisteron, qui y prit part, était Pierre le Filleul ou Filholi. Nommé à l'archevêché d'Aix, le 9 mars 1506, Pierre retenu sans doute pour le service du roi, fut préconisé le 9 octobre suivant, mais ne put être installé sur son siége que le 8 octobre 1508. Deux ans après, l'université d'Aix le choisit pour chancelier. Comme les affaires de l'Etat ne lui permettaient point de résider assidûment dans son diocèse, il en confia l'administration à divers vicaires généraux. On le voit, dès 1513, lieutenant de gouverneur en Provence, et, en 1515, titré conseiller d'honneur du parlement d'Aix. Fort peu de temps après avoir pris en main la lieutenance , il eut à réprimer les mouvements qui éclatèrent à Marseille , entre Forbin et Guiran, au sujet de l'administration de cette ville. Pierre le Filleul prit parti pour le premier et fit emprisonner Guiran. L'archevêque d'Aix s'était trouvé, en 1510, au concile que le roi Louis XII réunit à Tours, et où il proposa huit questions relatives à la guerre qu'il se disposait à déclarer au pape Jules II pour secourir Alphonse, duc de Ferrare, son allié. En quittant cette assemblée, Pierre le Filleul vint à Aix pour se préparer à se rendre à Pise, mais comme il traversait le Comtat, il fut arrêté par ordre du Pape et conduit à Avignon, où il fut détenu prisonnier. Sa détention ne fut pas bien longue, car Jules II étant mort dans la nuit du 20 février 1513, la paix se fit entre la cour de France et le Saint-Siége. Pierre, rendu à la liberté, vint à Aix et donna des ordres pour l'embellissement de son église métropolitaine, dont il fit fermer le chœur par une grille en fer ouvragé, et décorer la sainte chapelle de peintures. Par ses soins, on construisit le grand escalier du palais de l'archevêché et une magnifique tribune fut élevée dans l'église des Dominicains de Saint-Maximin. En 1518, il visita canoniquement son chapitre. Après le désastre de Pavie et pendant la captivité du roi François Ier, en Espagne, on forma à Paris un conseil public où le clergé, la noblesse, le parlement, l'université et la bour geoisie avaient des députés. C'était là qu'on traitait du bon ordre de la capitale. Pierre le Filleul, qui avait dès lors la qualité de lieutenant général du roi, dans l'Ile-de-France, fut appelé par ses fonctions à faire partie de ce conseil. Jean Morin, prévôt des marchands, représenta que l'archevêque d'Aix n'était point aussi propre qu'un militaire à réprimer les désordres , et l'on recommanda au comte de Saint-Paul , gou verneur de Paris , et à Anne de Montmorency, cette partie du gouvernement. Mais comme on s'aperçut que les plaintes du prévôt étaient plutôt dictées par le désir de supplanter l'ar chevêque que par l'amour du bien public , la régence et le parlement soutinrent ce prélat, qui était en effet un homme fort habile pour les affaires. Contraint de résider à Paris, Pierre le Filleul pria en 1530 le roi François Ier de lui accorder Antoine d'Imbert pour coadjuteur. Ce prince, qui avait pour lui la plus grande estime, se montra favorable à sa demande, et, depuis ce moment, l'archevêque d'Aix se retira à Paris, où il mourut à l'âge de 102 ans, jouissant encore de toutes ses facultés, le jeudi 22 janvier 1540, ou mieux 1541, selon notre manière actuelle de compter. Ses funérailles eurent lieu dans la chapelle basse du palais. On l'inhuma dans l'église des Franciscains, et sur son tombeau fut placée sa statue en pierre avec l'épitaphe suivante : « Iey gist Révérendissime Père en Dieu, Messire Pierre Filholi, natif de la ville de Gannat en Bourbonnois, archevesque d'Aix en Provence et lieutenant pour le Roi au gouvernement de Paris, et l'Isle de France, lequel après avoir vescu CIl ans, mourut regretté de tout le peuple dans la ville de Paris le xxii janvier MDXL. On lit au sujet de ce prélat dans le Nécrologe de Saint-Sau veur : « Mourut Révérend Père en Dieu, Pierre Filholi, archevêque de la sainte Eglise Notre-Dame d'Aix, premier président en la Chambre des comptes de Paris. Il vécut dans l'archevêché 34 ans, 3 mois et 14 jours, et atteignit l'âge de 102 ans. Il dota et fonda pour le salut de son âme et de celle de ses parents, une messe dite des enfants de chœur, un salut tous les jours, et le chant de complies, chaque samedi dans l'église de Notre-Dame de Consolation, hors des murs. Il en richit son Eglise ainsi qu'une épouse de nombreux joyaux pour la gloire et l'honneur de Dieu, et lui laissa sa croix, sa crosse, sa mitre et divers autres biens. On l'inhuma en 1540, à Paris, dans l'église des Frères-Mineurs. » Pierre le Filleul permit en 1515, aux religieux Servites, dits de l'Annonciade, de construire à Aix, au quartier de Saint Jean, une maison de leur Ordre et une église que bénit Antoine de Tende, évêque de Riez. Comme on fut obligé de la démolir pendant les guerres que Charles-Quint fit en Provence, on donna à ces religieux l'église de Saint-Antoine où ils demeurèrent jusqu'à la Révolution. En 1518, le grand vicaire de Pierre autorisa l'établissement à Aix, de diverses compagnies de Pénitents. Ce prélat portait pour armoiries : d'azur, à la bande d'or, accostée de deux glands de même.
64. — FRANÇOIS DE DINTEVILLE (1506-1514). François de Dinteville était le dernier des quatorze enfants de Claude de Dinteville , seigneur de Commarin en Bourgogne, d'Eschenetz, Polisy, etc., conseiller et surintendant des finances de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, auprès duquel il fut tué devant Nancy, en 1477. Sa mère était Jeanne de la Baume, descendante des puissants comtes de Montrevel. La jeunesse de François fut soigneusement cultivée. Après avoir étudié à Dijon et à Autun, il fut envoyé à Pavie pour y apprendre le droit civil et canonique, fut reçu docteur au bout de cinq ans, revint en France, fut attaché à la maison du cardinal Georges d'Amboise, obtint de nombreux bénéfices et parvint enfin au siége épiscopal de Sisteron, le 9 mars 1506. Depuis plusieurs années, la peste avait dépeuplé cette ville, la plupart de ses habitants l'avaient abandonnée, le chapitre cathédral s'était retiré à Aubignosc. Il y résidait encore lors que François vint prendre possession du siége, en juillet 1508. On lit dans des papiers échappés à la destruction du greffe de l'ancienne officialité de Sisteron, qu'en 1511, sous l'épiscopat de François de Dinteville, le tribunal fut saisi d'une plainte contre les insectes qui désolaient le territoire de Saint-Michel, près de Forcalquier. Les habitants de cette petite paroisse, fatigués de faire une guerre inutile à ces redoutables ennemis de leurs récoltes, se pourvurent, par voie canonique, par devant l'official du diocèse, à l'effet de poursuivre ces animaux suivant les formes juridiques. Ces sortes de procédures étaient alors fort communes. A la mort de Jean Baillet, évêque d'Auxerre, arrivée le 20 novembre 1513, les chanoines de cette cathédrale se réunirent le 5 décembre suivant, et le 30 janvier 1514, jour qu'ils avaient fixé pour l'élection, ils donnèrent leurs suffrages à François de Dinteville qui fut préconisé le 6 mars de la même année. Ce fut la dernière élection faite par le chapitre d'Auxerre, car le règne de François Ier, qui suivit de près, modifia la manière de nommer les évêques de France , mais n'y porta aucun changement dans celle d'administrer le temporel des évêchés pendant la vacance des siéges. François de Dinteville, alors âgé de 49 ans, accepta sa nomination à l'évêché d'Auxerre. Au moment de sa promotion à l'évêché de Sisteron, il était curé des Riceys, au diocèse de Langres, prieur de Choisy, au diocèse de Meaux, chanoine de la cathédrale d'Autun, de celle de Langres, de Beaune et de Dijon, abbé de Châtillon-sur-Seine et de Montier-en-Der. En montant sur le siége d'Auxerre, il conserva l'abbaye de Montier-en-Der qu'il possédait depuis le 1er janvier 1499, mais renonça à tous ses autres bénéfices. Dans l'intérêt même de la ville et sans déroger à l'ancien usage de la joyeuse réception dont on lui fit grâce sur la recommandation de Louis XII, le nouveau prélat vint à Auxerre, dès le mois de mai 1514, afin d'empêcher, par sa présence, que les gens de guerre n'envahissent les biens de l'évêché. L'année cependant ne s'écoula pas sans la cérémonie accoutumée. Le 17 décembre, il fut reçu à l'abbaye de Saint-Germain, par l'abbé François de Beaujeu, et le lendemain, il fit son entrée solennelle dans la cathédrale. Quant au serment qu'il devait à l'Eglise de Sens , il s'en était acquitté dès le 5 du même mois. Le 3 avril de l'année suivante, il rendit une ordonnance contre l'abbesse et les religieuses de Saint-Julien d'Auxerre, leur enjoignant de ne point sortir de leur clôture sans permission , de n'admettre chez elles que leur médecin et de veiller sur leur temporel mieux qu'elles ne faisaient. Il songea d'abord à réparer entièrement les maisons épiscopales de Varzy et de Regennes. C'est avec raison que l'on a vanté les ornements que François de Dinteville donna à sa cathédrale : ils étincelaient d'or et de pierreries, et certainement, aucune église de France n'en possédait alors de plus magnifiques : ils furent depuis la proie des calvinistes. Les orgues lui coûtèrent une somme considérable : les huguenots s'emparèrent plus tard des tuyaux et ne laissèrent que le buffet. Les verrières du portail septentrional sont dues aussi à la munificence de ce prélat. Pendant son épiscopat, François de Dinteville n'eut pas l'ombre d'une difficulté avec son chapitre, ni avec aucun des chanoines en particulier. Il aima beaucoup les habitants d'Auxerre et prit toujours soin de leurs intérêts. Il demeura plus d'un an à Paris , afin de recommander aux conseillers du parlement la cause des Auxerrois pour le bailliage transféré à Villeneuve-le-Roi , pendant que le duc de Bourgogne jouissait du comté d'Auxerre, et son crédit obtint, en 1523, un arrêt qui adjugea au bailliage de sa ville épiscopale les pays situés entre l'Yonne et la Loire. Il se donna aussi beaucoup de peine, en 1526, pour la tenue de foires à Auxerre et pour que la ville recouvrât ce qui revenait anciennement à ses habitants sur la vente du sel. Aumônier ordinaire de Louis XII et de François Ier, François de Dinteville fut tendrement aimé de ces deux monarques et passait chaque année trois ou quatre mois à la cour. Cependant, malgré ces absences, l'hérésie naissante de Luther n'infecta point son diocèse. Il assista exactement aux assemblées et aux conciles provinciaux que tinrent les archevêques de Sens , Etienne Poncher et Antoine du Prat, et fut commis, le 13 août 1516, par le pape Léon X avec les évêques de Paris et de Grenoble, pour procéder aux enquêtes nécessaires à la canonisation de saint François de Paule. Presque toujours , il se fit aider dans ses fonctions pastorales par quelque évêque inpartibus. La douceur qui lui était naturelle ne l'empêcha point de défendre les droits temporels de son siége. Ayant appris que l'ancienne tour et la maison seigneuriale de Toucy avaient été démolies par Aimar de Prie, baron de ce lieu, pour y bâtir un nouveau château , il le fit comparaître par devant lui à Auxerre , le 20 juillet 1 523 , afin que le château nouvellement construit fût déclaré jurable et vendable à l'évêque d'Auxerre , quand celui-ci l'exigerait. Le 27 juillet 1527 , il assista au conseil où le roi François I proposa la question de son retour en Espagne. Quelques années auparavant, ce prince l'avait employé dans une circonstance fort délicate , il s'agissait de négocier un traité avec Clément VII. Ce pape, issu de la maison de Médicis, ne voyait pas sans effroi le tout-puissant et rusé CharlesQuint affermir sa domination en Italie. Dans l'intérêt des Etats de l'Eglise et dans celui des Florentins , il eut été beaucoup plus avantageux d'avoir pour allié le généreux et chevaleresque roi de France, que le cauteleux et sournois Autrichien. Il paraît que l'éloquence de l'évêque d'Auxerre fit bien sonner tous ces avantages à l'oreille du Pape, et celui-ci vit avec plaisir François Ier arriver en Italie. Mais le malheureux monarque ne tarda pas à voir toutes ses espérances renversées ; notre armée fut détruite sous les murs de Pavie, et le roi fut fait prisonnier. Les relations de Clément VII avec François Ier ne lui portèrent pas bonheur non plus : Charles-Quint lui garda rancune. Le faible pontife essaya d'échapper au malheur qui le menaçait, mais ses indécisions ne firent que hâter sa perte. Le connétable de Bourbon arriva, en juillet 1527, devant Rome avec les sectaires allemands , et la ville fut prise et pillée pen dant deux mois. Jamais les Goths et les Vandales ne l'avaient réduite à une pareille misère. François de Dinteville, désespéré des résultats déplorables de ses négociations , se retira dans son abbaye de Montier-en-Der, et s'appliqua avec vigueur à réformer les mœurs monastiques. Il établit des chapitres généraux qui se tenaient le 30 juin ; tous les bénéficiers , les prieurs devaient y assister, sous peine d'excommunication , de suspense et de privation de bénéfice. Ce fut François de Dinteville qui fit construire le réfectoire , le bâtiment appelé depuis vicairie, et le portail de l'église. Le chapitre et le cloître furent réparés par ses soins , car le déla brement des édifices abbatiaux était si grand, que les religieux étaient forcés d'aller coucher dehors. Aimé de Montbéliard, abbé d'Huiron et vicaire général de François, de concert avec celui-ci, fit reconstruire en entier les bâtiments de l'abbaye. Il permit à M. de Montbéliard , écuyer, de bâtir un moulin à Billory, moyennant un cens annuel et perpétuel de cent sous. Il transigea aussi sur différents droits avec les habitants des villages voisins. Ce fut encore François qui fit exécuter un beau Martyrologe, in-folio vélin, que l'on voit actuellement à la bibliothèque de Chaumont. Il fut écrit en 1522 , par Guil laume le Marchand, chanoine, chantre d'Auxerre. Enfin , Clément VII confirma en sa faveur tous les priviléges précédemment accordés au monastère de Montier-en-Der. François de Dinteville se démit de cette commende, en janvier 1528, en faveur de son neveu qui était évêque de Riez, et qui lui succéda sur le siége d'Auxerre. François de Dinteville était parvenu à l'âge de 66 ans lors qu'il fut attaqué d'une diarrhée dont la persistance le conduisit au tombeau. Le 24 avril 1530, sentant sa fin approcher, il fit une confession générale de toute sa vie, entendit la messe et reçut la sainte communion. Le lendemain, il récita sa confession et communia de nouveau ; puis, il fit venir plusieurs personnes, en présence desquelles il écrivit spn testament qu'il fit signer par son secrétaire, Louis Bride, notaire apostolique. Le 28 , il demanda l'extrême-onction qu'il ne reçut que le len demain, et rendit le dernier soupir, ce jour-là, vendredi 29 avril 1530, un peu avant quatre heures du soir, au milieu des larmes et des sanglots d'une assistance émue. Selon son désir, il fut inhumé sous l'un des jubés de sa cathédrale, où ses ossements furent retrouvés le 16 septembre 1730, lors de la sépulture de François Broc, l'un de ses successeurs. Il avait légué, pour douze services à vigiles et grand'messe, à dire chaque année pour le repos de son âme , douze livres payables à chacun de ces services. La cathédrale d'Auxerre ne fut point oubliée dans son testament. Comme sa mort arriva en 1530, ce n'est point à lui que s'applique la note qu'on trouve à la page 4 de l'Histoire de Sisteron, tome II, par M. de la Plane. En supposant que le fait dont elle parle soit authentique, ce que l'on nous permettra de révoquer en doute, car Sainte-Palaye, en ses Mémoires historiques sur la chevalerie, ne nous paraît pas une autorité suffisante, c'est à François de Dinteville, son neveu, d'abord évêque de Riez, puis d'Auxerre, qu'il faudrait l'appliquer. La Vie de François de Dinteville a été écrite par Guillaume le Marchand, chanoine, chantre d'Auxerre. Elle n'a pas été imprimée. Ce prélat portait pour armoiries : de sable, à deux lions léopardés d'or, l'un sur l'autre.
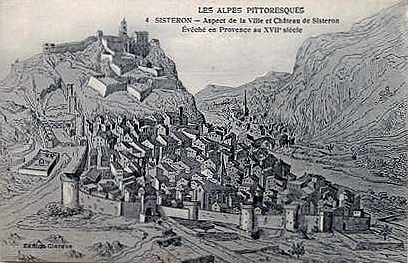
65. — CLAUDE I DE LOUVAIN (1514-1519). Né à Soissons, Claude de Louvain était le fils aîné de Jean de Louvain, seigneur de Nesle, vicomte de Berzy gouverneur de Compiègne pour le roi. Nicolas de Louvain , l'un de ses frères , fut gouverneur de Milan. A la mort de Jean Millet, évêque de Soissons, survenue le 1er avril 1503, Claude, chanoine de cette Eglise, obtint la majorité des suffrages capitulaires. Guillaume Cornet, archidiacre de Soissons, qui avait eu treize voix pour lui, forma opposition à son élection, mais Claude fut préconisé à Rome, le 24 avril 1503. Les registres du Vatican lui donnent encore pour compétiteur, un autre chanoine, appelé Bernard de Vauvray. Il prêta serment de fidélité entre les mains du roi, le 1er août. 1503, assista au concile national convoqué par Louis XII, le 16 septembre 1510, et fut transféré à l'évêché de Sisteron par une bulle du 17 août 1514. Claude de Louvain avait pris depuis peu de temps possession de ce nouveau siége, lorsqu'il eut l'honneur de recevoir, le 13 janvier 1516, dans sa cathédrale, le roi François Ier, revenant d'Italie après la victoire de Marignan et passant par Sisteron. Ce prince avait avec lui la duchesse d'Angoulême, sa mère, la reine Claude, son épouse, et la duchesse d'Alençon, sa sœur, depuis si célèbre sous le nom de reine de Navarre. La famille royale , si l'on en croit la tradition, logea dans la maison de noble Gaspard Curet, seigneur de SaintVincent, maison qui subsiste encore et qui , jusqu'à ces derniers temps, a appartenu à MM. de Ventavon. Quelques auteurs assurent qu'en 1513 , Claude de Louvain avait été nommé grand-aumônier du roi, mais rien ne prouve qu'il ait jamais eu ce titre. Ce qui est plus certain, c'est que vers 1510 , il devint abbé commendataire de Bèze, au diocèse de Langres. Ce prélat mourut en 1519, et portait pour armoiries : de gueules, à deux bars d'or, Vécu semé de trèfles du même.
66. — MICHEL DE SAVOIE (1519-1522). Le concordat de 1516, entre François Ier et Léon X, avait définitivement privé les chapitres cathédraux de la plus importante de leurs prérogatives, celle d'élire les évêques. Cet acte avec la cour de Rome attribuait ce droit au roi, sauf la confirmation et l'investiture canonique par le Saint-Siége. Aussi voyons-nous ici la première application à Sisteron de cette nouvelle règle. François Ier présenta au pape Léon X , Michel de Savoie, pour remplir le siége épiscopal que la mort de Claude de Louvain laissait vacant, et le Saint-Siége l'agréa, ainsi qu'il est dit dans le Livre vert. En 1521 , Michel de Savoie fut désigné par François Ier pour succéder sur le siège de Beauvais à Louis de Villiers de l'IsleAdam, mort le 24 août 1521 , évêque de Beauvais. Sa préconisation pour ce siége eut même lieu dans un consistoire tenu par le pape Léon X, quelques jours avant sa mort , arrivée le 1er décembre 1521. Des bulles ne- lui furent point expédiées par suite de la vacance du Saint-Siége, et sa nomination au siége de Beauvais demeura sans effet. Michel de Savoie mourut en décembre 1522, au moment où Adrien VI, successeur de Léon X, allait confirmer sa translation. Il portait pour armoiries : d'azur, à trois colombes d'argent.
67. — CLAUDE II D'HAUSSONVILLE (1523-1531). Le roi n'intervint pas pour nommer un successeur à Michel de Savoie : il est inutile de chercher les motifs de cette abstention. Voici comment Fouquet Bernard, notaire du chapitre de Sisteron, raconte l'élection de ce prélat : « L'indiction XIe, le dernier jour de décembre 1522, et la première année du pontificat de Clément VII, Michel de Savoie de bonne mémoire, évêque de l'Église de Sisteron, ayant passé de vie à trépas peu de jours auparavant , et son corps ayant reçu les honneurs de la sépulture ecclésiastique , les chanoines de la cathédrale de Sisteron s'occupèrent de lui élire un successeur et appelèrent à eux les chanoines de Forcalquier. Alors, tous ensemble réunis en un seul chapitre, rien autre n'étant à délibérer, sans concert préalable, soudainement tous et chacun portèrent leur suffrage sur Claude d'Haussonville, seigneur de Saint-Amand, absent ; tous donc, d'une seule voix et d'un seul esprit, le de mandèrent pour évêque et pasteur de l'Église de Sisteron. » L'élu était d'une noble famille lorraine, qui a donné depuis plusieurs hommes distingués : Joseph-Louis d'Haussonville lieutenant général et grand-louvetier de France, qui mourut en 1794; Charles-Louis-Bernard de Cléron, comte d'Haussonville, chambellan de Napoléon Ier et membre de la Chambre des pairs sous la Restauration; et M. le comte Joseph d'Haussonville, homme politique, publiciste distingué, membre actuel de l'Académie française et auteur de nombreux ouvrages très estimés par les érudits. Notre Claude était religieux dans l'abbaye de Saint-Victor de Marseille. Dès qu'il eut été promu à l'épiscopat, et confirmé par une bulle du pape Clément VII, en novembre 1523, il donna des preuves de son activité et de ses talents d'administrateur. Il fit réparer sa cathédrale, en accrut les revenus, recouvra ce qui en avait été aliéné. Sa principale acquisition, et il la fit à ses propres frais, fut celle de l'hospice de Giropey, avec les prés, les terres et tout ce qui en dépendait, pour l'unir à la mense de l'Église de Sisteron. Cet achat l'obligea à s'endetter beaucoup. Nous le voyons chargé aussi de la prévôté commendataire de l'église de Sainte-Marie de Pignans, au diocèse de Fréjus; et c'est en cette qualité que, le 8 février 1528, il fait exécuter une sentence rendue en sa faveur, par Amédée Imbert, conseiller du roi, contre le couvent de Saint-Maximin, au sujet du droit de fournage et de mouture dans le territoire de Carnouls. Des conventions passées, en 1525, entre la cour d'Aix et les consuls de cette ville nous le montrent garde du sceau royal et conseiller au parlement de Provence. Il mourut à Lyon le 31 août 1531. Ce prélat portait pour armoiries : d'or, à la croix de gueules frettée d'argent.
68. — ANTOINE I" DE NARBONNE (1531-1539). Les deux chapitres cocathédraux crurent pouvoir user de leur droit d'élection , comme lors de la précédente vacance du siége; ils se réunirent, le 4 septembre 1531 , et nommèrent à l'unanimité un d'entre eux, Chérubin d'Orsières, qui était aumônier de la reine. Le roi François Ier fit aussitôt valoir les droits que lui donnait le concordat ; il annula l'élection et appela au siége épiscopal de Sisteron, Antoine de Narbonne, abbé régulier d'Aniane, au diocèse de Maguelone. Chérubin d'Orsières devint, le 4 août 1536, évêque de Digne, et occupa ce siége pendant neuf ans. Antoine de Narbonne était fils de Guérin, seigneur de Salelles et de Marguerite de Miremont. Elevé en l'abbaye d'Aniane, sous les yeux de son oncle, abbé de ce monastère, il y fit profession en 1507, en devint cellerier en 1513 et abbé le 16 juin 1516 sur la démission de son oncle. Il fut le dernier des abbés réguliers , et prit possession le 7 septembre de cette année. En 1519, il présenta au roi le relevé des biens du monastère. En vertu du concordat signé avec Léon X, François Ier le nomma, en septembre 1531, à l'évêché de Sisteron; mais Antoine n'en garda pas moins l'abbaye d'Aniane. On voit en effet ce prince lui adresser, en septembre 1533, des lettres ordonnant que des foires seraient tenues deux fois par an, dans cette ville. Le roi confirma la tenue de ces foires par de nouvelles lettres données en mars 1535 à Estramiac, près de Lectoure, et qu'on trouve dans un ancien registre des archives impériales. Le nouvel évêque ne résida que rarement dans son diocèse, retenu sans doute auprès des grands par d'autres fonctions : aussi en 1532, il nomma son vicaire-général, Gérard de Genevrières, moine d'Aniane en Languedoc. Il est à présumer, sans témérité, que l'évêché de Sisteron et l'abbaye d'Aniane souffrirent également de cet état de choses. Un ancien titre de l'an 1540, nous apprend qu'Antoine de Narbonne était aussi, vicaire général de Jean, cardinal de Lorraine, et, certes , ce vicariat ne devait pas être une sinécure ; car le cardinal était archevêque de Narbonne et de Reims, évêque de Metz , de Toul, de Verdun et de Térouanne , et possédait en outre les abbayes de Cluny et de Fécamp. Bien des chartes publiques prouvent qu'Antoine occupait le siége de Sisteron dans les années 1533, 1534 et 1539. Transféré cette dernière année à l'évêché de Mâcon , Antoine de Narbonne prit possession de ce nouveau siége, le 11 janvier 1541, et mourut au mois d'octobre 1542. L'année précédente , Arnaud de Contades, juge de Narbonne, lui avait dédié un abrégé sur le 33e livre des Pandectes. Paris 1541, Antoine de Narbonne portait pour armoiries : de gueules plein.
69. — AUBIN DE ROCHECHOUART (1539-1560). Issu de l'illustre maison de Rochechouart , qui doit son origine aux vicomtes de Limoges, et qui a pris son nom de la terre de Rochechouart, petite ville située sur les confins du Poitou et du Limousin, Aubin de Rochechouart, était le troisième fils d'Aimeri de Rochecouart, troisième du nom, seigneur de Mortemart et de Tonnay-Charente , conseiller et chambellan du roi, sénéchal de Saintonge, gouverneur de Saint-Jeand'Angély en 1500, puis viguier de Toulouse, en considération des services qu'il avait rendus en 1509, dans la guerre d'Italie contre les Vénitiens. Sa mère était Jeanne de Pontville, dite de Rochechouart , dame de Mauze. Aubin , fut assurément nommé en 1540 à l'évêché de Sisteron; mais nous ne le trouvons mentionné avec ce titre que sur un acte du 16 décembre 1543. A cette date, sur la requête des sequestres des revenus épiscopaux, il ordonne à Marc-Antoine de Benoît, de résilier un bail locatif fait entre Antoine de Narbonne, ancien évêque de Sisteron, et Claude Garret. Du reste , ce prélat ne prit jamais en personne possession du siége, et cette circonstance explique trop bien que son épiscopat n'ait point laissé de traces. On ne sait même pas à quelle époque il cessa de siéger, soit par mort, soit par démission. Ce dut être vers 1560. Il portait pour armoiries : fascé, ondé d'argent et de gueules de six pièces.
70. — AIMERI DE ROCHECHOUART (1560-1580). Aimeri de Rochechouart, frère du précédent évêque et abbé de Saint-Savin, au diocèse de Poitiers depuis 1547, lui succéda vers 1560 sur le siége épiscopal de Sisteron. Columbi ne nous apprend rien de ce prélat jusqu'en 1573; pas plus que son prédécesseur, Aimeri sans doute n'était observateur des lois de la résidence. En 1570, il avait pour vicaire général Rainier du Bousquet , prieur de Ganagobie qui, le 26 septembre de cette année, installa à Sisteron la confrérie des Pénitents Blancs. A cette époque, une partie de la population avait été entraînée dans l'hérésie protestante, et au milieu de ces malheureuses divisions, les catholiques, éprouvant le besoin de resserrer les liens qui les unissaient , songèrent à établir dans la ville cette pieuse association. Sur leur demande, l'évêque leur abandonna un emplacement attenant à son palais : c'était l'ancienne église de Saint-Thyrse, entièrement ruinée par les sectaires. En 1573, il fit rétablir à Mane le monastère de religieuses qu'avaient détruit presque de fond en comble les protestants , et sa générosité contribua efficacement à ramener cette pieuse communauté à sa première splendeur. Trois ans après, il établit à Manosque la confrérie des Pénitents-Bleus qui, réunie en 1600, à celle des Pénitents-Blancs , jusqu'à l'époque de la Révolution, se fit toujours remarquer par le nombre, le zèle et la ferveur de ses membres. Ces petits événements s'effacent devant les affreux ravages commis de 1560 à 1567 par les Calvinistes en Provence et surtout à Sisteron. Les archives du chapitre de Forcalquier déplorent ainsi ces jours néfastes : «L'année dernière 1562, dans les mois de mai et de juin, des troupes de ces hérétiques luthériens, vulgairement nommés huguenaux, conduits par le malin esprit, en haine et en mépris de la sainte mère Eglise, épouse immaculée de Jésus-Christ, Notre Seigneur et très doux Père, ont osé briser les autels de pierre, consacrés dans ladite église et dans plus de vingt autres églises qui en dépendent.... Ensuite, d'un grand nombre de livres, écrits tant sur des membranes que sur du papier, et composés de chartes, traitant de théologie, de droit canon, de droit civil ou de littérature, profane, mais honnête, les uns ont été déchirés, les autres livrés aux flammes par ces barbares. Avec les livres, ont aussi péri tous les titres où étaient conservés les priviléges , les statuts et les louables coutumes de ladite église » La conduite de l'évêque de Sisteron dans ces déplorables circonstances nous est tout à fait inconnue. Aimeri de Rochechouart n'était point sans doute au milieu de son troupeau pour lui offrir les consolations de son ministère. Aucun historien n'a précisé la date de sa mort, nous avons été plus heureux ; mais en mentionnant ce fait intéressant pour l'histoire de Sisteron et de son Eglise, il nous eut été bien agréable de rencontrer sur notre prélat une appréciation moins triste et moins sévère. Aimeri de Rochechouart mourut à Paris le mercredi 28 décembre 1580, et voici en quels termes le chroniqueur Pierre de Lestoile parle de son décès dans le Journal de Henri III : « L'évêque de Sisteron mourut ce jour. C'était un vrai pourtrait d'Epicure et ung des plus vilains et sales du trouppeau, duquel la mort fust semblable à la vie. » Aimeri de Rochechouart portait pour armoiries : fascé , onde d'argent et de gueules, de six pièces.
71. — ANTOINE II DE CUPPIS (1581-1606). Issu d'une noble famille piémontaise, Antoine de Cuppis naquit à Asti , et grâce à ses talents autant qu'à d'honorables protections , il était devenu aumônier de la reine Louise de Vaudémont , femme de Henri III. Le siége épiscopal de Sisteron lui fut donné, non pas en 1584, comme l'affirme la Gallia christiana, mais bien en 1581 , ainsi que l'a dit Jean Columbi , Nous le trouvons, en septembre 1585, à Aix, au concile provincial que présida Alexandre Canigiani , archevêque de cette ville. Quelques années après, la Ligue, dont le but avoué était de défendre la religion de nos pères contre les envahissements des novateurs , mais dont le but réel était de saper la maison régnante de France à la faveur des troubles et des désordres de la guerre civile , la Ligue, disons-nous, continuait alors en Provence l'œuvre des protestants. Le duc de Lavalette , frère du duc d'Epernon , gouverneur de la Provence , ayant été insulté à Aix, où le parlement était en grande partie composé de ligueurs, assembla, au nom de son frère qui lui avait cédé ses pouvoirs, les Etats à Pertuis, créa de nouveaux procureurs du pays et demanda l'autorisation d'établir un parlement royal. De leur côté, les ligueurs qui avaient aussi leurs Etats, continuèrent d'administrer, comme s'ils eussent été seuls dépositaires de l'autorité. On sent tout ce qu'un pareil désordre dut produire de maux dans la province : chacun se divisa , suivant ses inclinations et son intérêt , et l'on ne put toutefois suivre un parti sans s'exposer à toutes les vengeances du parti contraire. Dans la vue de réparer quelques échecs et de marcher plus rapidement à son but, la Ligue ne trouva rien de mieux que d'implorer l'assistance de Charles-Emmanuel, duc de Savoie, et il nous semble inutile d'ajouter que ce funeste secours ne se fit pas attendre. Le parlement d'Aix ouvrit à ce prince les portes de la Provence et l'accueillait comme un libérateur, et pendant qu'à la mort de Henri III (1er août 1589), il plaçait le sceptre entre les mains du cardinal de Bourbon , le parlement royal alors siégeant à Pertuis proclamait Henri de Navarre , seul et légitime héritier du trône de saint Louis. La lutte dès lors s'envenima, le duc de Savoie fit des progrès , et dans son effroi, le parlement royal, pour s'éloigner du théâtre de la guerre, abandonna Pertuis, se transporta à Manosque et enfin à Sisteron, où il tint sa première séance, le 2 janvier 1591, sous la présidence d'Arthur de Prunier, seigneur de Saint-André, président au parlement de Grenoble. Au milieu de ces désordres, le clergé lui-même, jeté hors de ses voies, ne distingua plus la ligne de ses devoirs. Tandis que Paparin de Chaumont, évêque de Gap, chassé par les protestants de sa ville épiscopale et obligé de se réfugier à la Baume, suivait le parti de Henri IV, à la tête duquel était le duc de Lavalette, Antoine de Cuppis, évêque de Sisteron, retranché dans son château de Lurs, y défendait la Ligue avec opiniâtreté. L'arrivée en Provence du duc de Savoie, dont il était né le sujet, exaltait encore le fanatisme du prélat : il avait rempli son château et le village de gens de guerre, la plupart sans aveu et mal disciplinés qui, de là, se répandaient dans les environs et y causaient beaucoup de dégâts. Les vigueries de Forcalquier et de Sisteron demandèrent, d'un commun accord, au duc de Lavalette, de mettre un terme à ces brigandages. Ce dernier profita du passage des troupes que Lesdiguières amenait en 1591 en Provence, pour faire droit à cette demande. Il eut une entrevue avec lui à Château-Arnoux. Lesdiguières se présenta donc devant le château de Lurs avec trois cents chevaux et l'infanterie du duc de Lavalette. La garnison, affaiblie par un long siége, n'en fit pas moins une résistance opiniâtre. Déjà une brèche considérable avait été faite et un premier assaut tenté inutilement par les assiégeants, lorsque le sieur de Ramefort, commandant en l'absence de Lavalette, en ordonna un second, et se logea avec les siens sur les ruines de la brèche. Ce trait de courage déconcerta tellement les assiégés, qu'ils demandèrent à capituler. Ramefort n'eut garde de refuser cette proposition : car un seul jour de délai eut attiré sur ses bras les troupes du duc de Savoie, dont l'avant-garde était déjà à Saint-Paul-sur-Durance, et Lesdiguières devait se retirer le lendemain avec son corps d'armée. Après tant de désordres qui devaient laisser dans le pays des traces si profondes, le conseil général de la communauté de Sisteron résolut, avec l'approbation de l'évêque, Antoine de Cuppis, par une délibération du 5 juin 1604, d'établir dans la ville un collége de Jésuites. Les constructions, adjugées à des prix exhorbitants, occasionnèrent bientôt des débats et des troubles si graves que l'on dut abandonner ce projet. Un arrêt du parlement d'Aix, ayant condamné, le 18 novembre 1598, Antoine Melve, prévôt de Forcalquier et vicaire de Saint-Sauveur de Manosque à opter entre ces deux bénéfices, Antoine opta pour la prévôté. Antoine de Cuppis nomma aussitôt vicaire de Saint-Sauveur, Jean Blanc, et, depuis cette époque, cette vicairie devint perpétuelle et inamovible. La communauté de Manosque demanda peu après l'établissemenl d'un plus grand nombre de prêtres pour desservir la paroisse de Saint Sauveur, mais l'évêque de Sisteron résista à ces prétentions. Sur l'appel qui en fut relevé par devant l'archevêque d'Arles , puis devant le vice-légat d'Avignon, l'archevêque d'Embrun , par une sentence du 3 août 1604 , porta ce nombre à huit au lieu de cinq. Dans l'intervalle, avait été publié l'édit de pacification, et Henri IV n'avait pu pardonner à l'évêque de Sisteron sa longue hostilité. Obligé de se démettre, en 1606 , de son siége épiscopal, Antoine de Cuppis se retira à Turin , où il expia dans la pénitence et dans l'exercice des bonnes œuvres ce que sa conduite politique précédente avait eu de répréhensible. Logé dans la maison des pauvres, il consacra à leur service ses jours et ses nuits, et c'est là qu'il mourut le lundi 24 août 1609. Ce prélat avait pour armoiries : de gueules, à trois coupes d'argent.
72. — TOUSSAINT DE GLANDEVES DE CUGES (1606-1648). Toussaint de Glandèves naquit à Marseille et appartenait à l'illustre famille provençale de ce nom qui possédait la seigneurie de Cuges. Bien qu'il ne fut âgé que de vingt-deux ans, il était membre du conseil d'Etat et privé du roi, lorsque Henri IV le nomma à l'évêché de Sisteron, vacant par la démission d'Antoine de Cuppis en 1606. Sacré au mois de juillet de la même année, il vint presque aussitôt prendre possession de son siége. Hélas ! la pauvre église de Sisteron avait grand besoin d'un pasteur vigilant pour cicatriser ses blessures. Le palais épiscopal était détruit, et le nouveau prélat fut obligé d'aller demander l'hospitalité à Balthazar Roubaud, prévôt de son église. Son activité ne recula pas cependant un instant devant la tâche qui lui incombait : elle suffit à tout. Pour mieux ranimer la ferveur catholique dans le diocèse, Toussaint de Glandèves facilita de tous ses efforts l'établissement de communautés religieuses ou pieuses confréries. Le 15 avril 1609, assisté de tout le clergé séculier et régulier de Manosque, de plusieurs ecclésiastiques de sa suite, des consuls de la ville , et d'un grand nombre d'habitants, il bénit et planta solennellement à Manosque la croix de fondation d'un couvent de Capucins et posa ensuite la première pierre de leur église qu'il put consacrer le 7 août 1611. Au commencement de 1613, il appela dans sa ville épiscopale les religieux du même ordre, et les plaça dans l'enclos qui porte encore au jourd'hui leur nom et qu'ils ont occupé jusqu'à leur suppression. Les Mémoires du temps que nous a laissés le chanoine Gastinel rapportent que le 29 mars de cette année, vendredi avant les Rameaux, après un sermon prononcé par le P. Basile de Salon, la croix des Capucins fut solennellement plantée à la Burlière. Ils ajoutent que ce même P. Basile prêcha en suite les Quarante-Heures, sur un théâtre, à côté du grand autel de la cathédrale, et qu'il prêcha à genoux, jour et nuit sans interruption. La cérémonie avait commencé le soir des Rameaux par une procession générale à laquelle assistèrent , dit-on, plus de dix mille personnes et où l'évêque de Sisteron, nu-pieds, porta la croix. Cette dévotion qui avait attiré un grand concours de populations voisines, finit le mercredi saint par une autre procession générale. On dut encore au P. Basile l'introduction à Sisteron des Pénitents-Gris, confrérie qu'il avait lui-même instituée, et dont Toussaint de Glandèves approuva les statuts le 5 avril 1614. A cette occasion, le chapitre, la communauté et le quartier de la place s'entendirent pour relever de ses ruines l'ancienne église de Saint-Martin qui fut mise à la disposition de la nouvelle confrérie. Chacun voulut bientôt en faire partie , les riches, les premiers. A leur exemple, tout ce qui n'était pas de la confrérie de Saint-Jean (les Pénitents-Blancs), entra dans celle du tiers-ordre et s'humilia sous la toile grossière prescrite par la règle. Une louable et pieuse émulation s'établit , dès lors , entre ces deux corps , et l'on peut dire que pen dant deux siècles , il n'en résulta que plus de zèle , plus de ré gularité et plus de bonnes œuvres. En 1615, Toussaint de Glandèves autorisa définitivement l'établissement d'un couvent de Minimes, que, six ans auparavant, Melchior de Janson avait fondé dans le bourg de Mane. En 1634, il permit l'établissement d'un couvent de religieuses Bernardines à Manosque, encouragea Jeanne de Valavoire, supérieure de Sainte-Catherine à Avignon, dans cette fondation, et assisté d'un nombreux clergé et de toutes les autorités locales, installa en personne cette communauté. D'un esprit et d'un savoir aussi distingué que son caractère et sa vertu , il joua un rôle considérable dans .les assemblées générales du clergé en 1617, 1625 et 1641. En 1612 , il avait assisté au concile provincial d'Aix, et en 1614 aux Etats du royaume. Mais ces grandes affaires ne l'empêchaient pas de veiller aux besoins de son troupeau : en toute occasion, il s'attacha à rétablir la discipline ecclésiastique bien ébranlée par les troubles précédents. Les maisons religieuses, celle des Clarisses surtout ne renfermaient plus guère que dissipation, légèreté ou inconduite : il les réforma, s'occupant des plus petits détails, jusques à l'étoffe et à la coupe du vêtement. Ce grand évêque ne pouvait manquer de s'associer de tout son cœur au vœu des Sisteronnais, d'avoir un collége dirigé par les Jésuites. Nous avons dit dans la notice préliminaire, comment ce vœu ne fut pas réalisé ; mais il ne tint pas à Mgr de Glandèves qu'il ne fût repris. Il offrit dans ce but une somme de 30,000 livres qui vaudrait près d'un million d'aujourd'hui. S'il ne put contribuer à faire donner aux jeunes gens l'instruction supérieure dans leur cité, il aida puissamment à y appeler, pour faire l'éducation des jeunes filles, les dames de la Visitation et les Ursulines. Ces deux nouveaux ordres de femmes venaient à peine de recevoir, à Rome, l'autorisation papale, que déjà on se disputait leurs établissements scolaires. La dame de Gariscan, femme du gouverneur de Sisteron, s'employa ardemment de sa personne et de ses biens, à attirer dans cette ville ces saintes sœurs, ennemies de l'ignorance. Notre prélat vendit aux dames de la Visitation les ruines du palais épiscopal, et acheta alors dans la rue Droite, au sieur du Barsac, une maison qu'il convertit en évêché : habitation plus que modeste pour sa destination , et qui a besoin que l'ancien nom d'Evescat qu'elle conserve, vienne aider aujourd'hui à la reconnaître (1). En 1630, vers la fête de Pâques, la peste fit son apparition dans Sisteron, avec une violence telle que l'on vit bientôt mourir cent cinquante personnes par jour ; presque, tous les médecins en furent victimes, ainsi que la plupart des prêtres . : l'épouvante et la terreur régnèrent seules jusqu'au 11 novembre, jour où les portes de la ville furent rouvertes et les communications redevinrent libres. Les hôpitaux, nombreux cependant, n'avaient pu suffire durant l'épidémie ; la charité particulière leur était venue en aide ; des quêtes se faisaient par les dames les plus haut placées de la ville, et l'évêque attachait des indulgences aux dons des fidèles. Nous connaissons déjà, par la notice préliminaire, l'assassinat commis, le 14 juillet 1617, par des émeutiers sisteronnais, sur la personne de maître François Alby sieur de Brez, un des commissaires chargés d'établir dans notre ville cet impôt jugé vexatoire, appelé la traite foraine. Nous savons aussi la terrible sentence qui frappa les principaux coupables. Il nous reste à indiquer le rôle admirable de notre évêque dans cette affaire. Il revenait de Paris où l'avait appelé l'assemblée générale du clergé, lorsqu'il apprit l'attentat, et put juger de ses suites funestes. « Touché d'un vif sentiment , ainsi qu'il s'exprime lui-même dans un Mémoire que nous avons sous les yeux à cause de la dignité du personnage assassiné et de la misère qui en retomberoit sur tant de pauvres innocents, pour être le cas mêlé avec le service du roy ; ne pouvant desnier à la charitté que sa charge l'oblige à l'endroict de sa bergerie toute dispersée » il se hâta de revenir parmi ses diocésains, dans l'espoir de les aider de son crédit ou de leur prodiguer du moins les soins et les consolations qu'ils étaient en droit d'attendre de lui. (2). Bientôt la condamnation prononcée par neuf conseillers du parlement lui fut connue ; il partit en poste pour Paris, vit le duc de Guise, gouverneur de Provence, le chancelier du Vair, dont il était connu, aborda le roi lui-même, et obtint enfin des lettres d'abolition. Ces lettres lui furent oc troyées « en la considération de la fidélité et affection où la
(1) M. de la Plane, Hist. de Sisteron, tome II.
(2) La Plane, Op. c
ville de Sisteron s'étoict par le passé maintenue et conservée au service du feu roy, Henry le Grand. » Les peines et amendes étaient modérées, le crime de rébellion pardonné, et la commune réintégrée dans ses priviléges. Le voyage, les démarches, le droit de sceau avaient coûté beaucoup au prélat. Lorsque, étant de retour, il demanda le remboursement de ses avances , les bourgeois de Sisteron le reçurent par des chicanes sur la forme de son mandat et sur chaque article de son compte. Alors, protestant que « l'ingratitude ordinaire aux peuples lui mettait l'arme au poing pour la combattre, » il en appela au parlement. Nous ignorons quelles suites eut cet appel. A la suite de cette affaire que nous avons voulu raconter brièvement, mais sans interruption, des intempéries fréquentes ruinèrent les récoltes et augmentèrent la misère publique : Jean Saurin , grand-vicaire de Mgr de Glandèves , permit de vaquer aux travaux des champs, en cas d'urgence, tous les jours, sauf le dimanche, les fêtes de la Vierge et le jour de saint Jean-Baptiste , moyennant une légère aumône. Une année avant sa mort, et le 14 du mois d'août, l'illustre évêque donna, à son église cathédrale, une vierge d'argent massif, portée par deux anges, et du poids de 94 marcs et demi. Suivant Gastinel, cette statue était du prix de 8,000 livres, qui en représenteraient au moins 20,000 , valeur actuelle. « Nous désirons, dit l'évêque (dans l'acte de donation reçu par Castagny, notaire), que le lendemain , jour de l'Assomption, cette vierge soit exposée sur l'autel et portée annuellement en procession générale par tous les lieux et carrefours de la ville , sous le dais de l'église, sans pouvoir ladite cérémonie être divertie, sous quelque prétexte que ce soit. » A ce don, il ajouta celui de sa chapelle en argent, consistant en six gros chandeliers, une croix, une mitre précieuse, une crosse et un encensoir avec sa navette. Pour recevoir dignement ces dons, l'église cathédrale subit quelques améliorations : le rétable du maître-autel fut renouvelé et décoré de deux grandes figures sculptées en bois par le meilleur sculpteur d'Aix : elles représentaient saint Thyrse, martyr, en soldat romain, et saint Donat, prêtre, revêtu de la soutane, du surplis, de l'étole et tenant en main, un bonnet carré. Ces riches dons, dont le prix se centuplait encore par les souvenirs qui s'y rattachaient, ont été fondus au creuset révolutionnaire. La statue elle-même du bienfaiteur fut brisée par les modernes vandales ; une seule chose a échàppé à leur fureur : c'est sa mémoire bénie que les populations gardent dans leur cœur. Toussaint de Glandèves-Cuges , mourut , d'après son épitaphe, le 18 janvier 1647, et ici nous nous demandons pour quoi les Bénédictins, qui rapportent ce monument, ont subs titué 1648 à la date qu'il mentionne. Est-ce une faute? interroge M. de la Plane; est-ce une rectification? Dans ce dernier cas, quels sont les motifs de la rectification? On ne nous les donne pas. En l'état , il vaut mieux s'en tenir à la date gravée sur la pierre : elle a dû éprouver le contrôle public et aurait été contestée au cas impossible où elle serait erronée. Notre prélat fut inhumé dans son église cathédrale de Sisteron, et sur son tombeau on grava cette épitaphe que la Gallia christiana seule nous a conservée : Pus manibus Illustrissimi ac Reverendissimi D. D. Tosani de Glandeves, episcopi Sistaricensis. Hic jacet Illustrissimus Dominus Tussanus de Glandeves, episcopus Sistaricensis, quem, nobilitas omnibus dignitatibus prseparavit, sapientia prsecox, anno setatis suse 226 episcopatui maturum autoravit, perspicax solertia publicis Provincial conventibus ssepe necessarium fecit, prudentia singularis totius cleri Gallicani comitiis prsesidem dedit, eloquentia cordium victorem, doctrina publicum oraculum, lïberalitas episcopalis palatii et castri restitutorem magnificum et ejusdem redituum amplificatorem exhibuit : quem pietas dum altaria pressit argenteorum donorum pondere, ex hoc etiam tumulo Dei parse Virginis tutelse submisit, sub cujus patrocinio nihil mori potest. Obiit anno aztatis 62, a partu Virginis 1647, decimo quinto. kal. februarii. « Aux pieuses mânes de très illustre et révérendissime Toussaint de Glandèves, évêque de Sisteron. Ci-gît très illustre seigneur Toussaint de Glandèves, évêque de Sisteron. La noblesse de sa naissance le prépara à toutes les dignités ; sa sagesse précoce le rendit mûr pour l'épiscopat à l'âge de 22 ans; son habileté rendit souvent sa présence nécessaire aux Etats de Provence et sa remarquable prudence lui valut de présider l'assemblée générale du clergé de France ; son éloquence lui soumettait les cœurs, sa science l'élevait au rang d'oracle public ; par sa libéralité, il fut le restaurateur du palais épiscopal, et accrut les revenus de son évêché. Cet autel , qu'il avait chargé de dons en argent, le couvre maintenant de la protection de la Vierge mère de Dieu, protection qui ne laisse rien mourir. Il quitta ce monde à l'âge de 62 ans , l'an de l'enfantement de la Vierge 1647, et le 15 des cal. de février. » Un mausolée s'éleva sur son tombeau dans la cathédrale ; mais les archives de la ville et de l'Eglise ayant été détruites, on ne saurait dire, s'il est dû à la reconnaissance du chapitre, ou à la famille de Glandéves. Aucun document propre à nous éclairer sur ce point n'a survécu. Toussaint de Glandèves-Cuges portait pour armoiries : fascé d'or et de gueules de six pièces.
73. — ANTOINE D'ARBAUD DE MATHERON (1648-1666). Antoine d'Arbaud de Matheron, seigneur de Bargemont, conseiller du roi, sortait de la noble famille de ce nom qui tirait son origine de Barthélemi Arbaud, jurisconsulte distingué en grande réputation dès 1321, sous le règne de Robert, roi de Sicile et comte de Provence, et qui donna à l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, même avant qu'il ne s'établit à Malte, plusieurs chevaliers. Son père fut Jean-Baptiste d'Arbaud de Matheron, seigneur de Peinier ; sa mère, Anne de Rochas, dame d'Aiglun. Son oncle, Honorat, chevalier de Malte, mourut à Rome , au moment où il remplissait une mission dont son ordre l'avait chargé auprès du souverain Pontife. Antoine d'Arbaud, administrateur du chapitre métropolitain d'Aix le 2 mai 1629, et prévôt de cette Eglise le 10 décembre 1638, devint vicaire général et official du diocèse, à la mort de l'archevêque Louis Bretel arrivée le 27 mars 1644. Au décès de Toussaint de Glandèves, il fut nommé à l'évêché de Sisteron par brevet royal du 17 juillet 1648. C'était un homme, dit Columbi, illustre à la fois par sa naissance, par son caractère et par sa science. Il reçut ses bulles apostoliques du pape Innocent X le 18 septembre suivant, et fut sacré, le 7 février 1649, dans l'église de l'oratoire à Aix, par François Adhémar de Monteil de Grignan, archevêque et prince d'Arles, assisté de Louis Duchaine, évêque de Senez et de Réné le Clerc, évêque de Glandèves. En juin 1650, il prêta serment au roi pour le temporel de son Eglise ; et assista aux assemblées du clergé de France tenues en 1650 et en 1656. Dans le courant de 1654, il publia deux mandements ordonnant le chant du Te Deum dans sa cathédrale et dans toutes les églises du diocèse, l'un en mai pour le sacre du roi Louis XIV, l'autre en août pour le double succès de la prise de Stenay et la levée du siége d'Arras. Nonobstant la sage prescription du concile de Trente, plusieurs diocèses n'avaient point encore à cette époque des séminaires. Le diocèse de Sisteron était de ce nombre. Claude de Thomassin, né à Manosque en 1615, chanoine théologal de Fréjus, protonotaire du Saint-Siége, docteur en théologie, conseiller, aumônier et prédicateur du roi , voulut réaliser les vœux si sages du concile, mais à la condition que le séminaire serait établi dans sa ville natale. L'évêque Antoine d'Arbaud de Matheron souscrivit volontiers à cette proposition qui assurait la fondation d'un établissement aussi nécessaire que cher à son cœur. Par acte du 3 novembre 1661, le pieux fondateur céda au séminaire, qui fut ouvert le 3 décembre suivant, sa maison et ses biens, se réservant pour toute sa vie, la direction de cet établissement, l'administration de ses biens , le choix des professeurs , et après sa mort , le droit pour sa fa mille de nommer à l'une des six places fondées dans le séminaire. Cette fondation fut confirmée par lettres patentes royales données à Saint-Germain-en-Laye, en novembre 1662, sous le titre de séminaire de l'Enfant-Jésus. Columbi parle d'Arbaud de Matheron avec éloges, un peu prévenu sans doute par la reconnaissance car il en avait reçu toutes sortes de secours et d'encouragements pour la composition de ses ouvrages et surtout de celui qui a pour titre : De rebus gestis Episeoporum Sistaricencium. Le chanoine Gastinel est loin d'abonder dans le sens de l'éloge. « On aurait dû graver, dit-il , sur son tombeau : Solus vixit , solus obiit, etsolus sepultus est, ou bien Mortuus est dives.. » Il nous semble que ce prélat avait l'avantage de réunir la science et les talents au mérite de la vertu. Nous ignorons s'il vécut seul , s'il mourut seul et riche , mais il fut enseveli seul dans l'église du couvent des Récollets de Notre-Dame-des-Anges, au-dessous de Lurs, maison dont il était le fondateur. Arbaud de Matheron quitta ce monde le mercredi 26 mai 1666. Il portait pour armoiries : d'azur, au chevron d'argent, au chef d'or, chargé d'une étoile de gueules.
74. — MICHEL II PONCET DE LA RIVIÉRE (1667-1674) . Fils de Pierre Poncet de la Rivière, comte d'Ablis , mort doyen des conseillers d'Etat , Michel Poncet , abbé d'Airvaux , au diocèse de la Rochelle , docteur de Sorbonne, aumônier du roi et agent général du clergé de France, fut, en mai 1667, appelé par Louis XIV à l'évêché de Sisteron. Le pape Clément IX lui ayant accordé ses bulles, il fut sacré dans l'église de la Sorbonne à Paris, le 28 novembre de la même année, par Hardouin de Péréfixe, archevêque de Paris, assisté de Niccolas Sevin, évêque de Cahors, et de François de Nesmond, évêque de Bayeux. En arrivant dans son diocèse, Michel Poncet y trouva bien des abus à réformer, on peut en attribuer une partie à son prédécesseur Antoine d'Arbaud de Matheron, si l'épitaphe proposée par Gastinel est justifiée. Ce même Gastinel nous a conservé plusieurs ordonnances de Poncet. Le nouveau prélat fut reçu selon l'usage, en avant de la grand'porte de la cathédrale, appelée alors porte-réal. Là, il fut frappé du mauvais état de la clôture du cimetière sur lequel donnait cette porte, et un de ses premiers soins fut d'amener le chapitre à s'entendre avec la ville pour hâter une réparation que la décence publique ne permettait pas de faire dépendre d'une misérable question d'intérêt. Toutefois, ce ne fut qu'en 1777, que ce cimetière fut abandonné, par suite de l'édit du 15 mai 1776, qui voulait que toutes les inhumations se fissent hors de l'enceinte des villes. Nous savons encore, qu'en 1673, Michel Poncet fit la visite pastorale de son diocèse et qu'il y fut accompagné par son théologal, Claude Saurin, homme de mérite, qui, avant Columbi, débrouilla l'histoire des évêques de Sisteron, et dressa en même temps un catalogue des chanoines. L'historien de Manosque profita de son travail, resté manuscrit et aujourd'hui perdu, il le cite quelquefois, et après Columbi, les Bénédictins auteurs de la Gallia christiana le citent également ; mais c'est à tort qu'ils lui donnent le prénom de Nicolas, au lieu de Claude : prénom que l'on trouve dans son acte d'élection à la chaire de théologal du 18 mai 1634. Un brevet royal du 22 novembre 1674, transféra Michel Poncet à l'archevêché de Bourges, pour lequel il reçut des bulles dans le consistoire du 17 juin 1675. Avant d'être institué pour cette Eglise que laissait vacante la translation de Jean de Montpezat de Carbon à l'archevêché de Toulouse, il consentit, avec ce dernier prélat, à l'érection de l'évêché d'Albi en métropole, sous certaines conditions exprimées dans un acte du 7 mai 1675, notamment celle de conserver le droit de primatie sur la nouvelle province. De plus, on détacha des revenus d'Albi 15,000 livres de rentes en dîmes, le temporel de l'archevêché de Bourges étant peu considérable. Cet archevêché n'ayant que 12,000 livres de rente, était, à cette époque, un des plus pauvres de France. Le 17 juillet de la même année, Michel Poncet prit possession du siége par procureur, et fit, le 30 octobre suivant, son entrée solennelle à Bourges. Ce prélat ne fit, pour ainsi dire, que paraître sur la chaire de saint Ursin. Une attaque d'apoplexie l'enleva à Bourges, dans sa 71e année, le dimanche 21 février 1677. On l'inhuma dans le chœur de sa cathédrale, près de la place du chancelier, et ce fut le dernier des archevêques dont les dépouilles aient été déposées, avant 1789, dans les caveaux de Saint-Etienne. Voici l'épitaphe qui fut alors placée sur son tombeau : Hic jacet Illustrissimus et Reverendissimus ZX D. Michael . Poncetius , patriarcha, archiepiscopus Bituricensis , Aquitaniarum primas. Obiit die XXI februarii, anno Domini MDCLXXVI1. « Ici repose illustrissime et revérendissime seigneur Michel Poncet, patriarche, archevêque de Bourges, primat des Aquitaines. Il mourut le 21 février de l'an du Seigneur 1677. » Lorsqu'en 1760, on perça la voûte qui supporte le pavé du sanctuaire de l'église supérieure, pour faire une nouvelle entrée au troisième caveau, on trouva le corps du vénérable prélat, que l'on déposa dans ce même caveau. Mais à l'époque néfaste où l'impiété ne craignit pas de porter jusque sur les sépultures une main sacrilége , son cercueil de plomb fut enlevé et ses ossements jetés à terre. Deux respectables ecclésiastiques, MM. Bonnamy et Godin, chanoines honoraires, étant descendus par curiosité dans ce caveau en 1809, trouvèrent épars sur le sol les ossements de cet archevêque. Ils les recueillirent avec respect, et les rangèrent dans l'une des niches de cette crypte. Le chapitre et la fabrique de l'église métropolitaine firent inhumer ces restes du côté du nord, à l'en droit où le cercueil était auparavant placé, et ils les firent couvrir, au niveau du sol, d'une dalle qui porte l'inscription suivante : Hic jacent ossa D. D. Michaelis Poncet de la Rivière , archiep. Bitur., à tumulo plumbeo erepta temporibus calamitosis, recollecta autem curis et sumptibus venerabilis capituli etfabricise hujus ecclesise, anno Domini 1 809, mense februàrio. Ici reposent les ossements de Monseigneur Michel Poncet de la Rivière , archevêque de Bourges, arrachés de leur cer cueil de plomb dans des temps désastreux, mais recueillis par les soins et aux frais du vénérable chapitre et de la fabrique de cette église, au mois de février 1809. » Michel Poncet de la Rivière portait pour armoiries : d'azur, à la gerbe de blé d'or liée de même, supportant deux oiseaux affrontés aussi d'or, et une étoile d'argent en chef.
75. — JACQUES III POTIER DE NOVION (1674-1680). Jacques Potier de Novion naquit à Paris en 1647, et était le deuxième fils de Nicolas Potier, seigneur de Novion, premier président au parlement de Paris, mort le 1er septembre 1693, et de Catherine Gallard, décédée le 23 avril 1685. Abbé du Petit-Citeaux au diocèse de Chartres, et reçu docteur en théologie de la Faculté de Paris, il fut nommé , le 22 novembre 1674, à l'évêché de Sïsteron. Diverses causes retardèrent sa préconisation en cour de Rome, et ce ne fut que dans le consistoire du 8 février 1677 que des bulles lui furent accordées. Sacré peu après, il prit la même année possession du siége qu'il occupa trois ans à peine. Un brevet du roi l'ayant, le 12 janvier 1680, transféré à l'évèché de Fréjus, il fut en cette qualité député de la province ecclésiastique d'Aix, à l'assemblée du clergé de cette année, mais avant d'avoir reçu les bulles de ce nouveau siége; il fut préconisé évêque d'Evreux, dans le consistoire du 29 mai 1681. Il prit possession le 16 mai 1682. En arrivant dans le diocèse d'Evreux , Jacques Potier pacifia quelques discordes qui s'étaient élevées au sein du clergé, eut soin de maintenir la paix, et vécut dans la meilleure intelligence avec son chapitre et ses prêtres. Cependant, après de longues années de tranquillité, les opinions qui se faisaient jour dans l'Eglise, amenèrent une scission déplorable entre lui et la plupart des membres de son clergé. En 1695, les Capucins qui, sous l'épiscopat de Guillaume de Péricard, s'étaient introduits à Evreux, trouvèrent le moyen de faire bâtir un autre couvent plus grand et plus magnifique, dont les bâtiments servent actuellement de collége. Jacques Potier fit quelque difficulté pour consacrer l'église du nouveau monastère, dont l'autel et le chœur, contrairement à l'ancienne discipline et aux règles admises par l'Eglise, étaient tournés vers l'Occident. Jacques Potier se fit représenter par son grand-vicaire, Nicolas de Vaucel, chanoine et archidiacre, au concile provincial , tenu à Gaillon, le 30 juin 1699 , et mourut après un épiscopat de vingt-six ans, le lundi 14 octobre 1709. On l'inhuma dans le chœur de sa cathédrale. Ce prélat avait pour armoiries : d'azur, à deux mains dextres d'or, au franc-quartier échiqueté d'or et d'azur.
76. — LOUIS DE THOMASSIN (1680-1728). Né à Aix, le 16 août 1637,et fils de François de Thomassin, seigneur de Saint-Paul, conseiller au parlement de Provence, et d'Anne du Chaine, Louis de Thomassin, neveu à la mode de Bretagne du célèbre oratorien de ce nom, fut nommé, le 24 avril 1671, coadjuteur d'Antoine Godeau, évêque de Vence. Préconisé en cour de Rome, il fut sacré à Paris, le 21 février 1672, en l'église des religieuses de la Visitation , par Jacques Adhémar de Monteil de Grignan , évêque d'Usez , assisté de Dominique de Ligny, évêque de Meaux, et de François de Nesmond, évêque de Bayeux. Le nouveau prélat prêta, le 8 mars suivant, le serment de fidélité d'usage entre les mains du roi, et devint, le 17 avril de la même année, jour de Pâques , titulaire du siége de Vence , par le décès d'Antoine Godeau. Louis de Thomassin prit solennellement possession de son siége, le 23 mai 1672, et à l'aide des libéralités de son prédécesseur, continua les embellissements commencés à la cathédrale et au palais épiscopal. Il fit réparer, par un facteur nommé Antoine Juliani, les orgues de son église, « car, dit un manuscrit du temps, les anciennes étaient trop petites, vieilles et indécentes pour une cathédrale. » Par ses soins, furent reconstruites en grande partie les églises de la Colle et de Saint-Paul, et le grand séminaire fut achevé. Ce nouveau grand séminaire fut autorisé par lettres patentes royales de 1681. Le P. Tourtoureaux, qui en fut nommé supérieur, devint grand-vicaire de Louis de Thomassin, par acte passé devant Me de Guignes, notaire à Vence, le 19 septembre 1 673, et mérita toute la confiance du prélat. Transféré à l'évêché de Sisteron par brevet royal du 2 février 1680, Louis de Thomassin ne fut préconisé pour ce siége que dans le consistoire du 29 mars 1681. Il prit possession au mois de décembre 1682, après avoir approuvé les actes de la célèbre assemblée qui promulgua les quatre fameux articles. Trois ans plus tard, l'évêque de Sisteron se trouvait député de la province d'Aix à l'assemblée du clergé lorsque son oncle, Claude de Thomassin , le fondateur du séminaire de Manosque le chargea de placer cette maison sous la direction des Prêtres de la congrégation de la Mission. En conséquence de la procuration qu'il lui donna à cet égard, Louis de Thomassin, par acte notarié du 30 octobre 1685, céda et transféra à cette congrégation, le P. EdmeJolly, général, acceptant et stipulant pqur elle , tous les meubles et immeubles qui appartenaient et appartiendraient à l'avenir audit séminaire. Le cessionnaire renonça de plus à tous les droits qu'il s'était réservés par l'acte du 31 octobre 1661, sauf un logement et la nourriture dans la maison. La congrégation des Prêtres de la Mission s'engagea, de son côté, de céder trois Pères et deux frères convers pour la direction et l'administration du séminaire de Manosque. Ceux-ci ne pouvaient être révoqués ou changés que par le supérieur général, et n'étaient tenus, à aucun service dans les paroisses. Claude de Thomassin devait de plus être regardé dans le séminaire comme le vrai fondateur, traité à l'égal des Pères directeurs, jouir des appartements qu'il occupait, et, après sa mort, il devait être célébré tous les jours et à son intention une messe en l'honneur de l'Enfant Jésus. Cette union fut confirmée par lettres patentes du mois de mai 1687. Depuis cette époque, jusqu'à la Révolution, c'est-à-dire pendant plus d'un siècle, les Prêtres de la congrégation de la Mission furent seuls chargés de cet établissement. Ils s'en acquittèrent avec autant de zèle que de succès, et bientôt l'éducation cléricale prit, dans le diocèse, un développement inconnu jusqu'alors. C'est sous leur habile direction que se formèrent tant de pasteurs vigilants et instruits, tant de vertueux prêtres, tant de sages directeurs des consciences, de sorte qu'on ne doit pas avoir moins de reconnaissance envers le pieux fondateur qu'envers les directeurs éclairés de ce séminaire diocésain. Claude de Thomassin qui contribua beaucoup à la rédaction des statuts synodaux du diocèse de Sisteron, publiés en 1710 seulement, mourut en 1692, à Manosque, et fut inhumé dans l'église de Saint-Sauveur. En avril 1688, Louis de Thomassin permit l'érection canonique du tiers-ordre de saint Dominique, faite dans sa paroisse, par Joseph Baudric, curé de Saint-Sauveur, à Manosque. « Il y avait déjà longtemps, dit M. de la Plane, que la religion réformée n'avait plus de partisans à Sisteron : tous avaient disparu dans le cours du siècle qui venait de s'écouler, les uns, en abandonnant le pays, les autres en abjurant l'erreur. On a des livres de la secte, dont les marges témoignent qu'en renonçant à l'hérésie, les possesseurs en ont fait le sacrifice à la sûreté de leur conscience. Mais dans certaines parties du diocèse, il n'en était pas de même : nombre de familles y conservaient de l'attachement aux nouveaux dogmes, et lorsque la révocation de l'édit de Nantes, le 22 octobre 1685, vint les mettre dans l'alternative ou de revenir catholiques ou de s'expatrier, la plupart prirent le parti de se soumettre et de rester dans leurs foyers. C'est dans la vue de procurer à ces familles, rentrées dans le giron de l'Eglise, les moyens d'instruction que réclamait leur état, qu'un pieux chanoine de Sisteron, Pierre-André Tyranny, conçut l'idée d'un établissement destiné à former de jeunes ecclésiastiques aux travaux des missions , « principalement pour celles de la campagne où il y a de nouveaux convertis. » Louis de Thomassin, goûta fort le projet de Tyranny auquel il voulut même s'associer, tant par le don qu'il fit d'une somme de cinq mille livres que par les démarches nécessaires pour en hâter l'exécution. Sur sa demande, le roi l'autorisa à doter, en avril 1698, le nouveau séminaire d'un revenu de deux mille livres, provenant, savoir : moitié de bénéfices qui y seraient attachés à perpétuité, et moitié d'un prélèvement sur tous les revenus ecclésiastiques du diocèse, au-dessus de quatre cents livres, les cures exceptées. Tyranny donna une métairie, celle de Maigro-Mine, sur la rive droite du Jabron, et sa maison appelée encore la Mission dans la rue de ce nom. C'était tout ce qu'il possédait. Les sujets ne manquèrent pas à la congrégation naissante qui, sous le nom de Missionnaires de la Croix, se vit bientôt en état de remplir l'objet de son institution. La réputation des nouveaux apôtres, s'étendait de jour en jour : on les appelait de tous côtés. En 1704, ils étaient à Tarascon où ils eurent occasion de connaître un saint prêtre d'Avignon que la Providence leur avait donné pour collaborateur, M. Laurent-Dominique Bertet. Ce dernier avait depuis peu, fondé à Sainte-Garde, diocèse de Carpentras, une congrégation semblable à celle qui venait de s'établir à Sisteron. Tyranny proposa de les réunir et de mettre en commun des efforts qui , tendant au même but , ne pourraient que gagner à n'avoir désormais qu'une seule et même direction. Cependant plusieurs années s'écoulèrent avant que cette utile fusion, également désirée par les deux religieux, pût s'opérer. Elle n'eut lieu que vers 1712. En attendant, les dignes prêtres de Sainte-Croix et ceux de Sainte-Garde continuèrent à travailler de concert au salut des âmes. Dans une mission qu'ils donnèrent à Sisteron en 1706, leur charité alla jusqu'au prodige. Bertet, au rapport de son biographe , prenait à peine quelques heures de repos et couchait ordinairement tout habillé. Après avoir préparé le matin , de très bonne heure, le peuple dans des instructions familières, il consacrait le reste de la journée à répondre à la confiance des fidèles qui l'acca blaient. Les pauvres en particulier trouvaient en lui non-seule ment un consolateur, mais encore un bienfaiteur toujours prêt à les secourir. Lorsqu'il avait distribué tout son argent, il se dépouillait de ses habits, de ses souliers, de son chapeau n'ayant plus alors pour cacher son dénûment que le confessionnal, d'où il fallait l'arracher après avoir renouvelé ses vêtements. Touché de tant de vertus, Louis de Thomassin accorda toute sa confiance à M. Bertet. L'homme de Dieu en profita pour disposer l'évêque, son pénitent, en faveur d'un établissement de charité, dont on s'occupait à cette époque à Sisteron, et ce ne fut pas sans fruit. Dans une quête générale faite à cette occasion par les missionnaires eux-mêmes et qui dépassa toutes les espérances, on vit ce prélat y contribuer pour une somme de mille écus. C'est encore, d'après les conseils du vénérable supérieur de Sainte-Garde que furent dressés les réglements de la nouvelle maison et même le plan et la distribution des bâtiments. C'est l'hospice actuel. Lorsqu'en 1713 la bulle Unigenitus vint frapper les jansénistes, quelques prêtres d'une foi suspecte cherchèrent à répandre l'esprit de révolte à Sisteron ; mais ils rencontrèrent dans M. Bertet un redoutable adversaire qui les confondit dans des conférences publiques, montrant ainsi aux fidèles, au clergé et à l'évêque lui-même la seule voie où il n'y eut pas pour eux danger de s'égarer. En 1680, Louis de Thomassin fonda à Lurs le petit séminaire de son diocèse et en confia la direction aux Prêtres de la Mission. Cet établissement dédié à saint Charles prospéra bien tôt et attira un grand nombre d'élèves. L'année suivante, par ses soins, ceux du chapitre de Forcalquier et de M. de Glandèves, seigneur du lieu, on construisit l'église paroissiale de Niozelles qu'il consacra sous le titre de l'Invention de saint Etienne, martyr, et lui donna pour patrons saint Alban et saint Candide. Nous connaissons de ce prélat : une Lettre et Instruction pastorale contre la fausse spiritualité, 29 septembre 1637, in-4e. Louis de Thomassin était parvenu à la 81e année de son âge et à la 46e année de son épiscopat lorsqu'il périt victime d'un triste accident. Récitant son bréviaire en se promenant sur la terrrasse de son château de Lurs, une vieille muraille s'écroula, et entraîna avec elle le vénérable prélat dont le corps vint se briser sur des rochers au fond d'un précipice. C'était le samedi 16 juillet 1718, ainsi que le portent les registres de la paroisse, et non pas le 13 de ce mois, comme l'ont dit Papon et divers autres auteurs. On l'inhuma dans l'église cathédrale de Sisteron, chapelle de la Valette, aujourd'hui de la Miséricorde. Ce prélat portait pour armoiries : d'azur, à une croix écotée d'or, et sur le tout un écusson de sable chargé de onze faux d'or, posées 4, 3 et 4.

77. — PIERRE-FRANÇOIS LAFITAU (1719-1764). Né en 1685 à Bordeaux où son père était courtier en vins, Pierre-François Lafitau dut sa fortune à son esprit. Il fit ses études chez les Jésuites, prit l'habit de cet ordre et se distingua par son talent pour la chaire. Ayant été envoyé à Rome au sujet des disputes élevées par les jansénistes contre la bulle Unigenitus, il plut au pape Clément XI. Sa conversation vive et aisée, son esprit fécond en saillies donnèrent à ce Pontife une idée favorable de son caractère et de ses talents. Nommé le 1er novembre 1719 à l'évêché de Sisteron, Lafitau quitta l'a Compagnie de Jésus, et, sur ces entrefaites, le cardinal de la Trémoille, chargé des affaires de France en cour de Rome , étant mort , l'évêque nommé eut mission de le remplacer. Préconisé dans un consistoire tenu au mois de février, Lafitau fut sacré le 10 mars 1720 dans l'église de Saint-Louis des Français à Rome par le cardinal Philippe-Antoine Gualterio, évêque d'Imola, abbé commendataire de Saint-Remi, de Reims assisté de N. Battelli, évêque de ..., et de Prosper Marefoschi, évêque de Cyrène in partibus, auditeur du pape. Cette même année, le pape Clément XI, vivement touché du malheur qui frappait la ville de Marseille, décimée par la peste, avait ordonné à Rome des prières publiques et des processions qu'il suivait lui-même à pied pour fléchir la colère divine. Après avoir accordé de nombreuses grâces spirituelles à cette Eglise si douloureusement éprouvée, et qui était aussi recommandable par la pureté inaltérable de sa foi que par son antique et constant dévouement au Saint-Siége, il envoya à M. de Belsunce, son évêque, deux mille boisseaux de blé, mesure romaine, et lui annonça cet envoi par un bref du 14 septembre 1720. Le premier ministre Dubois, naguère sacré archevêque de Cambrai , eut le tort de supposer que cette généreuse offrande avait pour but d'humilier la France et de dénigrer son gouvernement. Il chargea Lafitau de retenir dans les ports d'Italie les trois vaisseaux porteurs de ce présent pontifical. Ils partirent malgré lui, furent pris par un capitaine barbaresque, qui, en apprenant leur charitable destination, s'empressa de les rendre à M. de Belsunce, qui les fit vendre au profit des pauvres. A cette époque, la contagion après avoir gagné sourdement la campagne et quelques villages des environs de Marseille, s'était, malgré toutes les précautions, répandue dans plusieurs villes de la Basse-Provence, et elle s'étendit même au delà de la Durance. Sisteron fut à l'abri du fléau qui envahit cependant plusieurs localités du diocèse. Au milieu de tant d'alarmes, on n'oublia pas de rendre grâces à la Providence, et le 19 janvier 1721, la ville fit le vœu solennel d'habiller tous les ans six pauvres à ses frais et de les faire assister, en perpétuel et vivant témoignage de sa reconnaissance à la procession que l'on était dans l'habitude de faire le 20 de ce même mois, jour de saint Sébastien. Lafitau n'eut pas plus tôt connaissance du danger que couraient ses diocésains, que dans l'effusion de son cœur, il leur écrivit : « Faut-il donc , mes très chers frères, que la première fois que nous vous adressons la parole, ce soit pour essuyer vos larmes, que nous soyions obligé de faire consister une partie de notre consolation à pleurer ensemble, et que nous n'ayions pas même l'espérance d'aller partager vos dangers. » Depuis que nous apprîmes hier soir qu'une partie de notre diocèse venait d'être enveloppée dans la contagion qui nous faisait pleurer sur nos voisins, nous n'avons cessé de pleurer sur nous-mêmes et sur l'impossibilité où nous nous trouvons d'aller prendre part à vos souffrances; à la vérité, quoique nous soyions absents de corps, nous sommes pourtant avec vous en esprit. » L'évêque annonce à ses ouailles que le souverain Pontife , touché de leurs maux personnels comme s'ils étaient les siens propres, a daigné leur ouvrir les trésors de l'Eglise, et qu'il leur adresse un bref portant indulgence plénière « pour tous ceux du diocèse de Sisteron, qui, après s'être confessés et se repentant de leurs péchés, se trouveront à l'article de la mort, soit par l'effet de la contagion, soit qu'ils succombent à une mort naturelle , après s'être consacrés au service de ceux qui en auront été infectés. » Ce bref donné à Sainte-Marie-Majeure, sous l'anneau du pêcheur, le 26 octobre 1720, est applicable à tous les fidèles de l'un et de l'autre sexe, attaqués de la contagion ou soupçonnés d'en être atteints, aux prêtres qui leur administreront les sacrements, aux médecins et chirurgiens qui les traiteront, aux sages-femmes qui aideront aux accouchements, aux nourrices qui allaiteront les enfants, à ceux qui enseveliront les morts , à toute personne enfin qui vi sitera les malades , les assistera , les consolera , etc. Le fléau se retira, laissant partout sur son passage le deuil et l'effroi. Cent mille victimes avaient succombé dans la Pro vence , et le diocèse de Sisteron avait apporté à ce chiffre, un contingent considérable. La paroisse de Sainte-Tulle, notamment, avait été cruellement éprouvée. Le fléau y fut importé par Anne Bonnet, épouse de Jean-Baptiste Crique, qui revenait de Marseille avec son nourrisson. Trois jours après son arrivée, c'est-à-dire le 7 août 1720, cette femme succomba avec son enfant. Le lendemain et le surlendemain, on compta deux autres décès sans caractère pestilentiel apparent. Il n'y eut plus de morts jusqu'au 30 août et l'on se rassura. Mais le 31, il survint un nouveau décès. La mort ne frappa personne jusqu'au 4 septembre, jour néfaste qui ouvrit la nécropole des pestiférés pour ne plus la voir fermée jusqu'au 14 mars 1721. Le bureau de santé eut à veiller tout à la fois et sur les progrès de la maladie,et sur les moyens de procurer aux habitants valides, le pain, la viande et le sel nécessaires, car un blocus sévère de troupes commandées par le marquis d'Argenson, ne permettait aucune communication avec les habitants des localités voisines. Ce bureau fut à la hauteur de sa tâche et sut pourvoir à tout. Les chapelles de Saint-Pierre et de Sainte-Tulle, une vaste métairie et le château furent convertis en infirmeries. On y vit aussi les plus généreux dévouements. Sur 426 personnes enlevées par le fléau, pas une qui fut privée des secours de la religion et de l'art, hélas ! trop impuissant vu la nature du mal. Les deux frères Archimbaud, l'un curé de la paroisse, l'autre médecin, et le notaire Blanchard remplirent leurs fonctions auprès des pestiférés avec autant de dévouement et de sang-froid que dans les temps ordinaires : et ces trois héros de l'humanité furent épargnés par le fléau. Le dernier perdit en un même jour ses deux fils, dans l'adolescence, et il se vit réduit à porter les deux cadavres sur ses épaules et à les ensevelir de ses propres mains. On se fera une idée du deuil et de la désolation de cette commune, en considérant qu'une population de 810 âmes se trouva réduite à 384 âmes ; que dans ce désastre, 45 familles se trouvèrent complètement anéanties ; que celle des Roland compta 19 victimes, celle des Filhol 16, celle des Dauvergne 8, etc. Mais ce qui en donnera surtout une juste idée, c'est le vœu formulé dans le conseil général du 29 septembre. « Une procession annuelle et perpétuelle, précédée d'un jour de jeûne, aura lieu à la chapelle de Sainte-Tulle, le dimanche, après le 21 septembre. Les prêtres de la paroisse, les magistrats de la commune et un membre au moins de chaque famille seront tenus d'y assister pieds nus, la corde au cou et un flambeau à la main, sous peine d'une amende de 20 livres au profit de la chapelle. Les consuls devront de plus communier à la messe qui y sera célébrée. Le jour de la fête de Sainte-Tulle, il n'y aura plus ni jeux, ni fanfares, ni danses; une amende de 10 livres est prononcée contre tout profanateur du saint jour de dimanche, et lecture de ce vœu sera faite chaque année par le greffier de la commune devant la porte de l'église, avant le départ de la procession. » Cette délibération fut religieusement observée pendant trois ans consécutifs. Mgr Lafitau jugea prudent de commuer ce vœu des habitants en une procession ordinaire à la chapelle de Sainte-Tulle, suivie de la messe pro vitanda mortalitate, et en une procession à chaque fête chômée de la sainte Vierge à la fin de laquelle on réciterait le chapelet devant le Saint-Sacrement exposé. Ces prescriptions s'exécutent encore de nos jours. Le fléau cessa entièrement à Sainte-Tulle, le 14 mars 1721, mais il sévit plus tard dans d'autres paroisses, entre autres à Corbières, où depuis le 21 septembre 1720 jusqu'au 11 avril 1721, il enleva 131 personnes sur une population de 400 âmes. Ce ne fut néanmoins que vers la fin de juillet que le blocus fut levé et le droit de circulation rendu aux habitants. Dubois, alors archevêque de Cambrai , désirait ardemment le chapeau de cardinal , Lafitau fut chargé de presser à cet égard le nouveau Pape et de séduire tout son entourage par des présents. Cependant les choses ne marchaient pas aussi rapidement qu'il le voulait. Dubois nomma , pour l'ambassade de Rome, le cardinal de Rohan, grand-aumônier de France. Lafitau, jaloux de se voir donner un collègue et un supérieur qui s'attribuerait tout l'honneur des négociations, redoubla d'efforts pour obtenir du Pape une promesse positive. Le 31 décembre 1720, au moment où les cloches de Rome annonçaient la naissance de Charles-Edouard, prince de Galles, de la maison des Stuart , son père , Jacques III , Lafitau, le cardinal Gualterio et deux neveux du Pape, entouraient ce vieillard languissant dans son fauteuil et le conjuraient de faire leur bonheur à tous, d'assurer l'appui de la France à un malheureux enfant donné par le ciel pour venger l'Eglise romaine, en un mot, de consommer la nomination de Dubois et de lui promettre au moins par écrit le premier chapeau vacant. Clément XI eut l'air de s'attendrir, prit une plume et traça tout de suite la promesse désirée, dont il avait depuis longtemps bien médité tous les termes. Lafitau, ébloui de sa conquête , envoya aussitôt, par un courrier, la promesse du Pape sans en bien peser les expressions. La colère de Dubois fut excitée à la lecture de cet écrit qui accordait, à la sollicitation de Jacques III, prétendant à la couronne d'Angleterre, ce qui avait été demandé par le régent de France. Aussi le premier ministre écrivit-il à Lafitau la lettre suivante : « En vérité, c'est un chef-d'œuvre de dextérité que l'engagement que vous avez tiré du Pape, la discorde l'aurait fabriqué elle-même qu'elle n'aurait rien pu imaginer de pire. M. le Régent est outragé, le prétendant compromis, et je suis couvert, aux yeux de l'Europe, de ridicule et de preuves de trahison. Je n'ai plus qu'à souhaiter que cet écrit ne soit vu de personne, et qu'il tombe éternellement dans l'oubli. » Clément XI descendit dans la tombe le 19 mars 1721, et le sacré collége, le 8 mai suivant, élevait sur la chaire de SaintPierre, le cardinal Michel-Ange Conti, qui prit le nom d'Innocent XIII. Le nouveau pape se montra plus accommodant, et le 16 juillet de la même année, donna à Dubois le chapeau si ardemment convoité. Le rôle que joua l'évêque de Sisteron dans les affaires du jansénisme, l'a rendu le point de mire d'atroces calomnies. Les gazetiers de la secte ne l'ont point épargné, et c'est malheureusement à ces sources suspectes que la plupart des biographes de Lafitau ont puisé. Nous ne rapporterons ici aucune des anecdotes plus que douteuses, racontées par quelques chroniqueurs contemporains, sur le caractère et les mœurs de Lafitau. Elles sont trop empreintes de l'esprit de parti, et indignes souvent du sérieux de l'histoire. Les querelles de ce prélat avec le jansénisme agitèrent une grande partie de sa vie. Il porta souvent à ses adversaires de rudes coups, et ses adversaires lui en rendirent aussi. Il n'est donc pas étonnant que sa mémoire ait souffert de toutes ces luttes. L'épiscopat de Lafitau a cependant laissé de bons souvenirs dans le diocèse de Sisteron. C'est lui qui réunit au séminaire de Lurs le prieuré de Sainte-Tulle, ainsi que la cure, moyennant une redevance annuelle en faveur de l'abbé de SaintAndré d'Avignon, à qui appartenait la collation de ce prieuré. Lorsque, le 20 mars 1739, la mort frappa au Puget-de-Théniers, dans le diocèse de Glandèves, le fondateur des mission naires de Sainte-Garde, Lafitau prit soin de faire rapporter à Sisteron le corps de ce saint prêtre, et fit déposer ses dépouilles mortelles dans l'église des missionnaires. Voulant reconnaître les services que le pieux abbé Bertet avait rendus à son diocèse, il écrivit, le 6 avril de cette année, à ses vicairesgénéraux : « Il est juste, Messieurs, que nous rendions à M. Bertet une partie des biens que nous en avons reçu pendant sa vie, et que nous fassions à sa mémoire le même honneur qu'il a fait à notre état. Nous n'avons peut-être point de paroisse dans notre diocèse qui n'ait été arrosée de ses sueurs apostoliques, éclairée par ses lumières, touchée par ses prédications et édifiée par ses exemples. Quarante ans de missions doivent lui avoir acquis toute notre reconnaissance , et une vie ainsi écoulée dans les plus pénibles fonctions du zèle , dans la plus parfaite pureté des mœurs , dans une continuelle mortification des sens, et dans une sainte habitude de la présence de Dieu , doit nous persuader qu'il nous reste peu à faire , pour accé lérer, s'il est besoin , l'heureux moment de sa récompense. » Dans cette vue, je vous prie d'ordonner que, dans chaque paroisse , on fasse incessamment un service , et que chaque prêtre , tant séculier que régulier, dise une messe pour le re pos de son âme. Je suis persuadé que nous travaillons pour nous, en priant pour lui, et que du haut du ciel , il nous en fera ressentir les effets. » L'évêque de Sisteron , prié par les Pères du concile d'Em brun de venir prendre part à leurs travaux , arriva à Embrun, le 31 août 1727, et assista, le 2 septembre, à la quatorzième congrégation particulière. Il continua de se trouver aux séan ces du concile , et en signa les actes. En 1731 il fut nommé abbé de Corneville , au diocèse de Rouen. En novembre et décembre 1744 , un typhus meurtrier dé cima la population de Sisteron. L'armée de l'infant d'Espagne, don Philippe, refoulée de l'Italie, avait été cantonnée dans la ville. La maladie ne tarda pas à se déclarer au milieu de ces troupes épuisées de fatigues. L'hospice de la Charité ne suffit bientôt plus au nombre des malades, il fallut les placer dans les églises, les monastères, les maisons particulières, les écuries, les rues même. « Si , dit le dernier historien de Sisteron, quelque chose peut adoucir le spectacle d'une pareille calamité, ce sont les prodiges de dévouement qu'elle fit éclater. Une de ces vertus que la religion tient en réserve pour les mauvais jours, surgit alors du fond de sa retraite. Une fille unique destinée au grand monde et à tout ce qu'il y a de plus propre à séduire, Mademoiselle de la Tour avait courageusement résisté aux tentations du siècle pour se jeter dans la voie étroite , mais plus sûre de l'Evangile. Trente ans passés au milieu de ces périlleux combats en avaient fait un modèle de perfection chrétienne, un ange sur la terre. A peine la maladie se fût-elle déclarée, qu'on ne vit plus que la sainte fille ; par tout où était le danger, là, on était sûr de la rencontrer, animan , entraînant tout par son exemple. Dans cette circonstance, les dames de charité ne faillirent point à leur mission ; elles prodiguèrent à l'envi des secours aux malades; les hommes mêmes rivalisèrent de zèle avec les femmes, et le père même de Mademoiselle de la Tour (1) ne fut pas le dernier à se signaler. » L'évêque de Sisteron, qui a été le biographe de cette religieuse visitandine, a retracé dans ce livre le triste spectacle qu'offrait alors sa ville épiscopale. Il se tait sur son propre rôle dans ces pénibles conjonctures ; mais nous savons que le pieux prélat se montra en tout point digne de la grandeur et de la noblesse de son caractère. Lafitau, dégoûté sur la fin de ses jours de toutes les disputes qui avaient agité son épiscopat, mourut au château de Lurs, le jeudi 5 avril 1764 , à l'âge de soixante-dix-neuf ans. Son corps fut inhumé à Notre-Dame des Anges , dans le couvent de Récollets dont il s'était montré l'insigne bienfaiteur. Il se rendait souvent de son château dans cette maison, afin de goûter dans la solitude le calme et le repos après ses longues luttes avec le jansénisme. C'est là qu'il voulut aussi reposer en attendant la résurrection bienheureuse, et la reconnaissance des religieux lui éleva, dans la chapelle souterraine de leur église, un tombeau portant l'inscription suivante : P. F. Lafitau, Sisteronensi episcopo. Felici dederat bonus pastorem populo justus et abstulit cui vivunt Deus omnia, extinctum querulis non dolor impotens reddit, non piamarmora judex assidua sed prece flectitur flectamur prece judicem. Obiit suse setatis octoginta episcopatus XLVI hujus cœnobiipietas memor beneficiiposuit, MDCC. LXVII. Le cœur du prélat fut déposé dans la cathédrale de Sisteron, chapelle de Sainte-Anne, aujourd'hui chapelle du Rosaire.
(1) Jean Geoffroy, seigneur de la Tour.
M. Lafitau a laissé un grand nombre d'écrits. Malheureusement, le mérite de ses ouvrages n'est pas de nature à soutenir la réputation dont il jouit de son vivant, et on n'en connaît plus guère que les titres : en voici la longue énumération. Réfutation d'un ouvrage (de l'abbé Cadry) intitulé : Histoire de la condamnation de M. de Senez par le concile d'Embrun, 1729, in-8e. — Histoire de la constitution Unigenitus , 1733 et 1738, 2 vol. in-12, Avignon, Delaire, 1766, 2 vol. in-12 ; Maëstricht , 1782, 2 vol. in-12; Liége, 1741, 3 vol. in-12; Venise, 2 vol. in-18; Besançon et Paris, Gauthier, 1820,in-8e. «On y trouve, dit l'auteur des trois siècles de la littérature, le vrai, qui doit être la base de tout ouvrage historique, et avec le vrai, de l'ordre, de la clarté, du développement, un style noble, convenable à l'histoire et une modération dont on ne doit jamais s'écarter. —Réfutation des Anecdoctes ou mémoires secrets sur l'acceptation de la constitution Unigenitus, par Villefore, Gray, 1734, 3 vol. in-8e. Cet ouvrage, ainsi que le précédent, prouve que Lafitau connaissait à fond la secte dont il dévoilait les intrigues. Cette connaissance allait jusqu'à voir bien avant et d'une manière bien précise dans l'avenir, comme il paraît par le passage suivant si littéralement vérifié lors de la révolution de 1789 : « Qu'on revienne présentement sur tout ce qu'on a lu dans cette histoire et on trouvera que le Quesnellisme n'est au fond que le calvinisme même, qui, n'osant se montrer en France à découvert, s'est caché sous les erreurs du temps. C'est ce qu'on a vu dans ces fameux projets où les quesnellistes voulaient réunir l'Eglise de France à l'Eglise anglicane et dans tous ces fameux libelles où ils ont érigé un tribunal à l'esprit particulier. Mais c'est ce qui paraîtrait encore mieux dans une de ces occasions critiques, que Dieu veuille détourner, où il s'agirait de trou bler tout pour établir une entière liberté de conscience ; pour lors, il est indubitable qu'on verrait les quesnellistes s'associer ouvertement aux protestants , pour ne plus faire qu'un même corps, comme ils ne font déjà qu'une même âme avec eux. » Lafitau avait désapprouvé la consultation donnée, le 30 octobre 1727, par cinquante avocats du parlement de Paris au sujet du jugement rendu à Embrun contre l'évêque de Senez. Il signala dans un mandement les Anecdotes de Villefore qu'il accompagna de la Réfutation. Les deux ouvrages furent supprimés par un arrêt du Conseil du roi du 26 janvier 1734. Oraison funèbre de Philippe V, roi d'Espagne, 1746 , in-4e. — Sermons pour le carême, Lyon, Duplain , 1747, 4 vol. in-12 , autre édition en 1752 ; ces sermons ne répondirent point à l'attente du public. Lafitau avait plus de geste et de représentation que d'éloquence. Il cite rarement l'Ecriture et les Pères, les preuves manquent de choix et les meilleures restent souvent de côté. Ils sont cependant bien supérieurs aux discours légers de quelques-uns de nos orateurs modernes, et traitent la morale avec plus de succès que les mystères. Malgré leurs défauts, ces sermons ont été traduits en espagnol par dom Jacinto de Nerva et publiés à Valence en Espagne , 1754 , 4 vol. in-4e. — Retraite de quelques jours pour les personnes du monde, Paris , 1750 , in-12. — Retraite pour les curés, Paris , 1750 , in-12. — Avis de direction pour les personnes qui veulent se sauver, Paris, 1752, in-12, augmenté considérablement et suivi d'un Avis pour gagner le jubilé, Paris, 1760, in?12. — Vie de Clément XI, souverain Pon tife, Padoue, 1752, 2 vol. in-12. —Lettres spirituelles, Pa ris, 1755, 2 vol. in-12; 1760, in-12. — Conférences spirituelles pour le cours d'une mission, Paris, 1756, in-12. — La vie et les mystères de la très sainte Vierge, Paris, 1759, 2 vol. in-12. L'auteur y montre plus de piété que de critique et associe à des choses incontestables des traditions incertaines ou même fausses. — Entretiens d'Anselme et d'Isidore sur les affaires du temps, Douai et Paris, 1759, in-12. Cet ouvrage a été attribué par erreur au P. Castel , jésuite. — Catéchisme évangélique, 1759, 3 vol. in-8e. — Vie de la sœur MarieAnne-Thérèse de la Tour, religieuse du monastère de la Visitation de Sisteron, Avignon (vers 1760) , in-12,. C'est un petit livre rarissime dont l'historien de Sisteron n'avait pu se procurer qu'un exemplaire mutilé. — Un grand nombre de mandements. Pierre-François Lafitau portait pour armoiries : d'azur, à une étoile d'or à huit rais.
78. — LOUIS-JEROME DE SUFFREN DE SAINT-TROPEZ (1764-1789). Louis-Jérôme de Suffren de Saint-Tropez naquit en 1722 dans le diocèse d'Arles et était fils de Pierre-Paul de Suffren, procureur-joint de la noblesse de Provence, et de Hiéronyme de Bruni. Son frère fut le bailli de Suffren dont le nom est si célèbre dans les annales maritimes de la France. Destiné à la carrière ecclésiastique, il s'appliqua à acquérir par des études sérieuses toutes les connaissances qui pouvaient orner son esprit et son cœur. Après avoir été vicaire général de Marseille en 1756 et prévôt de la collégiale de Saint-Victor de la même ville, il fut, le 9 juin 1764, nommé par le roi. à l'évêché de Sisteron et préconisé pour ce siége dans le consistoire du 9 juillet suivant. Son sacre eut lieu le 30 septembre et sa prestation de serment de fidélité au roi le 8 octobre de la même année. Ce prélat assista, le 11 juin 1774, au sacre du roi Louis XVI à Reims, et fut nommé, le 25 décembre suivant, abbé commendataire de Mazan, au diocèse de Viviers. L'épiscopat de Mgr de Saint-Tropez sera à jamais illustre dans les fastes de la commune et de l'Eglise de Sisteron. Ami des entreprises grandes et utiles plein de dévouement pour le bien de ses diocésains, ce prélat conçut le projet d'un grand canal d'irrigation qui devait changer une place aride et stérile en une campagne délicieuse couverte de jardins, de prairies et de fleurs. Ces mêmes eaux qui, trop souvent avaient amené des dégradations et des désastres, devaient amener l'abondance et la richesse. Ce canal était possible : ce fut assez pour vouloir en réaliser l'exécution. Armé d'une volonté ferme et inébranlable, usant de toute son autorité, dédaignant les clameurs et les injures d'une population aveugle, il poursuivit courageusement son œuvre, vainquit tous les obstacles, surmonta toutes les difficultés et put enfin léguer aux générations futures, ce monument de son amour et de son génie. On connaît cette parole admirable du prélat : « Les pères me maudiront, les enfants me béniront. » Jamais parole ne trouva un plus parfait accomplissement : l'œuvre achevée, le sentiment des obstacles et des débats s'est effacé, le bienfait seul a survécu et s'étendra sur l'avenir. La population bénit ce qu'elle avait outragé, et par sa reconnaissance, elle dédommage la mémoire du bienfaisant pontife des excès de ses ancêtres. Déjà dans deux occasions solennelles, la ville de Sisteron a fait éclater ses sentiments de profonde gratitude ; la première en élevant, en 1824, dans ses murs, un obélisque commémoratif de l'établissement du canal, obélisque chargé d'inscriptions en l'honneur de M. de Saint-Tropez et de ses zélés coopérateurs dans cette œuvre patriotique ; la seconde, en plaçant dans la principale salle de son hôtel-de-ville le portrait du prélat; la dénomination du canal Saint-Tropez donnée à cette construction est, au surplus, une protestation publique et éclatante des sentiments des habitants. Le creusement de ce canal remonte à 1779. Le malheur des temps d'un côté, la translation du pontife au siége de Nevers d'un autre côté, ne permirent point à M. de Saint-Tropez d'exécuter plusieurs autres grands travaux qu'il méditait. Il n'a pas tenu à lui que la belle route qui relie aujourd'hui Manosque, Forcalquier et Sisteron, ne fût exécutée sous son épiscopat. C'est à ce titre qu'on a dit avec raison de cet évêque, qu'il était le Turgot de son diocèse. Un autre fait marquant avait, déjà avant cette époque, signalé l'épiscopat de Saint-Tropez, nous voulons parler de l'établissement d'une liturgie particulière à l'Eglise et au diocèse de Sisteron. Parmi toutes celles qui surgirent dans le cours du dernier siècle, la liturgie de Sisteron se faisait remarquer par une singulière alliance de la liturgie romaine avec les rites divers établis dans un grand nombre de diocèses de France, par la disposition des offices et par la forme du chant. Le mandement qui prescrit l'usage du nouveau bréviaire, à l'exclusion de tout autre, porte la date du 3 juin 1774. Ce ne fut toutefois qu'en 1777 qu'il fut généralement adopté, les lenteurs de l'exécution typographique en ayant retardé l'achèvement jusqu'à cette année. Le Missel sistéronéen ne fut imprimé qu'en 1785, ainsi que les livres Graduels et Antiphonaires pour lutrin. Une ordonnance de l'évêque de Digne a détruit il y a quelques années, et annihilé l'œuvre de Mgr de Saint-Tropez, en prescrivant la liturgie romaine dans le diocèse de Digne, comprenant aujourd'hui tout l'ancien diocèse de Sisteron. Un événement que l'histoire a consigné déjà dans ses annales, marqua la dernière année de l'épiscopat de Mgr de Saint-Tropez à Sisteron. Ce prélat, revenant de Pierrevert, près de Manosque, se rendait à son château de Lurs : arrivé aux portes de Manosque, il trouve une foule tumultueuse qui lui prodigue l'injure et la menace, l'accusant d'être l'auteur de la disette de grains qui se faisait déjà sentir et le vil associé d'un criminel accapareur. Sa voiture est entourée, ses chevaux dételés, le postillon retenu prisonnier. Une grêle de pierres assaillit la voiture dont les vitres sont brisées. L'évêque voit jaillir son sang de deux blessures, l'une à la tête, l'autre au bras. C'en était fait de lui, si, à la nouvelle de cet attentat, plusieurs habitants honnêtes ne fussent accourus à son secours. Deux jeunes gens se dévouèrent entre tous les autres et couvrirent de leur corps la personne de l'évêque. Cependant les consuls de Manosque, les sieurs Eyssautier et Nicolas, avertis de cette agression sauvage, accourent en toute hâte revêtus de leurs chaperons, et leur présence modère un peu l'impétuosité des assaillants. Ils trouvent Mgr de Saint-Tropez appuyé contre un mur, presque évanoui, sous le coup de l'émotion et de la frayeur que lui avait causées cette scène de désolation. Le prélat, après quelques instants de repos, put s'acheminer jusqu'au village de Volx, où il trouva une voiture qui le ramena à Lurs. Triste destinée d'un pontife dont le cœur ne respirait que bienveillance et dont tous les actes ne tendaient qu'à l'amélioration de la condition du peuple ! Une commission du parlement d'Aix vint à Manosque avec quatre cents hommes des régiments de Lyonnais et de Vexin, pour instruire la procédure. Elle entendit des témoins, lança des mandats d'arrêt, dressa son rapport, mais la gravité des événements politiques qui survinrent alors, ne permit pas de suivre cette affaire. Il est à croire cependant que ce ne fut pas là l'unique motif de l'abandon de la procédure. Mgr de Saint-Tropez, content d'avoir effrayé les coupables par une captivité préventive et par cet appareil de justice, sollicita probablement cette issue. Le 9 mai 1784, il obtint l'abbaye de Saint-Vincent de Metz, et enfin, au mois de juin 1789, fut appelé au siége épiscopal de Nevers pour lequel il fut préconisé le 3 du moïs d'août. Il en prit possession par procureur le 7 septembre suivant et fit son entrée au mois de décembre de la même année. Mais dès l'année suivante, ayant refusé de prêter serment à la constitution civile du clergé, il se vit obligé de partir pour l'exil et se réfugia, en 1791, à Turin, où il mourut le mardi 21 juin 1796 dans la soixante-quatorzième année de son âge et la trente deuxième de son épiscopat. Son corps fut inhumé dans l'église métropolitaine de Saint-Jean-Baptiste. Il portait pour armoiries : d'azur, au sautoir d'argent, cantonné de quatre mufles de léopard d'or.
79. — FRANÇOIS DE BOVET (1789-1802). Fils de Jean-Pierre de Bovet, conseiller du roi, garde des sceaux de la province de Dauphiné, et de Madeleine-Françoise de Reynaud de Sollier, François de Bovet naquit à Grenoble le 21 mars 1745. Sa famille réunissait le triple éclat qui résulte d'une noble et ancienne origine, du mérite personnel et des emplois importants, mais telle était sous ce rapport, comme sous tous les autres, l'humilité vraiment évangélique du saint prélat que personne, durant sa longue carrière, n'a pu lui entendre prononcer un seul mot relatif à ce sujet : il savait, et toute sa vie l'a prouvé, que la véritable grandeur du chrétien n'existe que dans l'excellence de ses œuvres. Une piété aussi profonde qu'éclairée, le besoin de se livrer à de fortes et constantes études déterminèrent son choix en faveur de la carrière ecclésiastique. La théologie ne le rendit point étranger aux belles-lettres; il puisa dans leur commerce cette pureté de goût, comme cette élégance de style, qui prête un mérite de plus à ses graves et solides écrits. Les succès qu'il ohtint au séminaire sous des maîtres habiles, présagèrent les éminents services qu'il devait rendre un jour à l'Eglise. Supérieur à la plupart de ses condisciples, il parvint cependant à s'en faire aimer : les blessures que ses triomphes pouvaient causer à son amour-propre étaient guéries par sa modestie et par l'aménité de son caractère. Dès qu'il eut été promu au sacerdoce, il devint vicaire général de M. de Conzié, évêque d'Arras, montra une haute connaissance de l'administration des affaires ecclésiastiques et fut élu prévôt du chapitre cathédral de cette Eglise. Le roi le nomma le 11 novembre 1785 abbé commendataire de NotreDame de Bonlieu ou du Carbon-Blanc, au diocèse de Bordeaux. L'abbé de Bovet siégea dans l'assemblée du clergé de France de 1785 à 1786 , comme député de la province ecclésiastique de Tours, et prit part à tous les travaux de cette assemblée. Il rédigea, notamment sur le concours pour les cures, un Mémoire de quarante-deux pages qui se trouve inséré dans le procès-verbal de l'assemblée. Le zèle avec lequel il secondait l'évêque d'Arras dans l'administration de son diocèse ne l'empêchait pas de cultiver toutes les sciences ecclésiastiques, en même temps qu'il s'occupait de recherches d'érudition et de critique. Nommé à l'évêché de Sisteron par brevet royal du mois de juin 1789, M. de Bovet fut préconisé dans le consistoire du 3 août suivant et sacré le 13 septembre de la même année. La révolution déjà commencée lui permit à peine de prendre possession de son diocèse, que le décret du 12 juillet 1790 sur la constitution civile du clergé, supprima totalement. Le prélat protesta contre cette suppression anticanonique, et consigna ses réclamations dans une lettre du 24 novembre de cette année au chapitre de sa cathédrale , dans une autre du 12 dé cembre suivant à ses curés et vicaires , dans celle du 14 mars 1791 aux électeurs des Basses-Alpes , dans des lettres à Jean-Baptiste Villeneuve, évêque élu des Basses-Alpes, et à François Marboz , évêque élu de la Drôme ; enfin dans une lettre pastorale du 18 juillet 1791 à son diocèse. De terribles épreuves étaient réservées au vénérable prélat, elles ne purent ni égarer sa conscience , ni intimider son courage. En vain des législateurs sacriléges essayèrent de briser le faisceau de l'unité catholique , M. de Bovet , dont le caractère fut toujours si doux dans la vie privée , soutint avec énergie et persévérance dans la chaire épiscopale , l'autorité du Saint-Siége et les droits des pasteurs. En suivant la conduite que lui traçaient ses devoirs, il s'attira de violentes inimitiés, et même des menaces de mort , ainsi que le prouvent les passages suivants d'une lettre qui lui fut écrite par l'un des plus notables habitants de Sisteron, sous la date du 28 avril 1791 : « Il existe un projet dont on ne se départira pas facilement : on veut vous faire une forte attaque ; on ne voit pas les dangers qui peuvent s'ensuivre : ils se peignent à mes yeux des couleurs les plus noires. Votre résistance entraînerait un désordre affreux dans cette ville. Les gens qui l'habitent pourraient se laisser entraîner par les méchants dans quelque mauvaise action et vous ne seriez pas la seule victime de leur colère. Epargnez à toutes les personnes honnêtes la douleur de voir votre vie et celle de vos amis en danger. » Réduit à l'impossibilité de gouverner son troupeau, craignant, s'il restait à Sisteron, d'attirer sur la tête de ses amis et celle des membres de son clergé, de sanglantes persécutions, François de Bovet crut devoir momentanément s'éloigner ; mais par une inconséquence qui n'est que trop familière à l'esprit révolutionnaire, traité de brandon de discorde par ceux qui voulaient son exil , il fut , au moment de franchir la frontière, arrêté comme transfuge, par des hommes du même parti. L'arrêté du Directoire du département de l'Isère du 11 sep tembre 1791 est un monument curieux de la manière dont la justice était rendue à cette déplorable époque : en voici les conclusions, textuellement rapportées : « Le Directoire a arrêté que M. de Bovet serais mis en liberté ainsi que son domestique ; que tous ses effets lui seraient rendus, à l'exception de la somme de sept mille deux cent trente livres en écus , qui serait déposée dans la caisse du receveur du district de Grenoble pour y rester en espèces, telle qu'elle est, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné par l'Assemblée nationale, à laquelle il sera incessamment adressé un extrait du présent procès-verbal. » L'évêque de Sisteron chercha un asile en Suisse , où beaucoup de prélats français s'étaient déjà réfugiés. La supériorité de ses lumières, son habileté dans la direction des âmes, lui valurent alors une mission de la plus haute confiance : il fut chargé par ses augustes parents de s'assurer si la vocation de Madame la princesse Louise-Adélaïde de Bourbon-Condé, morte plus tard le 10 mars 1824 supérieure de l'institution de l'Adoration perpétuelle au Temple, n'était point le fruit de conseils imprudents ou d'une exaltation passagère. Il écrivit à cette princesse pour lui témoigner ses craintes , et le 24 oc tobre 1795, étant à Turin chez les Carmélites, elle lui fit une réponse remplie de raisonnements sages et de sentiments pieux, aussi honorables pour sa mémoire, qu'édifiants pour les fidèles. Mgr de Bovet avait adhéré à l'exposition des principes sur la constitution civile du clergé, rédigée par son métropolitain, Mgr de Boisgelin, archevêque d'Aix, et signée par tous les évêques députés à l'Assemblée nationale constituante. Après avoir résidé à Fribourg et à Turin, il se rendit à Ferrare, où l'accueillit avec bonheur le cardinal Alexandre Mattei qui en était archevêque. Il publia alors quelques écrits relatifs aux affaires de France. Nous citerons les Réflexions sur le nouveau serment prescrit en France et sur les motifs par lesquels on croit pouvoir le justifier, Ferrare, 1793, in-8 de 5I pages ; Réflexions sur un mandement de J.-B. Villeneuve , évêque , aux fidèles des Basses-Alpes , Ferrare , 20 décembre 1795, in-8e de 35 pages ; Réflexions sur un prétendu bref du 5 juil let 1796, Ferrare , 4 janvier 1797, in-8e de 33 pages. Le premier de ces écrits était dirigé contre le serment prescrit en France par le décret sur la constitution civile du clergé ; le second, contre un mandement de l'évêque constitutionnel des Basses-Alpes, qui prétendait juridiction sur une partie du diocèse de Sisteron ; et le troisième sur un bref de Pie VI, que M. de Bovet semblait croire avoir été rédigé réellement à Rome, mais non pas destiné à voir le jour, se déclarant ainsi en opposition avec les Annales catholiques de M. de Boulogne qui avaient soutenu l'opinion contraire. Un ouvrage plus important que fit alors paraître l'évêque de Sisteron est celui qui a pour titre : Les Consolations de la foi sur les malheurs de l'Eglise, en Suisse, 1797, in-12; 2e édition, 1798, in-12; 3e édition, Toulouse, Manavit et Paris, Le Clere , 1819, in-12. Ecrit avec l'âme et la plume de saint Cyprien, cet ouvrage sera dans tous les temps éminemment utile, même pour d'autres circonstances que celles qui en ont été l'occasion. L'évêque de Sisteron passa en Allemagne, et c'est là qu'il signa, comme tous les évêques français exilés, l'instruction sur les atteintes portées à la religion, du 15 août 1798. Après le concordat, il fut du nombre des évêques qui, sans refuser positivement la démission de leur siége, envoyèrent cependant à Pie VII une réponse dilatoire au bref Tarn multa, du 15 août 1801 , adressé aux titulaires des siéges épiscopaux de France, répandus alors dans toutes les parties de l'Europe , pour obtenir que ces prélats résignassent leurs fonctions. Il signa aussi les Réclamations canoniques, adressées au Pape, le 6 avril 1803. Ne voulant pas cependant mettre obstacle à l'exécution du concordat, il déclara dans une Instruction à son clergé, du 5 décembre 1801, et dans une lettre du 21 avril 1802, qu'il ne s'opposait pas à l'exercice des nouveaux pouvoirs, et qu'il laissait son troupeau entre les mains du souverain Pontife, qui se chargerait de pourvoir seul à ses besoins. En 1804, il se retira en Angleterre, et, après avoir longtemps hésité, envoya , en 1812 , sa démission au Pape et au roi Louis XVIII, car il ne voulut jamais reconnaître Napoléon Ier, comme chef du gouvernement français. M. de Bovet fut déterminé à cette démarche par la crainte de paraître favoriser l'opposition fâcheuse qui s'était formée dans une fraction du clergé français émigré contre le concordat et dont les conséquences eussent amené un schisme. Rentré en France, à l'époque de la première Restauration, en 1814, M. de Bovet fut nommé, le 8 août 1817, à l'archevêché de Toulouse, et préconisé pour ce siége métropolitain dans le consistoire du 1er octobre suivant. Les obstacles qui retardèrent l'application du nouveau concordat, reculèrent sa prise de possession. Ses bulles ne furent reçues et autorisées que par une ordonnance royale du 15 septembre de cette année. Il fut installé par procureur, et voulait se rendre dans son diocèse, mais l'état de sa santé le retint à Paris. Ne croyant pas pouvoir, à cause de son grand âge et de quelques infirmités, vaquer suffisamment aux fonctions de l'épiscopat, il donna sa démission et fut tout aussitôt nommé chanoine du premier ordre du chapitre royal de Saint-Denys. Il fut aussi compris dans la commission d'évêques et d'ecclésiastiques , créée par l'ordonnance royale du 20 juillet 1825, pour l'établissement à Paris d'une maison centrale des hautes études ecclésiastiques. M. de Bovet, qui, toute sa vie s'était occupé de travaux d'érudition, put alors, en toute liberté, satisfaire son goût pour l'étude, et publia successivement divers ouvrages. Voici le titre de ces travaux : Les Dynasties égyptiennes selon Manéthon, considérées en elles-mêmes et sous le rapport de la chronologie et de l'histoire, Paris , 1829 , in-8e ; édition revue et corrigée, Avignon, Seguin, aîné, 1835, in-8e; Paris et Lyon, Périsse, 1855, in-8e.!|L'auteur examine dans ses livre le degré de confiance que mérite la chronologie de Manéthon. Cet ouvrage se compose de deux parties : dans la première, M. de Bovet expose les différences qui existent entre les écrivains qui ont suivi Manéthon ; le rapprochement de la chronologie de Manéthon, de celle de l'histoire sacrée, forme la deuxième partie. Après avoir applaudi aux travaux de Champollion, il se tient en garde contre les illusions et l'enthousiasme de ceux qui croient voir tous les nuages se dissiper aux rayons d'une science respectable sans doute, mais qui, vrai semblablement ne percera jamais tous les doutes que l'antiquité égyptienne a fait concevoir. Histoire des derniers Pharaons et des premiers rois de Perse, selon Hérodote, tirée des livres prophétiques et du livre d'Esther, Avignon, Seguin, aîné; Paris, Gaume, frères, 1835, 2 vol. in-8e. L'auteur commence où Guérin du Rocher avait fini. Il prétend prouver que le troisième livre d'Hérodote est tiré presque entièrement du livre d'Esther. Il croyait ce travail utile à la religion et propre à réfuter les difficultés qu'on forme contre le livre d'Esther. Mais ce système ne donne-t-il pas lieu à d'autres difficultés? N'est-ce pas introduire le pyrrhonisme dans l'histoire que d'imaginer tous ces travestissements dont quelquesuns sont spécieux, mais qui, au fond , ne sont guère concluants? Ce sont là de ces suppositions, que l'on peut rendre plus ou moins vraisemblables, avec de l'esprit et du savoir, mais qui auraient les résultats les plus graves, en fournissant le prétexte de nier tous les témoignages historiques. Aussi, tous les savants s'accordent à rejeter ce système. Au reste, il faut avouer que M. de Bovet l'appuie sur beaucoup d'aperçus ingénieux, et qu'il fait preuve, dans ce travail de connaissances historiques très étendues. L'Esprit de l'Apocalyse, ouvrage posthume, précédé d'un Jugement porté sur les ouvrages de Mgr de Bovet, par Mgr Guillon, évêque de Maroc, doyen de la Faculté de Paris, et d'une Notice biographique , par M. le marquis du Bouchet , Paris , 1840 , Gaume, frères , in-8e. Cet ouvrage se fait remarquer, par la sagesse de ses vues, l'étendue de sa science, la sûreté de sa dialectique et la pureté toujours noble et élégante de sa diction. Ce n'est pas un commentaire : l'auteur se propose uniquement de déterminer, d'une manière plus précise, qu'on ne l'avait fait jusqu'à lui , l'objet de cette révélation mystérieuse. Distingué dans ses manières, mais simple dans ses habi tudes , Mgr de Bovet ne connaissait de magnificence que pour accomplir des actes de charité. La prière et l'étude furent les principales occupations de sa longue carrière : à la première il doit sans doute le ciel ; à la seconde, des droits éternels à la juste reconnaissance des amis de la religion et des sciences historiques. Sa bienveillance gracieuse, son caractère toujours égal, rendaient ses vertus plus aimables, sans qu'il perdit jamais rien de la dignité de la vieillesse , ni de la majesté du sacerdoce. Il avait cet esprit d'à-propos , cette finesse de tact, cet atticisme de langage qui faisaient autrefois le charme de la société , et dont les modèles se trouvaient fréquemment dans le haut clergé. Trois mois avant sa mort, M. de Quélen, archevêque de Paris , alla lui souhaiter une bonne année. « A quatre-vingt-treize ans, lui répondit-il , on ne peut plus me souhaiter que le bonjour. Il reçut, durant sa longue et dernière maladie, les tendres et pieuses consolations de ce prélat qui, lui aussi, avait eu ses persécutions, et expira entre ses bras, le vendredi 6 avril 1838, à Paris. On l'inhuma dans le caveau de l'église des Carmes, de la rue de Vaugirard , à côté des cardinaux de Bausset et de la Luzerne, et auprès du vénérable abbé Legris Duval. Sur une table de marbre fixée dans la nef, se lit son épitaphe, composée par M. de Quélen, et qui est ainsi conçue : Hic requiescit in spe beatse resurrectionis corpus Illustrissimi et Reverendissimi . Fkancisci de Bovet. Episcopus olim Sistarisensis (sic), profide studioque ecclesiasticse disci plinse tuendse exul, sedatis tempestatibus , in patriam redux, ad archiepiscopatum Tolosanum evectus, mox adversa valetudine, sede cessit. Ab infantia sacris litteris enutritus, à juventute doctus à Deo , cujus usque ad senectam et senium mirabillia (sic) pronuntians, Ecclesise Gallicanse unus ex consenioribus , ipse senior, plurimo clero adprecatus , obiit die VIaaprilis, anno MDCCCXXXVIH, setatis vero suse XCIV. Hyacinthus Ludovic, de Quelen, archiepiscopus Parisiensis, Csesar, marchio du Bouchet, et Alexander Guillemin, virtutis et amicitise mémorise memores posuere. M. de Bovet portait pour armoiries : d'azur, à un bœuf d'argent, la queue ramenée sur le dos, passant sur une ter rasse de sinople.
PRÉVÔTS DU CHAPITRE DE SISTERON.
1.--Guillaume Ier se trouve mentionné dans une transaction entre Tiburge, comtesse d'Orange, et l'évêque de Sisteron. A cet acte furent témoins Pierre Géraud, évêque de Riez, Raimond, évêque d'Apt, et Geoffroi, prévôt d'Aix , en 11 45.
2. — P. en 1164 , contribue de ses conseils à faire rendre par l'église de Sisteron, sous l'épiscopat de Pierre de Sabran, à Pons , abbé de Montmajour, quelques églises que le même Pons avait cédées en échange.
3. — Guillaume II Brunelli est nommé en 1174 dans une charte de Bermond, évêque élu, lequel transige avec Etienne, chevalier du Temple et administrateur des maisons provinciales de son ordre. En 1202, il est témoin d'un acte d'accord intervenu entre Alphonse II , comte de Provence , et Guil laume , comte de Forcalquier. C'est sans doute le même qui, sous cette initiale W (Willelmus) est présent comme prévôt de Sisteron, à la fondation de l'abbaye de Tournemine, faite Je 20 avril 1205.
4. — Raimond I est témoin en 1212 de la charte de confirmation des priviléges de la ville de Sisteron, par Guillaume de Sabran , usurpateur du comté de Forcalquier.
5. — S. témoin d'une transaction entre l'évêque Raoul et les frères de Reillanne, en 1227.
6. —G. Banolius (et non Gebanolius comme l'écrit la Gallia christiana), est témoin de la vente faite par Raimond Bérenger à l'évêque Raoul, de la terre d'Auzet (1232).
7. —B.... traite en 1234, de concert avec le chapitre et l'évêque Raoul , de la collation de l'emploi de sacristain. Il est peut-être le même que le précédent.
8. — Michel, cité dans un compromis entre l'évêque Humbert et les Hospitaliers de Manosque, en 1246. La même année, ce prévôt et les chanoines cédent à l'évêque un jardin pour y construire un palais épiscopal où il résidera.
9. — Raimond II est qualifié prévôt de Sisteron dans une charte de Guillaume, empereur des Romains, en 1251, en faveur de l'évêque Humbert.
10. — B... Il en est fait mention dans une charte, qui déclare les églises de Saint-Jean de Bevons et de Saint-Martin de Noyers unies à la mense épiscopale (1255).
11. — M témoin en 1259 , dans une transaction entre Othon, évêque de Gap, et Guillaume, évêque de Grasse.
12. — P. Bon était prévôt en 1266. Il est témoin, en 1269, d'une donation faite à l'évêque Alain , par les frères Bertrand et Raimond de la Mure. Il paraît dans un autre acte en 1270 ; enfin, selon le Livre vert de la ville (42 et 43), il est nommé dans un acte d'échange entre l'évêque et le chapitre , conclu en 1280.
13. — Jacques Bueymondi (ou de Raimondi, comme on lit dans certaines chartes), transigea, en 1285 avec l'évêque Géraud de Puymichel. Par cet acte, le prévôt et les chanoines abandonnent à l'évêque le prieuré de Saint-Vincent et de Saint-Michel de Gentiac, avec tous ses droits et appartenances. En 1303 , on le mentionne dans une charte de l'Eglise d'Embrun. M. Ed. de la Plane assure qu'il occupait encore en 1311.
14. — Etdjînne (alias Sébastien) Dupin est prévôt sous l'évêque Pierre de Lamanon. Il fut témoin dans une charte d'Adémar, évêque de Marseille, en 1325. Louis-Ant. Ruffi nous apprend en outre que ce prévôt fut vice-auditeur général du pape.
15. — Bertrand Arnaud , mentionné dans une quittance aux archives de la ville , en 1332.
16. — Michel de la Mure fonda, en 1339, une chapelle dans l'église cathédrale.
17. — Guillaume Arnaud, est signalé, en 1371, pour sa mauvaise gestion des hôpitaux. On sait qu'en cette année un triple fléau désolait la ville et ses environs : la guerre , la disette et leur compagne ordinaire, une épidémie.
18. — Raimond III Ripert , est mentionné prévôt de Sisteron et à la fois vicaire général de Jean Fillet , évêque d'Apt , en 1396. Les notes de de Haitze, nous le représentent vers 1414 dans une transaction passée entre le chapitre de Sisteron et les frères Mineurs. Le 10 décembre 1416, au nom du chapitre, il assista au concile provincial assemblé à Aix , d'ordre du roi Louis ; quelques-uns des Pères présents furent délégués au concile de Constance. Le 4 mars 1423 , il fut témoin à la confirmation des droits accordés au chapitre de Forcalquier par l'évêque de Sisteron, Robert Dufour.
19. — Ponce Snati, en 1431 , s'opposa à la réforme qu'étaient chargés d'opérer dans le diocèse de Sisteron, Aimon, archevêque d'Aix , et Bertrand Raoul , évêque de Digne.
20. — Pierre Arpilhe est prévôt en 1474, d'après les minutes du notaire Jean Rollandy (fol. 131).
21. —Michel de Brinonia, de 1487 au moins jusqu'en 1510.
22. —Jean Ier Emeric, de 1526 à 1549.
23. — Antoine de Gombert, élu le 2 septembre 1562, ne paraît pas avoir siégé ; peut-être son élection fut-elle annulée.
24. — Jacques Ier Garret-Catin, en 1572 (registre des insinuations ecclésiastiques , fol. 324).
25. — Nicolas Emeric, en 1580. Nous ne savons sur quoi se fonde M. de la Plane pour l'indiquer en 1550.
26. — Balthazar Roubaud, en 1605 (même reg., fe 156). 27. — André Chanut , en 1612.
28. — Jean II Chanut, frère du précédent, ne paraît pas avant 1622; c'est mal à propos que dom Denys de SainteMarthe, dans la Gallia christiana, le place avant son frère André, lequel, en 1614, obtient des lettres royaux pour être reçu à demander la collation de certains bénéfices.
29. — Jacques II Reinaud , docteur en théologie, paraît en 1645, et vivait encore en 1669.
30. — Louis-Alphonse de Valbelle, que n'a point cité M. de la Plane, fils d'Antoine, seigneur de Montfuron, et de Françoise de Félix, dame de Valfère, docteur en théologie de la Faculté de Paris, agent général du clergé, aumônier du roi, et maître de son oratoire, occupa la prévôté de 1670 à 1674. Il fut sacré, le 1er septembre 1680, évêque d'Alet, quitta en 1684 ce siége pour celui de Saint-Omer, et mourut le 29 octobre 1708, à l'âge de soixante-cinq ans.
31. — Jacques III Reinaud, en 1674, mort le 22 novembre 1718 (d'après le registre de la paroisse).
32. — Augustin Reinaud, neveu des précédents, est élu prévôt en 1712, à l'âge de vingt-deux ans ; il résigne en 1756, et meurt en 1758.
33. —Joseph Collombon, en 1757,mort le21 février!780.
34. — Jean-Joseph Mitre de Laidet, dernier prévôt, élu en 1780, mort le 27 avril 1816.
Nota. Dans ce catalogue qui offre encore bien des lacunes, nous avons employé les noms que M. de la Plane a ajoutés, d'après ses découvertes particulières, à la série donnée par la Gallia christiana et nous en avons cité quelques autres qui lui étaient échappés.

ABBAYES DU DIOCÈSE DE SISTERON.
Nous parlerons d'abord des monastères qui, depuis longtemps, ont cessé d'exister, et ensuite de ceux qui ont duré jusqu'à la Révolution.
VAL-BENOIT. La plus ancienne abbaye, dont le souvenir soit parvenu jusqu'à nous, est celui de Val-Benoît. Honoré Bouche (Hist. de Provence), parle d'un lieu situé au diocèse de Sisteron, près le comté de Sault, et appelé par les habitants Vallis Bodonensis (Val-Benoît) ; c'est là, pense-t-il , qu'était le vieux monastère. Cette conjecture désigne assez bien la localité qui appartient aujourd'hui au diocèse de Valence, et où se trouve l'ancien prieuré de Saint-May, débris lui-même de l'abbaye fondée par Saint-Mary (ou Marius). Cet endroit n'a donc rien de commun avec Bevons, petit village à quelques kilomètres de Sisteron, et qui a pris son nom du vainqueur des Sarrasins à Pierre-Impie. Les commencements du monastère du Val-Benoît se sont perdus dans la nuit des siècles. Nous savons seulement qu'il existait au commencement du VIe siècle, lorsque saint Mary en fut élu abbé. Le patrice Dyname a écrit la vie de ce saint, et son ouvrage a mérité les louanges du pape saint Grégoire. Grégoire de Tours (Eist., liv. 6), lui consacre aussi quelques lignes. Voici comment s'exprime ce dernier abbréviateur de l'ouvrage de Dyname : « Saint Mary, issu d'une famille de condition obscure, naquit à Orléans. Il se fit religieux dans un monastère (celui de Micy probablement); dès sa jeunesse, il se forma à la discipline monastique et apprit à combattre pour Dieu en accomplissant de bonnes œuvres. Il grandissait donc dans cette abbaye, comme un lis parmi les arbres d'une forêt, et édifiait tous ses frères, lorsque du consentement de Gondebaud, prince des Bourguignons, il fut choisi pour père par les chanoines de Val-Benoît, au diocèse de Sisteron. Jean, alors évêque de ce diocèse, confirma cette élection de sa propre autorité ; et ainsi par la faveur de la divine miséricorde, celui qui avait su se bien gouverner lui-même, fut appelé à gouverner les autres. Mary fut amené à son abbaye, et béni par l'évêque, au grand contentement de tous ses nouveaux frères. » Par une coïncidence remarquable , observe le nouvel historien de Sisteron, c'est à cette même époque que saint Donat, natif d'Orléans comme saint Mary, vint également se vouer à la solitude dans l'étroite vallée de nos environs, appelé depuis Combe Saint-Donat (vers l'an 500). Au risque de nous répéter, traduisons ici deux morceaux d'un ancien bréviaire du diocèse de Sisteron : « Marius, né à Orléans, de parents distingués (on voit qu'il y a contradiction sur ce point) , atteignit plus rapidement sa maturité devant Dieu que devant les hommes Dégoûté des vaines grandeurs du monde, dédaignant la noblesse de sa naissance comme la dignité sénatoriale , il fit abandon de tous ses biens , qui étaient fort considérables , et entra dans un monastère. Il atteignit bientôt un degré de sainteté si élevé, que de disciple il passa maître en vertu ; sa réputation s'étendit au loin, et déjà plusieurs abbayes d'hommes l'avaient instamment et longtemps sollicité pour abbé, quand les moines de Val-Benoît , quoique bien éloignés de lui , en firent choix. Il se rendit à Paris , où une maladie grave le saisit ; mais l'ap parition de saint Denys suffit à le guérir. Averti par Dieu même de la mort prochaine de saint Donat, il se hâta de le visiter sur la montagne de Lure ; il reçut son dernier soupir et lui rendit les devoirs de la sépulture. Lui-même, connaissant prophétiquement la fin de sa vie, reçut les sacrements de l'Eglise, recommanda à ses disciples l'observation de la règle, puis il prédit à Lucrèce, alors un de ses moines et plus tard évêque de Die, l'irruption en Italie et en France des Lombards et des Sarrasins, ainsi que la ruine prochaine de son monastère de Val-Benoît. Après quoi il s'endormit paisiblement dans le Seigneur (Tiré de Dyname, patrice des Gaules, vivant en 590)... « Marius, né à Orléans vers la fin du Ve siècle, alla se ca cher dans une solitude voisine, pour servir celui dont le service est un empire; mais ses miracles le découvrirent et firent connaître ses vertus , jusque dans la Gallo-province. Les moines de Val-Benoît le demandèrent à Gondebaud, roi de Bourgogne, et l'obtinrent de Jean, évêque de Sisteron, pour que l'exemple continuel du bien fortifiât ceux que la sévérité de la discipline pouvait rebuter. » Nous ne chercherons pas à concilier ces divers récits légendaires, et tâcherons seulement de préciser, autant que possible, la date de l'arrivée de saint Mary en Provence , et celle de sa mort. Il fut fait abbé avant 509 , où Gondebaud fils de Gonderic ou Gondioc, après la mort de ses trois frères , Chilpéric , Gondemar et Gondegésile , posséda seul le royaume de Bourgogne. Dyname, ajoute que le saint abbé s'en alla vers le Christ, le 6 des calendes de février, et fut enseveli par Lucrèce, évêque de Die. L'année n'est pas indiquée, mais on peut la placer vers 550, car Lucrèce siégea de l'an 541 à l'an 573. Après que saint Mary eut heureusement passé dans l'autre vie, écrit le Bénédictin anonyme de Forcalquier, quelques lustres d'années s'écoulèrent ; alors , toute la France était à peu près dépeuplée par la cruauté de certaines nations barbares ; les monastères du Christ , ô deuil universel, étaient changés en désert : des chrétiens dévoués firent enlever de Val-Benoît les restes mortels de l'homme de Dieu , et par la faveur divine, le firent apporter dans cette ville de Forcalquier, etc. . . » Cette translation eut lieu par les soins d'Arnoul, évêque de Sisteron; l'église qui reçut les reliques de saint Mary fut mise sous sa protection et en prit le nom (en 925), tandis que la ville acclamait le saint comme son patron et son protecteur spécial. Peu après la mort de l'illustre abbé, et avant la translation de ses reliques, la prophétie qu'il avait faite à Lucrèce s'accomplit ; les barbares Lombards, puis les Sarrasins ravagèrent l'Italie et la France méridionale : ce fut pour le soustraire aux profanations de ces derniers que le corps du grand abbé de Val-Benoît fut transporté à Forcalquier. Précaution prudente ! Le monastère fut livré aux flammes. Au temps de Charlemagne , il se releva par les soins de Jean II , évêque de Sisteron, et dura jusqu'au Xe siècle. Il devint ensuite un prieuré dépendant de l'abbaye de l'Ile-Barbe , au diocèse de Lyon. Du reste, à part saint Mary, les historiens ne nous ont transmis le nom d'aucun autre abbé de Val-Benoît.
MONASTÈRE DES BAUX. Au commencement du IXe siècle, Jean , évêque de Sisteron, fonda dans un lieu de son diocèse, appelé les Baux , un monastère régulier, avec l'aide et le conseil du très pieux Charles empereur. Dom Claude Estiennot a tiré du cartulaire de Psalmodi en Languedoc, la charte de cette fondation, et Mabillon l'a insérée dans ses commentaires De re diplomatica; en voici le sommaire : L'évêque de Sisteron donne les églises de Sainte-Marie , mère de Dieu , de Saint-Jean-Baptiste, avec un ancien baptistère, de Saint-Etienne, etc., sur le territoire du comté et de l'évêché de Sisteron, au pied du mont appelé les Baux, avec tous les droits qu'y peut prétendre l'Eglise de Sisteron, pour fonder un monastère régulier selon l'ordre de Saint-Benoît. En même temps, il y établit douze moines, avec un abbé du nom de Adémar. Nous ne savons pas autre chose de ce monastère, si ce n'est qu'à une certaine époque il fut uni à celui de Psalmodi.
PRIEURE DE GANAGOBIE. Laurent Bureau parle longuement du prieuré de Ganagobie ; malheureusement nous avons vu qu'il ne fallait ajouter qu'une foi bien restreinte à ses affirmations. Voyons ce qu'en disent les auteurs modernes. Entre Lurs et Peyruis , à une égale distance de Sisteron et de Manosque , au milieu d'une solitude profonde , se détache de la chaîne de Lurs, un plateau élevé chargé de pins et de chênes verts. Là, sur le sommet, s'aperçoivent les ruines d'un antique monastère. C'est Ganagobie (podium Ganagobie, Garagobie, Canacopie, Conoguoriense). Avant le IXe siècle, ce n'était qu'une vaste forêt. S'il faut en croire le Livre vert de l'évêché de Sisteron, un évêque du nom de Jean, donna à Dieu et à Saint-Pierre de Cluny, le puy de Ganagobie , faisant partie de son patrimoine, et y éleva deux églises , l'une en l'honneur de la Vierge , l'autre en l'honneur de Saint-JeanBaptiste ; il voulut être enseveli dans cette dernière , qu'il combla de preuves de sa libéralité. Mais en quel temps vécut ce prélat? Question difficile à résoudre. Nous n'avons vu que deux évêques du nom de Jean , et le dernier était contempo rain de Charlemagne. La supposition d'un troisième , par Columbi , n'est pas heureuse ainsi que nous l'avons ci-devant démontré. Reste à conclure que la date de cette fondation est incertaine. Les titres du monastère assurent qu'il est mentionné en 939, dans une bulle du pape Etienne VIII ; on trouve du moins la preuve que le prieuré de Ganagobie était florissant en 963. Lambert de Reillane le dota de quelques fonds vers cette époque, et, en 1013, son fils Boniface y ajouta tout ce qu'il possédait à Peyruis. Voici l'acte que rapporte Columbi à cette dernière occasion : « Il est du devoir de tout homme, pendant toute sa vie, d'employer au service de Dieu les biens qu'il possède; c'est pourquoi, moi, Boniface, je donne quel que chose de ce qui m'appartient à la très sainte et vénérable abbaye de Cluny, dont le seigneur Odilon est abbé, en l'honneur des bienheureux apôtres Pierre et Paul , pour le remède de mon âme et de celle de mes parents. Or, les biens que je donne sont situés dans le comté de Sisteron, au lieu appelé Peyruis, et je les cède en entier, en totalité, autant que j'y ai droit. Ce faisant, je confirme la donation que mon père Lambert et ma mère Salburge ont déjà faite de cet héritage, et comme eux, je veux que les frères de Cluny, qui habiteront dans ledit lieu de Sainte-Marie de Ganagobie, le gardent et le possèdent. Que si, ce qu'à Dieu ne plaise, quelqu'un tente de retirer cet héritage des biens de Cluny, il appartiendra néanmoins à ce monastère sans que personne puisse y contredire. Bien plus, si moi, ou un de mes fils, ou parents, venons à l'encontre de cette charte, que j'ai faite librement, je veux que nous encourions le courroux du Dieu tout-puissant et celui de tous les saints, jusqu'à amendement. Que cette charte demeure donc immuable dans ses stipulations. Fait l'an dn Seigneur 1013. Ont signé Boniface et son épouse. D'autres chartes encore relatives à ces premiers temps de Ganagobie se trouvaient entre les mains de Columbi qui d'abord avait eu l'idée de les publier; il s'en est abstenu par un scrupule au moins étrange : c'est que la latinité en était à demi-barbare (verum deterruit ista cogitantem sermo semibarbarus), et avec l'historien ont disparu les documents (La Plane). Les comtes de Forcalquier se montrèrent généreux à l'égard de notre prieuré. Guillaume IV, mort en 1208, lui donna les seigneuries de Ganagobie, de Sigonce, d'Aris et de Vallons. En 1220, Garsinde, petite-fille de Guillaume et veuve d'Alphonse II, comte de Provence, lui fit de nouvelles concessions, et trois ans après, toutes ces concessions furent confirmées par Raimond Bérenger. En 1391, les moines de Lérins vinrent mettre en sûreté à Ganagobie les restes précieux de saint Honorat, leur fondateur. Cent ans plus tard (1491), le prieuré étant venu à vaquer par la mort du titulaire, Claude de Molette, Jacques d'Amboise, abbé de Cluny, y nomma Louis de la Grolée, déjà prieur d'Upaix de Thèze, de Ribiers et en outre abbé d'Aiguebelle au diocèse de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Comme ce choix frustrait les religieux de l'élection capitulaire, ils ne voulurent pas le recevoir, s'assemblèrent , élurent un des leurs , et se disposèrent à la résistance. A peine du haut du monastère, Louis de la Grolée est aperçu, qu'une décharge de coups de couleuvrine l'avertit de l'accueil qui l'attend. Il poursuit néanmoins sa marche, encourageant de son mieux les gens de sa suite. Alors les révoltés qui s'étaient portés au devant de lui , se replient sur l'église, escaladent le toit , s'y retranchent et font pleuvoir une grêle de traits, de pierres et de charbons enflammés. Malgré cette vive résistance, Louis de la Grolée tint bon , et cette attitude , digne d'un conquérant , lui livre le champ de bataille. Son successeur, Pierre de Glandèves , fit reconstruire le château de Sigonce, et fut, en 1550 , remplacé par René du Bousquet. Celui-ci, subjugué par une famille pauvre et avide, la laissa bientôt envahir le couvent. Esprit du Bousquet , son frère , s'installa , comme chez lui, au château de Sigonce et il sut si bien s'affranchir de toute dépendance, qu'à la mort de René du Bousquet, arrivée en 1572, il parvint à s'emparer de cette terre. Il colora son usurpation en faisant passer le prieuré sur la tête de Jean Gombert, son domestique. Simple confidentiaire , Gombert ne jouissait de rien. Il fut attaqué par Jean de Lussy, pourvu canoniquement. Ce dernier, en vertu de la recréance que lui adjugeait un arrêt du grand conseil , vint affermer les biens et établir des officiers pour l'administration de la justice. Il retournait à Paris dans le but d'obtenir la maintenue, lorsqu'il fut assassiné par ordre de du Bousquet qui ressaisit ainsi une proie près de lui échapper. Après la mort d'Esprit du Bousquet, René son fils aîné lui succéda dans tous ses biens, dans la confidence du prieuré et dans tous ses vices, disent les Mémoires contemporains. Fatigué bientôt de n'être seigneur que sous un nom emprunté , René se fit vendre la terre de Sigonce, par acte du 21 mai 1586, moyennant une pension de cent dix écus qu'il ne paya jamais : Gombert étant nourri dans le château comme un simple domestique. René du Bousquet ne jouit pas longtemps du fruit de ses rapines: il mourut laissant pour successeur son frère Lambert , beaucoup plus méchant que lui. Celui-ci, voyant que Gombert, devenu vieux, avait des scrupules sur le rôle qu'on lui faisait jouer, l'obligea de se démettre en 1612 et de céder la place à René Massebeuf, un de ses parents , dont il espérait avoir bon marché. Il se trompa; moins patient que son prédécesseur, Massebeuf s'échappa de Sigonce et alla s'établir à Ganagobie. Lambert, soupçonnant un des religieux du cou vent , dom Jourdan , d'avoir prêté les mains à cette évasion , se présente , au milieu de la nuit, à la tête de vingt-cinq ou trente assassins , devant le monastère, en brise les portes , fait poignarder dom Jourdan et ramène Massebeuf , lié et garotté à Sigonce. Tant de violences attirèrent enfin les regards de la justice. Un arrêt du parlement décréta Lambert de prise de corps. Mais des protections vinrent en aide au coupable et le tirèrent de ce mauvais pas. Impuni, il n'en devint que plus audacieux. Ne pouvant compter sur Massebeuf qu'en le gardant enchaîné, il voulut le contraindre à résigner, et , comme il ne put y réussir, il prit le parti de l'attaquer, comme confidentiaire, lui ,son complice. Le réfectorier du couvent , dom Vincent Raffin, frère de son lieutenant de juge à Sigonce fut chargé de la commission. On lui fournit les pièces de confidence, et Massebeuf fut assigné au grand conseil. Son crime était évident ; un arrêt le dépouilla de son bénefice. Il faisait mine pourtant de résister encore, lorsque, moyennant cent pistoles, la prudence lui conseilla de fermer la bouche. Vincent Raffin ne tarda pas à recevoir le prix de ses complaisances. Lambert du Bousquet, le mit, en 1615, à la tête du monastère. On ne saurait dire tous les excès auxquels se livra alors Lambert ; il n'est sorte de violences qu'il ne se permit. Un jour, il fit arracher toutes les dents à un huissier qui lui donnait une assignation. Souvent dénoncé, arrêté même et conduit aux prisons de Digne, du Bousquet, à la faveur des temps de trouble où il vécut avec d'immenses richesses, et les intrigues de sa femme, trouva toujours le moyen de se dérober à la justice. Cependant la docilité de Raffin eut un terme. Las d'être un instrument de ruine pour le couvent, il résigna, en 1638, ses fonctions que recueillit l'orientaliste Jacques Gaffarel. Attaqué par le nouveau prieur, Lambert du Bousquet, on le pense bien, ne négligea rien pour se maintenir dans ses usurpations. Mais, moins heureux cette fois, il fut démasqué et condamné à la restitution par arrêt du conseil du 10 sep tembre 1638. Malgré cet arrêt, l'usurpateur ne se tint pas pour battu , et il eut encore assez de crédit pour forcer son adversaire à tran siger et à lui abandonner, sa vie durant , le titre de seigneur de Sigonce, ainsi que les droits de pêche, de chasse et autres prérogatives seigneuriales sur les terres, dont la longue et injuste possession allait enfin lui échapper. Ainsi , pendant près de 80 ans, la famille du Bousquet jouit de tous les revenus de Ganagobie, et quoiqu'elle n'eut rien lorsqu'elle vint y chercher l'hospitalité , la fille unique de Lambert hérita de biens immenses évalués à la moitié du territoire de Sigonce. Sous Pierre Gaffarel, en 1668, le prieuré avait un revenu annuel de 3,975 livres, grevé de 445 livres de charges. Ce revenu était du double en 1787, lors de, la suppression. On comptait , dans la maison , d'après Louvet , treize religieux , y compris le prieur. Plus tard, il n'y en avait plus que six, savoir : le prieur, quatre officiers (sacristain , infirmier, camérier et réfectorier) , et deux cloîtriers. Dans les anciens titres , le prieur prend la qualité de baron , Baro podii Ganagobie. Il était seigneur haut justicier de quatre places, nommait à six prieurés et siégeait aux Etats de Provence, immédiatement après l'évêque de Sisteron. L'église passait pour une des plus belles et des plus anciennes de la province, le pavé surtout était remarquable par ses dessins en forme de mosaïque. Elle ne subsiste plus qu'en partie et sert d'église paroissiale. Le monastère bâti sur un plateau fort élevé, offrant un des plus beaux points de vue de toute la Provence, est devenu la proie du plus hideux vandalisme ; sa destruction, objet d'une vile spéculation, excitera toujours les regrets des amateurs de l'antiquité et des beaux-arts. Les tombeaux n'ont pas été plus respectés, des fouilles profanatrices ont mis à découvert beaucoup de pierres tumulaires, chargées de sculptures. Ganagobie subit le sort des maisons de l'observance de Cluny , dont un arrêt du conseil prononça la suppression, le 17 octobre 1787. Il y eut encore un nouvel arrêt le 27 mars 1788 , et un bref du pape Pie VI , du 4 juillet de la même an née. Enfin des lettres patentes royales confirmèrent et autorisèrent ce bref, le 19 mars 1789. Les armoiries du prieuré de Ganagobie étaient : de gueules, à une épée en pal, et deux clés passées en sautoir, brochantes sur l'épée, le tout d'or, et autour de l'écu était écrit : Ganagobie. Prieurs de Ganagobie.
1. — Campanus (année inconnue, peut-être vers la fin du IXe siècle) , contribue , selon Columbi , à l'érection du monastère.
2. — Ebrard , en 1046.
3. — Arnoux, contemporain de Hugues, abbé de Cluny, qui vivait en 1048.
4. — Bertrand , prieur sous Pierre le Vénérable, en 1122.
5. — Rambaud , tiré du prieuré de Ganagobie pour occuper le siége épiscopal de Sisteron, en 1126 ou environ.
6. — Guillaume Anglic ou Langlois était prieur en 1208.
7. —Audibert (1220) nommé dans les chartes de Garsinde et de Raimond Bérenger.
8. — Imbert Vinilena ou mieux Verdeleine , connu par ses démêlés avec l'évêque Alain au sujet d'un moulin, sur la Durance, d'après Gastinel (1267). Il existe ici, dit M. de la Plane, une lacune considérable. Le prieur qui reçut à Ganagobie les reliques de saint Honorat, en 1391, n'est point nommé.
9. — Louis de Barras (1420) transige avec le prieur de Saint-Marcellin, près Peyruis (Registre de Guillaume Arpilhe, notaire, fol. 23) ; ordonne en 1437 la transcription des priviléges du prieuré (Archives du monastère).
10. — Claude de Molette passa, en 1471, un compromis avec un religieux du couvent ; dans cet acte, il s'intitule : Prior prioratus de Podio Ganagobie (Registre du notaire de Sisteron, Guillaume Buglon).
11 . —Louis de la Grolée succède au précédent, en 1491 par lettres du 31 janvier (Reg. de Jean Chais, notaire, fol. 337).
12. — Pierre de Glandèves, protonotaire apostolique, prieur-commendataire de Ganagobie ; fit reconstruire le château de Sigonce. Il existe à ce sujet un curieux devis , montant à 925 florins (Minutes de Pierre Isnard, notaire à Peyruis, conservées au greffe du tribunal de Sisteron, an 1502).
13. — René du Bousquet , en 1550 ; il en a été suffisamment parlé plus haut, ainsi que des quatre qui vont suivre.
14. — Jean de Lussy, canoniquement élu le 13 août 1572, et assassiné peu après par ordre d'Esprit du Bousquet.
15. — Jean Gombert, confidentiaire d'Esprit du Bousqueten 1573.
16. — René Massebeuf, confidentiaire de Lambert du Bousquet, en 1612.
17. — Vincent Raffin, aussi prieur confidentiaire, de 1615 jusqu'en 1638.
18. —Jacques Gaffarel , né à Mane en 1601 , prit le bonnet de docteur en théologie et en droit canon , et se rendit habile dans les langues orientales. Il s'attacha particulièrement à l'étude des sciences occultes et cabalistiques, sur lesquelles il avait des opinions fort singulières. Le cardinal de Richelieu le choisit pour son bibliothécaire, et le chargea d'acheter en Italie les meilleurs livres manuscrits et imprimés. Gaffarel revint avec une ample moisson. Résignataire de Raffin, il se démit en 1660 du prieuré en faveur de son frère, et mourut à Sigonce en 1681. Ses principaux ouvrages sont : Mystères secrets de la cabale divine, défendus contre les paradoxes des sophistes , Paris, 1625, in-4e; Curiosités inouïes sur la sculpture talismanique des Persans, horoscope des Patriarches et lecture des étoiles, Paris, 1629, in-8e; Index ou catalogue (latin) de dix-neuf cahiers cabalistiques dont s'est servi Jean Pic de la Mirandole, Paris , 1651 , in-8e; Histoire universelle du monde souterrain, contenant la description des plus beaux antres et des plus rares grottes, caves, voûtes, cavernes et spélunques de la terre. Le prospectus de ce dernier ouvrage fut imprimé à Paris, 1666, in-folio de 8 feuillets, il est très rare. Quant au livre, dont les planches étaient toutes gravées à la mort de Gaffarel , il n'a point paru , mais on s'accorde à dire que c'était un monument de folie et d'érudition. Gaffarel voyait des grottes jusque dans l'homme, dont le corps présente mille cavités, il parcourait les cavernes de l'enfer, du purgatoire et des limbes, etc. Un ouvrage de Gaffarel , plus sérieux que les précédents, est celui qui a pour titre : Qusestio pacifica, num orta in religions dissidia componi et conciliari possint per humanas rationes et philosophorum principia , per antiquos christianorum orientalium rituales libros, et per propria haereticorum dogmata, Paris, 1645, in 4.
19. — Pierre Gaffarel succéda à son frère en 1660, et garda le prieuré jusqu'en 1690.
20. —Jean Gassaud, né à Forcalquier, et neveu des deux Gaffarel, devint prieur de Ganagobie en 1690.
21. — Jean-Victor Décorio possédait le prieuré en 1736. 22. — Louis Boin, né à Lurs, devint prieur en 1754. 23. — Bernard Robaud, prieur de Ganagobie, en 1769, fut dépouillé par la Révolution, et mourut à Sisteron, le 12 octobre 1796.
ABBAYE DE LURE. L'abbaye de Lure dut son origine à saint Donat, ami et disciple de saint Mary, et son compatriote. L'endroit où elle était située, au pied du mont Lauthière, a retenu le nom de Combe Saint-Donat , à environ douze kilomètres à l'ouest de Sisteron. On lit dans le Martyrologe d'Adon : « En un bourg de France, au pied d'une montagne appelée Lure, on fête la naissance de saint Donat , prêtre, qui , dès sa plus tendre enfance admirablement doué par la grâce divine, vint d'Orléans en ce lieu pour se livrer entièrement au service du Christ. Il y passa plusieurs années, menant la vie d'un anachorète; lorsqu'arriva le jour où le ciel devait le rappeler, saint Mary l'apprit par révélation et vint le visiter. Saint Donat mourut alors en priant. » Ce récit diffère de celui qu'on lit dans la vie de saint Mary lui-même : « A ces merveilles, il faut ajouter que, quoique éloigné du lieu où se mourait Donat, serviteur de Dieu, il le sut en esprit, et le fit connaître à ses moines en versant des larmes. Quelques-uns de ceux qui l'entendirent voulurent s'assurer de la vérité de la nouvelle ; on envoya au lieu où l'homme de Dieu avait combattu les combats du Christ, et le messager vit bien que saint Mary avait prophétisé vrai. » Il n'est pas impossible de concilier les deux versions, en disant que saint Mary partit aussitôt pour aller visiter son saint ami mourant, et arriva avant son trépas. Honoré Bouche assure que plusieurs églises de Provence possédaient des reliques de saint Donat, et qu'une église paroissiale d'Embrun lui était dédiée. Ainsi que pour l'abbaye de Val-Benoît, nous ne pouvons fixer, même approximativement, la date de la fondation de l'abbaye de Lure. M. de la Plane indique le VIe siècle, et la mort de saint Donat en 535. Il cite, et nous traduisons d'après son texte, un passage extrait d'un ancien bréviaire du diocèse de Sisteron, qui ajoute quelques faits à ce qui précède. « Donat, né à Orléans, fut toujours admirablement favorisé de la grâce divine. Aimant la solitude, il erra dans beaucoup de forêts et sur les montagnes, pour s'y cacher et y mieux servir Dieu. Enfin, Jean ,très saint évêque de Sisteron, et comme lui originaire d'Orléans, l'appela dans sa ville , et l'établit dans le vallon de Lure , où le religieux , loin de tout commerce des hommes, se donna tout entier au service de Dieu. Quand sa mort approcha, le bienheureux Mary en reçut avis d'en-haut, et accourut près de lui du Val-Benoît; alors au chant des louanges divines et au milieu du concert des anges, Donat plein de mérites ,et célèbre par ses miracles, rendit à Dieu son âme très agréable au Seigneur. Son corps fut enseveli par le même abbé, puis , plus tard , transféré à Sisteron. Plus tard encore, une partie de ses restes mortels enrichit le grand autel de l'église métropolitaine d'Avignon ; une autre partie , très religieusement conservée à Sisteron, y a été l'objet d'un culte pieux jusqu'à ce que, lors des guerres des hérétiques, elle eut le sort des autres reliques des saints, vers la fin du XVIe siècle. » Les Sarrasins ayant détruit de fond en comble l'abbaye de Lure, la comtesse de Forcalquier, Adélaïde, en abandonna les ruines aux évêques de Sisteron , qui permirent à Foulques des Orgues (de Alsonicis) et à certains autres seigneurs de la relever et d'en faire hommage à Guigues, abbé de Boscaudon, dans le diocèse d'Embrun. Ce dernier fait nous aidera à préciser la date de sa reconstruction : en effet , Pierre de Sabran qui siégea à Sisteron de 1142 à 1169, est celui aux mains de qui fut faite la remise de Lure à l'abbé Guigues : ce fut donc avant 1170. Guillaume IV, comte de Forcalquier, confirma, en 1195, la même donation dont voici la charte extraite du Cartulaire de Boscaudon. « Foulque des Orgues , Frezols et Rambaud son frère et son neveu Raimond Lallier ; Undebert de Vaux, et son frère Guillaume et ses fils Léger et Undebert ; Bertrand de Graveson , Guillaume de Montlaux , et Léger frère d'Alfant , ont donné à Dieu et à Guigues, abbé de Boscaudon et aux moines de son monastère, pour le rachat de leurs âmes et des âmes de leurs parents, le lieu de Lure, comme les limites en ont été tracées , en présence de Pierre , évêque de Sisteron. Les témoins de cette donation ont été le même Pierre évêque entre les mains de qui elle a été faite , etc. » L'approbation et confirmation de Guillaume est en ces termes : « Moi , Guillaume , comte de Forcalquier, avec mon frère Bertrand, pour le remède de mon âme et des âmes de mes parents, je donne, livre et cède à Guigues, abbé de Boscaudon et aux frères qui servent Dieu dans cette abbaye et à leurs successeurs , le lieu de Lure près la fontaine de Martarol, pour y établir une abbaye; je veux qu'on puisse travailler sur la montagne autant que besoin sera pour entre tenir les moines... Cette donation a été faite à Manosque dans le cloître de Notre-Dame. Les témoins en ont été frère Hugues Villebis , archidiacre de Sisteron, etc. Giraud , prêtre, a écrit la présente. » Au lieu de : frère Hugues Villebis, Bouche a lu et il a peut-être raison : Frère Hugues ; Guillaume archid. de Sisteron. Par la confirmation de Guillaume IV, neveu du précédent , nous apprenons que l'abbaye possédait alors un domaine dans la vallée de Saint-Pons, un cellier à Saint-Etienne et un moulin à Montlaux. Les limites de ses propriétés à Lure même s'étendaient depuis le four Miramas, jusqu'au delà de la Combe-Lauthier. « Plus tard, dit M. de la Plane, la piété des fidèles l'enrichit de nouveaux biens, elle lui en procura nonseulement au voisinage, à Manosque, à Forcalquier, à Reillane, au Revest, à Curel, à Ribiers, à Mison, etc., mais à Aix et à Marseille. » Une énumération plus complète se trouve dans une lettre du pape Alexandre IV, donnée en 1255 et relatée par Columbi. On y voit que Lure possédait un grand nombre d'églises , parmi lesquelles NotrerDame de Réal , Saint-Pierre de Lançon , Saint-Géraud de Peipin, Sainte-Marie de Duman, Saint-Pierre de Rousset, Saint-Nazaire , les églises de la Roche, de Volx, de Clausonne et de Clavecombe , etc., etc. Lure comptait vingt religieux en 1318, lorsque le pape Jean XXII, l'unit au chapitre d'Avignon par une bulle donnée en cette ville le 30 mai 1318, la 2e année de son pontificat. Cette pièce est trop longue pour que nous l'insérions ici (Voir la Gallia christiana , Tome Ier, aux Preuves, et Columbi). Ce dernier auteur soulève une question importante. L'abbaye de Lure était jusque-là soumise à l'évêque de Sisteron , et l'on ne voit pas qu'il ait consenti à l'union , quoique l'abbé fut tenu de lui jurer obéissance. Cela est vrai , mais le Pape a prévu le cas à la fin de sa bulle quand il dit : « Que personne n'ose en freindre la teneur de la présente , sous peine d'encourir la colère du Tout-Puissant et des bienheureux Pierre et Paul ses apôtres. » Il y a mieux, en 1417, l'abbé de Lure, prêtant serment à Robert Dufour, évêque de Sisteron, fait cette réserve :" Sauf l'obéissance que je dois à l'évêque d'Avignon". L'union fut donc réellement accomplie avec ou sans le consentement de l'Ordinaire. Julien, cardinal de la Rovère, le 28 juin 1471, sécularisa l'abbaye de Lure par ordre du pape Sixte IV, et rappela que ce monastère de l'ordre de Saint-Benoit, dans le diocèse de Sisteron, était autrefois uni à l'Eglise d'Avignon, qu'il en dépendait avec tous ses droits et appartenances ; alors il l'assigne à la mense capitulaire de manière qu'aucun chanoine de cette Eglise ou toute autre personne ne puisse être institué dans ladite abbaye.

Abbés. La nomenclature de ces abbés est fort incomplète dans la Gallia, mais nous la trouvons à peu près sans lacunes, surtout depuis la fin du XIIe siècle, dans le livre de M. de la Plane, auquel nous avons tant d'obligation.
1. — Hugues, ou Guigues de Revel, abbé sous l'épiscopat de Bermond d'Anduze, en 1174, l'était encore en 1183, lorsque Bernard, évêque de Sisteron, confirma l'abbaye de Lure à celle de Boscaudon. Guillaume IV, comte de Forcalquier, le mentionne aussi dans une charte à la même occasion. Il passa ensuite à la tête de l'abbaye de Chasselay ou Chales, diocèse de Grenoble. C'est le même que la Gallia christiania des frères Sainte-Marthe, appelle Gui ou Guigues. Il devint évêque de Digne (Voir première partie, page 46).
2. — Imbert, mentionné dans la charte de Guillaume IV après Hugues, devint, en 1192, évêque de Riez (Voir Impartie, page 334).
3. — Rostaing, siégeait en 1207, lors de la même charte. En 1205, il avait été témoin dans la charte de fondation de l'abbaye de Tournemire.
4. — B...., abbé de Lure en 1218. Peut-être n'est-il pas distinct du suivant? Bonfils , abbé de Saint-Victor de Marseille , du consentement de sa communauté , lui confirma , le 13 décembre 1218, les biens, domaine seigneurial, droits et cens que l'abbaye possédait aux Orgues.
5. —Vincent de Barras , est arbitre dans un différend , entre Humbert, évêque de Sisteron, et le commandeur des Hospitaliers de Manosque, en 1251 (Livre vert de l'évêché, dans Gastinel).
6. — N..., abbé de Lure en 1285, assiste en cette qualité au concile de Riez.
7. — Isnard de Mauvoisin , de famille noble, siegeait au mois de mars 1307, date à laquelle il fut témoin dans une charte de Jacques , évêque de Sisteron, en faveur du mpnastère de Saint-André d'Avignon. On le retrouve encore en 1346.
8. — Astorge, de l'ordre de Cluny, était abbé de Lure , lorsque, le 9 décembre 1395, il assista au jugement porté par les cardinaux-prêtres, Jean de Mareuil , du titre de Saint-Vital , et Pierre de Thurey, du titre de Sainte-Suzanne , contre Alziar d'Albert , chevalier, seigneur du Thor. Ce dernier avait commis des dégâts sur la terre de Thouzon, au préjudice de Guillaume , abbé de Saint-André , et fut condamné à vingt livres d'indemnité.
9. — Andouin Giraudi, le 14 janvier 1418, jure obéissance à Robert Dufour, évêque de Sisteron , sauf le droit de l'Eglise d'Avignon. Cette réserve rappelle l'union de l'abbaye au chapitre d'Avignon en 1318. En 1423 , il jure une autre fois obéissance au même prélat.
10. — Elzéar Garachi, abbé de Lure, donne à bail certaines propriétés de l'abbaye, en 1426 (Reg. de Guillaume Arpilhe, notaire en cette année).
11. — Bertrand Standolas était prieur claustral de la cathédrale d'Avignon en même temps que abbé de Lure. Le 5 décembre 1456, d'après le Livre vert, il prête serment d'obéissance au vicaire général de l'Eglise de Sisteron, le siége étant vacant.
12. — Gervais Stavonqui , paraît dans une procuration reçue en 1486 , par le notaire Bertrand Arpilhe ; vers 1505 , on le trouve mentionné dans les archives d'Aix. En même temps qu'il était abbé de Lure , il avait un canonicat à Sisteron, et vivait encore en 1511.
13. — Louis de Vento, d'une famille noble de Marseille, était abbé en 1520. Son existence nous est connue par un opuscule en vers latins , intitulé : Orationes, epistolse et epigrammata , par Léon Trimond , des Mées , conseiller du roi à la cour de Nîmes , et chanoine de l'église cathédrale de cette ville, Lyon, 1612, in-16. Une pièce à la page 159 est en honneur de Louis de Vento , abbé de Lure et docteur en théologie. L'auteur y fait allusion à son nom de Vento , du Vent.
14. —Antoine de Béraudin, en 1543 et encore en 1565.
15. — Antoine Catin, chanoine de Forcalquier, nommé par son parent, Jacques Garret, prévôt de Sisteron et vicaire général d'Aimar de Rochechouard , évêque de cette ville , en 1595.
16. — Jean Aymini, en 1601 ou environ.
17. —Annibal Aymini, neveu du précédent, en 1620. Il était en même temps aumônier de la reine.
18. — Félix de Castellane bullé le 10 octobre 1667.
19. — Louis de Valavoire, frère de François-Auguste de Valavoire, lieutenant général des armées du roi, nommé le 8 septembre 1695, reçut ses bulles le 10 février 1696.
20. — N. de la Combe de Monteil, en janvier 1716.
21. — Balthazar de Burle-Valory de Real de Curban. Né à Sisteron, le 6 janvier 1791, il reçut le bonnet de docteur de Sorbonne, fut pourvu d'un canonicat dans l'église collégiale de Saint-Méry à Paris, et obtint, en 1717, la commende de l'abbaye de Notre-Dame de Lure, sur la démission qu'en donna le précédent. Il mourut à Paris , le 9 novembre 1774, et les registres du chapitre de Notre-Dame de Paris le qualifient chapelain de l'Eglise de Paris, seigneur de Gubian, Cellier et autres lieux. Cet abbé, qui fut l'éditeur d'un ouvrage remarquable intitulé : Traité de la science du gouvernement, compose par son oncle Gaspard de Burle de Réal, grand sénéchal de Forcalquier, a publié : Dissertation sur le nom de famille de la maison qui règne en France, en Espagne, sur les Deux-Siciles, et dans les Etats de Parme et de Plaisance (s. 1., 1735) in-4e; Paris, 1761,in-4e.
22. — Etdznne-André-François de Paule Fallot de Beaumont de Beaupré. Né à Avignon le 1er avril 1750, d'une famille noble, il fut pourvu d'un canonicat dans la cathédrale d'Agde et nommé abbé de Lure en 1775. M. de Lauzières de Thémines, évêque de Blois, le choisit pour vicaire général , et M. Pélissier de Saint-Ferréol , évêque de Vaison, le demanda et l'obtint pour coadjuteur avec future succession. Il fut sacré le 21 décembre 1782, à Frascati, sous le titre d'évêque de Sebastopolis in partibus, et par la démission de M. de Saint Ferréol devint, en 1786, évêque titulaire de Vaison. Dépouillé de son siége par la Révolution, il se réfugia à Chambéry en mars 1792, se rendit à la fin d'août à Turin, qu'il quitta au mois de septembre pour se fixer à Nice, mais il ne resta dans cette ville que trois semaines. Il espérait toujours pouvoir rentrer dans son diocèse, et l'on trouve dans l'Observateur du Midi, du 9 octobre 1792, un article passionné et peu révérencieux sur ce prélat, qui fut porté sur la liste des émigrés le 9 ventôse, an II (27 février 1794). Après le concordat, il fut nommé, le 9 avril 1802, à l'évêché de Gand, passa en 1807 à celui de Plaisance, et enfin Napoléon le nomma, le 15 août 1813, à l'archevêché de Bourges, dont il ne put jamais obtenir les bulles. En mars 1815, il devint premier aumônier de l'empereur, qui , le 3 juin suivant, l'appela à la Chambre des pairs. M. Fallot de Beaumont , que ce prince avait employé dans diverses négociations entre lui et le pape Pie VII , se démit de l'archevêché de Bourges et de l'évêché de Plaisance, et se fixa à Paris pour vivre dans la retraite. C'est là qu'il mourut, le 26 octobre 1835, doyen des évêques de France, après avoir reçu les derniers sacrements des mains de Mgr de Quelen , archevêque de cette Eglise.
23. — Claude-Louis Rousseau. Né à Paris, le 2 novembre 1735, et successivement élevé au collége des Grassins, à celui de Louis-le-Grand, et au séminaire de Saint-Magloire, il se fit, à peine promu au sacerdoce, une réputation d'orateur, et devint vicaire général et chanoine honoraire d'Albi, en 1767. Pourvu d'un canonicat dans la cathédrale de Chartres, il fut nommé, le 7 octobre 1781 , abbé de Notre-Dame de Lure, se réfugia pendant la révolution, en Suisse et en Allemagne, et ne rentra en France qu'à la fin de 1799. Son ancienne renommée le fit appeler, le 9 avril 1802, à l'évêché de Coutances, pour lequel il fut sacré le 25 de ce même mois. Membre de la Légion d'honneur le 5 juillet 1804, il fut transféré à l'évêché d'Orléans, le 22 mars 1807, préconisé le 3 août suivant, et mourut sur ce siége en cours de visite pastorale à Blois , le 7 octobre 1810.
ABBAYE DE CRUIS. Cruis, en latin Crocium, et plus anciennement Castrum de Crocio, est un petit village situé sur la route de Saint-Etienne à Forcalquier, au pied de la montagne de Lure. Son nom vient évidemment de Crux, croix, et les armoiries du lieu, étaient : d'azur, à un abbé mitré et crosse d'or. Honoré Bouche ne fait remonter l'origine de l'abbaye de Cruis qu'à un comte de Provence , Raimond Bérenger, qu'il fait vivre vers l'an 1100. Il se trompe; pour le prouver, nous n'avons qu'à rappeler une lettre écrite par Grégoire VII à l'évêque de Sisteron, en 1074. Ce prélat avait tenté de placer sous sa juridiction l'église de Cruis, qui s'en plaignit au Pontife ; d'où cette lettre véhémente, qui compare l'évêque à Ananie et à Saphire, et le menace de l'excommunication, s'il ne renonce à son projet. Toutefois, il ajoute : « Géraud... si vous croyez avoir des droits sur l'église de Cruis, venez à nous avec les chanoines de ce lieu, et vous trouverez justice devant nous. » Bien avant 1074, il y avait donc à Cruis un chapitre de chanoines réguliers ou non, qui s'appelait chapitre de Saint-Martin de Cruis, ou Domus placiti Dei. Ce chapitre était indépendant de l'Ordinaire, et relevait immédiatement du Saint-Siége : privilége qui ne pouvait manquer d'amener de fréquents conflits avec l'autorité ecclésiastique locale ; nous venons d'en voir un exemple. Cette fois, le monastère conserva son immunité ; mais il devait finir par la perdre, ainsi que nous le verrons. Remarquons que la lettre de Grégoire VII ne fait mention, en parlant de la maison religieuse de Cruis , ni de prévôt, ni d'abbé, mais seulement de chanoines, sans dire s'ils étaient ou non réguliers : il resterait donc place pour cette supposition, qui concilierait le sentiment de Bouche avec le fait indu bitable que nous apportons, ce serait : que Raimond Bérenger, comte de Provence , ait , au commencement du XIIe siècle, fait transformer le chapitre de Saint-Martin de Cruis en abbaye, lui assignant de nouveaux revenus, et y appelant des chanoines réguliers. Quoi qu'il en soit de cette conjecture, les chefs de la communauté ont porté tantôt le titre de prévôt, tantôt celui d'abbé, et dans le catalogue que nous allons en dresser tout à l'heure, il y aura quelquefois doute sur celle de ces qualités qui leur a appartenu. Les évêques de Sisteron ne se lassèrent pas de battre en brèche le privilége d'exemption de la maison de Cruis. En 1418, Robert Dufour parvint à s'en faire nommer abbé : c'était un succès très grand, et qui en promettait un autre définitif. En effet, Mitre Gastinelli , successeur de Robert Dufour, sollicita , et obtint du pape Calixte III, la réunion de l'abbaye à l'évêché (1456). A partir de ce moment, les évêques de Sis teron ajoutèrent à leurs titres celui d'abbé de Cruis , et la liste des abbés n'est que celle des évêques. La mense abbatiale de Cruis s'ajouta à la mense épiscopale, et l'accrut de 203 florins (4,060 fr.), et de 600 septiers de blé, mesure de Lurs. Abbés et prévôts de Cruis.
1. — Bernard, abbé en 1179. En 1207, le monastère était gouverné par un prévôt; nous lisons, en effet, sous cette date, que Bernard, évêque de Sisteron, céda l'église des Ybourgues au prévôt et aux chanoines de Cruis.
2. — Raimond , prévôt de Cruis, témoin en 1231, dans une donation faite par Pierre Bermond, chevalier, à l'église de Lurs, vivait encore en 1244.
3. — Imbert transige en 1249 avec la communauté des Ybourgues, au sujet de quelques droits seigneuriaux.
4. —Guillaume est arbitre en 1267 dans un différend entre l'évêque Alain et le prieur de Ganagobie, Imbert Vinilena.
5. — Pierre Gfraudi, prévôt de Cruis, fait, en 1269, échange de quelques églises avec l'évêque de Sisteron ; le 25 juin 1286, Pierre Giraud de Puymichel, évêque, sur la proposition de notre abbé, nomma Rostaing d'Alfand, moine de Saint-André, à la cure de Saint-Julien de Ferrassières ; la même année ou la précédente, selon la manière moderne de commencer l'année. Pierre Giraudi se trouva au concile provincial tenu à Riez par le métropolitain Rostaing , archevêque d'Aix : il n'y est pas nommément indiqué présent. C'est de lui sans doute qu'il s'agit dans le passage suivant d'Honoré Bouche : « L'an 1299 (le 6 mai), un Pierre Giraud, abbé de Cruis des chanoines réguliers de Saint-Augustin, au diocèse de Sisteron, ayant acheté de Bertrand de Baux, seigneur de Courthezon, les terres de Saint-Vincent, de Genciac , de Malcor et d'Aigremont, diocèse de Sisteron, pour le prix de 31,000 sols couronnez provençaux, en fit hommage au sénéchal et au procureur du roi en Provence, qui l'obligèrent et ses successeurs, d'en renouveler l'hommage, et faire le serment de fidélité de 30 en 30 ans et d'en payer le lods ; attendu que ces terres et châteaux tombaient en mains-mortes. » Les biens acquis comprenaient en bref tout ce qui avait appartenu à feu Ameil d'Agoult, seigneur de Curban, dans la vallée de SaintVincent, sauf l'affare que ce seigneur avait au lieu et territoire de Jarjayes. Pierre Giraudi est peut-être le même qui, le 28 octobre 1301, indiction XVe, acheta de Raimond Garnier de Manosque la moitié de la Tour de Bevons (aujourd'hui Valbelle). Ce qui est certain, c'est qu'en cette année Pierre, évêque de Sisteron, Durand de Marseille , et Jacques de Fréjus, furent consultés par Renaud de Lecco, sénéchal de Provence et de Forcalquier, pour savoir si cet officier du roi devait ratifier ou infirmer cette acquisition de biens qui tombaient en mains-mortes , et par là nuisaient au trésor royal. Les prélats consultés, furent d'avis de valider l'achat à certaines conditions, dont la principale était que de 30 en 30 ans , l'abbé actuel et ses successeurs renouvelleraient le serment d'hommage et de fidélité au roi. L'abbé et une vingtaine de ses moines, presque tous prieurs de quelque église, acceptèrent la condition.
6. — Rostaing, évêque de Sisteron, prenait, en 1330, le titre d'abbé de Cruis.
7. —Guillaume Giraudi, abbé de Cruis, en exécution du contrat de 1299 , renouvelle en 1339 le serment trentenaire d'hommage et de fidélité au roi, entre les mains de Jean d'Aigueblanche, chevalier, sénéchal pour le roi Robert, des comtes de Provence et de Forcalquier.
8. — Robert Dufour, évêque de Sisteron et abbé de Cruis, en 1418, reçoit en cette dernière qualité le serment de Gaubert, chanoine de Cruis, fait prieur d'Eparron.
9. — Mitre Gastinelli, évêque de Sisteron, obtient en 1456, du pape Calixte III, la réunion du monastère de Cruis à l'évêché. Maintenant, nous le répétons, la liste des abbés n'est plus que celle des évêques. Prenons cependant encore quelques notes.
10. — Laurent Bureau, le 13 juillet 1502, remet aux habitants de Cruis les cens et services qu'ils lui devaient, à condition qu'ils répareraient et entretiendraient l'église abbatiale paroissiale, tant que lui abbé vivrait.
11. — Aimeri de Rochechouard fait acte d'abbé le 1er mai 1559, et le 10 juillet 1566, il afferme certains biens ruraux à des habitants de Cruis.
12. — Toussaint de Glandèves, en 1629, fait savoir au roi que Aimeri de Rochechouard n'avait pas eu le droit d'aliéner, le 1er mai 1559 , le domaine de la Tour de Bevons, propriété particulière de l'abbaye. Le prince déclara cette aliénation nulle, comme faite au mépris des édits royaux. Le 31 août 1628, Toussaint de Glandèves avait fondé une vicairie à Cruis et l'avait conférée à maître Georges Bernard ; c'est lui aussi qui, dès 1617, avait obtenu du Pape que le prieuré de la Tour de Bevons fût réuni à la mense capitulaire de Cruis, pour ce motif sans doute que le monastère avait énormément souf fert des désordres et des guerres civiles. Mentionnons que la Tour de Bevons a pris le nom de Valbelle en 1680, lorsque la famille de Valbelle désira avoir une terre qui portât son nom. Le 10 mars 1660, Antoine d'Arbaud de Matheron, évêque de Sisteron, fut, par sentence judiciaire et conformément à la constitution de Charles IX, 1572, déchargé des aumônes générales. Cette constitution voulait que les possesseurs de bénéfices ecclésiastiques, pour lesquels ils payaient la dîme au roi, fussent exempts d'autres contributions.
ABBAYE DE SAINTE-CLAIRE. Au commencement du règne de Charles II d'Anjou, sur la demande d'Alasie de Mévolhon, dame de Curban, Gérarde de Sabran, abbesse de Sainte-Claire d'Avignon, vint fonder une maison de son ordre à Sisteron (1282) ; les habitants de la ville donnèrent les mains à cet établissement, et, en 1285, les fondements du nouveau monastère furent jetés, non loin des bords de la Durance, dans une terre appelée encore aujourd'hui Champs de l'Abbesse. La Durance est une dangereuse voisine ; aussi dangereux était-il de bâtir un couvent de femmes, en rase campagne, à une époque où des bandes soldatesques parcouraient sans cesse le pays : l'emplacement était donc mal choisi. Dès l'origine, le couvent de Sainte-Claire de Sisteron se plaça sous la protection de saint Damien, il subissait la juridiction du général et des provinciaux des Frères-Mineurs, et la règle du tiers-ordre de Saint-François. Il se composa de douze religieuses nées de parents nobles ou des meilleures familles bourgeoises de la Provence, d'une sœur converse et de deux servantes. L'abbesse, depuis le XVIe siècle, fut à la nomination du roi. En 1360, par suite des inondations de la Durance et de la terreur qu'inspiraient les guerres civiles, le couvent fut transféré dans l'intérieur des remparts de Sisteron. Précaution tardive et inutile; le 17 juillet 1540, les eaux des Combes s'amassèrent en avant du rempart qui céda sous leur poids ; le monastère fut submergé, trente-deux personnes périrent dans cette catastrophe, dont une vieille inscription a perpétué le souvenir. Le rempart se releva ; mais le couvent n'en fut pas moins continuellement exposé aux débordements des eaux. En 1581, les pauvres religieuses durent se réfugier dans le palais épiscopal. En 1452, les prieurés de Saint-Didier et de Saint-Marcellin de Valernes; en 1464, l'abbaye de Saint-Pierre de Souribes, furent réunis à l'abbaye de Sainte-Claire; cependant elle ne fut jamais bien riche et eut besoin des libéralités de plusieurs souverains : Humbert II, le dernier dauphin, lui légua sur la seigneurie d'Upaix douze saumées de blé, autant de vin et 40 sols viennois (50 fr.), moyennant deux anniversaires et un Salve Regina à réciter pour le repos de son âme par chaque religieuse en particulier. La reine Sancie, femme du roi Robert, disposa, en faveur des dames de Sainte-Claire, de mille onces d'or (100,000 fr.), qu'elles employèrent à acheter un domaine à Valernes, un autre à Mison, le péage de Peipin et une partie du péage du pont de la Baume. Un arrêt du conseil d'Etat du 24 janvier 1749, un décret de l'évêque du 25 décembre suivant, des lettres patentes du roi du mois de mars 1750, et enfin un arrêt du parlement portant enregistrement des dites lettres (3 juin |1750) : tels sont les actes qui supprimèrent cette abbaye, se fondant sur l'insuffisance de ses revenus. M. de la Plane, croit (et il pourrait bien deviner juste) que l'évêque avait pour cette suppression un motif qu'il n'avoue pas, c'est de détruire dans son diocèse un petit foyer d'insubordination féminine. L'historien dit à ce propos : « Il n'y a pas longtemps, sur la porte d'un cabinet de l'ancien couvent, on lisait en gros caractères : Pièces contre les évêques. » Au moment où elle cessa d'exister, l'abbaye avait un revenu d'environ 2,000 écus, sur lequel elle supportait 2 ,755 francs de charges. Ses biens furent partagés entre les dames de Saini-Bernard de Manosque et les Ursulines de Sisteron.
Abbesses. 1 . — Gerarde de Sabran , première abbesse, désignée par l'assemblée générale des Sisteronnais pour résoudre et hâter la fondation du monastère (1285). Elle était comme l'abbesse qui lui succéda, abbesse de Souribes, au diocèse de Gap.
2. — Béatrix, de Sisteron, en 1314, d'après, un acte au thentique.
3. — Alixende de Vins , en 1328 , sur laquelle on n'a pas de détails, non plus que sur un certain nombre de celles qui vont suivre.
4. — Suriane d'Arenc, en 1339.
5. — D. Andréa, en 1351.
6. — Beatrix de Saint-Vincent est mentionnée sous l'année 1355.
7. — Marie de Corse, en 1386.
8. — D. Biquière se qualifie humble abbesse du monastère de Sainte-Claire de Sisteron, dans un acte du 10 février 1399.
9. — Galice de Puget, en 1407.
10. — Douce Gantelmi , en 1417.
11. — Ermengarde, en 1437.
12. — Jeanne I" de Mévolhon, élue en 1440. En 1452, elle réunit à son monastère les prieurés de Saint-Didier et de Saint-Marcellin, de Valernes, ordre de Saint-Benoît, dépendant de Saint-Guillem-le-Désert, diocèse de Lodève; en 1464, l'abbaye de Saint-Pierre de Souribes, diocèse de Gap. A cette dernière maison, avait été réunie quelques années aupara vant (1440), .celle des dames de Sainte-Catherine de Digne, de; l'ordre dé Saint-Augustin. Jeanne de Mévolhon mourut le 8 octobre 1469 (d'après les minutes du notaire Jean Rollandy) — (Voir première partie,page 265).
13..---T- Louise I"de la Grolée, mentionnée dans des actes publics de 1478, de 1486, de 1494 et de 1496. Elle mourut en cette dernière année. D. Edm. Martène l'a vu nommée dans une bulle du pape Sixte IV, donnée le 19 janvier 1475.
14. — Catherine de la Grolée, élue en 1496, rend hommage l'année suivante pour la terre de Souribes. Son élection avait été confirmée, le 1er mai 1496, par le provincial des Frères-Mineurs, alors à Uzès. Dans la lettre de confirmation, il est dit que Catherine a été promue à l'abbatiat par suite de la mort de la vénérable et noble sœur Louise de la Grolée, autrefois abbesse.
15. — Marie du Chatelet, élue en 1509, est au mois de mars confirmée par le provincial de l'ordre. Elle est ensuite mentionnée dans des actes de 1511, de 1522 et de 1538. Dom Martène lui fait succéder Madeleine Grille, mais sans indiquer de date. Cet auteur omet la suivante et quelques autres.
16. — Philippine de MONTBOISSIER, est nommée par le roi en 1540. Elle meurt la même année, et le 17 juillet, dans l'inondation dont il a été parlé plus haut. Deux religieuses seulement échappèrent au désastre, et l'une élut l'autre abbesse.
17. — FRANCOISE MONET, élue par une seule voix... Le 23 juillet de la même année, 1540, elle fut reconnue et installée par le provincial de l'ordre, jusqu'à ce que par la Majesté royale ou par un autre supérieur, il soit pourvu à cette dignité. Le roi et le Pape approuvèrent ce qui s'était fait. Néanmoins le roi désigna une autre abbesse,Emérique de Bouliers, religieuse Augustine, qui ne perdit pas de temps et fit valoir ses droits ; elle était soutenue par le crédit de sa famille et arguait d'irrégularité l'élection de Françoise Monet. Un long procès s'engagea, et les prétentions d'Emérique triomphèrent en 1556.
18. —EMERIQUE de BOULIERS, de la maison de Trivulce, nommée par le roi, est reconnue le 4 décembre 1556.
19. —Louise de Bouliers, parente et probablement sœur de la précédente, occupe de 1562 à 1592.
20. — Anne de Rousset est élue par les religieuses en 1595, et confirmée par le Père provincial, puis obtient des lettres royales. Elle quitta ce monde le 19 octobre 1616.
21 . —Jeanne II (ou Anne) de Bonne est nommée par le roi, et le 22 novembre 1611 , par le Pape , coadjutrice de Anne de Rousset, et lui succéda en 1616. Elle gouverna le monastère jusqu'à sa mort arrivée en 1651.
22. —Madeleine de Gruel, du Saix, nommée le 14 no vembre 1651, par lettres royales, datées de Poitiers, reçoit ses bulles le 10 janvier 1652, se démet le 29 janvier 1680, et meurt le 28 mai 1686. « Entre Madeleine de Gruel et Jeanne de Lambert, Hugues du Temps et les auteurs de la Gallia christiana, placent N. de Villebois. Cette abbesse nous est inconnue. Si elle a jamais existé , ce qui est fort douteux , on voit par les dates qui nous pressente, qu'elle n'a pas dû siéger longtemps , et seulement depuis le 29 janvier 1680 jusqu'au 31 décembre de la même année. » (Note de M. de la Plane.)
23. — Jeanne III de Lambert-Maynier est nommée par le roi, le 31 décembre 1680, et transférée, en 1688, au monastère de Sainte-Claire d'Azille, diocèse de Narbonne, où elle meurt en 1724.
24. — Madeleine II de Bérulle, abbesse de Sainte-Claire d'Azille, en 1684, est transférée à Sisteron le 15 août 1688, prend possession le 30 octobre de la même année , et meurt le 7 mars 1710.
25. — Clémence de Sallemare de Ressis, née à Vienne d'une illustre et fort ancienne famille, est nommée par le roi le 19 avril 1710.
26. — Barbe de Comps, dernière abbesse, en 1749, lors de la suppression du couvent.
PRÉVÔTÉ DE CHARDAVON. Il nous reste à dire quelques mots d'une communauté religieuse de moindre importance que celles dont nous venons d'esquisser l'histoire , mais que, cependant nous ne pourrions passer sous silence sans injustice et sans être incomplets : c'est la prévôté de Chardavon, qui dépendait du diocèse de Gap mais qui, dès 1385, se trouvait dans le faubourg de Sisteron, à la Baume. Il n'entre pas dans notre plan de suivre toutes les controverses qui divisent les historiens provençaux sur l'histoire ancienne de ce lieu ; nous laisserons donc de côté le patrice Dardanus, élevant sur les hauteurs de Dromont une ville puissante qu'il nomme Theopolis , et nous arrivons au monastère qui remplaça la cité grecque, si tant est que cette dernière ait ja mais existé. Dans le XIe siècle , Chardavon était redevenu un désert, lorsque de pieux cénobites vinrent y cacher leur humilité. Bouche croit que ce monastère fut fondé vers la même époque que la chartreuse de Durbon. D'autres, plus probablement, pensent qu'il fut une filiation de la prévôté d'Oulx, en Piémont, dont la fondation est due à Géraud Chevrier, un des évêques de Sisteron a raison qu'ils donnent est que les deux maisons avaient des dîmes en commun , entre autres celles de Seyne. Or, Géraud Chevrier devint évêque en 1060. La prévôté ou le prieuré de Sainte-Marie de Chardavon était sous l'invocation de la Vierge et de saint Jean-Baptiste. Par un privilége spécial , nul n'avait le droit de passer sur les terres du monastère; l'accès en était surtout interdit aux femmes. Les chanoines eux-mêmes avaient sollicité cette rigoureuse défense, conforme à la règle de Saint-Augustin. Nous trouvons ce fait dans une charte de 1204, rapportée par Bouche , historien de la Provence, et dont il nous faut citer les termes : « Au faubourg de la Bauçae, il y a une chapelle de Saint-Antoine dans le village, et dehors l'église paroissiale de Saint-Marcel, anciennement de l'ordre des Psalmodiens , et aujourd'hui la demeure des chanoines réguliers de Saint-Augustin avec leur prévôt, vulgairement dits de Chardavon, transférés du village de ce nom à cette église. . . La cause de cette transférence nous est inconnue, comme aussi beaucoup d'autres choses, touchant l'état de cette prévôté Le plus ancien titre que je trouve de cette prévôté, est un privilége et une sauvegarde de Pierre, roi d'Aragon, comte de Barcelone, et marquis de Provence, lequel titre n'est point dans les archives de cette prévôté, mais bien dans celles du roi à Aix, au registre Turturis, fol. 215, verso. Voici en extrait la charte du roi d'Aragon : « En l'honneur de Notre-Seigneur Jésus-Christ et de la bienheureuse Marie ; en l'honneur de l'église de Saint-Jean-Baptiste et de Saint-Marcellin, faisons savoir à tous présents et à venir, que nous Pierre, etc. , accordons à Isnard Donanze, prévôt de Chardavon, le sollicitant , qu'il est défendu à toute femme d'aborder la maison et d'entrer dans leur terroir, et aux gens de guerre d'y pénétrer, ainsi qu'à toutes autres personnes, soit par les grandes ouvertures du chemin qui est au milieu de la plaine, soit par les posterles (chemins dérobés), soit par les raccourcis. De plus, nous prenons sous notre garde et protection ladite prévôté, ses biens , meubles et immeubles, avertissant que quiconque violera la teneur de la présente encourra notre colère. Fait l'an de l'Incarnation 1204 , au mois d'avril , indiction VIe. » Les guerres du moyen-âge furent funestes à Chardavon, celles surtout qui suivirent la mort de la reine Jeanne de Naples : le parti opposé au duc d'Anjou y porta le fer et la flamme. Nous voyons les suites de cette dévastation par le passage suivant de l'historien déjà cité. « Des lettres patentes de la Reyne Marie, mère de Louis II, données à Sisteron, le 14 août 1385, il appert qu'un Guillaume Affache, prévôt de Chardavon, vint trouver cette Reyne et lui représenta que son monastère de Chardavon était entièrement démoli et abandonné à l'occasion des guerres de ce temps-là (qui estoient sans doute celles de Charles de Duras) et des contagions sur venues ; que les meubles et les bestiaux avoient été emportés : Monasterium dirutum, destructum, et totaliter devastatum , tam in domibus , animalibus , averibus, quam in aliis bonis, suis; en façon, dit-il, qu'on n'y peut pas faire le service divin, ny par impuissance, rétablir la maison claustrale au point où elle estoit auparavant ; en considération de quoy, il pleut à Sa Majesté , de permettre la transférence de ce monastère à la Baume, bourgade de Sisteron, où déjà ils avoient une maison, tout proche du pont de Durance, qui leur servoit d'hospice, ou de retraite, pour s'y retirer, quand les œconomes venoient à la ville, pour les affaires du monastère. A quoy la Reyne con descendant après leur avoir donné une confirmation de tous les priviléges que son monastère avoit autrefois eus de Raimond Bérenger, comte de Provence, de Charles I et II, de Robert et de Louis, roys de Sicile et comtes de Provence; comme encore de la reyne Jeanne (desquels priviléges il ne se trouve aucune mémoire dans les archives de cette prévôté) elle lui donna permission de faire assembler tous ses religieux et les loger à la maison de la Baume qu'ils avoient auparavant, laquelle ils donnèrent puis après à l'évêque. de Gap qui est le prieur de l'église de la Baume, en échange de l'église parroissiale de S. Marcel (qui estoit anciennement de l'ordre des Psalmodiens, comme j'ai marqué en l'Histoire) au même lieu de la Baume où ils sont maintenant (Bouche, Hist. de Prov., t. Ier, Addit., p. 10). » L'ancien couvent ne se releva jamais de ses ruines; le nouveau retrouva dans le faubourg de Sisteron où il s'était établi, la paix que la solitude de son premier établissement n'avait pu lui assurer. Toutefois, le nombre des religieux qui l'habitaient varia beaucoup selon le temps. En une élection de prévôt, faite l'an 1319, par conséquent avant la translation, on y comptait vingt-six prieurs de villages et dix-sept chanoines résidants au monastère; au temps où écrivait Bouche, il n'y avait plus « outre le prévôt , qui était commendataire, que cinq chanoines, un novice, et un curé séculier pour les fonctions curiales. » Qu'on veuille bien remarquer que si, à ce propos, nous citons si fréquemment Honoré Bouche, c'est que, ayant été lui-même prieur de Chardavon, et ayant écrit l'Histoire monumentale de Provence, que l'on sait, il était impossible de choisir pour les temps anciens un meilleur guide que lui. Vers le milieu du XVe siècle, la prévôté perdit un droit précieux, l'élection de son prieur : la nomination en appartint au roi, qui ne l'accorda guère qu'à la faveur. Ainsi, sur les nominations royales, on trouve quatre Birague de suite. En 1547, l'ordre, ou plutôt le désordre, qui régnait à Chardavon, appela l'attention du roi. Un inventaire des biens de la communauté fut fait, et l'agent royal en afferma la totalité aux frères Garret, dits Catin, marchands de Sisteron. Par ce bail, 300 écus d'or (3,000 fr.) sont attribués au prévôt, et 40 (400 fr.) à chacun des religieux, pour la nourriture et le vestiaire. Les fermiers s'obligent , en outre, de payer les curés et les vicaires à la nomination du prévôt , et de fournir neuf charges de blé, savoir : la première au juge de la prévôté, la deuxième au notaire, la troisième au barbier, et les six autres pour les pauvres (de la Plane). Les guerres de religion du XVIe siècle abaissèrent considérablement les revenus de cette prévôté. Le personnel , dès 1319, avait toujours diminué. A l'époque dont nous parlons, il ne restait plus que quatre chanoines, un sacristain et un novice. En 1630, les chanoines avaient chacun quinze charges de blé et part égale avec le prévôt dans la dîme du Plan des Tines, valant à chacun cent cinquante coupes de vin. Les revenus de la prévôté étaient de cent vingt charges de blé et 3,000 livres argênt, et ses charges s'élevaient à environ 1,800 livres. Le titulaire prenait possession dans l'église de Saint-Marcel de la Baume de son bénéfice consistorial ; nous disons consistorial, parce que les bulles en étaient demandées et expédiées en consistoire comme pour les évêchés et les abbayes; il avait haute, moyenne et basse juridiction. L'église actuelle de Chardavon fut construite en 1671; elle fut bénite le 19 juillet de la même année, par dom François Aillaud, chanoine, doyen de Chardavon, et vicaire général de la prévôté, député, à cet effet, par Pierre de Marion, évêque-comte de Gap. Elle est sous le vocable de Notre-Dame de bienheureuse Consolation. En 1782, le chapitre de Sisteron obtint une bulle qui lui unissait le prieuré des chanoines réguliers de la Baume ; sur 4,000 livres de revenus que possédait la communauté, 1,800 étaient destinées au séminaire de Gap, et le reste au chapitre de Sisteron. La bulle n'eut pas le temps de sortir son effet subordonné à la mort des titulaires : 89 arriva.
Nomenclature des prévôts qui ont échappé à l'oubli.
1. — Isnard Donanze, en 1204 (d'après la charte longuement citée plus haut).
2. — Olivier, en 1230.
3. — Raimond de Imberti, en 1238.
4. — Bertrand de la Baume , en 1245.
5. — Raimond du Caire, en 1260.
6. — Pœrre Miramas, en 1290.
7. — Raimond de la Motte, mort le 5 janvier 1319.
8. — Raimond de Vaumeilh, déjà prieur de Manteyer, fut élu le 19 janvier 1319. Nous avons vu que 22 membres de la prévôté avaient des prieurés ailleurs.
9. — Feraud de Barras , en 1337.
10. — Guignes, en 1346.
11. — Hugues de Mérindol, en 1349.
12. — Renaud de Vaumeilh, en 1380.
13. — Guillaume Affache , en 1385.
14. — Bertrand de La Motte, en 1394.
15. — Isnard Préveyral, témoin dans le contrat de mariage de noble Jean Gombert, et Astrugète, fille de maître Prioret Laydet, notaire (Registre de Guillaume d'Aigremont, alias Plantevigne, fol. 89).
16. — Jacques Autard (Bouche l'appelle mal à propos Artaudi), en 1442.
17. — Pierre de La Villette, premier prévôt commendataire, en 1447.
18. — Gaucher de Forcalquier, évêque de Gap, en 1480, mort le 5 avril 1484.
19. — Gabriel de Monteynard (notaire, Bertrand Arpilhe , fol. 31 et 42), en 1485.
20. — Louis de Forbin, prend possession le 11 août (même notaire, fol. 35), en 1486.
21. —'Ramond Ricardi, d'Aix, en 1504.
22. — Bernardin Gamberia, de Casal, en 1514.
23. — François Accurse de Cassanigo, milanais, en 1528.
24. — Jacques-Antoine de Birague, en 1555.
25. — Louis de Birague, fils de Jérôme de Birague, chevalier de l'ordre de Saint-Michel, et de Louise Avogadro, prit, possession le 3 mai 1560, succède dans l'abbaye de Flavigny, diocèse d'Autun, à son cousin le cardinal René de Birague chancelier de France, et meurt à Flavigny le 13 mai 1592. Horace de Birague, son frère, occupe le siége épiscopal de Lavaur de 1583 à.1601.
26. — Camille de Birague, neveu du précédent, devint prévôt en 1581.
27. — Philippe de Birague, prit en 1610 possession de la prévôté.
28. — Claude Amat, conseiller, aumônier ordinaire du roi, occupait en 1663.
29. — Honoré Bouche, né à Aix en 1598, et ordonné prêtre en 1625 par le cardinal de Richelieu, archevêque de cette ville, qui le fit son vicaire général ; il fut en 1633 pourvu de la prévôté de Saint-Jacques les Barrême, au diocèse de Senez , dont il se démit en 1661. Louis XIV, à qui il avait été présenté en 1660, pendant son séjour à Aix, lui donna en 1665 la prévôté de Chardavon. Honoré Bouche, qui mourut à Aix au mois de mars 1671 et fut inhumé dans l'église des Carmes-Déchaussés , s'est acquis une juste réputation par son histoire de Provence. Cet ouvrage a pour titre : "Chorographie ou description de la Provence histoire chronologique de ce pays." Aix, 1664, 2 vol. in-folio , imprimés aux frais des Etats de la province. L'érudition que Bouche y étale est souvent peu ménagée, le style en est diffus, la diction quelquefois obscure , mais c'était là le goût et le défaut de son siècle.
30. — Melchior Bouche, d'Aix, parent du précédent, lui succéda dans la prévôté en 1671, et non en 1669, comme le dit M. de la Plane. 31. — Antoine de Cellières, mentionné en 1680.
32. —Victor-Augustin de Méliand, né le 10 juillet 1626; il était le septième enfant de Blaise de Méliand, seigneur d'Egligny, ambassadeur de France en Suisse, et de Geneviève Hurault, sa première femme. Pourvu d'une charge d'aumônier de la reine-mère Anne d'Autriche, et nommé en 1648, abbé de Bassac, au diocèse de Saintes, il fut préconisé évêque de Gap le 25 septembre 1679 et transféré le 27 juin 1684 à l'évêché d'Alet. Prévôt de Chardavon en 1687, il se démit de son évêché en octobre 1698, renonça quelques années après à sa prévôté, et mourut à Paris, au séminaire des Bons-Enfants où il s'était retiré, le 23 septembre 1713.
33. — Jean de Cruzenet, de Burgnac, au diocèse de Limoges, fut prévôt jusqu'en 1728.
34. — François de Castellane, en 1737.
35. — Pierre de Lieutaud, vicaire général d'Orange, en 1756.
36. — Joseph Laurent de Gombert, chanoine de SaintVictor de Marseille, en 1764.
37. — Honoré Ricaudy, dernier prévôt en 1780, mort à Paris en 1802.
![]()