SSAI SUR L'HISTOIRE MUNICIPALE DE LA VILLE DE SISTERON.
PAR
M. E.D DE LAPLANE
1874

AVANT-PROPOS.
L'ESSAI que nous présentons au public ne nous a point paru indigne de son attention, même après les nombreuses et savantes recherches dont l'Histoire du Droit Municipal a été l'objet. Ce ne sont point des lumières nouvelles que nous apportons sur l'origine et l'ancienneté du régime municipal en France, ni sur son existence plus ou moins prolongée, pendant l'époque de ténèbres qui suivit l'invasion des Barbares. Ces faits ont été suffisamment éclaircis par les divers écrits publiés sur cette matière. Mais il est une période de l'Histoire municipale, jusqu'ici entièrement négligée, et que nous avons cru devoir soumettre à une étude spéciale : c'est celle où l'association communale, reprenant une vie nouvelle, commence à se reconstituer d'elle-même, et, sans autre impulsion que celle de ses besoins, se développe peu à peu, laissant au temps, ce grand architecte, le soin de régulariser et de cimenter l'édifice ; spectacle, à la fois piquant et instructif, auquel des textes précis et non interrompus semblent nous faire assister, comme s'il se passait réellement sous nos yeux. On demandera peut- être, comment il s'est fait qu'une aussi importante série de documents se soit rencontrée dans les obscures archives d'une petite ville et comment elle a pu y braver les outrages des siècles. Une telle découverte pourrait passer, en effet, pour une sorte de bonne fortune. Cependant, il est à croire que des recherches analogues à celles que nous avons faites nous-mêmes à Sisteron, ne seraient pas non plus ailleurs sans résultat. Car, il ne faut point oublier qu'après avoir dû leur conservation au respect religieux qui jadis nè cessa de les entourer, la plupart de nos richesses paléographiques trouvèrent leur salut même dans le mépris qu'affecta souvent pour elles la sauvage ignorance de nos modernes Vandales. Depuis l'établissement du Comté de Forcalquier ( 1054 ), la ville de Sisteron continua d'en faire partie : et, en possession paisible, à ce qu'il paraît, du régime municipal , elle n'avait point songé à l'assurer contre les entreprises des souverains. Mais , à la mort du dernier comte ( 1209 ), le pouvoir étant tombé entre les mains d'un usurpateur(1), elle pensa que le moment était venu de ne plus abandonner ses vieilles libertés aux chances des événements politiques. Elle exigea des garanties et les obtint. Quoique sans titre légitime pour faire de telles concessions, le prince qui souscrivit la charte de 1212, eut du moins le mérite d'être le premierà reconnaître officiellement que pour la ville de Sisteron il existait d'autres droits que ceux de la force et de l'arbitraire : fait qui, une fois constaté et entré dans le domaine de ce que les jurisconsultes appellent : verba enun
(1) Guill. de Sabran , fils de Guiraud Amic et d'Alis de Forcalquier.
ciativa)1) , devint le fondement des institutions de la cité. Le droit romain , dont l'étude commençait à se répandre, hâte bientôt les progrès de la civilisation. Ces progrès sont déjà remarquables dans les statuts, qu'en 1257 Charles d'Anjou accorde, sur leur prière, aux habitants de Sisteron. Plus tard , c'est encore à la haute sagesse du droit romain que nos chartes demandent le complément des garanties qui leur manquent. Néanmoins les coutumes , ce droit vivant dans les mœurs (2) , ne disparaissent pas toutes devant la loi romaine. Celles qui sont plus particulièrement l'expression des besoins du pays conservent leur autorité. De ce nombre est le statut du comte Guillaume de Forcalquier, touchant les successions ( 1170 ). Également filles du sol et plus tenaces encore, d'autres coutumes semblent être la source peu connue de quelques dispositions consacrées par la législation moderne. Il serait intéressant de signaler jusqu'à quel point ces
(1 ) In antiquis enunciativa verba probant. ( Dumoulin sur la Cout. de Paris . )
(2) Jus quoddicitur moribus constitutum. De Leg. 32 - § 1.
rapports existent; mais ce n'est point ici le lieu d'entreprendre cette recherche. Longtemps, l'exercice du droit municipal se réduisit à des formes simples comme la société qu'il représentait. C'était la masse entière des citoyens qui prenait part aux affaires, qui les décidait en assemblée générale et qui en confiait ensuite l'exécution à des agents spéciaux, nommés syndics. Mais, dès les premières années du XIV siècle, un nouveau travail organique s'opère dans la commune. La constitution municipale reçoit une forme plus régulière et plus en harmonie avec le mouvement social. Sans rien perdre de la largeur de ses bases, sans imposer aucun sacrifice au droit commun, elle concentre l'action administrative pour lui donner plus de force et plus de célérité. Un conseil est établi. Partagée entre les divers membres qui le composent, la surveillance municipale s'étend à tout, embrasse tout. Grâce à ses soins, il y a sûreté, liberté partout, et nulle charge, nul impôt qui ne pèse, d'un poids égal, sur tous les citoyens, sans distinction. Toutefois, au milieu de cette importante réforme , traitée , on le voit , comme une affaire de famille , où est la royauté ? Ce n'est point elle qui a imaginé la constitution nouvelle et qui l'a imposée. Non, ce n'est point elle. Mais la royauté, ce pouvoir que la sagesse de nos Comtes a rendu si doux, si tutélaire, a mieux fait que cela. Elle a laissé le vœu de la commune se manifester, puis elle s'y est associée, dès qu'elle en a reconnu la justice et l'opportunité. C'est là, du reste, à quoi se borna presque toujours l'intervention de ces souverains dans les affaires de la cité ; conciliant ainsi, avec les droits de leur couronne, les droits de leurs sujets. Aussi, est-ce dans le cœur des Provençaux que ces princes fondèrent leur véritable empire. Au milieu des embarras sans cesse renaissants où les jeta, pendant deux siècles, la vaine et malheureuse possession du royaume de Naples, où auraient-ils trouvé tant de ressources inespérées , si ce n'est dans l'affection de leurs peuples? Le pays sans doute, sous les deux maisons d'Anjou, cut souvent à souffrir. De longues dissensions l'agitèrent. Il eut bien des charges à supporter, de douloureux sacrifices à s'imposer; mais quelque grands que furent ses malheurs, il n'eut pas du moins à déplorer le plus grand de tous, la perte de ses libertés. Dans la charte du comte Guillaume dont nous venons de parler ( XII° siècle ), il est question de gens de la campagne (rusticorum), comme faisant partie, avec le clergé, la noblesse et les bourgeois, des conseils du prince, et, dans le siècle suivant, nous voyons toutes les communautés du bailliage de Sisteron convoquées à une assemblée des États tenue à Valensole ( 1296 ) . Il ne saurait donc y avoir doute sur l'existence politique du Tiers-État aux époques les plus reculées, et sur la part qu'il prit constamment aux affaires du pays. Il n'est pas moins certain que de temps immémorial aussi, les subsides régulièrement répartis au marc le franc, ne laissaient aucun nom en dehors de l'allivrement et que même, en vertu des constitutions de l'empire toujours en vigueur , il ne dépendait pas du souverain d'accorder des exemptions d'impôt, à moins qu'il en dégrevat d'autant l'affouagement général, Nous donnons, en appendice, le texte d'un allivrement des habitants de Sisteron, exécuté en 1327. Rien n'est plus propre à jeter du jour sur l'ancien état de la ville. Les noms mêmes, cette expression de la famille, premier anneau de la grande chaîne sociale, malgré leur apparente sécheresse, deviennent pour l'observateur un sujet d'utiles méditations. Ces noms, nous les avions entrevus, dès le siècle précédent, au milieu du tumulte des assemblées générales. C'est maintenant, chacun chez soi et paisiblement assis au foyer domestique, que l'inflexible dénombrement va surprendre les citoyens. Il nous fera connaître ceux que la maladie, l'absence ou la négligence ont tenus éloignés de ces parlements publics, où se traitent les affaires de la commune. Car ici, nul ne saurait échapper. Tous, riches et pauvres, enfants d'une même patrie qui les protège tous également, doivent lui venir en aide. Tous lui doivent compte de leurs ressources foncières, industrielles et jusqu'à leurs plus faibles moyens d'existence. La femme, jusques là obscure et ignorée au fond de son intérieur, à défaut de droits politiques, se montrera elle aussi , du moins comme être civil lorsque , représentant la propriété , elle sera appelée à supporter les charges qui y sont attachées. Parmi les obligations que les Sisteronnais imposent à Guillaume de Sabran (1212) , est celle de ne pointdémembrer certaines parties du territoire. Voilà donc le principe de l'inaliénabilité du domaine déjà reconnu ! Principe salutaire dont l'avenir, qui n'appartient qu'aux institutions utiles, va s'emparer pour le consacrer de nouveau et le fortifier même , en investissant les peuples du droit de le défendre à main armée ( 1352 ) . Nous produisons divers documents relatifs à l'ancienne administration du bailliage. Ces sortes de pièces sont rares. Renfermé dans un cercle d'attributions bornées et passagères, et en cela bien différent de la commune dont l'action n'est jamais suspendue, le ressort bailliager, on le conçoit, a dû ne laisser que peu de traces de sa participation aux affaires. Les témoignages que nous en avons recueillis tiennent à des circonstances fortuites. Nous les devons à la malheureuse nécessité qui réduisit souvent le pays à se lever tout entier pour repousser de redoutables agressions, et surtout à la remarquable ponctualité que mit le conseil de la ville chef-lieu à enregistrer, jour par jour, les mesures prises par les États, en vue de la défense commune. Les documents dont nous faisons usage sont d'autant plus précieux que le droit y est partout rappelé et clairement défini . Mais le grand pivot sur lequel roule incessamment la machine administrative, c'est la franche et loyale représentation de tous les intérêts : Quod omnes tangit ab omnibus approbetur ; admirables paroles qui mériteraient d'être écrites en lettres d'or, et qu'en attendant, pour l'honneur du droit commun , nous sommes fiers de trouver consignées, depuis plus de 400 ans, dans les fastes oubliés de notre ancien bailliage ( 1 ) Cependant, ces immortels principes d'équité naturelle , base de nos institutions provençales
(1) Livre vert . Fo 91 vº.
et une des gloires du moyen âge, vont, en s'éloignant de cette époque si souvent mal appréciée, subir de graves altérations. C'est le moment où , sous prétexte de réforme religieuse , de hardis novateurs ébranlent la société jusques dans ses fondements. Leurs doctrines amènent une licence dont la fâcheuse réaction enveloppe, pour les mutiler, jusqu'aux libertés les plus légitimes. La présidence est enlevée aux États pour être attribuée à l'archevêque d'Aix ( 1555 ), et bientôt les Etats eux-mêmes, devenus suspects au despotisme , sont suspendus et remplacés par un simulacre de représentation ( 1639 ). Le mérite seul ne suffit plus pour être admis aux emplois. On n'y arrive désormais que par l'intermédiaire du fisc dont il faut , avant tout , satisfaire les exigences. La municipalité qui, elle aussi, ne peut rester sans fléchir, sous la main du pouvoir, se voit imposer des offices dont elle est obligée de se racheter pour rentrer dans le plein exercice de ses droits. Deux siècles et demi s'étaient écoulés, depuis qu'un gouvernement imprudent qui avait corrompu ses voies, substitua souvent l'arbitraire à l'autorité légale. On sent combien de griefs un pareil régime dut accumuler sur sa tête. Le moyen âge lui-même , malgré ses titres au respect de la postérité , n'a pu échapper à l'anathème encouru par cette époque véritablement anormale , avec laquelle l'ignorance n'a cessé de le confondre. e Enfin apparaît 89 , et de toutes parts les plaintes éclatent. Mais, quoique long-temps comprimées , ces plaintes sont remplies de modération et de convenance. Elles portent principalement sur la réforme des abus : long et triste inventaire de tout ce qu'en fait de libertés, le XVIII siècle était réduit à envier au XIV. Nous faisons connaître les doléances que les communautés de la sénéchaussée de Sisteron expriment dans cette occasion solennelle. On conçoit tout l'intérêt qui s'attache à un semblable document, d'autant qu'il n'a point été imprimé et qu'on ne le retrouve plus que sur une feuille bien fugitive, mais authentique, que le hasard des événements a respectée pour la faire tomber en nos mains ; c'est l'expédition même remise aux députés de la sénéchaussée à l'assemblée de Forcalquier. L'importance de ce cahier, rédaction officielle de ce que la sénéchaussée possédait alors d'hommes les plus éminents et les plus éclairés, dans l'ordre du Tiers-État, consiste en ce qu'on y trouve fixés , d'une manière précise , l'étendue comme la nature des griefs du pays. On peut croire que rien n'y a été oublié et que là véritablement se bornent les besoins et les vœux de l'époque. C'est là aussi désormais, que l'histoire doit prendre son point de départ, pour marquer la limite qui sépare l'ancien et le nouvel ordre de choses, et pour bien distinguer, dans le grand événement qui amena cette séparation , ce qui appartient au droit , de ce qui fut l'œuvre des passions. Quoiqu'il en soit, le présent ne saurait faire oublier le passé. Celui-ci est assez glorieux pour que notre vanité trouve son compte à ne point le dédaigner. Mais ce passé, pour le connaître, il faut l'étudier, et comment l'étudier, si ce n'est dans les sources mêmes ? C'est le parti que nous avons pris. Nous ne déchirons qu'un coin du voile ; d'autres finiront par l'arracher. Les ouvriers ne manquent point à l'œuvre. Tout tend évidemment à une restauration historique, et la génération présente qui se dévoue à cette noble et utile entreprise n'entend pas en laisser le mérite à celles qui doivent la suivre. Nous avons pensé que ces préliminaires ne seraient point déplacés à la tête de l'Essai sur l'Histoire municipale de la ville de Sisteron. Bien que resserré dans un cadre étroit, le tableau qui va se dérouler devant nous, ne laisse pas d'avoir une certaine portée. Quelques jalons étaient nécessaires ; ils serviront à en mieux faire saisir l'ensemble. Forte du double appui du temps et des mœurs, notre ancienne administration de commune ne tomba point de vétusté. Elle ne céda qu'à la tempête ; et restée, depuis, dans les souvenirs de la patrie, elle y subsiste comme un titre de gloire, et pourquoi faut-il ajouter, comme un objet de regret ? car l'homme a beau faire, il ne saurait lutter de puissance avec les institutions que la raison et la nature des choses lui ont données. Leur esprit survit aux coups que sa main leur porte, et du fond même des ruines dont il s'entoure, s'élèvent des enseignements qu'il doit du moins subir. L'académie royale des inscriptions et belles lettres ayant honoré de son suffrage et d'une couronne ce modeste travail, il était de notre devoir de le soumettre à une révision sévère et de le rendre par là moins indigne de la glorieuse distinction dont il a été l'objet.( 1 )
(1) Rapport fait à l'Académie des Inscriptions et Belles- Lettres , au nom de la Commission des Antiquités Nationales , et lu à la séance publique du 10 août 1838, par M. le Comte Alexandre de Laborde. Après cette distribution de médailles aux ouvrages qui nous ont paru mériter le mieux cette distinction, nous avons éprouvé, Messieurs, un sentiment pénible : c'est de n'avoir pas une égale faveur à accorder à un travail excellent de M. de Laplane, intitulé : Histoire Municipale de la ville de Sisteron. Au moment où tant d'efforts se réunissent pour perfectionner parmi nous les institutions de ce genre, il était intéressant de trouver une tradition non interrompue du système communal déjà déclaré d'origine immémoriale, dans une charte de 1296, et qui semblait par là se rattacher en quelque sorte aux beaux temps de ces institutions, à ces municipalités romaines dont Cicéron se glorifiait d'exercer les charges dans la petite ville d'Arpinum, et que Montaigne déclare tellement cher aux peuples, qu'ils estiment toute autre forme de police monstrueuse et contre nature. Cette charte de 1296 forme un rouleau de six pieds de haut contenant plus de mille noms ; elle confie l'administration de la ville à un conseil général nommé par tous les citoyens assemblés sur la place publique, et qui doivent être convoqués toutes les fois qu'il faudra apporter quelques changements à leurs statuts ; et tels furent la sagesse et le patriotisme de ces bourgeois législateurs, qu'ils surent , pendant plusieurs siècles, se gouverner ainsi sans violence et sans trouble, et défendre leurs libertés, leurs priviléges, contre les comtes de Provence, et plus tard contre l'autorité des rois de France. Seulement une clause singulière se trouve dans cette charte : c'est celle qui exclut de toutes fonctions publiques les avocats et les procureurs. Cette clause est encore relatée dans un édit de Henri II, de 1547 ; mais elle n'a plus reparu depuis , etje ne pense pas qu'on fût bien accueilli aujourd'hui si on voulait la rétablir. L'ouvrage de M. de Laplane nous a paru un modèle à étudier sur cette question ; il est écrit dans un style clair, concis, méthodique, et appuyé de citations nombreuses tirées de documents authentiques . L'académie a sollicité et obtenu de M. le Ministre de l'instruction publique une quatrième médaille d'or pour M. de Laplane..... » Les Membres de la Commission des Antiquaires de France, Signes à la minute : GUÉRARD , DUREAU DE LA MALLE , HASE , RAOUL-ROCHETTE , NAUDET , JOMARD, Baron WALCKENAER. Comte de LA BORDE , Rapporteur. L'académie adopte les conclusions ci-dessus . Le Secrétaire perpétuel de l'académie, DAUNOU.

ESSAI SUR L'HISTOIRE MUNICIPALE DE LA VILLE DE SISTERON
Quam civitatis formam patres arique instituerint; ulteriora mirari , præsentia sequi . Tacit. Hist. L. IV. C. VIII.
LA VILLE DE SISTERON possède des archives qui, comme celles de la plupart des petites villes, sont peu connues, sans mériter, toutefois , le sort qui a été jusqu'ici leur partage. On pourra en juger par l'examen que nous allons faire des vieux cartulaires et autres titres conservés , en original, à la mairie de cette commune. La série des nombreux documents que renferme ce dépôt s'étend, depuis les premières années du xu° siècle ( 1212 ), jusqu'à nos jours, embrassant ainsi une période de plus de six cents ans. Au milieu de ces vénérables écritures , trésor enfoui de sagesse et de patriotisme , nous avons dû nous borner et ne prendre que ce que réclamait l'intelligence du sujet que nous nous proposons de traiter , savoir : l'Institution municipale, son organisation, ses progrès, la nature et l'étendue de ses attributions , les priviléges qu'elle donnait aux citoyens , comme les charges qu'elle leur imposait ; enfin , les vicissitudes diverses, à travers lesquelles s'élabora cette œuvre lente du temps et de l'inaltérable bon sens de nos pères (1). C'est un curieux spectacle, pour nous hommes du xıx siècle, si avides de mouvement, si impatients de progrès ; c'est un curieux spectacle que ce travail séculaire de la raison et de l'expérience pour formuler quelques modestes règlements de police et d'administration. Dans la simplesse de leurs mœurs , nos aïeux ne songeaient point à sortir du domaine de la réalité pour se jeter dans les abstractions. Qu'y auraient-ils gagné ? En possession de toutes les garanties sociales, jouissant de la liberté et de l'égalité civiles, du droit de s'administrer et de faire par eux-mêmes leurs affaires, ces biens, les premiers de tous et qui, trop souvent pour d'autres furent le prix
(1) La plupart des pièces que nous dépouillons ici, et dont nous ne pouvons citer que des fragments à l'appui de notre travail , doivent être imprimés, en entier, dans le grand Recueil des Monuments de l'histoire du Tiers-Etat que prépare le savant M. Augustin Thierry.
d'une longue et pénible conquête, ces biens, ils les avaient toujours connus. Ils formaient comme une portion de leur patrimoine, et cette portion n'était pas, à leurs yeux, la moins précieuse. C'est donc à conserver ces avantages que tendirent constamment leurs efforts. Plus d'une fois, sans doute, ils eurent à modifier la forme de leur association communale. Mais, architectes prudents, ils se gardaient bien d'ébranler l'édifice, en le réparant. Ne concevant d'utile que ce qui est praticable , ils étaient tellement pénétrés de la nécessité de borner là leurs théories , qu'il fallait que tout citoyen nouvellement admis, ainsi que chaque membre du conseil, en entrant en fonctions, jurât, non-seulement de faire ce qu'il croirait utile au pays, mais encore de s'abstenir d'inutiles essais , utilia agere , inutilia prætermittere. C'est tout un monde que ces paroles mettent entre nos pères et nous ; il serait bien possible que tout notre esprit n'y comprit rien, ou n'y vît qu'une insignifiante et puérile formalité. Pour mettre quelque ordre dans cet examen, nous considérerons : 1º L'Institution municipale , son organisation, son existence jusqu'en 89 ; 2º Les Libertés publiques, leur rapport avec les droits et les devoirs du citoyen ; 3º Le Bailliage, sa constitution, ses trois états.
I
LA MUNICIPALITÉ ,
SON ORIGINE , SON ÉTAT JUSQU'AU XIV SIÈCLE.
L'ÉTABLISSEMENT municipal , à Sisteron, n'a point d'origine connue. On doit conclure de ce silence , pour peu que l'on soit familiarisé avec l'histoire , que cette institution , ainsi que celles de la plupart des villes du midi de la France , remonte jusqu'au municipe romain , et , de là peut-être , jusqu'au gouvernement autonome des cités gauloises ; car , à l'exception des villes où le vainqueur imposa le régime colonial , on sait que partout ailleurs , sa politique respecta les usages établis , laissant les populations continuer à se gouverner par leurs propres lois. Ainsi , on le voit, ce serait avec l'origine même de la cité que se confondrait, à Sisteron, celle de l'administration communale. On pourrait, en ce cas, mettre quelque gloire à rappeler un pareil titre. Pendant que tout, jusqu'aux noms mêmes des villes , semble s'effacer dans l'histoire, il faut bien se résigner à ignorer ce que devint le régime municipal. Il dut subir la loi commune. Entraîné dans le vaste naufrage de la civilisation, il conserva néanmoins assez de vie pour se reconstituer de lui-même, aussitôt que des temps meilleurs le permirent. La tempête qui força l'arbre à plier ne l'avait pas déraciné. Après l'orage, il put se relever, et le sol qui le vit naître retrouva un abri sous ses rameaux protecteurs. L'expulsion des Sarrasins, vers la fin du x siècle, ayant délivré le pays de la longue et dure oppression où l'avaient retenu ces Barbares, un mouvement de restauration sociale commença dès lors à se manifester de toutes parts . Les églises sortirent de leurs ruines ( 1 ). Le clergé que la persécution avait dispersé, se rallia et reprit le service des autels. A sa voix les peuples se ranimèrent. Une Bulle du pape Nicolas 11 (1061 ), adressée aux habitants de Sisteron porte en tête: Clero, ordini et plebi (2). Il est donc permis de croire, puisqu'il est ici question de Magistrature (ordini) (3),
(1) La reconstruction de la cathédrale de Sisteron date, selon toutes les apparences,des premières années du xi siècle ( 1030 environ)
(2) Hon. Bouche . Histoire de Provence , Tom. 2. p. 78. — Nov. Gallia Christ. Tom. 1. preuv . fo 89 .
(3) Raynouard. Hist . du Droit municipal, Tom. 1 , p. 338-40.
que la commune ne resta point en arrière du mouvement général, et qu'elle dut être même un des premiers besoins de la société renaissante. En confirmant le consulat et la commune, le plus ancien titre de nos archives, qui est à la date de 1212 , en reconnaît ainsi formellement la préexistence (1) . er En 1257, deux citoyens de Sisteron , cives Sistaricenses, Baudoin Scoffier et Guillaume Bourgogne , se rendent auprès de Charles I, Duc d'Anjou, et la Comtesse Béatrix de Provence, son épouse, alors à Saint-Remy et obtiennent de ces princes le maintien des bonnes et immémoriales coutumes de la ville ; en outre, la concession d'un certain nombre de statuts concernant la justice (2). Peu après ( 1266 ), ce ne sont plus de simples citoyens, mais des syndics qui terminent, pour le compte de la communauté , ses différends avec le Prévôt et le Chapitre de Cruis, sur le droit d'usage de la forêt de Bosc Crompat (3 ). Jusqu'ici, faute de monuments plus précis, nous n'avons pu qu'épier, en quelque sorte, la commune pour en constater l'existence. Plus heureux maintenant , nous allons la voir apparaître constituée sur
(1) Consulatum confirmo vobis et ratum facio in perpetuum...... Item confratriam vestram confirmo...... ( Charte de Guillaume de Sabran se qualifiant Comte de Forcalquier ). Voyez Append.
(2) Sac des Priviléges et Liv. vert , fº 2 .
(3) Sentence arbitrale. Orig. en parch.
ses larges et profondes bases. En voyant ce qu'elle est, nous saurons ce qu'elle fut; car elle en est encore aux formes primitives. Ses délibérations sont celles du forum où la cité tout entière est appelée à régler elle-même ses affaires. Ainsi, lorsqu'en 1283, il s'agit d'autoriser l'établissement du monastère de Ste. Claire, tous les habitants se réunissent, selon l'usage à son de trompe, en assemblée générale, in parlamento publico, pour prendre une délibération en faveur de cette pieuse et utile fondation (1). Plus loin (1290), le collecteur d'un fouage, sommé par le juge de livrer les fonds de sa caisse, appelle de cette prétention inouïe à l'assemblée générale des citoyens qui tous, à l'exception d'un seul, déclarent qu'il n'y a pas lieu d'obtempérer à l'injonction du juge : décision dont prend acte l'appelant (2). Une autre fois, sur la question de savoir si, pour empêcher l'introduction des vins étrangers à Sisteron, il ne conviendrait pas d'imposer aux taverniers l'obligation de ne vendre que le vin provenant de leurs propres caves, l'assemblée consultée répond, tout d'une voix, qu'elle est de cet avis, quod sic. Après quoi, le bailli, sur la réquisition et de l'expresse volonté de l'assemblée (3), ordonne au trompette
(1) Universitas hominum de Sistarico, more solito voce preconis in parlamento publico, congregata. Nov. Gall. Christ. Tom. 1 . Instr. fo 92 .
(2) Chart. orig . en parch .
(3) De ipsorum voluntate , requisitione , assensü et consensu.
juré de la ville de faire connaître , par voie de publication, la délibération qui vient d'être prise, et dont la peine est de cent sols d'amende pour les délinquants. La charte d'où ces faits sont tirés est à la date du 6 janvier 1296. Il y est dit, en outre, que dans cette assemblée convoquée, selon la coutume , par autorisation du bailli , on remarque plus des deux tiers des habitants , et parmi eux les hommes les plus honorables du pays ( 1 ) , sans autres détails. Mais la nomenclature qui manque ici, se trouve dans une seconde charte de la même année, et qui plus est, du même jour. Rien de plus imposant que cette longue série de noms, au nombre de près de mille, développés dans un rouleau en parchemin, de six pieds et demi de haut, sur quinze pouces de large; page immense, mais insuffisante encore à la matière qui n'a pu s'y resserrer qu'à l'aide d'une écriture fine et chargée d'abréviations. Au milieu de la foule qui se presse autour de lui , le notaire, souvent distrait, a laissé échapper quelques erreurs ; il a fait plusieurs double-emplois. Il y a même des noms qui semblent reparaître jusqu'à trois fois . Mais , à l'aspect du colossal instrument sorti de la plume du scribe officiel , quel lecteur ne se sentirait porté à l'indulgence pour des fautes d'inattention et de fatigue ?
(1) In quibus sunt et esse asserunt plus quam due partes hominum universitatis dicte civitatis Sistarici , et inter quos fertur quod consistit melior et sanior pars universitatis dicti loci, et totius consilii ejusdem.
Nous aurons à revenir sur ce dernier document. Il suffira, pour le moment, de noter qu'il y est question d'envoyer des syndics nommés ad hoc , à une assemblée convoquée à Valensole ; et qu'ensuite , en vertu d'une autorisation , précédemment accordée à la ville par le grand sénéchal, de créer , pendant l'espace de trois ans, un ou plusieurs syndics, à son choix, les magistrats nouvellement élus reçoivent une extension de pouvoirs applicable à d'autres affaires qui leur sont spécialemet désignées. Ainsi finit la commune , avec le XIIIe siècle. Le xıve lui ouvre une ère nouvelle. Le mouvement de la société, devenu plus actif, a multiplié les besoins , les affaires ; et , avec eux , les devoirs de l'administration. Mais telle qu'elle est , l'administration n'est plus suffisante. Deux syndics ne peuvent étendre à tout leur sollicitude . La sphère dans laquelle se meuvent ces magistrats est d'ailleurs trop bornée. N'ayant que des pouvoirs spéciaux, les cas imprévus les trouvent sans qualité ; et là, où il serait utile d'agir sans délai, il faut attendre une nouvelle délégation. Ces inconvénients peu sensibles aux époques de langueur sociale, ne sont plus tolérables , et l'administration doit désormais pouvoir répondre à toutes les exigences de la cité ; mais en donnant plus de latitude à l'autorité syndicale, n'est-il pas convenable d'y ajouter aussi quelques garanties ? Tel est le problème à résoudre : suivons le curieux travail d'organisation qui va s'opérer dans la commune. On dirait des abeilles qui, pour construire leur ruche , n'ont qu'à s'abandonner à l'admirable instinct qu'elles tiennent de la nature. La commune sous les Comtes de Provence , pendant les XIV et xve siècles. Dès l'an 1307, le nombre des syndics est porté à quatre, et ces magistrats continuent leurs fonctions pendant plusieurs années (1). En 1313 , sur la demande du sénéchal, trois syndics sont nommés pour se rendre à l'assemblée qui doit se tenir à Aix, le 25 du mois de mars, et les notaires de la cour sont obligés de rédiger gratis l'acte d'élection, sous peine d'être privés de leurs offices (2). Les syndics élus en 1315, reconnaissant la nécessité de conserver, autrement que dans des actes isolés, les preuves et la tradition des affaires , achètent un registre pour y inscrire la recette et la dépense des sommes appartenant à la communauté , les comptes des tailles mises et à mettre, ainsi que les ordonnances que les syndics seront dans le cas de rendre conjointement avec leur conseil (3).
(1 ) Reg. des comptes courants , fo 21 .
(2) Chart. orig. en parch.
(3) Et pro scribendis ordinationibus faciendis per eos cum consilio consiliariorum constitutorum syndicis antedictis. Reg. des comptes cour. fo 2.
Voilà donc les syndics avec un conseil ! Toutefois, ce conseil n'est encore que temporaire et nommé suivant les besoins du moment. En ouvrant un registre pour la comptabilité , on a été frappé du désordre qui règne dans cette partie du service public. Les préposés au recouvrement des subsides n'ont, pour la plupart, rendu leurs comptes que d'une manière incomplète. Plusieurs se trouvent reliquataires de sommes plus ou moins fortes, mais inconnues et dont il importe de constater la valeur ; sans quoi il n'y aurait pas d'administration possible. A cet effet, la commune sollicite auprès du sénéchal, la convocation par-devant la cour, de toutes les personnes chargées jusques là et à quelque titre que ce soit, du maniement des deniers publics, afin d'y soumettre leurs comptes à un certain nombre d'auditeurs nommés par l'assemblée générale des citoyens ; demande que l'autorité s'empresse d'accueillir ( 1324 ) . Cette même année , les syndics manquant de pouvoirs pour transiger , au sujet de certaines affaires dont ils avaient été chargés , en reçoivent de plus étendus de l'assemblée générale , mais à la condition expresse de s'adjoindre quatre personnes notables de la ville qui leur sont désignées , et sans le conseil desquelles ils ne doivent rien terminer , sous peine de nullité , aliter non (1 ) Mais si , à l'aide d'un conseil , la gestion des syndics présente des garanties suffisantes , pourquoi ne pas rendre ce conseil permanent ? pourquoi n'en pas faire une institution régulière ? Il semble que l'administration ne pourrait qu'y gagner, et qu'en cessant de vivre, pour ainsi dire, au jour le jour, sa marche en serait et plus prompte et plus sûre. Cette pensée est trop naturelle, pour ne pas se réaliser bientôt dans les faits. Aussi, l'année ne s'écoule pas sans nous montrer les quatre syndics déjà entourés de huit couseillers et d'un jurisconsulte-assesseur placéà leur tête (2). La même délibération renferme encore une disposition qui ne doit point nous échapper. C'est celle par laquelle le conseil nouvellement institué arrête que sa délibération actuelle, comme tout ce qui à l'avenir intéressera l'administration, sera couché dans le registre commun , par la main d'un officier public, afin de donner à ces actes l'authenticité qui leur est nécessaire (3).
(1 ) Chart. orig. en parch .
(2) Consiliarios deputatos per universitatem hominum civitatis Sistarici ..... Délibér. du 10 déc. 1324. Reg. des compt. cour. fº 40 .
(3) Item fuit ordinatum quod predicta et alia que fient per universi- tatem predictam , scribantur per manum publicam in presenti cartulario communi universitatis predicte et illa que ibi scribentur pro publicis habeantur. Reg. des compt . cour. fo 40 . Le registre dont il est ici question est le même que celui qui fut commencé, en 1315, et qui coûta quinze sols ( 8 fr. environ d'aujourd'hui). Il ne paraît pas qu'il en ait existé de plus ancien. Ajouterons-nous quc ce vieux cartulaire est en papier, mais en papier si épais, si lissé et si fibreux, qu'au premier aspect il est impossible d'y voir autre chose qu'une pâte de coton? Cependant, comme ce papier est d'ailleurs bien pétri et qu'il laisse apercevoir des traces de la forme, marques distinctives du papier de linge , il est probable qu'il y est entré quelques parties de lin ; car ce ne fut que peu à peu , et par un amalgame progressif de chiffons de linge que l'on parvint à perfectionner le papier , en rejetant de sa composition les éléments grossiers du coton et même de la laine qui jusques-là en avait fait la base. De là , la difficulté de fixer avec précision l'origine du papier de chiffes . Ainsi, tandis que les uns en reculent l'usage jusqu'en 1301 et font honneur de cette invention à l'Allemagne, d'autres assurent qu'en France le papier de linge n'existait pas avant 1311 et même 1318 ; en Angleterre, avant 1342 ; en Espagne et en Italie , avant 1367. ( Jansen. Essai sur l'orig . de la gravure. Tom. 1. p. 333. ) Dans cet état de la question , on ne verra peut-être pas sans intérêt , qu'outre le registre , objet de cette note , les archives de la ville de Sisteron conservent un échantillon de papier , à la date de 1316 et qui est bien supérieur à celui de 1315. Il est certain qu'à partir de cette époque le papier s'améliore rapidement. Il devient aussi plus commun , participant ainsi au mouvement qui entraîne la société. Le parchemin qui régnait en maître a trouvé un rival qui lui dispute l'empire, et qui est au moment de le lui enlever. Envain les lois qu'effrayait la fragilité du papier , l'ont-elles frappé comme d'anathème , en lui interdisant le sanctuaire de la justice ; il triomphe de tous les obstacles , et la civilisation a conquis un nouvel et précieux élément. Les feuilles qui ont servi à l'allivrement des habitants de Sisteron , en 1327 , offrent un papier de très-bonne qualité , où l'on remarque , en filigrane , l'empreinte d'une cloche avec son battant . Viennent ensuite diverses pièces , à la date de chacune des années 1335 , 37 , 39 et 1340. Enfin, en 1341 , apparaît le premier registre des délibérations du conseil , et, avec lui , la preuve de l'étonnant degré de perfection auquel était, dès lors ,parvenue la fabrication du papier.
En 1326 , nous retrouvons les mêmes syndics et le même conseil , mais accru de plusieurs autres membres (1) faisant partie d'une assemblée générale , où dès lors , parvenue la fabrication du papier.
(1) Et plurium aliorum deputatorum dictis syndicis per universitatem predictam. Délib. du 27 avril. Reg. des compt. cour. fo 42.
sont nommés, outre les auditeurs des comptes, quatre cominaux ( cominales seu communes ) , chargés de se partager la connaissance des différends relatifs aux propriétés situées , soit dans la ville , soit dans le territoire (1) . L'année suivante , une affaire importante occupe la communauté. Elle fait procéder à un allivrement général des habitants : mesure devenue indispensable , depuis que de nombreux changements opérés dans les fortunes ont ôté toute possibilité de conserver , dans la répartition des tailles , cette juste balance qui seule peut en alléger le poids. Aussi les lettres du grand sénéchal relatives à cet objet , recommandent- elles expressément de veiller à ce que chaque citoyen ne soit imposé que selon ses facultés (2) . Douze citoyens , choisis dans chaque quartier , sont appelés à prendre part à ce travail. Tous acceptent , et , en entrant en fonctions , jurent sur les saints Évangiles qu'on leur présente et qu'ils touchent , de ne révéler à personne le secret de leurs opérations , de n'avoir en vue que l'intérêt général , de lui sacrifier
(1) Quibus communibus tam in civitate quam extra.... data fuit plena et libera potestas , ut super questiones ortas et que orientur suo tempore , super possessionibus , proprietatibus et pategiis et aliis quibuscumque ad ea pertinentibus et occasione ipsorum audiendi , inquirendi , examinandi et fine debito terminandi. Déliber. du 27 avril. Reg. des compt. cour. fo 43 .
(2) Quod per reformationem ipsam in contributione talliarum ipsarum pro singulorum facultatibus faciendâ , quantum erit factibile , servetur equalitas inter cives . Lettr. du 6 juillet.
l'intérêt privé et d'omettre tout ce qui serait inutile à ces fins (1 ) . Il n'y a plus de doutes sur les avantages résultant de l'établissement d'un conseil : l'épreuve est décisive. Mais en adoptant définitivement cette institution, restent divers points à régler. Combien de temps doivent durer les fonctions des nouveaux magistrats ? à quel mode de renouvellement convient-il de les soumettre ? L'expérience , ce grand maître , peut seule répondre à ces questions. En attendant , on s'arrête au parti d'avoir un conseil composéde douze membres lesquels , à l'expiration de leurs fonctions qui seraient annuelles ou semestrielles , si on le juge plus convenable , désigneraient eux-mêmes leurs successeurs . C'est dans ce sens qu'est formulée la demande soumise à la sanction royale ; sanction qui ne se fait pas attendre et qui est pleine et entière(2) . Le prince exige seulement qu'il soit donné connaissance au sénéchal du résultat des élections , et fixe à quatre ans la durée de l'autorisation qu'il accorde , faisant expresses défenses à ses officiers de s'immiscer , en aucune manière , dans l'administration de la ville qui , à cet égard , continuera à jouir de tous ses droits.
(1) Juraverunt ad sancta Dei Evangelia manu tacta , ordinata et disposita per eos , juxta potestatem eis concessam , tenere secrete et nemini revelare .... et publicam utilitatem , pro posse , preferri private et utilitatem ipsius universitatis facere et inutilia pretermittere . ( Reg. de l'allivrement de 1327 , voir à la fin de l'appendice. )
(2) Lettr . du 12 février 1333. Roul. en parch.
" Tous les hommes , porte la délibération du 6 mars 1334 , tous les hommes ont un penchant naturel pour la discorde ; disposition fâcheuse qui produit souvent chez eux, autant d'avis qu'il y a de têtes , et au milieu de la confusion inséparable de la mul- » titude , peut-être sera-t-il difficile de s'entendre pour la nomination du nouveau conseil (1)" Сеpendant , il n'a rien été fait encore d'aussi important dans la commune. Il s'agit de créer un conseil type , pour ainsi dire , destiné à se reproduire de lui-même. Où serait l'inconvénient de choisir six personnes notables qui , investies de la confiance de l'assemblée , procéderaient seules à l'élection ? C'est ainsi , en effet, que l'élection a lieu , et elle répond à tous les vœux. Chaque classe de citoyens , comme chaque quartier de la ville a une égale part dans la représentation communale. A côté du fier gentilhomme , du grave jurisconsulte et du riche marchand, le petit mercier, l'utile artisan et l'humble laboureur trouvent leur place (2) , apportant chacun à la direction des affaires publiques
(1) Quiaest quasi impossibile quod omnes possent unanimiter con- cordare ad eligendos ipsos duodecim probos viros ..... propter naturalem ad discordandum facultatem , et quotquot capita , tot sententie , et ubi multitudo , ibi confusio,
(2) De qualibet peda, tres viros ut decentius electio ipsa procederet et in debita et communi utilitate duraret , scilicet : de peda de Saunaria et de inviis : Dominum Joh. Celley militem , Pontium Molleti mercatorem , Raymundum Quintalon laboratorem ; et de peda Carrerie Recte et Coste : Dominum Matheum de Rauco jurisperitum , Magistrum Garinum Authonii physicum et Giraudum Coassam sabaterium ; de peda de Rivo : Franciscum Arpilham mercatorem , Joh. Revelli macellarium et Joh. Chalvini mercerium ; et de peda de burgo Raynaudo : Dominum Raymundum Ruffi jurisperitum , Durandum Ortolani cordoanerium , Joh. Tornatoris notarium.
le tribut de ce bon sens et de ces lumières naturelles que la science n'a point faussés : tribut modeste et qui pourtant a sa valeur. Ce n'est qu'un denier , mais un denier d'or. Douze membres composent maintenant le conseil. Ces membres sont tous égaux. Rien ne les distingue. Est-ce que tous vont se saisir de l'administration ? tous vont-ils concourir également et simultanément à l'expédition des affaires? la chose paraît difficile. Que d'embarras et , en même temps , que de dépenses (1) ! N'est-il pas plus naturel que le conseil délègue une partie de ses pouvoirs ? n'y avait-il pas auparavant des syndics que ce soin regardait spécialement ? Eh bien ! que sous le même nom , deux conseillers reprennent les mêmes fonctions qu'exerçaient ces magistrats . Toutefois , en se déchargeant sur les syndics de la tâche la plus pénible , leurs collègues ne leur doivent pas moins le sacrifice de tous leurs efforts pour les aider à porter le fardeau. Ils doivent surtout se montrer assidus aux séances. Jusqu'ici le conseil ne s'est réuni qu'à des époques indéterminées. Mais la voie du progrès s'élargit. Un jour , et bientôt deux de
(1 ) Esset nimis laboriosum et sumptuosum , si ipsi omnes duodecim consiliarii circà ipsa negocia vacarent.... Délibér. du 11 avril 1334 . Roul. en parch.
chaque semaine vont être consacrés aux affaires publiques(1). On aime à compter sur l'exactitude. Cependant, comme entre les faiblesses humaines, le relâchement n'est pas une des moins communes, peut-être ne sera-t-il pas inutile de l'avertir qu'une amende de douze deniers est là pour le prévenir (2). Les défaillants sans excuse légitime ne pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes, si la peine les atteint. Ils ne sauraient prétexter cause d'ignorance, car le son d'une des grosses cloches de la cathédrale annonce l'heure des réunions (3), Le nombre et l'importance des affaires règlent seuls la durée des séances ; mais quelle que soit cette durée, il convient d'en attendre la fin ; et, dans la crainte que d'oiseux débats ne viennent les prolonger il faut que la discussion ne laisse la parole aux membres de l'assemblée, l'avocat du conseil et les syndics exceptés, que chacun à son tour, et lorsqu'il est appelé à donner son avis (4) . Une infraction plus grave est celle
(1) Le lundi , à l'issue de la Messe. ( Délibér. du 6 août 1341. ) Le lundi et le vendredi. ( Id. du 28 avril 1356. )
(2) Quâ defuerit hora predicta , nisi esset infirmitate , quod absit absenciâ justa , non simulata vel alia justa excusatione impeditus venire , solvat pro vice qualibet et solvere teneatur , ut infra irremissibiliter XII denar, monete tunc currentis. ( Délibér . du 6 août 1341. )
(3) Item ordinaverunt dicti Domini Consiliarii quod quilibet consiliarius dicte civitatis debeat esse quandocumque convocatus fuerit , infra palacium predictum in tintinabulo ecclesie et quod de ipso palacio non exire , donec dictum consilium tenuerunt , in pena duodecim denar. ( Délibér . du 1er juillet 1351. )
(4) Item quod nullus consiliarius audeat loqui , dum erunt in consilio , sine licencia bajuli , nisi advocatus dicti consilii , vel syndicus , nisi per ordinem et dum vocatus fuerit. ( Délibér. du 1er juillet 1351. )
qui porterait, hors du conseil, la connaissance de ce qui s'y passe. Aussi, pour y obvier, il ne suffit pas, comme dans les cas précédents, d'une légère peine pécuniaire, et ce n'est point trop que d'appliquer à cette coupable indiscrétion , qui est presque une trahison, la privation à perpétuité de tous les droits de citoyen ( 1 ). Nous voyons encore que tout habitant de Sisteron, élevé par la confiance de ses concitoyens, au rang de conseiller, n'était pas libre de refuser. Il devait accepter cet honneur, et rarement sans doute, il lui prit la fantaisie de le décliner, car il savait à quel prix était son refus. Si nous n'avions le document sous les yeux, nous n'oserions énoncer la quotité de cette amende, qui était de cent marcs d'argent fin (2) . S'il est triste de n'attendre que de la crainte l'accomplissement d'un devoir, c'est une raison de plus pour ne pas faire de ce devoir une charge trop pesante. Le
(1) Item etiam voluerunt et ordinaverunt quod nullus de consilio et ad consilium vocatus revelet ordinata in consiliis , et si contrarium fecerit et reperiatur fecisse , quod perpetuo sit privatus honoribus et qui buscumque aliis privilegiis et libertatibus dicte ville Sistarici. (Délibér. du 8 avril 1393. )
(2) Lettr. du sénéchal du 13 avril 1359. En orig. Il est juste de dire que cette mesure fut prise sous l'impression d'une profonde terreur inspirée par la présence d'un ennemi que rien n'arrêtait dans ses déprédations, et qui mettait , à chaque instant , la ville en péril. C'étaient les débris de l'armée vaincue à Poitiers , et qui , répandus sur le sol de la France , se disputaient le royaume comme une proie .
citoyen qu'absorbent les affaires publiques, au détriment de ses propres intérêts, ne saurait, sans injustice, être condamné à souffrir ce dommage. La patrie ne peut exiger de lui plus qu'elle n'exige de ses autres enfants. De vieux adages, ce code de la sagesse ne disent-ils pas que « nul n'est tenu de faire la guerre » à ses dépens et que « là , où le labeur est sans rémunération, là aussi, arrive à grands pas, l'indigence aux dures et mortelles étreintes » (1) ? Telles sont les considérations, à l'aide desquelles le conseil croit de son devoir de ne pas laisser sans indemnité ceux de ses membres qui se vouent particulièrement au service de la chose publique. Ainsi , l'avocat du conseil , les deux syndics et le notaire-greffier recevront à l'avenir, chacun six florins d'or, pour l'année de leur exercice, et les auditeurs des comptes dont les fonctions ne sont que passagères, deux florins (2) . Jusqu'ici le recouvrement des tailles s'est effectué au moyen de collecteurs nommés par quartiers et au fur et mesure des besoins. Le conseil juge convenable de compléter ce mode de perception , par l'institution d'un clavaire pris dans son sein et spécialement chargé
(1) Attendentes hii pronominati de consilio qui circa negocia dicte universitatis expedienda laborant propria negocia obmittentes sunt remuneratione condigni, juxtâ id quod dicitur: « nemo tenetur propriis » stipendiis militare » et ulterius sapiens dicit : « cum labor in dampno est , crescit mortalis egestas . » ( Délibér. du 28 juin 1346. )
(2) Délibér. du 6 novembre même année.
de l'entrée et de la sortie des deniers communaux (1) . Il s'occupe ensuite de la police, cette branche si importante de l'administration et qui , à elle seule , entraîne tant de détails que tout le zèle des syndics n'y peut suffire. Un concours plus actif de la part de leurs collègues leur est ici absolument nécessaire, si l'on veut que rien ne demeure en souffrance. Il sera facile de donner à chacun d'eux une portion de surveillance à exercer. Ainsi, tandis que les uns auront, sous leur inspection, les boucheries, le marché au poisson, les boulangers (2) , les autres tiendront la main à l'exécution des règlements relatifs à la taxe des raisins et au débit du vin ; à l'achat comme à la vente des grains et autres denrées sur la place publique ; à l'étalonnage des poids et mesures , etc., etc. Toutefois, ce n'est que successivement et sans s'écarter de sa ligne ordinaire de prudence que le conseil adopte ces améliorations ( 3).
(1) Attendentes quod universitas Sistarici seu consilium ejusdem stare non potest.... sine aliquo clavario qui pecuniam dicti consilii recipiat et opportunis loco et temporibus restituat et assignet.... 1356 17 avril . Reg. des délibér.
(2) Fuit ordinatum quod Petrus de Celeone et Petrus Botarelli inspiciant carnes et pisces in quibus detur plena fides de actis et gestis per eos, utrumque ipsorum in premissis . 1357. 29 avril. Reg. des délibér. Item ordinaverunt et constituerunt impectores (alias , regardiatores , regardeurs ) carnium recentarum salsarum et piscium , oleorum et ponderatores panis vendentis .... 1392. – 15 août. Reg. des délibér.
(3) Item elegerunt.... allegalatorem ponderum quorumcumque et balansarum , Dominicum Bansini argenterium de Sistarico.... Item elegerunt et ordinaverunt allegalatorem mensurarum et eminarum quarumcumque , videlicet annone, civate, ceterorum bladorum , salis, gippi , calcis , grossis et menutis , Antonium de Ste Michaële fusterium .... 1392 15 août. Reg. des délibér. 15 Item elegerunt correterios hujus civitatis ad vinum vendi faciendum et alias res venales , Antonium Egidii et Ant. Johannis.... 1425. août. Reg. idem.
Le premier objet qui, tous les ans, après leur installation, appelle ordinairement l'attention des nouveaux magistrats , c'est la police rurale. Mais qui croirait que pour faire respecter les fruits de la terre il n'y eut d'abord qu'à s'en rapporter, sur ce point, à la foi du serment ? C'est pourtant sur cette unique garantie, remarquable naïveté sociale, que reposent les premières délibérations du conseil , notamment celle du 28 juillet 1343. Il y est dit que tous les habitants, sans distinction, même les femmes de mauvaise vie , inhoneste, jureront de ne porter personnellement aucun dommage aux propriétés d'autrui, et, en outre, de dénoncer, sans ménagement, tous les délits de ce genre qui viendraient à leur connaissance , sous peine de cinq sols d'amende . Plus tard , il est vrai , ces mesures deviennent insuffiantes ; il faut leur en substituer de plus efficaccs . A cet effet, des agents spéciaux sont chargés moyennant salaire, de veiller à la garde du territoire (1). Les contraventions sont sévèrement punies, et les pères
(1) Ces gardes , d'abord au nombre de seize , pris également dans chaque quartier de la ville , et successivement réduits à dix et à huit , recevaient deux deniers ou un patac de chaque propriétaire de vigne. ( 1389 - 21 août. Reg. des délibér. - 1391. - 16 août. Reg. idem.)
et mères répondent , en pareil cas , pour leurs enfants (1) . Une exclusion rigoureuse frappe les bestiaux étrangers qui tenteraient de s'introduire dans les terres de la communauté (2). Tout propriétaire est dans l'obligation de détruire par le feu, les chenilles qui dévorent ses arbres (3), à défaut de quoi, libre au premier venu de couper et d'emporter les arbres qui, passé le mois de janvier, ne seront point nettoyés (4). Chaque habitant, le long de ses propriétés, doit pourvoir à la viabilité des communications vicinales (5). Pour ce qui est de la police intérieure de la ville, on remarque les dispositions prises à l'égard des cabarets. L'entrée n'y est permise qu'autant qu'il n'y a point de feu pour la commodité de ceux qui les fréquentent, car on ne doit s'y arrêter qu'en passant, uniquement pour boire ou prendre quelques aliments, et nullement pour s'y livrer à d'autres distractions (6) .
(1) 1385.
(2) 1393. - 13 avril. Reg. des délibér. - 13 octobre. Reg. id.
(3) Ardere et cremare chanilhas de arboribus possessionum suarum.... 1399.- 30 décembre. Reg. id.
(4) Sit cuilibet permissum tales arbores scindere omnino et portare quò voluerit sine prejudicio aliquali.... 1453, 27 octobre. Reg. id.
(5) 1391. - 16 août. Reg. id.
(6) Item quod nulla persona dicte civitatis in tabernis ad calefacien- dum bibitores et bibitrices...... ignem facere presumat...... Item quod nulla persona in tabernis conveniens ad vina bibenda vel emenda ad folancas hujus modi sive ignem ad se calefaciendum accedere et inibistare presumat.... nisi dumtaxat pro coquendo eo quod in dicta taberna esset comestura.
Les filles publiques sont particulièrement tenues de ne pas séjourner dans les cabarets (1) Il est défendu de transporter à découvert , d'une maison à l'autre, de la braise ou des tisons enflammés (2), d'entasser des balayures et des immondices dans les rues (3), et de mener les chiens autrement qu'en lesse, même à la chasse (4). A chacune de ces contraventions sont attachées diverses peines pécuniaires depuis un gros jusqu'à cinq sols. Le porc, que la police condamne a ne point quitter sa loge, est traité avec plus de sévérité encore : s'il est trouvé errant dans la ville et y causant du dommage,
(1 ) Item prohibitum fuerit mulieres inhonestas stare et presentare in tabernis de nocte et de die nisi dumtaxat pro vino accipiendo vel bibendo extra tabernam , quo accepto et bibito incontinenti recedere teneantur.... ( Délibér. du 20 février 1343. ) Au nombre des progrès dont la civilisation fut redevable aux croisades , il faut compter l'établissement des auberges. Ce ne furent d'abord que de simples asiles pour les étrangers. Du temps de St. Louis encore, nul n'était reçu « à faire demeure en taverne, se il n'estoyt trespassant ou il n'avoyt aucune mansion en la ville. » ( Ordonnances du Louvre , tom. 1 , p 74. ) Depuis , ces maisons s'ouvrirent insensiblement pour les habitants du pays ; mais l'influence d'une telle innovation sur les mœurs et les habitudes de la vie, imposa de nouveaux devoirs à l'administration , qui dut sentir , de bonne heure , la nécessité d'entourer les cabarets d'une surveillance spéciale.
(2) 1419. Août. Reg. des délibér.
(3) Bordilhas et immundicias. - 1428. - 8 octobre. Reg. id.
(4) 1435.- 30 août. Reg. id.
on peut le tuer impunément, moyennant qu'une pièce de monnaie soit déposée dans l'oreille de la victime (1) . Pendant la tenue des foires où toute personne étrangère, hors les voleurs et les meurtriers, peut venir en sûreté, un local particulier est assigné à chaque sorte de marchandises. Il en est de même pour les diverses espèces de bestiaux, et malheur à celui qui exposerait des animaux malades en vente ; car, il ne s'en tirerait pas à moins de la confiscation et de cent livres d'amende. Les marchands de la ville sont eux-mêmes obligés d'abandonner leurs boutiques pour se conformer au règlement. La nuit, la ville est éclairée au moyen de lumières placées de deux en deux maisons. Les denrées doivent rester à leur prix ordinaire, et défense est faite aux hôteliers de profiter de ces moments d'affluence pour les renchérir ( 1356. – 13 août ) (2) . Rien, on le voit , n'échappe à la sollicitude municipale ; mais le conseil a maintenant à traverser de bien mauvais jours, de ces jours d'épreuves où il n'y a de refuge que dans le patriotisme. Heureusement, ce noble sentiment ne saurait lui faire défaut pas plus qu'au reste de ses concitoyens dont il ne tient le
(1) Cuilibet sit permissum dum tales porcos facientes dampnum reperient, interficere illos et denarium unum ponere in auriculâ, libere et impune ,absque aliquâ penâ... 1392. – 19 août . Reg. id.
(2) Voir aussi Reg. des délibér. 1391. 16 août , et 1401. 19 août
pouvoir qu'à charge d'en user pour l'honneur et l'utilité du pays. Au printemps de l'an 1357, l'épouvante se répand tout-à-coup dans la ville. Après avoir rançonné le pape dans Avignon, l'archiprêtre Cervole, à la tête d'une nuée de bandits, s'est dirigé vers la Haute- Provence, où déjà il a envahi plusieurs châteaux, aux portes même de Sisteron (1). Le salut de la ville est au prix d'un sacrifice immense. Il s'agit de la destruction des faubourgs ; mesure désespérée qui va laisser sans asile une partie des habitants. Quelque dure que soit cette nécessité, elle est subie sans murmure. L'évêque seul fait entendre quelques plaintes inopportunes au sujet de certains droits assis sur les édifices condamnés à la démolition. Mais il est obligé de se résigner à la loi commune (2) .
(1) Arnault de Cervole , surnommé l'archiprêtre , était un gentilhomme du Périgord , échappé au carnage de Poitiers. ( Baluz. Vit. papar. Avenion. tom. 1. p. 334. – Odoric. Raynald. Annal. eccles. tom. xvI . an 1357 , nos 3 et 4. ) En ce temps mesme, dit Froissart ( vol. 1. ch. 177. p. 205. ) vint un chevalier qu'on clamoit messire Arnault de Canolle ( sic ) et communément dict l'archepestre, une grande compaignie de gens d'armes assemblés de tous pays, qui veirent leurs soudes faillies , puisque le roi de France estoyt pris. Si ne savoient gagner en France , si allèrent premièrement devers Provence et y prindrent plusieurs fortes villes et forts chasteaux , et dérobèrent tout le pays , jusques en Avignon et n'avoyent autre chef , ne capitaine fors le chevalier archipretre. »
(2) Lettr. de la reine Jeanne du 20 octobre 1359. Liv. vert. fo 18. L'évêque, qui était prince de Lurs , résidait habituellement dans ce château. Il ne venait à Sisteron qu'accidentellement et certains jours de fête , où il y avait pour lui obligation d'officier dans sa cathédrale. Mais il n'eut jamais aucune autorité temporelle dans la ville. En 1425 , l'évêque Robert Dufour ayant employé dans une de ses lettres aux syndics , l'expression , civitas nostra , une main contemporaine écrivit en marge du Livre vert où cette lettre est insérée : « Non est vestrum , pater reverende , civitas ; est regis et comitis ; spiritualitas est vestra. » ( Liv. vert. fº 96. )
Le surcroît de population que ce déplorable événement amène dans la ville, y est accueilli avec un touchant intérêt. L'administration pourvoit, de son mieux, à loger les nouveaux venus, chacun eu égard à sa condition. Mais le péril, qui va toujours croissant, augmente aussi l'effroi . La situation est des plus critiques ; et afin que d'imprudentes manifestations ne viennent point l'aggraver encore, en trahissant tout ce qu'il y a d'émotion et de faiblesse au fond des cœurs , une peine terrible qui n'épargne ni l'âge , ni le sexe , est décernée contre ceux qui , en cas de siége, laisseraient échapper des cris d'alarme. Il n'y a pour eux d'alternative, qu'entre payer une amende de vingt-cinq livres, ou avoir la langue coupée ( 1 ). Une autre fois et dans une circonstance analogue, une peine non moins redoutable ( cent marcs d'argent fin, ou à défaut, la perte du pied ou de la main ) est
( 1 ) Quod preconisetur universitatis nomine , in locis solitis Sistarici , quod nulla persona cujuscumque sit conditionis , homines vel mulieres , pueri vel infantes non audeant clamare , seu clamorem facere si contingeret civitatem nostram invadere, seu in obsessum tenere et hoc sub pena lingue vel xxv Libr. ( Délibér, du 18 mars 1357 ou 1358 , ( N. S. ) L'année commençait alors à Pâque, qui tomba , cette année là , le 9 avril. )
portée contre ceux qui refuseraient de monter la garde , ou qui abandonneraient leur poste avant d'en avoir reçu l'ordre ( 1 ). Nous n'avons point à examiner, encore moins à justifier la rigueur des dispositions prises ici par le conseil . Nous ne voulons que constater son pouvoir, en montrant jusqu'à quel point il a la faculté de l'étendre, et cela, sans sortir de son droit, puisquele bailli, loin de s'y opposer, s'empresse d'attacher le mandement exécutoire à la peine statuée par l'autorité municipale (2). La même énergie que le conseil met dans l'usage de son pouvoir , il la porte dans la défense de ses droits. Il faut voir avec quelle sollicitude il veille à leur maintien. C'est surtout contre les entreprises des
(1) Item fuit ordinatum qued preconisetur quod quilibet ad pri mum mandatum vadat ad suam logam et ipsam non deserat pro aliquo , nisi haberet in mandatis, et hoc sub pena centum marcharum argenti fini , et si solvere non posset , amittat manum vel pedem et hoc de presenti . ( Délibération du 5 juin 1368. )
(2) Mandamentum est dominorum nostrorum regis et regine et ejus bajuli quod..... ( 1357. Reg. des délibér. ) Toute peine, pour être exécutoire, avait besoin de l'attache du bailli, qui la donnait sur la demande du conseil. Cette demande était conçue en ces termes : «Nobilitati et prudencie domini.... bajuli regi preconizari facere dignetur per dictam civitatem. » La publication faite , le trompette et le notaire du conseil qui l'accompagnait , en faisaient la relation au bailli , en présence de deux témoins : « Qui dictus preco una mecum infra scripto notario eunti et paulo post redeunti retulimus dicto domino bajulo , in presen tia..... predicta omnia publice divulgata fuisse per dictum preconem , per civitatem Sistarici et castrum de Balma ut supra habuit in mandatis . « ( 1343, 20 septembre. Reg. des délibér . )
officiers royaux qu'il a à se prémunir; car ces agents sont envers la commune dans un état d'hostilité permanente. Ils ne peuvent lui pardonner des priviléges qui les enferment dans un cercle d'attributions trop bien définies, pour permettre à leurs petites passions d'en sortir impunément. Ces officiers, qui sont au nombre de cinq, savoir : le bailli , le juge , le notaire, le clavaire et le sous-viguier composent ce qu'on appelle la cour royale. Tous doivent être étrangers au pays (1) ; ils ne peuvent même y être mariés ; ils sont renouvelés tous les ans (2) ; en cas d'absence, il leur est permis d'avoir des lieutenants (3) , mais ils ne doivent se faire remplacer que par des personnes d'un rang égal au leur, et qui, comme eux, ne soient ni de la ville, ni du bailliage (4) ; il leur est défendu d'acheter leur emploi (5), et le bailli, ainsi que le juge ne sont installés qu'après avoir fourni une caution par devant la chambre des comptes (6). En entrant en fonctions , ils jurent d'observer les priviléges de la
(1) 1212. Nones de février. Chart. de Guillaume de Sabran. 1388 , 6 août. Chart. orig. en parch.
(2) 1391.6 septembre. - Lettr. de la reine Marie , en orig. , et Liv. vert , fo 66.
(3) 1377. 20 novembre , Liv. vert , fº 81. v.
(4) Ibid. fo 83 .
(5) 1379.15 juillet. Pièce orig. - 1427.- 28 octobre. Pièce id. 440. 3 mai , Reg. des délibér.
(6) 1455. 11 juin. Lettr. du sénéch.
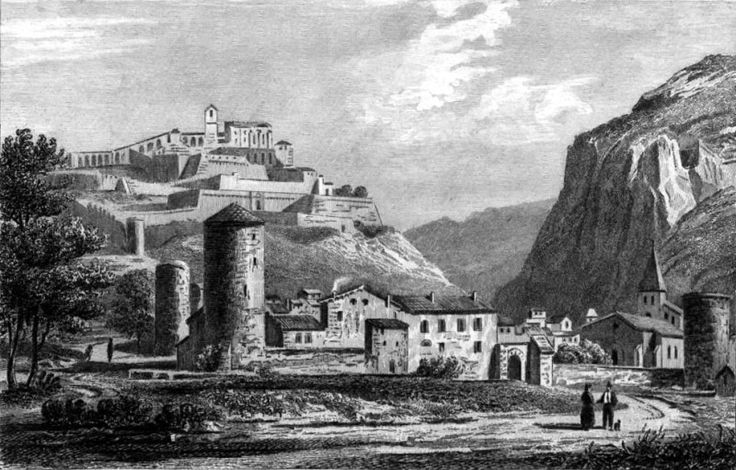
communauté (1) et, à la fin de leur charge, ils sont tenus de faire leur syndicat, c'est-à-dire, de demeurer quinze jours dans la ville, afin que si, pendant l'année de leur exercice ils ont donné lieu à quelque plainte, ils puissent être poursuivis (2). Enfin, il leur est interdit de faire partie du corps municipal (3) . Telles sont les limites tracées autour des agents du pouvoir, limites dans lesquelles il faut bien qu'ils se renferment ; car, outre que leur devoir les y oblige, la royauté qu'ils représentent et dont ils prétendent maintenir les droits, ne consent point à couvrir de son nom leurs empiétements. Elle entend trop bien ses intérêts , pour ne point apprécier tout ce qu'il y a de haute sagesse dans l'institution municipale et pour ne pas respecter en elle une des bases de son autorité : aussi, entreses délégués et la commune, toutes les fois qu'il y a conflit, il est presque sans exemple que ceux-là ne soient déboutés de leurs prétentions (4), et afin même d'éviter qu'ils ne les renouvellent, ils sont,
(1) 1380. - 23 février. Pièce orig. - 1386 – 29 juillet. Privil. de la reine Marie , en orig. et Livr . vert, fo 59 .
(2) 1387-12 septembre. Liv. vert. fº 80 vº.
(3) 1440-29 mars. Reg . des délibér .
(4) Voir notamment : Lettre du sénéchal , contre les agents subalternes de la cour qui refusent de contribuer aux tailles, du 30 juin 1349. Livr . vert. f 36 - Id. contre ceux qui troublent l'élection consulaire, 3 janv. 1354, id. f° 43-44.- Id. contre le juge qui conteste àla communauté le droit de nommer des officiers dans les fiefs qu'elle possède , 27 juillet 1381 , orig. en parch. Id. contre le clavaire et le sous-viguier , 1408 , 21 janv. Liv. vert , fo 92. - 1411 , 27 fév.
le cas échéant , condamnés à une amende de cent livres de couronnats ( 1 ). Cette peine pourtant n'a guère d'autre effet que de rendre les officiers royaux plus adroits à trouver des biais pour y échapper. Rarement ils manquent de protester de leur respect , on pourrait dire de leur amour pour les libertés qu'on les empêche de violer (2). Plus les temps sont difficiles, plus ils les regardent comme propres à favoriser leurs tentatives. Ainsi , lorsqu'en 1347 , le pays est vivement agité, par suite de la mort tragique d'André de Hongrie, premier mari de la reine Jeanne, le bailli et le juge s'ingèrent de leur autorité privée, d'indiquer à Sisteron, une montre de troupes, mesure nécessaire peut-être , et que les circonstances ne permettent pas de différer. Mais , outre qu'il y a ici excès de pouvoir de la part de ces officiers, les franchises communales n'admettent pas l'introduction de milices étrangères, et le conseil ne saurait y consentir ; car , pour lui, il n'y a pas de plus grand péril que celui qui menace les priviléges
(1) Liv. vert , fo 84 .
(2) Et dicti Dominus Bajulus et judex responderunt quod non in- tendunt propter aliqua dicta , vel facta , dicenda vel facienda aliquod prejudicium generari dicte universitati nec singularibus personis ejus- dem , nec in aliquo derogare privilegiis statutis , conventionibus , libertatibus , seu immunitatibus dicte universitatis ..... nec ipsa statuta , conventiones , privilegia , libertates , franchesias et immunitates , prop- terea dicte universitati diminuere cassare vel annulare , sed potius ipsas , pro viribus , dicte universitati defendere et tueri , pro posse corum . 1347-6 juillet. Reg. des délibér.
.dont le dépôt lui est confié. D'ailleurs, le danger fût-il plus pressant encore qu'il ne l'est réellement, de quel droit, le bailli et le juge prétendent-ils seuls le conjurer ? Est-ce que la défense du pays ne regarde pas également le conseil ? n'est-ce pas lui qui se ligue avec les villes voisines, et qui, dans l'intérêt commun, juge de l'opportunité de ces associations, les accepte ou les refuse , suivant qu'il y voit plus ou moins de convenance et d'utilité (1) ? n'est-ce pas lui qui , placé à la tête des communautés du bailliage, participe aux conseils de guerre (2), traite avec l'ennemi , pour le rachat des forteresses dont celui-ci s'est emparé (3) ; concourt avec les barons et les nobles à l'élection du chef militaire (4) ? n'est-ce pas lui qui , pour la sûreté particulière de la ville, nomme le capitaine du guet (5) et les connétables de quartiers (6), lève sa bannière , dispose des bombardes (7) ; ordonne les gardes, de jour et de nuit (8), loue des compagnies de brigands , les passe en revue , conjointement avec
(1) 1357– 20 août. Reg. des délibér. -1392 - 12 sept. Reg. Id. - 1394-8 avril . Reg. Id.
(2) 1375-27 avril. Reg. des délibér .
(3) 1391-20 juin - 28 août - 7 octob. - 16 févr. 1392 17 avril. Reg. id.
(4) 1359 - Liv. vert , fo 41. Ibid. 8 novemb. fo 42.
(5) 1399-14 oct. id. f° 66 .
(6) Item ordinaverunt de novo conestabulos carteriorum civitatis Sistarici et in quolibet ipsorum. 1393 - 17 octob . Reg. des délibér .
(7) 1385-19 mai. Reg. id. Les bombardes étaient de gros canons.
(8) 1359-23 juin et 8 nov. Liv. vert , fo 41-42.
le bailli (1 ) ; règle le temps et les obligations du service de ces mercenaires et pourvoit à leur solde (2) ? n'est-ce pas lui enfin qui garde les clefs de la ville et en dispose (3) ? C'est là , sans doute , un grand pouvoir , on dirait presque une puissance. Mais en est-il de plus légitime? Et ce pouvoir n'est-il pas comme inhérent aux entrailles même de la cité ? Toutes les fois que la discussion au conseil doit s'ouvrir sur des matières un peu importantes , il est rare que des notables de la ville ne viennent y prendre part. Ce sont des membres adjoints , adjuncti (4) , et le nombre en est quelquefois considérable. Il y a pour ces citoyens obligation de se rendre aux séances , dès qu'ils en ont reçu la notification ; et de peur que , par oubli ou autrement, ils ne s'éloignent de la ville, les jours de convocation, la consigne est donnée aux portes de leur rappeler le devoir qu'ils ont à remplir (5).
(1) 1368-9 juin. Reg. des délibér. Les brigands tiraient , on le sait , leur nom d'une sorte de vêtement à l'usage des gens de guerre , appelé Brigandine.
(2) 1357-12 octob. Reg. des délibér .
(3) 1357 - 4 août. Reg. des délibér. -1408-19 nov. orig. en parch.
(4) Adjunctis pluribus aliis.... Multis aliis ..... 1357. Reg. des délib. Passim.
(5) Predicti domini consiliarii congregati.... ordinaverunt de licen- ciâ quo suprà quod Dominus Jacobus Arpilhe syndicus capiat et habere debeat de quolibet portali unam clavem et quod non aperiantur donec subscripti citati comparuerint in consilio pro consulendo et ordinando quid agendum. 1393-22 août. Reg. des délib .
Indépendamment du conseil ordinaire et du conseil renforcé de membres adjoints , existent toujours ces assemblées générales où , dans les grandes occasions, sont appelés tous ceux qui , ayant feu et lieu , larem foventes jouissent de l'imprescriptible droit d'intervenir dans les affaires de la communauté. Nul même ne doit en négliger l'exercice, car à chaque manquement est attachée la peine de cinq sols d'amende (1 ). Plus le conseil est obligé de mettre de soins à défendre ses priviléges, plus il sent la nécessité de veiller à ce qu'aucun titre ne s'égare. A cet effet , il ordonne la transcription , dans un registre particulier, de toutes les pièces importantes dont les originaux existent aux archives. L'exécution de ce travail est confiée à l'organiste de la cathédrale, Maître Guillaume Chambon ( 1364). Il ne saurait être en meilleures mains ; car, nul n'est plus expert en calligraphie. Sous sa plume remarquable par le fini de ces beaux caractères , dits de forme, s'élève bientôt un monument digne de son objet. Tout ce qui intéresse les libertés
( 1 ) Item prenominati domini consiliarii , una cum eis adjunctis..... ordinaverunt pro causis predictis notificandum fore , citandum et convocandum omnem populum dicte universitatis Sistarici majorem partem et voce preconia , et inde prenominatus vice bajulus et capitaneus precepit Johanni Eyssarici nuncio.... quatenus preconizet mox per dictam civitatem quod omnis caput hospitii cras mane veniat ad palacium regium in consilio , sub penâ quinque solidorum , auditurum que sunt preposituri syndici dicte civitatis et alias ad consulendum . 1393-19 janv. Reg. des délibér.
publiques se trouve maintenant réuni en un seul cartulaire. C'est le code de la patrie ; code précieux, destiné à servir, d'âge en âge, au gouvernement de la cité, et qui, au jour encore où ces mêmes libertés dont il est le dépositaire ne seront plus , les recommandera au souvenir et aux regrets peut-être de la postérité (1) . Si, sous le rapport calligraphique, le Livre vert ne laisse rien à désirer, il n'en est pas de même pour ce qui est de la correction et de la disposition des documents qu'il renferme. On admire, sans doute, ce Recueil des priviléges. Chacun est fier de savoir que là sont consacrés tous ses droits. Mais ce livre, ce chef-d'œuvre de l'art, ce monument de patriotisme, nul ne se soucie de le lire, rebuté qu'il est, par
(1) On peut encore aujourd'hui, après un laps de cinq siècles, apprécier toute la beauté de l'écriture de Chambon , tant elle a conservé de fraîcheur et d'éclat. Nous ignorons le temps que le copiste mit à cette transcription. Mais on trouve, dans les comptes du clavaire de l'année 1365, la somme de neuf flor. dix sols ( environ 80 fr. de notre monvaie ), payée pour le travail et l'achat du vélin, employés au livre desp riviléges. On lit encore, sous l'année 1405, qu'une reliure en bois , recouverte d'une peau de mouton peinte en vert , fut exécutée par Raymond Olivier, dominicain de la Baume, au prix d'un florin, pro ligatione et copertura Libri privilegiorum. Mais, avant cette époque, le recueil des priviléges était déjà connu sous le nom de Livre vert. Ce n'est donc, ici, qu'une seconde reliure nécessitée sans doute, par l'adjonction de nouvelles pièces survenues depuis le travail de Chambon. Il est étonnant que pour la reliure actuelle, qui est toute récente, on n'ait pas eu, comme frère Olivier, l'attention de conserver au Livre vert sa couleur primitive, afin de continuer à mettre d'accord la couverture et le titre, et de ne pas détourner ainsi la trace de cette origine.
le défaut d'ordre qui y règne et qui en rend la lecture fatigante : cette négligence est grave de la part des membres de l'administration , auxquels il importe de ne rien ignorer de ce qui concerne les libertés du pays. Pour y obvier, le conseil arrête qu'il sera immédiatement procédé à la rédaction d'une table raisonnée des matières, pour être jointe au Livre vert (1), et qu'en outre, afin de répandre , autant que possible , la connaisssance des priviléges parmi les citoyens, un double de cette table sera affichée, en placard, sur les murs du palais (2) . Chaque année, un gardien spécial est donné au Livre vert. Le dépositaire est ordinairement un jurisconsulte et l'un des hommes les plus éclairés du conseil (3). Ce recueil acquiert bientôt une grande autorité. On voit le juge s'en servir pour appuyer ses décisions (4). Toutefois, il y a encore de l'obscurité dans quelques-unes de ses parties. Mais quel texte, si précis qu'il soit, peut se dire hors du domaine de la controverse ? Y a-t-il rien qui ne cède à la torture interprétative ? C'est là , on le sait , la pâture des esprits faux. Un texte auquel ils s'attachent, n'est-ce pas
(1) 1387-1er octob. Liv. vert , fo 56 vº.
(2) Quinze sols huit deniers payés à celui qui a placé : tabulam pri- vilegiorum in pariete curie, murando, collando et clavellando. Compt. du clavaire Jean Giraud , an 1388 .
(3) 1389 - 21 août. Reg. des délib. 1566-25 mars . Reg. id. 1392 - 15 août. Reg. id.
(4) 1387-14 décembre. Liv. vert , fo 85.
comme la feuille de l'arbre pour l'insecte ? Tout en se résignant à cette nécessité de l'humaine faiblesse, le conseil croit de son devoir d'opposer de nouvelles barrières aux envahissements de la chicane. Six personnes de la ville, des plus recommandables par leurs lumières et par leur probité, sont désignées par lui, à l'effet de rechercher dans le livre des priviléges, les passages douteux, les expressions ambiguës, pour en faire le sujet d'un mémoire à présenter au roi et obtenir de sa sagesse tous les éclaircissements nécessaires (1). A mesure que nous avançons , l'ordre et la régularité règnent de plus en plus dans les diverses branches de l'administration. On dirait qu'il n'y a plus de place pour les abus. L'erreur même ne saurait subsister ; car , le conseil a pour principe qu'il n'y a point à rougir de reconnaître ses fautes et de les réparer, lorsque surtout, la liberté peut en souffrir, « la liberté , ce trésor inestimable , incomparablement plus précieux que l'or (2). » Maintenant, la tenue des registres est admirable. Rien n'y manque. Pendant que les délibérations du conseil , écrites, pour ainsi dire, à la lueur des flammes qui dévorent une partie du bailliage , semblent tout sacrifier aux préoccupations d'une guerre locale , guerre peu connue et où ,
(1) 1399 12 sept. Reg. des délib .
(2) Cum nulli pudere debeat etiam suum errorem corrigere , cumque libertas sit auro incomparabilis . 1348 -22 décemb. Reg. id.
par un concours de circonstances fatales, viennent dans un but commun de pillage, se rencontrer aux portes mêmes de Sisteron, et les bandes de Raymond de Turenne et les débris d'une armée battue en Piémont, sous les ordres du comte d'Armagnac ( 1391 ), il y a , disons-nous , pendant et nonobstant la confusion de cette terrible époque , des registres particuliers pour tout ce qui a trait aux affaires litigieuses . Quelques nouvelles dispositions introduites dans les règlements , nous apprennent que le clavaire devra présenter, chaque mois, l'état de sa caisse (1 ) et tenir ses comptes à double (2) ; qu'il est défendu au notaire-greffier de rédiger et de sceller des pièces officielles sans l'aveu du conseil ; que jusqu'à révocation, les ordonnances municipales sont rigoureusement exécutoires (3), et que toute mauvaise gestion de la part des syndics ou des conseillers, reconnue et dûment constatée, devra être poursuivie, sans ménagement, par leurs successeurs immédiats (4) . Tel est, jusqu'à la fin du xiv siècle , l'état du régime municipal. Le xvº y apporte de nouvelles modifications. Quelque soin qu'aient pris jusqu'ici les syndics sortant de charge, pour mettre leurs successeurs au courant des affaires qu'ils n'ont pu terminer, les intérêts
(1) 1391 – 15 août. Reg. des délibér .
(2) 1392-15 août. Reg. id.
(3) Ibid.
(4) 1390-20 janv. Chart. orig.
de la communauté ne laissent pas d'avoir quelquefois à souffrir de la transition. Cet inconvénient, on l'a reconnu , et c'est pour l'éviter , que l'on a vu, en certaines occasions, le conseil prorogé d'une année (1). Mais ce n'est là qu'un expédient, et il importe d'y pourvoir d'une manière définitive. Dans ce but, il est statué qu'à l'avenir les syndics de l'année précédente feront partie du nouveau conseil, où leur présence et leur utile coopération auront pour effet d'empêcher la tradition administrative de s'interrompre. Il est créé aussi un assesseur en titre, pris cette fois en dehors des douze conseillers existants (2). Les lettres patentes qui consacrent ces nouvelles dispositions sont, suivant l'usage, présentées par les syndics au juge, pour en requérir l'exécution. Placé sur son tribunal, qui était un modeste siège en bois, et même s'il fallait s'en tenir à la rigoureuse acception des mots, une simple poutre ( trabe), le juge, à genoux, la tête découverte et inclinée pour plus de respect vers la terre, déclarait, d'un air satisfait, qu'il
(1) Ordinaverunt.... quod dicti domini consiliarii infra scripti remaneant et remanere debeant in consilio ipsius civitatis Sistarici, pro anno venturo, attentis eorum probitate, legalitate et legali gubernatione per eos factis in negociis predicte universitatis, et attentis et consideratis negociis majoribus et ponderosis hodiernis temporibus ipsi universitati occurrentibus et in manibus ipsorum dominorum consiliariorum existentium et inceptorum , et etiam attentis plenariâ notisciâ predictorum negociorum penes ipsos dominos existentium...... 1386 10 avril . Reg. des délib .
(2) 1401 - 16 avril. Liv. vert , fo 68.
était prêt à assurer, dans tout leur contenu, l'exécution des lettres qu'il faisait, à l'instant même, transcrire mot à mot dans les registres de la cour, et dont il rendait l'original aux syndics (1). Au nombre des élections municipales on trouve maintenant celle du capitaine du guet (2). On remarque également ici pour la première fois ( 1401 ), les syndics avec les habits distinctifs de leur charge (3). C'est sur leur traitement, qui est actuellement de seize florins , qu'ils sont tenus de faire cette dépense. La distinction du vêtement syndical consiste d'abord, à ce qu'il paraît, dans la fourrure (4) ; puis, c'est dans le chaperon mi-parti de deux couleurs, à l'instar de celui qu'ont adopté l'assesseur et les syndics de la ville d'Aix (5). Plus tard enfin, lorsque des troubles graves menacent d'éclater, nous voyons les consuls, qui
(1) Pro tribunali sedente.... hilari vultu , capite discoperto , genibus flexis ..... inclinato capite versus terram pro majori reverentiâ , paratum se obtulit litteras exequi et executioni demandari , nihil de contingentibus in iisdem litteris obmittendo .... presentibus opportune inspectis remanentibus presentanti. Liv. vert. passim.
(2) 1405 - 15 août. Reg. des délibér .
(3) Pro raupis seu libratâ dominorum syndicorum. 1402 16 juin - Raupas Livreye - 1439 - 15 août. Reg. des deliber.
(4) Pro folratura vestium syndicatûs. Compt. du clav. de l'année 1436.
(5) Capucia fieri facere bispartita , videlicet de duobus pannis duorum colorum que admodum faciunt assessor et syndici civitatis aquensis - 1465. Cette disposition semble indiquer l'époque où le chaperon remplacé par le bonnet ou le chapeau commence à se rabattre sur les épaules et n'est plus qu'une marque purement honorifique. ( Pasquier , Rech, de la France , tom. 2. )
alors ont remplacé les syndics, décourre la ville, revêtus du chaperon de velours noir, doublé de satin rouge (1 ). Déjà un siècle s'est écoulé, depuis que la constitution actuelle régit la commune. Limitée d'abord, ainsi qu'on peut se le rappeler, à une durée de quatre ans, cette constitution a été constamment prorogée depuis (2). Toutefois il semble au conseil que par les progrès du temps , les bases de son organisation sont devenues un peu étroites. Il se propose de les élargir. A cet effet, il sollicite auprès du roi René, alors à Naples ( 1439 ) , l'autorisation d'élever le nombre des conseillers à quarante. Cette demande ayant été accueillie, il soumet le nouveau projet à l'assemblée générale des chefs de maison , qui l'adopte unanimement et charge le conseil lui-même de faire la nomination, pensant qu'il s'en acquittera d'autant mieux que , par des informations préalables, il a eu soin de s'assurer de la capacité des éligibles . En conséquence, après avoir invoqué le nom de Dieu , fait le signe de la croix et juré sur les Saints
(1) 1562-30 mars. Reg. des délib. Le chaperon , tel qu'il est ici décrit a subsisté jusqu'au moment où la révolution de 89 n'admit plus pour distinction municipale que l'écharpe tricolore.
(2) Savoir: en 1338, pour quatre ans; en 1343, par le grand sénéchal, au nom de la reine Jeanne , qui venait de succéder au roi Robert , son aïeul , pour un an ; en 1344 , pour quatre ans ; en 1348 , pour huit ans . Reg. des délib . En 1360 et 1378, pour dix ans. Liv. vert, fos 44 et 65.
Évangiles d'agir avec conscience et loyauté, le conseil procède au choix de douze citoyens probes, intelligents et qu'entourent l'estime et la considération publiques . Trois, suivant la coutume, sont pris dans chaque quartier, et également parmi les nobles, les bourgeois, les artisans et les laboureurs. Ce noyau ainsi formé, s'accroît par l'adjonction de quatre membres retenus du conseil sortant, puis se complète jusqu'au nombre de quarante. Mais à peine terminée, l'élection donne lieu à une réclamation. Une des nominations est signalée comme faite en violation de l'article du règlement qui ne veut pas que le beau-père et le gendre, pas plus que le père et le fils , ou deux frères puissent siéger au même conseil . L'erreur est effectivement reconnue, et à l'instant même réparée (1) .
(1) Quod ordinetur per consilium modernum in concilio proximo faciendo de quolibet carterio, tres probi homines , prudentes , sagaces, boneque conscientie et fame , ac capaces et habiles ad sanè consultandum... qui erunt in numero duodecim ... qui quidem duodecim probi homines cum quatuor ordinandis de consilio moderno debeant ordinare benè , ut dictum est , et stare residuum dictorum quadraginta consiliariorum de quibus eligere debeant nobiles , burgenses , artistas et laboratores.... Eorum mediis juramentis ad santa Dei evangelia manibus ipsorum corporaliter tactis de benè servire et legitimè ordinare et ordinaverunt, Dei nomine invocato, munientes se signaculo sante crucis dicentes : in nomine patris , etc .. juxtâ commissionem eis datam , ordinaverunt et observari voluerunt pro bono statu dicte reypublice , quod ipsi duodecim electi , in exigendâ residuâ quantitate non ponant aliquem filium , fratrem sive generum ipsorum consiliariorum jam electorum et eligendorum stantibus simul , vel separatim . juillet, 1er et 15 août. Reg. des délibér . 1440-22.
Jusqu'ici ( 1482 ), le renouvellement du conseil a eu lieu, chaque année, le 15 du mois d'août , jour de la fête de l'Assomption. On ne sait ce qui a déterminé le choix de cette époque. Mais il est certain que sous le rapport financier elle est peu convenable. Ce n'est pas au milieu de l'année, au moment de la récolte, et lorsque commencent à peine à s'effectuer les rentrées, qu'il est possible au clavaire sortant d'arrêter ses comptes. L'impôt, malgré ses exigences, ne peut rien contre l'ordre des saisons. Il ne saurait forcer la terre à rendre, avant le temps, le fruit des sueurs qui l'ont fécondée. Il y a donc pour le conseil obligation de se plier à la même nécessité et de prendre ses mesures pour que l'année financière marche de front avec l'année administrative. D'après ces considérations , il est décidé que le renouvellement du conseil changera d'époque et que désormais il sera fixé au 25 mars (1).
La commune, depuis sa réunion à la France.
Nous voilà Français maintenant (2) Nous le sommes devenus par une transition si insensible, qu'à la bienveillance toute paternelle des nouveaux souverains, à
(1) Ne rationes clavariorum valeant inbrigare. ( Délibér . du 13 février 1482. )
(2) En vertu du testament de Charles du Maine, dernier comte de Provence, en faveur de Louis xi , à la date du 10 décembre 1481 .
leur empressement à se déclarer les protecteurs de nos libertés , on ne se douterait pas que nous avons changé de maîtres. " Chiers et bien amez, écrit Charles VIII aux syndics, conseil manants et habitants de la ville de Sisteron, immédiatement après la mort du roi son père, Chiers et bien amez, nous avons présentement sceu le trespassement de feu nostre trés chier seigneur et père que Dieu absoille , dont avons esté et sommes si trés desplaisans que plus ne pourrions, et pour ce que depuis que la conté de Prouvence a esté réduicte en nostre obeyssance et à la coronne de France avez gardé si bonne ferme et entierre loyaulté à nostre dict feu seigneur et père qu'en estes dignes de louable recommandation et y devons bien avoir et prendre singulière confiance , nous vous avons bien voulu advertir dudict cas, en vous priant que veuilliez bien garder et continuer envers nous la bonne loyaulté que avez gardée envers mon dict feu seigneur et père ; et tenez vous certains que nous sommes délibérez de vous garder et entretenir en bonne justice, aussi en vos droicts, privilleges et en tant que pourrions doresnavant, vous relever et soulager vous et nostre peuple de patie des charges que avez pourtées et soustenues le temps passé et en toutes choses vous tenir si bons et favorables termes que reconnaisserez par effect l'amour et affection que desirons avoir à vous et en manière que chascun selon son état et vocation pourra vivre soubz nous, en seure paix, repos et tranquillité, et toujours vous aurons en espécialle et singulière affection, comme nos bons , vrays et loyaultz, ainsi que de brief avons entenction vous rescripre plus à plain. Donné à Amboise , le premier jour de septembre ( 1483 ). Charles ( 1) . » Louis XII , on le pense bien, ne pouvait manquer , lui aussi , d'attacher son nom à la reconnaissance de nos priviléges (2). Nous montrerons même , ailleurs , que cet excellent prince ne borna point là sa sollicitude, et nous dirons par quels bienfaits il mérita, auprès du peuple de Sisteron, le glorieux surnom qui recommande sa mémoire. François 1er monte sur le trône le 1er janvier 1515, et le mois de son avénement ne se passe pas sans que les habitants de Sisteron reçoivent de ce monarque, des lettres confirmatives de tous les droits, franchises et immunités dont ils sont en possession de jouir. Parmi ces droits est notamment compris le consulat , nonobstant, ajoutent les lettres, l'interruption qu'il a éprouvée (3). Depuis quelques années, en effet, l'exercice des charges municipales avait été suspendu. Une lacune qui existe ici dans la suite des délibérations,
(1) Liv. vert , fo 98. vo
(2) Lettr. du 5 février 1501. Nous avons inutilement cherché cette pièce. Mais on ne saurait douter de son existence qui est constatée dans les anciens inventaires . Voy. celui de 1582. p. 103.
(3) Rouleau en parch. sac des privil.
nous empêche d'en connaître la cause (1). Tout ce que nous savons, c'est qu'un commissaire du parlement vient rétablir les choses sur l'ancien pied, à cela près, qu'à dater de ce moment les syndics changent de nom et vont désormais s'appeler consuls (2). A défaut de preuves directes contre les véritables auteurs du désordre signalé dans la charte de 1515, à voir la manière dont les officiers royaux ont su le faire tourner à leur profit, il est difficile qu'avec leurs
(1) Au milieu de ces troubles, les archives de l'hôtel de ville firent quelques pertes regrettables, et sans l'effroi salutaire qu'un monitoire fulminé, à ce sujet, par le vice-gérant d'Avignon, inspira aux spoliateurs, il est à croire que les pertes eussent été bien plus considérables. Voici comment s'exprime cette pièce, publiée sur la demande des syndics : Ut si sint qui seu que , clam , latenter , furtivè , maliciosè , occul te , aut aliàs indebite et injuste.... qui habuerint , ceperint , detinuerint , retinuerint , furati fuerint , usurpaverint , celaverint , occultaverint , occupaverint , sibi que ipsis appropriaverint , id suosque aut alios usus converterint.... Nonnulla instrumenta emptionum , transactionum , accapitorum novorum , feudorum laudimiorum........ Limitationum territoriorum diversorum et aliorum quorumdam contractuum , instrumenta , litteras , apochas , apodixas , libros rationum , quittantias , cedulas , bilhetas , tractatoriosque processus et alias quas cumque scripturas tam publicas , quam privatas , dictos dominos assessorem , syndicos et universitatem Sistaricensem , seu actorem ejusdem tangentes , seu tangentia et concernentia ..... infra decem dierum.... a die monitionis reddant et restituant ..... Alioquin precipimus quathenus omnes et singulos malefactores dictarum scripturarum ..... in vestris ecclesiis singulis diebus dominicis et festivis .... pul satis campanis , candelis accensis et ...... extinctis ac in terram provectis.... excommunicatos publicè et generaliter nuncietis..... Datum Avenione.... die vigesimâ mensis martii , 1514.
(2) 1516-24. septembre. Roul. en parch.
antécédents surtout, ces agents échappent au soupçon de n'y être pas demeurés étrangers. De tous les temps, l'administration municipale a joui , en matière civile , d'une certaine portion de juridiction. C'est elle, entr'autres, qui a constamment pourvu à la tutelle des enfants mineurs. Eh bien ! sous prétexte de l'interrègne consulaire, le juge n'a pas manqué de s'emparer de cette attribution, et la preuve que ce n'est qu'un prétexte, c'est que depuis même la réintégration de l'autorité municipale, il s'efforce de se maintenir dans son usurpation, jusqu'au moment où il faut que la rigueur vienne le contraindre à y renoncer (1). On a vu que le juge, ainsi que les autres officiers royaux ne peut, avec ses fonctions, cumuler celles de conseiller de la commune. L'exclusion maintenant va plus loin ; elle s'étend aux avocats et aux procureurs . Le croira-t-on ? les avocats et les procureurs exclus des affaires publiques ! C'est encore là un de ces traits qui confondent , par leur étrange contraste avec nos idées actuelles. Est-ce que par hasard, il n'en serait pas de la conduite des affaires publiques, comme de la conduite des affaires privées ? Est-ce que
(1) 1533, 8 novembre. Pièce orig. en parch. On voit par ce document que le consulat était en possession et saisine ancienne et récente de l'exercice de juridiction en matières civiles en première instance, et mesmement de donner tutelles et cures aux enfans mineurs de ladite ville, faire inventaires, interpositions de décrets et autres exploits en cas requis...... ne retenant la court que la matière principale et du pétitoire par devers elle.
pour bien diriger celles-là , l'expérience aurait appris qu'il y a quelque chose de mieux que les lumières et le savoir du légiste ? Ces questions pourront étonner. Aussi , quoiqu'elles se présentent ici naturellement, nous serions-nous bien gardés de les poser, si nous n'avions pour y répondre, le document même qui les a provoquées. Voici ce curieux document; c'est un édit du roi Henri II. Comme pour le désir que nous avons, dit ce prince, de veoir les villes de nostre royaume bien policées et gouvernées et les deniers communs d'icelles tellement administrez , régis et mesnaigez, qu'ils puissent suffire à l'entrétènement, réparation et fortification des dictes villes et aultres affaires nécessaires concernans l'utilité et bien publique d'icelles, avons advisé que le mieux que pourrions faire en cela est d'en laisser l'administration aux bourgeois et nobles marchans des dictes villes qui ont cognoissance , soings et cure d'administration de deniers, pour ce qui ne sont si ordinairement occupez et detenus en autres affaires que nos officiers et ministres de justice, lesquels oultre qu'ils ont leur vaccation ordinaire au fait de ladicte justice, n'ont telle cognoissance et expérience au faict et maniement de deniers et à les bien mesnager et despenser que les dicts bourgeois et marchans. Nous, à ces causes et après avoir mis cest affaire en délibération, avec les gens de nostre conseil privé, avons par leur advis, dict, statué et ordonné , disons, statuons et ordonnons, par édict , statut et ordonnance, que doresnavant, nos officiers éz courtz souveraines, jurisdictions ordinaires tant des prevostez que bailliages et sénéchaulcées et semblablement des jurisdictions extraordinaires, soit des courtz des généraulx de la justice des aydes ou des esleuz et pareillement des chambres de nos comptes et aussi tous advocatz et procureurs éz dictes jurisdictions, ne pourront estre par en aprés , promeuz en charges ou estatz de prevotz , majeurs eschevins et aultres estatz de ville , soit par voie d'ellection ou autre manière de provision, et ce, sur peyne, quant aux élizans de cents escus d'or d'amende envers nous et aultres cents escus d'amende au proffict de la dicte ville, payable par chascun des dicts élizans et oultre ce , estre privez de leur droict d'ellection ou provision qui partant nous appartiendra ou à nos successeurs roys de France, pour y celle fois, et quant à nos dicts officiers qui auront este esleuz ou prouveuz des dictes charges et » estatz et auront de faict accepté les dictes ellections et provisions, soubz peyne de privation de leurs estatz et offices royaulx dont nous les avons, en ce cas, dez a présent comme pour lors et pour lors comme dez maintenant, privez et privons de leurs dicts offices, desclarez et desclarons vaccans et impétrables sur eulx, par les dictes présentes, et quant aux advocatz et procureurs ez dictes jurisdictions qui auront, en semblable, accepté de faict les ellections ou provisions des susdictes charges et estatz , soubz peyne de cents escus d'or d'amende envers nous... Donné à Fontainebleau, au moys d'octobre 1547 (1). Atteint par cet édit , dans la personne de son assesseur qui est toujours , on le sait , un docteur ès-lois le conseil imagine de réparer cette perte par la création d'un troisième consul. Il est à remarquer que pour effectuer cette combinaison nouvelle, il croit d'abord n'avoir pas besoin d'autorisation. Puis , se ravisant, et doubtant à ce n'estre pas recepvaible sans avoir permission et lettres , il se pourvoit auprès du gouverneur de la province qui , n'y voyant aucun inconvénient, pourvu que l'édit du roy soit gardė, lui accorde l'objet de sa demande ( 1548 ) (2). Mais de graves événements se pressent. Une crise est imminente, et dans la confusion qui en est inséparable, quelle main désormais assez puissante pourra retenir, hors des affaires publiques, les hommes qu'on avait cru devoir en éloigner ? Nous avons vu les déplorables jours de la fin du xıve siècle. Alors du moins, les citoyens unis entr'eux et ne formant pour ainsi dire qu'une seule et même famille , n'eurent à se défendre que contre l'ennemi de l'extérieur. Mais, aujourd'hui que le feu des discordes religieuses a
(1) Sac des privil.
2) Ibi
pénétré dans leur sein , partout autour d'eux s'agitent d'aveugles passions. Pendant que le tumulte est dans la rue, ce qui se passe au conseil n'est malheureusement pas de nature à ramener le calme dans les esprits. Car là, au milieu des plus vives irritations, se débat la grande, l'immense question qui divise la cité, et qui bientôt doit diviser l'Europe entière. Il s'agit de l'unité chrétienne, de ce principe conservateur sur lequel depuis mille ans et plus reposent également et l'Église et l'État. La foi catholique , contre laquelle s'élèvent de nouveaux dogmes, n'est plus représentée au conseil que par la faible majorité d'une voix ( 21 contre 19 ) ( 1 ) ; indice effrayant de la lutte qui se prépare et à laquelle les deux partis se disposent, en recourant à un expédient inouï jusques là dans les fastes de la commune, et dont ils ne doivent pas offrir un second exemple ; expédient qui consiste à s'adjoindre, chacun de son côté , un certain nombre de lieutenants (2). Après avoir favorisé les novateurs, le gouvernement
(1) Mesmes maistres Raymond Chaix a dict que sy l'on faysoit payer les messes, il volloyt que la ville lui aydât à payer le ministre, à rayson de six escus par mois ; incontinent maistre Jehan Daigremont a requis acte du dire de maistre Chaix et semblablement de opinion loys Agulhenc a dict qu'il volloyt payer les messes du sien dont M. d'Allons a requis acte, sur quoy , voyant que y avoyt diversité de opinions a esté arresté cessé de prépouser desdictes messes afin que n'y vint désordre . 1562 - 30 mars. Reg. des délibér
(2) Même délibé.
dans son égoïste et perfide politique, croit qu'il n'aura qu'à parler, lorsqu'il voudra les arrêter sur la pente rapide où lui-même les a placés. Mais ses concessions ont fait de la révolte une puissance, et c'est désormais d'égal à égal qu'il faut traiter avec elle. Déjà même , il ne lui suffit plus de bouleverser l'Église. Elle ose aspirer plus haut. En attendant , elle se contente de la part qu'on lui fait dans les affaires , laissant au pouvoir ses rêves de conciliation. Il faut voir, en effet, le singulier accord qui règne dans le conseil , depuis qu'un édit a ordonné d'y introduire , en nombre égal , les partisans des nouvelles doctrines. Tant que y sera le congrefier de la religion que nous a mis le sieur de Biron (1), écrivent les catholiques, nous serons toujours en grebuge ; car , il ne respecte rien à la pluralité des voix de ceux qui » sont au conseil, et à ce que se y délibère, comme il debvoyt faire, sans escrire aultre chose, mais par la grande affection d'augmenter leur religion, quant les catholiques opinent quelque bonne chose, ceulx » de la religion , quant se voyent foible, ne font que
(1) Armand de Gontaut, baron de Biron, chevalier des ordres du Roi. On peut reconnaître , ici , la main malheureuse qui plus tard (1570) signa cette paix que son peu de succès fit appeler , boîteuse et mal assise. Biron était resté boîteux d'un coup d'arquebuse qui lui fracassa la jambe, et De Mesmes sieur de Malassise concourut avec Biron à cette vaine tentative de rapprochement entre les catholiques et les huguenots.
empescher les voix et protester contre les opinants pour atterrer le peuple. A leur tour, ceux de la religion prétendue réformée, se fondant sur les derniers édits , se plaignent de ce que maître Jehan d'Aigremont, greffier des catholiques, bien qu'il ne doive rien signer et expédier sans son collègue , maître Simon Robert, signe néanmoins et expédie journellement sans lui. Puis, il laisse, disent-ils , plusieurs choses notables et en adjoute d'autres desquelles n'a jamais esté parlé, chose fort escandaleuse et digne de grand repréhen- » sion : ajoutant que si on n'y pourvoit est fort dangereux d'esmeute et grand inconvénient (1). Mais on a beau faire. Cet inconvénient tant grand qu'il est, on ne l'évitera pas. Car, de ces deux éléments hétérogènes mis en contact, que peut-il sortir, sinon des orages ? Ce qu'il y a de plus fâcheux , c'est qu'au milieu de ces tristes démêlés, la patrie n'est plus comptée pour rien. En vain sa voix cherche à se faire entendre. Ses intérêts ! on n'y songe plus ou on les sacrifie à des préoccupations de parti. Ces libertés, dont on était si jaloux et pour le maintien desquelles naguère on eût donné sa vie, trouvent aujourd'hui une majorité toute prête à en voter l'abandon. Ainsi lorsque le gouverneur de la province exige de faire lui-même l'élection consulaire, sur une liste triple de
(1) 1564. Pièce aux arch.
candidats qui lui sera soumise, cette prétention qui anéantit en quelque sorte la commune, en lui enlevant l'élection directe pour ne lui laisser que le droit dérisoire de présentation , est accueillie par cinquante voix contre quarante-sept (1). Qu'attendre désormais de telles assemblées ? Plus elles sont nombreuses, et elles le deviennent chaque jour davantage par le désir qu'ont les partis de mesurer leurs forces , plus elles sont nombreuses, plus il y règne d'effervescence et de confusion. Les choses en viennent au point qu'il est sérieusement question de mettre à la place de ces indisciplinables cohues , un conseil général permanent, limité à soixante membres , d'où serait tiré le conseil ordinaire. Bien que faite à diverses reprises et finalement adoptée, sans discrepance aulcune , suivant les termes de la délibération (2), cette proposition n'a pas de suite. Mais peu après ( 1591 ), le parlement royal retiré alors à Sisteron , à cause des troubles de la ligue, faisant droit à la demande de quelques citoyens (3), y rend, contre
(1) 1567-23 mars. Reg. des délibér.
(2) Du 31 mars 1585.
(3) Remarquons, en passant, ce droit qu'avaient les simples citoyens de demander les réformes qui leur paraissaient nécessaires ; droit d'autant plus important qu'on n'y recourait que dans des circonstances graves. L'usage, en ce cas , était de présenter non une humble supplique , mais ce qu'on appelait un comparant , sorte de caveant consules , sur lequel l'autorité devait statuer d'urgence. C'est encore sur l'initiative prise par quelques citoyens, en dehors du conseil, que le député de la ville aux états de 1788, reçut pour mandat de demander la révocation de l'édit de 1535 ; édit funeste qui, en viciant la constitution Provençale, a privé le pays du plus beau et du plus utile de ses priviléges, celui d'élire les dépositaires de sa confiance. (Reg. des délibér. Séance du 16 décembre 1788. pag. 441. )
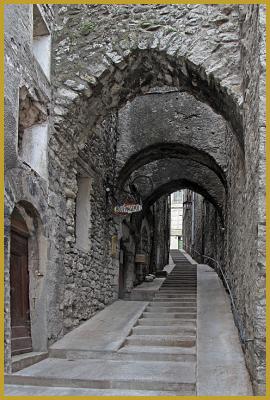
le vœu des consuls, un arrêt constitutif du nouvel état de la ville. En voici les principaux chefs. Le conseil général est réduit à quarante-huit membres, dont douze de chaque quartier, renouvelés par tiers tous les ans et pris, selon la coutume, parmi les habitants des quatre qualités, savoir : gentilhommes ou nobles, bourgeois ou marchands , artisans et laboureurs ; et comme on a enfin renoncé à la périlleuse chimère de concilier le droit et la révolte, les choix porteront à l'avenir, sur des personnes capables, catholiques, bons et fidelles subgects de Sa Majesté. Ce qui , en rétablissant le principe, rétablit aussi la paix. Deux habitants de la Baume sont appelés à représenter leurs concitoyens au conseil général, lequel est ainsi porté à cinquante. Trois consuls, un greffier, un trésorier, un capitaine du guet et huit conseillers qui auront à examiner et à clore les comptes de l'année précédente, forment le conseil ordinaire. Aucun d'eux ne doit être parent au degré de consanguinité ; mais deux beau-frères et deux cousins germains pourront être admis au conseil général. Il faut un délai de cinq ans pour la réélection des mêmes consuls, et de trois ans, pour celle des conseillers. Le greffier qui, à raison de ses fonctions, jouit d'une influence dont il abusa souvent, n'aura plus voix délibérative. Les conseillers inexacts à se rendre aux séances continuent à être passibles d'une amende, laquelle est maintenant de deux écus. En se rappelant qu'au milieu du xıv siècle, la peine décernée, en pareil cas , était de douze deniers , on peut juger dans quelle proportion le taux de l'argent s'est élevé. (1) En 1619, une innovation remarquable est introduite dans le règlement; c'est celle de l'allivrement qui devient une des conditions de l'éligibilité. On voit ensuite que les conseillers sont réduits à quatre, et qu'ils changent leurs noms en celui de députés. Dès lors aussi le conseil général s'appelle indifféremment le conseil des cinquante ou des apparens. Ainsi est régie la commune jusqu'au moment où une nouvelle et dernière réforme (1770) vient clore la série de nos révolutions municipales, de toute celles, du moins, dont nous avons entrepris l'esquisse. Dans l'intervalle, il est vrai, nos institutions ont à subir diverses atteintes . La fiscalité nous impose des offices municipaux. Elle nous vend un maire, un greffier, un procureur du roi de sa façon, enfin tout ce qu'elle peut; car, il n'est pas jusqu'au valet de ville
(1) 1591-28 juin. Reg. des délibér .
et au trompette dont les humbles fonctions ne soient élevées aux honneurs de la finance. (1) Mais tout cela , on le voit, n'est qu'affaire d'argent et ne prouve rien contre le droit , pas plus que ces édits où, sous prétexte que les élections populaires ont des inconvénients , qu'elles sont une source d'inimitiés et de divisions , et pour les incapacités ambitieuses une occasion de» s'agiter , le despotisme ministériel d'une époque de dégradation essaie de renverser le dernier obstacle que lui opposent encore les libertés communales (2), Voici le règlement de 1770. Le préambule indique les causes qui l'ont rendu nécessaire. Le règlement de cette commune, y est-il dit, fait en l'année 1619, pour sa direction, est presque tombé dans l'inexécution, soit tant par un effet de la vétusté que par un effet de la révolution qu'il y a eu dans cette ville, indépendamment qu'il ne porte que sur les élections des officiers municipaux et non sur les articles d'administration qui doivent nécessairement
(1) Édits de juillet 1690 - du mois d'août 1692 - décembre 1706 - mars 1709 – août 1722 - novembre 1733. En 1757, ces offices que la ville avait abonnés, furent réunis au corps de la communauté. Depuis la création de la charge de maire, le premier consul prend le titre de maire premier consul, et en cette qualité , il autorise les conseils ; les consuls en corps s'intitulent lieutenants généraux de police.
(2) Édit de novembre 1771. Les dispositions de cet édit ne s'étendaient point à la Provence. Ce ne fut que l'année suivante ( décembre 1772) que de nouvelles atteintes furent portées à ses droits. Mais , sur les vives et justes remontrances du pays, l'édit fut retiré, et les élections municipales reprirent leur cours accoutumé.
avoir lieu dans une communauté bien réglée. Ce règlement donne trois consuls et quatre députés qui participent à l'administration et ont voix délibérative et sont maîtres des délibérations s'ils veulent, au préjudice des trois consuls, principaux officiers municipaux et administrateurs, ce qui est unique dans cette province. Cette multiplicité d'administrateurs et le fort allivrement qu'ils doivent avoir , rendent l'élection difficile, par le manque de sujets, si bien que depuis longtemps on a été obligé , tantôt de brêcher audit règlement et tantôt de le modifier ce qui rendait insensiblement l'élection arbitraire ; d'où il résultait un nombre infini d'inconvénients. D'ailleurs, ces députés sont auditeurs des comptes, et il arrive très souvent qu'ils entendent le compte de leur administration ce qui n'est pas régulier et est préjudiciable aux intérêts de la communauté. En conséquence, un nouveau projet de règlement en soixante articles est arrêté et soumis dans une conférence préparatoire aux principaux allivrés, ainsi qu'aux personnes les plus intelligentes du pays. Exposé ensuite à l'hôtel de ville, pour que chaque habitant ait la liberté de le voir et de l'examiner, ce projet est unanimement adopté, dans une assemblée composée, suivant l'usage, de tous les chefs de famille, et immédiatement revêtu de l'autorisation et homologation nécessaires. Ce document est un peu long; mais il est important. Il mérite d'autant plus d'attention qu'en lui se résume tout ce que l'expérience des siècles que nous venons de parcourir a légué de raison et de sagesse administratives : vénérable et précieux monument de ces antiques libertés, si chères à nos pères, et dont nous allons recueillir les derniers soupirs. Le nouveau règlement fixe à trente-quatre le nombre des membres du conseil ordinaire, savoir : trois consuls en charge, les trois consuls de l'année précédente, et vingt-huit conseillers . Chacun des trois états y est représenté par neuf de ses membres, et la population agricole de la Baume par un habitant de ce faubourg. Le premier consul est pris parmi les gentilshommes, officiers retirés du service avec le grade de capitaine, avocats et médecins ; et les deux autres, comme auparavant, parmi les bourgeois, notaires, procureurs, négociants, marchands, chirurgiens, apothicaires, droguistes, orfèvres, artisans et tous gens de métier. Chaque consul et le greffier sont afflorinés trente florins cadastraux , et les conseillers, chacun vingt ( 1). Pour être élu consul , greffier , auditeur , estimateur,
(1) Le florin cadastral valait 62 liv. 10 sols. Le livre terrier, ou cadastre de la communauté était, année commune, de 16172 flor. 6 sols ; sur quoi, après avoir déduit 306 flor. 6 sols pour l'afflorinement des fonds possédés en franchise par le chapitre de la cathédrale, les hôpitaux et les maisons religieuses , et 2300 flor. pour l'allivrement du sol des maisons de la ville qui ne devait rien, restait 13566 flor.
il faut dix ans d'habitation, et cinq ans pour être conseiller ; nul ne peut être réélu qu'après trois ans d'intervalle, si ce n'est le conseiller de la Baume, qui pourra l'être après un an, attendu le petit nombre d'éligibles que présente le faubourg. Les fils de famille, sous l'autorisation et le cautionnement de leur père, pourront être nommés consuls; mais, ne seront éligibles à aucune charge les mineurs quoiqu'allivrés, les prévenus en justice, les faillis, les décadens et ceux dont les biens sont en discussion. Il en sera de même des débiteurs de la communauté et de tous ceux qui sont en procès avec elle. Les consuls ne seront point parents entr'eux jusqu'au troisième degré inclusivement, et ne feront point partie du même conseil le père et le fils, le beau-père et le gendre , ainsi que deux frères ; mais l'exclusion ne s'étend point aux cousins germains, à l'oncle et au neveu, ni aux beaux-frères, pourvu qu'ils n'excèdent pas le nombre de deux. Les articles 11 et 12 déterminent la forme de l'élection. Tous les ans, le 8 décembre, jour de la fête de la Conception, l'assemblée réunie , il sera fait autant de billets qu'il y a de conseillers du premier état. Deux de ces billets porteront le mot nominateur, et ceux auxquels ils écherront, désignés ainsi par le sort, iront prendre place à la droite des consuls. La même opération aura lieu pour les conseillers du second et troisième état; après quoi, les six nominateurs, produit de cette première élection ( 1 ), se sépareront aussitôt du reste de l'assemblée, et sans communiquer avec personne, monteront dans la salle de la conférence, dont les portes, refermées à deux clefs sur eux, ne leur permettront pas de désemparer qu'ils n'aient nommé dix conseillers, y compris celui de la Baume, pour remplacer ceux qui sortiront chaque année, en commençant parles plus anciens . Les nominateurs procèderont ensuite à l'élection des trois auditeurs des comptes, de trois estimateurs ( anciens cominaux ), des trois consuls et du greffier, et en cas de partage , les deux candidats proposés seront tirés au sort. Ainsi nommés et présentés au conseil, les trois consuls et le greffier devront être ballotés , et si l'un d'eux vient à être rejeté , les nominateurs remonteront dans la salle de la conférence pour en choisir un autre. Le ballotage s'effectuera , au moyen de deux tiroirs adaptés à une gorge de loup, dont l'un portant pour inscription , en dehors : approbation ; et l'autre : réprobation. Le fond de ces tiroirs sera garni de coton , afin d'éviter que les boules en tombant ne décèlent les suffrages. Un bassin placé sur le bureau contiendra
(1) Ainsi , chose remarquable ! après plus de quatre siècles , et comme à l'origine même du conseil (1334), l'élection définitive n'a lieu que par l'intermédiaire de six notables tenant leurs pouvoirs d'un premier degré d'élection .
autant de boules qu'il y a de votants, lesquels iront, l'un après l'autre, sans tumulte ni confusion, recevoir, chacun de la main du premier consul , une boule pour la déposer dans l'un des tiroirs qu'il voudra ; après quoi, il lèvera la main pour montrer qu'il a donné son vote. Pendant que le premier consul dépouillera le tiroir de l'approbation et en comptera tout haut les boules, l'ex-premier consul fera la même chose pour celui de la réprobation ; et dans le cas où les boules réprobatives excèderaient celles de l'approbation, les nominateurs, ainsi qu'il a été dit, auront à pourvoir au remplacement du candidat rejeté. A égalité de boules, celui qui en est l'objet, sera reballoté jusqu'à trois fois , et censé approuvé si l'égalité s'y trouve toujours. La première année, l'élection sera faite par six conseillers tirés au sort, parmi les cinquante qui composent actuellement le conseil ; et les vingt-huit qui dans la suite sont appelés à le former seront pris, savoir : neuf, dans les seize des cinquante nommés, depuis trois ans ; neuf, dans les seize nommés depuis deux ans ; et neuf, dans les seize nommés depuis un an, et , dans le cas où il ne s'en trouverait pas pour assortir les états et l'allivrement nécessaires , il ysera suppléé par d'autres. Les consuls , aprės leur installation, nommeront le procureur du roi de la police. Le premier consul sortant de charge, après avoir rendu compte des affaires de la communauté, procèdera à l'installation des nouveaux élus qui prêteront serment entre ses mains , de bien et fidèlement gérer dans leurs fonctions . Les trois auditeurs des comptes sont allivrés , chacun cinquante florins. Ils prêtent serment avant l'audition du compte. Ils ne sont point parents des consuls, ni du trésorier, jusqu'au degré de l'ordonnance ; ils ne peuvent être réélus qu'après deux ans. Les conseillers peuvent ètre nommés auditeurs. Néanmoins , lorsqu'il est question de délibérer sur l'approbation du compte, ils doivent s'abstenir d'opiner et monter dans la chambre de la conférence. Pour l'audition du compte, il est alloué huit livres à chacun des auditeurs . Lorsqu'il y a des comptes tutélaires, des sequestrations et autres adjugés par les auditeurs, ils peuvent y assister tous les trois ; mais entre tous, ils ne prennent que les honoraires de deux. Les estimateurs ne sont point parents entr'eux. Ils font les rapports des blés, les défalquements et dirigent les enchères des fermes de la ville, sous la rétribution accoutumée. Lorsqu'ils ont des estimations à faire, ils ne doivent prendre que trente sols par jour, dans la ville, et le double dans le territoire; s'ils opèrent pour le compte de la communauté, il ne leur est rien dû. Dès le 4 janvier, le trésorier dépose son compte sur le bureau , afin qu'il puisse être jugé et clos avant le 12 du même mois. Le dimanche suivant, il y aura un conseil général pour l'imposition de la taille. Ensuite le bail de la trésorerie sera mis aux enchères, et s'il ne se présente pas d'enchérisseur, on nommera d'office un trésorier qui sera forcé d'accepter. La taille est exigible par quartier , de trois en trois mois, à dater du 1er février. Il sera payé au trésorier ce qui est d'usage pour ses comptes , moyennant quoi il fournira les trois originaux du compte et le papier. Le conseil général sera publié et convoqué, à son de trompe, les jours de dimanche ou de fêtes, pour deux heures après midi, ou tel autre jour, si quelque affaire pressante l'exige, et à l'heure qu'il plaira aux consuls d'indiquer. Les conseillers sont tenus d'y assister, sous peine de cinq livres d'amende. Chacun dans le conseil doit se placer et opiner à son rang , sans tumulte niconfusion . Il suffit de dix-huit conseillers, ycompris les consuls, pour tenir les séances et valider les délibérations . Le premier consul y fait toujours les propositions, à la charge par lui de les communiquer à ses collègues. Les consuls en charge nomment , avec les commissaires du bureau, les régents du collège, et les consuls nomment seuls les maîtres d'écoles pour être approuvés (1).
(1) On sait que par l'ordonnance de Blois ( art. 24 ), confirmée par l'édit de 1666 , l'enseignement religieux et la discipline des petites écoles appartenaient aux évêques diocésains.
Les règlements relatifs aux officiers de justice et des employés dans les fermes du roi , continueront à être exécutés, selon leur forme et teneur, sous peine de nullité des actes qui y seraient contraires. Les consuls , pour droit de chaperon , reçoivent chacun soixante livres . La même somme est allouée au greffier, indépendamment de ses droits sur les cadastres, les expéditions et sur les actes de fermes , qui lui seront payés par les fermiers, savoir : à raison de neuf livres pour les fermes du poids et du vin, et de six livres pour les autres . Hors le cas de la députation aux états, qui est dévolue au premier consul et dont la province fait les frais, les députés de la ville ont chacun six livres par jour en voyage, et quatre livres pendant le séjour. Nulle charge municipale n'est perpétuelle ni héréditaire , et il est défendu d'en réunir deux sur la même tête, si ce n'est les auditeurs qui peuvent être pris, ainsi qu'on l'a dit , parmi les conseillers. Les consuls ne feront aucune dépense excédant dix huit livres, sans une délibération du conseil de la communauté. Toutefois, en cas d'urgence, ils peuvent passer outre, sauf de soumettre, dans la quinzaine, la dépense à l'approbation du conseil. Toutes les matrices des poids et mesures resteront dans l'hôtel de ville, pour y avoir recours au besoin. Les poids, balances et mesures de tous les particuliers qui achètent, vendent et débitent des marchan dises et denrées, seront vérifiés tous les trois mois dans l'hôtel de ville par l'échantillonneur, en présence des consuls et le résultat de la vérification sera consigné dans les registres de la communauté. Tous ceux qui seront surpris se servant de faux poids ou mesures, seront passibles de cinquante livres d'amende, ou autre arbitraire au jugement des consuls. La bannière sera mise régulièrement sur la place par le valet de ville, tous les jours de marché, dès le matin à huit heures, et enlevée à dix heures, pendant l'été, et à onze heures pendant l'hiver, pour marquer le moment où les revendeurs, hôtes, etc., peuvent acheter des fruits , gibier et volailles (1). Il est défendu à tous les habitants et étrangers de se tenir, les jours de marché, aux avenues de la ville et sur les grands chemins, pour y retenir et acheter les denrées, sous peine de vingt-cinq livres d'amende. Les maraudeurs et ravageurs de campagne , s'ils sont pris, payeront, outre le dommage, une amende de dix livres pendant le jour, et du double pendant la nuit. En cas d'insolvabilité, le délinquant sera contraint par corps. L'amende sera de quinze et de trente livres, si le délit est commis dans un jardin ou autre propriété close de murs ou de haies, et le maître ou toute autre personne digne de foi qui aura dénoncé le coupable, sera cru, comme auparavant, sur son serment.
(1 ) Cette même disposition existait déjà en 1358. Voy. délibér du 7 avril.
Les délibérations seront rédigées et signées le conseil tenant (1). Après avoir montré quel fut, dès son origine, l'état de notre ancien gouvernement municipal, en avoir suivi le développement et étudié avec soin et dans les sources mêmes, la lente et curieuse organisation , nous avons à considérer cet établissement sous le point de vue des libertés publiques et du rapport de ces libertés avec l'existence civile et politique des citoyens .
(1) 1770-8 juillet. Reg. des délibér.
II
LES LIBERTÉS PUBLIQUES.
IL en est des anciennes libertés de la ville de Sisteron, comme de sa constitution municipale dont elles émanent, et avec la destinée de laquelle elles se confondent. Leur origine se dérobe à tous les regards, et les chartes ne répandent sur leur existence que des lueurs faibles et tardives. Cette ignorance, du reste, tient à des causes qui ne sont point particulières à cette ville. Il en est peu, en Provence, qui ne soient dans le même cas. Et pourtant ces villes, malgré les ténèbres qui couvrent les premiers siècles de leur histoire , ne doutent point qu'alors , comme plus tard, la base de leur gouvernement ne fût le régime municipal et que, par suite, sauf la dépendance politique , elles n'aient constamment joui, dans l'ordre civil, de la liberté la plus étendue. Elles n'en doutent point, et elles ont raison ; car il serait difficile qu'il en fût autrement lorsque, d'une part, on ignore quand et comment ces institutions prirent naissance, et que, de l'autre, leur préexistence est constatée dans les documents du XIII siècle. Ce n'est donc qu'à partir de cette époque , et à mesure que ces documents apparaissent que nous allons , dans la seconde et troisième parties de notre travail , reprendre et compléter l'examen que nous avons commencé.
XIII SIÈCLE .
Charte de Guillaume de Sabran. Privileges de Charles Ier. ( 1212-1257. )
Le dernier comte de Forcalquier , Guillaume iv , venait de mourir ( 1209 ) . Il terminait sa longue et orageuse carrière , ne laissant pour héritier qu'un enfant , le jeune comte de Provence , Raymond Béranger , son arrière petit-fils . Mais il avait de sa sœur Alix, épouse de Guiraud , Amic de Sabran , un neveu comme lui appelé Guillaume , seigneur ambitieux et qui , aidé dit-on de sa mère , dont l'esprit entreprenant ne le cédait point à celui de son fils , profita des circonstances pour s'emparer de la souveraineté. Il serait difficile de savoir au juste la part que la ville de Sisteron prit à cette révolution. Il y a apparence , toutefois , que craignant de perdre de son importance politique en passant sous l'autorité des comtes de Provence , elle ne s'opposa que faiblement aux vues de l'usurpateur , si même elle ne les seconda pas ouvertement. Il est certain , du moins, qu'elle s'empressa de traiter avec lui. De son côté , Guillaume de Sabran , dans la charte qu'il accorde aux habitants de Sisteron (1), habitants qu'il distingue en nobles , consuls , bourgeois et peuple (2), ne dissimule point les bonnes dispositions qu'il a trouvées en eux. Aussi , en reconnaissance et avant tout , on le croit sans peine , il s'engage à les défendre contre les aggressions du comte de Provence. Il leur confirme , ainsi qu'on la déjà vu , le consulat et la commune , confratriam , avec attribution de la justice
(1) En date des nones de février 1212.
(2) Militibus , consulibus , burgensibus et universo populo Sistaricensi.
civile, la participation au jugement des causes criminelles qu'il se réserve et l'arbitrage des différents qui pourraient survenir entre lui et les nobles du pays. Il veut aussi que le droit de cosses appartienne au consulat (1). Guillaume promet , en outre , de faire jouir les hatants de Sisteron de l'exepmtion de tous droits de péages par eau et par terre (2), de se conformer à l'usage établi de ne nommer ni bailli , ni notaire qui ne soit étranger au pays (3), de ne point démembrer la vallée de Noyers de sa juridiction, de ne construire aucune forteresse , soit dans la ville , soit dans le territoire, et de ne point permettre que les troupes étrangères qu'il aura à sa suite y logent (4), de se contenter de la levée ordinaire de cent fantassins et de cinq cavaliers pour servir si le besoin l'exige , pendant l'espace d'un mois , et dans les limites du comté seulement. Enfin , il couvre d'un généreux pardon tous les délits dont son oncle ou lui aurait pu être l'objet , déliant les habitants de Sisteron de leur serment de fidélité et
(1) Le droit de cosses était du 30º sur tous grains vendus au marché.
(2) Franchise accordée par le dernier comte de Forcalquier , en 1202. ( Arch. de l'anc. chambre des comptes, à Marseille. )
(3) C'est à l'empereur Fréderic Barberousse que remonte , dit-on , l'usage établi en Italie, et suivi depuis en Provence, de ne point placer les officiers royaux dans le lieu de leur naissance .
(4) Quod si mainatas alienas habuero non hospitentur infrà Sistaricum.
d'obéissance , s'il n'observe religieusement lui-même toutes ses promesses . Telles sont les conditions que la ville de Sisteron obtint en retour de sa soumission . Si elle vit dans le pouvoir qui s'imposait à elle , autre chose qu'un fait violent et passager , l'événement se chargea de dissiper bien vite son illusion ; car , peu d'années suffirent au jeune comte de Provence pour rentrer dans la plénitude de ses drois ( 1220 ). Pour ce qui est de la charte de Guillaume de Sabran, comme elle n'est au fond que la confirmation de ce qui existait avant lui , la plupart des souverains qui se succédèrent depuis en Provence ne firent aucune difficulté d'en reconnaître les dispositions (1) . Ce titre eut pourtant besoin , plus d'une fois , d'être défendu contre des attaques assez vives . Quelques intérêts puissants qu'il contrariait essayérent de le représenter comme vicié dans sa source et par conséquent nul dans ses effets . Mais la ville de Sisteron triompha constamment de cette objection , en s'autorisant d'abord de la sanction des souverains légitimes et ensuite , lorsque le droit public fut mieux connu, de la fameuse maxime en vertu de laquelle les actes de souveraineté que se permet un usurpateur , quoique nuls de leur essence , puisent néanmoins dans la raison d'intérêt public
(1 ) Notamment la reine Marie ( 1386 ) , le roi Réné ( 1437 ) et François ler ( 1515 ).
de quoi suppléer au droit qui leur manque pour les valider (1). N'ayant à considérer ici la charte de 1212 que sous le point de vue municipal , peu importe la question de son origine , question fort indifférente , lorsqu'il s'agit uniquement de faits, et de faits publics indépendants de l'autorité qui les constate. Ce document est donc pour nous comme un phare placé sur la route que nous allons parcourir et qui , tout en marquant le point de départ , éclaire encore , en arrière , une partie de l'horizon . Le nouveau comte , on le voit , ne se réserve de la justice que les causes criminelles ; encore promet-il de ne pas juger ces causes sans l'avis des consuls et des notables de la ville (2) ; disposition sage et qui est bien moins , il faut le dire , une faveur ou un hommage rendu à la magistrature municipale , qu'une garantie offerte à la justice elle-même. Le bailli, à cette époque , était encore le seul juge , et cet officier , tiré de l'ordre des chevaliers , était bien plus propre au métier de la guerre qu'à l'étude des lois (3) .
(1) Grot. de jure bell. et pacis. Lib. 1. c. Iv. § xv-2. Cité dans un procès , au sujet d'une question de droit de péages , contre le seigneur de la Brillanne ( 1691 ).
(2) Clamores omnes et questiones veniant antè consules , exceptis homicidio , furto , sanguinis effusione et criminibus.... Etiam promitto quod justicias quas accipiam de his que ad me pertinent cum consilio consulum et procerum accipiantur .
(3) L'ignorance où étaient les chevaliers de la jurisprudence , dit Saint Simon , força les rois à leur donner des conseillers roturiers, lesquels , ajoute plaisamment le caustique écrivain , se tinrent cachés entre les jambes des nobles juges, d'où ils soufflaient à ces derniers les opinions et les sentences. Peu-à-peu les chevaliers , membres du parlement rendu stable par Philippe le Bel ( 1302 ), cessèrent d'assister aux séances et les souffleurs montèrent sur les sièges. »
La création du juge royal à Sisteron se rattache, selon les apparences, à la réforme que Raymond Béranger opéra dans la justice en 1235. Mais ce n'est qu'en 1257 , dans la charte de Charles d'Anjou que, pour la première fois, il est fait mention expresse de cet officier (1). On a vu que par cette charte les habitants de Sisteron obtiennent des statuts concernant l'administration de la justice. Charles et Béatrix son épouse confirment d'abord la célèbre disposition attribuée au dernier comte de Forcalquier, touchant les successions (2). On sait que par ce règlement , publié à Sisteron vers l'an 1170, avec le concours des trois États, clergé, barons, bourgeois et paysans (3), les filles mariées et dotées sont exclues de l'héritage de leurs père et mère, de celui de leurs frères et sœurs , à moins que ceux-ci , mourant sans postérité, ne disposent par testament en leur faveur. Loi importante, dit Papon , dans un temps où il n'y avait point de jurisprudence.
(1) Coram judice vel bajulo.
(2) Statutum quod dicitur fecisse dominus Guilhermus quondam comes Forcalquerii.
(3) Consilio omnium baronum comitatûs ..... et multorum aliorum procerum tam clericorum quam militum, tam burgensium quam rusticorum.
Disposition barbare, s'écrie un autre historien, effet du caractère dur et inquiet du comte de Forcalquier et du chagrin que lui causèrent les femmes (2). Si, avant de distribuer la louange ou le blâme à ce prince, nos historiens avaient pris la peine d'examiner jusqu'à quel point il mérita l'un ou l'autre, il leur eût été facile de s'assurer qu'en proclamant cette loi dans ses états , Guillaume n'en était point l'auteur, et qu'il ne faisait que l'emprunter à d'autres parties de la Provence, où elle existait de toute ancienneté. Il est d'autant plus étonnant que Papon ne l'ait pas remarqué, qu'il rapporte ailleurs les statuts de la ville d'Arles , où cette disposition est formellement consacrée (3). Il y a plus : cet usage n'était point particulier à la Provence. Il était connu également en France longtemps avant Saint-Louis. Les établissements de ce monarque portent : " qu'une fille noble" dotée, n'eût-elle qu'un chapel de roses , se voyait exclue de la succession du père et de la mère qui avaient constitué la dot (4). Suivant les statuts de Charles Ier , un acte public
(1) Hist. de Prov. Tom. 11. p. 251 .
(2 ) Essai sur l'Hist. de Prov. ( par Ch.-Franç. Bouche. ) Tom. 1. p. 58 et 59.
(3) Papon , tom 11. p. 235. Secundum antiquum morem civitatis Arelatensis ..... Gallia Christ. Tom. I. instr. fo 98.
(4) Ordon. du Louvre , tom. 1. p. 116 , note C.
est maintenu et doit recevoir son effet aussi longtemps qu'il n'est pas détruit par un acte postérieur ; toutefois, s'il s'agit d'un titre argué de faux, ou d'une créance à laquelle le débiteur ait des quittances partielles ou finales à opposer, il suffira à celui-ci de la production de ces pièces pour être admis, sans autre formalité, aux débats judiciaires. Lorsque, pour effectuer un paiement, la cour a fixé un délai , il faut strictement s'y conformer. Nul ne peut être contraint de prendre en paiement des biens meubles ou immeubles, s'il préfère de l'argent. Le débiteur en retard et cité en justice paye deux sols pour livre de dépens, et le créancier ne doit rien, à moins qu'il ne succombe dans sa demande (1). Tout citoyen de Sisteron, prévenu de larcin , ira devant son juge naturel (2), et si son innocence est reconnue, il n'aura d'autres frais à supporter que ceux de geôle et de nourriture modérément taxés. La cour n'a point à poursuivre d'office les injures, hors le cas où elles auraient été proférées en présence du juge, du bailli, ou dans l'église. Chacun est libre d'appeler au comte ou à son lieutenant des décisions du juge, et celui-ci est tenu de délivrer la sentence de condamnation s'il en est requis. Lorsque la cour a des poursuites à di
(1 ) C'est le droit domanial , appelé plus tard droit de Latte. Pecunia ad principem lata, dit un de nos publicistes. (Ch.-Fr. Bouche. - Droit public du comté , état de la Provence. In-8
(2) Vid.infra.
diriger contre un citoyen de Sisteron, elle est obligée de lui en donner connaissance à domicile, de manière à ce qu'instruit à temps et de la procédure et de son objet , le prévenu puisse, avant jugement , être entendu dans ses moyens de défense. Les jurisconsultes ne doivent se charger d'aucune cause sans l'autorisation de la cour, et nul ne doit donner des conseils à un étranger débiteur d'un habitant de Sisteron , ou prévenu d'injures contre lui , sans le consentement du créancier , de la personne injuriée , du comte , du bailli ou du juge. Les objets vendus sont assurés à l'acheteur jusque dans sa maison, et ne peuvent être retenus en gage. Le même privilége est accordé aux étrangers qui, ayant des dettes à Sisteron, y arrivent avec leurs denrées pour les livrer en acquit de ce qu'ils doivent. Toute personne de la juridiction du comte , qui aura contracté à Sisteron, est , pour le fait de ce contrat , justiciable de la cour royale de cette ville. Acôté de ces règlements utiles et qui annoncent les progrès dûs à l'étude du droit romain, étude déjà alors fort répandue en Provence (1), il existe une disposition qui interdit à la cour du comte la connaissance des excès auxquels l'habitant de Sisteron
(1) Dès le XIIe siècle, il y avait à Sisteron même des jurisconsultes distingués : deux surtout de la même famille , Mathieu et Guillaume Dufort, ont attaché leur nom à des monuments historiques. Le premier coopéra, ou du moins assista comme témoin, au testament de Raymond Bérenger, fait comme l'on sait en 1238, dans notre couvent des cordeliers ( Ruffi , Hist. des Cout. de Prov. p. 114. ) ; et le second prit part , dans sa maison de campagne du Gaure, près de la Durance ( aujourd'hui St.-Jérôme ), à un traité passé entre Jean Dauphin de Viennois et l'évêque de Gap, au sujet de quelques points de juridiction et de service militaire, le 5 septembre de l'an 1300. ( Valb. Hist. du Dauphiné. tom. 1. p. 54. )
viendrait à se porter envers les membres de sa maison, lorsque ces excès ne sont pas tellement graves qu'ils puissent, sans scandale, demeurer impunis (1). On pourrait croire qu'ici encore c'est la loi romaine qui attribue au père de famille un pouvoir exorbitant ; mais il est à remarquer que la femme est admise à jouir du même privilége. Il y a donc toute apparence que le véritable but de ce statut est de murer, en quelque sorte, le foyer domestique, pour n'en permettre l'accès aux officiers royaux que dans le cas où la vindicte publique ferait de leur intervention une nécessité. Après avoir ainsi réglé la justice, le comte maintient les habitants de Sisteron dans leurs bons usages et coutumes (2), de même que dans la franchise des droits de cosses et de leyde (3) ; il les exempte de la
(1) Item quod Dominus Comes vel ejus curia non possit inquirere vel punire aliquem qui vel que excederet contra aliquem vel aliquam de familia sua, scilicet de familia hominis vel mulieris Sistarici, nisi excessus adeo esset gravis et enormis quod sine tumultu et maximo scandalo populi preteriri non possit.
(2) Item quod omnia illa que rationabiliter laudata sunt et confir- mata in Sistarico sint firma.
(3) La leyde était un droit sur toutes sortes de denrées et de marchandises entrant dans la ville.
gabelle et des bans pour la vente du vin ; il prohibe l'importation des vins étrangers dans la ville, se réservant, toutefois, pour lui et ses successeurs, le droit d'en faire apporter lorsqu'ils seront dans le cas de séjourner à Sisteron. Il défend de toucher aux fenêtres et aux auvents des particuliers, sans leur consentement, et d'ouvrir aucune andronne ( rue couverte, cul-de-sac), sans des raisons d'utilité publique bien reconnues ; il confirme à la ville le droit de bucherage partout où elle a été constamment en usage d'en jouir. Il veut que rien ne s'oppose à la libre sortie des blés et autres denrées de la ville, si ce n'est en temps de guerre ou de disette, ou pour toute autre cause d'intérêt public. Il promet de ne demander que les taxes accoutumées et dans les cas suivants, savoir : lorsque le comte marie une fille, qu'il arme un de ses fils chevalier ; qu'il fait le voyage de la terre sainte ; qu'il achète une terre de la valeur de plus de mille marcs d'argent ; qu'il a besoin de rançon pour être délivré des mains de ses ennemis, ou lorsqu'enfin il est obligé de se déplacer pour les affaires de l'empire (1). Tous les subsides sont répartis par des prud'hommes choisis parmi les citoyens de la ville et désignés par la cour du comte.
(1) C'est ce qu'on appelait les six cas impériaux, en Provence et dans tous les pays qui avaient autrefois reconnu l'empire d'Allemagne.
En échange de ces diverses concessions ou confirmations, Charles 1er exige que la ville de Sisteron qui jusque là, ainsi qu'on l'a vu, n'avait été soumise qu'au service de cent fantassins et de cinq cavaliers, fournisse à l'avenir, un homme par feu, ou deux cents hommes , parmi lesquels cinquante arbaletriers pour servir, à leurs frais, pendant quarante jours de l'année, dans toute l'étendue des comtés de Provence et de Forcalquier. Il est dit en outre que si le comte est obligé de tenir la campagne, de lever le siége d'une place, ou s'il est réduit à quelque grande extrémité, la ville fera tous ses efforts pour venir à son secours (1). Les habitants de Sisteron ne peuvent être contraints de donner de l'argent pour les cavalcades. Ils n'en donnent que de leur propre volonté. Lorsqu'on sait les conditions que la plupart des villes de Provence eurent à subir en passant sous la domination de Charles d'Anjou, conditions qui, pour quelques-unes d'entr'elles, furent le sacrifice de leurs libertés les plus précieuses (2), on peut s'étonner de la faveur particulière avec laquelle ce prince altier et si jaloux d'étendre son autorité, traite ici la ville de Sisteron. Nous omettons quelques autres dispositions
(1) Quodtunc tota villa exeat totaliter ad suum efforcium in auxillum Domini comitis et suorum.....jf
(2) Papon , Hist. de Prov. tom. 1. preuv. p. 97-98 .
moins importantes pour arriver à la dernière, qui est une amnistie et l'abolition générale du passé, pour tous les habitants, à l'exception de ceux qui , lors de la destruction du château et du massacre des juifs, ont ouvertement levé l'étendard de la révolte (1).
XIV ET XV SIÈCLES.
Subsides. Allivrement. Monnaies.
EN SUCCÉDANT à Charles II son père ( 1309 ), le roi Robert se trouva presqu'aussitôt engagé, en Italie, dans des guerres dont le poids retombait en grande partie sur la Provence. Nos vieux livres de comptes gardent un fidèle souvenir des dons gracieux qui dans cette occasion , furent offerts à ce prince. Car, tout en refusant au souverain le droit de demander d'autorité les subsides, le pays ne s'en montrait que plus empressé de venir à son secours toutes les fois que les circonstances l'exigeaient. Mais il voulait être libre dans son vote. Il faut dit la lettre de convocation aux états tenus à Aix le 25 mars 1313, il faut que les députés aient des pouvoirs suffisants pour
(1)Chart. orig. du 3 des calendes de septembre 1257, et Liv. vert , f 2. Les mêmes priviléges sont encore textuellement rapportés dans la charte de confirmation donnée par Charles II le 11 janvier 1288. Id. fo 4-7, et de nouveau confirmés par la reine Jeanne le 26 avril 1345 . Id. f 21.
accorder, s'il y a lieu, une grâce au roi notre sire (1) . C'est encore sous forme de grace et non à titre de fouage que la ville de Sisteron consent à contribuer aux frais d'un armement extraordinaire ordonné en 1316 par le grand sénéchal (2). Par un privilége spécial , les habitants de Sisteron ne payaient point dans les villages la taille des biens qu'ils y possédaient , et ils n'étaient, pour ce fait, contraignables qu'à Sisteron même (3). De tous les priviléges de la ville aucun n'était plus impatiemment supporté par les habitants des villages . C'est qu'aucun, il faut le dire, ne blessait un droit plus précieux , plus cher au pays ; un droit qui , depuis les Romains, était resté comme inhérent au sol, et qui, sous le nom de taille réelle, formait une des
(1) Gratiam etiam faciendi Domino nostro regi , si propterea fuerint requisiti.... Chart. orig. en parch.
(2) Prefata tamen universitas habens ergà Dominum nostrum regem intime devocionis affectum intendit et vult presertim , in tam arduis agendis que incumbunt presentialiter pro armata quam idem Dominus noster rex nunc fieri mandavit in provinciâ subvenire de gracia et non pro focagiis , dum tamen ipsa generosa subventio libertatibus ipsius universitatis et privilegiis non inferat in futurum.... 17 décembre XII indict. Chart. orig. en papier . Cette pièce , on le voit , n'a d'autre date que l'indiction. Mais il ne saurait y avoir doute pour l'année , puisque Richard de Gambateza au nom de qui elle est expédiée et qui paraît , à diverses reprises dans la liste des grands sénéchaux de Provence , depuis 1302 jusqu'en 1316, n'offre que cette dernière année qui s'accorde avec la XIV indiction .
(3) Charte du 24 janv. 1307. Orig. en parch.
bases de la constitution provençale. Mais d'où venait aux habitants de Sisteron le privilége d'y déroger ? Pour bien comprendre une pareille immunité, il est nécessaire, ce nous semble, de se reporter à l'époque où elle dût prendre naissance. Il faut, surtout, ne point se préoccuper de l'idée que ce fut une usurpation ou une concession sans équité comme sans but. Alors peut-être il sera permis de n'y voir qu'une précaution prise dans l'intérêt des deniers publics que l'anarchie féodale mettait souvent en danger, et pour lesquels il n'y avait véritablement de sûreté que dans les villes fermées . Quoi qu'il en soit, les seigneurs se montrèrent toujours fort mécontents de ce privilége, et plus d'une fois, malgré les ordonnances, ils essayèrent d'en arrêter l'effet. Ils allèrent même jusqu'à vouloir interdire à leurs vassaux de cultiver les terres des habitants de Sisteron. Mais cette tentative, la plus étrange qu'il fût possible d'imaginer fut aussi la dernière dont ils s'avisèrent, et ils n'eurent plus qu'à se résigner à ce qu'il n'était pas en leur pouvoir d'empêcher (1) . Heureux encore les seigneurs, s'ils n'avaient point eu d'autre grief contre la ville de Sisteron ! Mais, par une fatalité singulière pour eux, pendant que les habitants de cette ville se dispensaient de payer dans les villages la taille des biens qu'ils y possédaient , ils
(1) 1402 - 5 août. Lettr. du roi Louis II. Orig. en parch.
forçaient les nobles à subir, à Sisteron, la loi commune et à y supporter leur part des contributions (1). Car là, ni plus ni moins que dans une république, régnait sur ce point une égalité parfaite entre tous les citoyens (2) ; et ce fut toujours en vain que les nobles cherchèrent à y faire prévaloir des prétentions contraires . Sachez bien , dit la reine Marie , dans une de ses lettres aux officiers de la cour royale, sachez bien , qu'en fait d'impôt, la rigueur des temps, comme la justice et le droit, exige que, hors le cas d'une franchise spéciale et prouvée par titre, il n'y ait d'exemption pour personne (3). Cette décision était formelle. Il fallut néanmoins réprimer encore bien des tentatives ayant pour but de l'éluder. Nous citerons, entr'autres, la contestation qu'élevèrent, à ce sujet, les maisons religieuses et le co-seigneur de St. -Vincent, magnifique Jehan Cureti Ils mirent, les uns et les autres , beaucoup d'insistance à se prévaloir de la franchise, mais rien
(1) 1391 15 juillet, Reg. des délibér .
(2) Item ordinaverunt quod provideatur contrà possidentesin civitate et territorio Sistarici et alibi larem foventes continue et contra illos qui partim Sistarici et partim alibi larem fovent qualiter et in quibus nobis contribuant in recompensatione predictorum - 1346-16 mai. Reg. des délibér.
(3 ) Non exigit presentium conditio agendorum , nec prebent tempora aliquem eximi ab onere talhiarum aut subventionum quarum libet pro utilitate publicâ editarum et edendarum , nisi eos quibus ex immunitate eis concessa exceptio est indulta.... Et plus loin : Nos juris publici sanctione pensatâ ... Lettr. du 2 juill. 1399 , Liv. vert fº 80 .
n'y fit : ils furent contraints de céder. Les religieux se résignèrent ; peut-être même finirent-ils par comprendre qu'admis à s'établir sur le sol de la commune et à y participer aux avantages dont elle faisait jouir les autres citoyens, il était bien juste qu'eux aussi payassent de quelques sacrifices la protection qu'ils en recevaient (1). Moins raisonnable, le seigneur de St.- Vincent entra dans un grand courroux, en apprenant la condamnation dont il était l'objet (2). Naguère encore, simple citoyen de Sisteron (3), et parvenu tout-à-coup de ce modeste rang , à une des premières dignités de la magistrature (celle de maître rationnal), cette haute et subite fortune lui tourna la tête. Supérieur sans doute, pour le savoir, à la plupart de ses compatriotes, mais gâté par l'habitude de la domination , il prit la résistance à ses prétentions pour une insulte , et sa mise à la taille pour une humiliation.
(1) Lorsque les dames de la Visitation (1631) et les ursulines (1642) arrivèrent à Sisteron pour y fonder une maison de leur ordre, la première condition qu'elles eurent à subir, ce fut également de prendre leur part des charges communales.
(2) Item, fuit ordinatum quod conventus fratrum minorum , predicatorum , monialium Sti. Authonii et Chardaonis nec non et magnificus Dominus Johannes Cureti , Dominus de Sto. Vincentio, solvant et sint astricti solvere eorum talhias pro bonis que possident in presenti civitate Sistarici , loco de Balmâ et eorum territoriis , prout et ceteri homines presentis civitatis et juxtâ eorum quotam. (Délibér du 26 juil . 1487) . (3) En 1483 , Cureti était assesseur du conseil. Voy. Reg. des délibér.
Voici la singulière lettre qu'il écrivit , à cette ocссаsion , au conseil : Messieurs sindiques et conselh de Sisteron assemblez en ung conselh , je me merveille que vos prudans et sages comme vous voules à moy faire deshonneur à l'instance daulcuns outrageux et daultres de pueple ; vous recognoissez bien les penes et travail que je prens chascun jour, pour le bien de ceste poure cité désolée et de petit conselh , je vous advise que si vous attemptez chose contre mon honneur, que je m'en vengerai contre ceulx qui l'oront ordonné ; ne faites pas comme vous avez faict aultrefoys contre le seigneur de Peyrux, couste à la ville v° . florins et reveillez le chien qui dort. Je vous ai fait et fait , chascun jour, honneur et prix et plus que je ne suis tenus , car quant vous me blesserez contre justice , vous vous en repentirez .
Votre amy quant vous plairat
ЈЕH. CURETI chevallier et conselher du roy et maistre rational
(1). Malgré cette âpre semonce , le conseil , on le pense bien, n'eut point à se détourner de la ligne tracée par ses devoirs. Mais la patrie dût déplorer de voir un
(1) Lettr. autographe .
de ses citoyens les plus honorables et les plus éclairés , un grave magistrat, en méconnaître à ce point, les institutions. Cureti ne pouvait ignorer qu'en Provence, le souverain lui-même n'avait pas le droit d'exempter de l'impôt, à moins qu'il ne déchargeât d'autant l'affouagement du pays (1 ). Aussi, c'est ce que ne manqua pas de faire Charles VIII lorsque, voulant récompenser les services que Blaise et Esprit Guiramand lui avaient rendus dans la guerre de Naples, il mit en franchise les propriétés que cette famille possédait à Sisteron (2). Équitables dans leur assiette , les subsides ne l'étaient pas moins dans leur répartition que les plus anciennes ordonnances recommandent d'opérer toujours au marc le franc (3). On a vu qu'en 1327, un nouvel allivrement eut lieu à Sisteron, Ce document, que nous avons retrouvé au fond d'un énorme sac portant pour étiquette : papiers inutiles, est d'un grand intérêt à cause des lumières qu'il répand sur l'état ancien de la ville, à une époque où elle n'avait point encore cessé d'être prospère , où ses faubourgs étaient debout , et sa population au plus haut point qu'elle eût jamais atteint . Les allivrés sont au nombre de 1224. L'estimation ne porte pas sur les
(1) Julien. Comment. sur les stat. de Prov. tom. 11 p. 22.
(2) Pièce aux arch.
(3) Ordonn. de Charles 11, donnée à Marseille le 2 septembre 1306 . Orig. en parch .
immeubles , mais l'avoir de chaque habitant est évalué en argent; et sur l'ensemble des estimations s'élevant à cent six mille cent huit livres ( environ onze cents mille francs d'aujourd'hui) , est perçue, à raison d'une pite par livre, la somme de cent dix livres dix sols sept deniers monnaie réforciat, de treize deniers au tournois, ou de quatorze sols au florin (1). Le tournois dont il s'agit ici, n'est pas le tournois de France, mais le tournois fabriqué à St.-Remi et qui était alors fort répandu (2). Parmi les autres monnaies ayant cours à cette époque à Sisteron, on remarque celle de quelques prélats et abbés, entr'autres, le gros crossé, petite pièce d'argent, valant la douzième partie du florin . C'est en livres crossées que fut acquitté le don gracieux offert, en 1313, au roi Robert. Mais la monnaie épiscopale la plus commune était celle des archevêques de Vienne. On l'appelait indistinctement, monnaie longue ou viennoise , et elle était plus faible d'un quart que la monnaie de Tours (3). Nous avons néanmoins la quittance des maçons qui , en 1331, construisirent
(1) Adpictam pro libra ascendit in formâ totius universitatis centum et vi milia et centum et VIII libras reforciatorum de quibus valet Turonensis XII den. que ascendit ad pictam pro libra cx. et x sol . vii den. ad rationem Turonense pro XIII den. vel floren. pro XIII sol .
(2) St. Vincens dans Papon. Histoire de Prov. tom. III . p. 579 .
(3) Ponendo et solvendo unum grossum turonense argenti cum o rotundo pro xx denar. dicte longe monete... Compt. cour. fo 53. ann . 1325.
la fontaine de la grande place, par laquelle ces ouvriers reconnaissent avoir reçu la somme de seize livres quatre sols , valant bonne monnaie réforciat , au cours actuel , six livres dix sols six deniers (1). Ce qui présente , avec l'évaluation ordinaire , une différence que nous avons cru devoir signaler. Une monnaie plus faible encore que la viennoise, à ce qu'il paraît, est celle que nos comptes désignent sous le nom de barbacane. Mais quelle était cette monnaie , et d'où lui venait sa dénomination? nous livrons cette question aux recherches aujourd'hui si actives des amateurs de notre ancienne numismatique. Tout ce que nous savons , c'est que, suivant un article de dépense effectuée, en 1326, vingt-quatre tournois d'argent et un florin d'or valaient soixante-neuf sols barbacans et que la même année , un des syndics se rendant à Aix , reçoit douze sols barbacans parjour(2) . Outre les florins d'or de seize et dix-sept sols provençaux (3) , nos livres de comptes du xivº siècle font mention du florin de Piémont valant 31 sols (4 ) , des florins d'or de grailhe , ou à la corneille (signigraileti) et du florin au cornet (de corneto), pièces des princes d'Orange qui avaient un cornet dans leurs armes.
(1) Monete longe XVI libr. IIII sol . valent bone monete reforc. nunc currentium sex libr. vi den. reforc .... id fo. 63.
(2) Viginti quatuor turonenses argenti et unum florenum auri valent sexaginta novem solidorum Barbacanorum ... Compt cour. fo 44.
(3) Floreni duo valent triginta quatuor solidos provinciales.. id fº 97.
(4) Id. fo 58

Il y a aussi des princes d'Orange, un gros denier d'argent de la valeur de sept deniers provençaux (1). Nos comptes parlent encore du carlin d'argent, ou gilhac , ainsi appelé , comme on sait, de l'Italien gigliato, à cause des fleurs de lys qu'il portait au revers, et valant seize deniers (2) ; du Robert d'argent ou sol couronnat de seize deniers , monnaie longue ; du dizain ou provençal d'argent de dix deniers (3); du sizain , de l'obole et de la pite , l'une la moitié, l'autre le quart du denier. Les monnaies de France qui circulaient alors le plus communément , étaient l'agnel d'or , répondant à 22 sols provençaux (4) ; l'obole d'argent de cinq deniers (5) ; le bourgeois (burgensis), dont chacun valait cinq pites (6) ; le sol tournois et le denier valois. Ce dernier équivalait à trois deniers provençaux (7). En 1327, le sénéchal de Provence , Raynaud de Scaleta , arrêta les poursuites que les officiers royaux du
(1) Moneta grossa argenti principis Aurasice , computando unum denarium grossum argenti dicte monete pro vII den. id fo 3. ann . 1313 .
(2) Id. fo 56.
(3) Uno provinciali argenti pro x den. computando.... id fo . 97 .
(4) In quatuor florenis et uno agno auri valent quatuor libras sex solid... id. fo. 53. ann. 1325.
(5) [Item unum obol. argenti monete regis Francie ad rationem pro obolo v den. id. fo . 3 .
(6) Moneta burgensis ad rationem XVI den . et obol. pro turono argenti et quinque den. pro obolo argenti , computando unum Borzes simplicem pro quinque pictis... id fo. 2. ann. 1313 .
7) Id fo. 58.
bailliage de Sisteron exerçaient contre ceux qui se servaient de la monnaie valois, à laquelle ces agents appliquaient, mal-à-propos, les dispositions d'un règlement, rendu depuis peu, touchant le cours des monnaies (1). Toutefois, si ce n'était que contre le mauvais aloi des monnaies de France que s'élevaient ces officiers, il n'y avait pas trop lieu de les en blâmer; car la monnaie valois , à cette époque, était tombée dans un grand discrédit. Le marc d'argent, de deux livres quatre sols qu'il valait en 1316, monta tout-à-coup jusqu'à cinq livres huit sols. Cet accroissement subit bouleversa toutes les fortunes, à tel point que cil qui souloit estre riche, dit une ordonnance du temps, sont amenuisiez de leur richesse, et tel y a qui n'ont de quoy vivre, les denrées sont enchéries et marchandise deslaissée (2) . Une révolution plus heureuse pour les finances et les monnaies des rois de France, est celle qu'opéra le célèbre argentier de Charles VII : aussi, ne voyons-nous pas les pièces que nos registres appellent des Jacques
(1) Ceterum quia cives ipsi et alii de bajuliâ dicte terre monetam illustris regis Francie que vocatur valoys recipiunt et expendunt per curiam nostram , pretextu , ut ponitur, cujusdam ordinationis nostre facta pridem super cursu monetarum inquisitiones fiunt , sicut ponitur, contrà eos adhicimus expressius in mandatis quod ab hujus modi inqui- sitionibus factis et faciendis propterea contra ipsos penitùs desistatis... Reg. de l'allivrement. fo . 2 .
(2) Ordonn. du 23juin 1317, rapportée par Le Blanc, Traité hist. des monnaies , p. 235.
Cuers éprouver, à Sisteron, comme la monnaie valois, des obstacles dans leur circulation (1). Plus les temps devenaient mauvais, plus les charges s'aggravaient, et plus aussi le conseil s'attachait à les distribuer également, jugeant avec raison que l'allivrement, pour être d'accord avec son nom, doit avoir toute la précision d'une balance (2). Jamais il ne perdit de vue cette base fondamentale de la répartition , et une révision sévère avait lieu toutes les fois qu'il s'agissait de mettre des subsides. Jamais aussi, il ne laissa ignorer que son intention, comme son devoir, était de défendre de tout son pouvoir, le privilége en vertu duquel tous les habitants de la ville sans distinction , tant ceux qui jouissent actuellement du droit de cité que ceux qui en jouiront à l'avenir, doivent également contribuer aux tailles et n'y contribuer qu'à Sisteron pour tous leurs biens quelconques (3).
(1) C'étaient des gros frappés à Bourges, pendant que Jacques Cœur était maître de la monnaie. Ces pièces sont d'argent fin et pèsent , suivant Le Blanc (id. p. 299.) , un gros ou trois deniers. Un dernier document monétaire nous apprend que, pendant la ligue, le gouvernement royal fit frapper à Sisteron, des pinatelles, petites pièces de la valeur de dix liards et qui n'étaient que des doubles parisis affaiblis. Il y en avait pourtant de plus faibles encore, puisque une ordonnance rendue , d'après l'avis des états de Brignoles (19 mars 1593 ) défendit le cours des pinatelles, autres que celles fabriquées à Toulon et à Sisteron. (Raynouard. Not. sur Brignoles , p. 68).
(2) Libra, libramen, alibramentum, proprement un contre-poids pour tenir un corps en équilibre.
(3) Item voluerunt et ordinaverunt quod omnes et quicumque homines et persone facientes larem in presenti civitate et qui fecerunt sacramentum fidelitatis vel facient in futurum in consilio , ut est moris , defendantur per consilium , vigore privilegiorum nostrorum , ut non contribuant in talhiis , seu quistis , nisi cum illis de Sistarico , pro bonis ipsorum quibuscumque... 1392-18 septembre. Reg. des délibér.
Service militaire.
La lettre de convocation aux états de 1313 enjoint en outre à tous les habitants de Sisteron, quelle que soit leur condition, d'avoir à se munir d'armes et de chevaux , afin qu'au premier requis, chacun d'eux soit prêt à s'acquitter du service auquel il est tenu (1). Une des premières conditions du service militaire était de s'armer et de s'équiper à ses frais. Il n'y avait, sur ce point, d'exemption pour personne ; seulement, l'armure se modifiait suivant le rang. Ainsi, lorque les riches devaient se procurer la cuirasse, le casque, le gorgerin, l'épée et l'arbalète, il suffisait aux moins aisés d'avoir le bouclier, la lance ou l'épée (2). Mais le fait le plus important à noter ici , c'est l'obligation où sont tous les habitants de Sisteron, sans distinction,
(1) Ut omnis persona , cujuscumque conditionis et statûs existat, se paret et muniat equis et armis , ut sint in continuo apparati , ut cum fuerint pro curiâ requisiti , cavalcatas facere debitas sint parati.
(2) Fuit post per plures annos ordinatum per curiam quod quilibet debeat tenere armaturas infra scriptas , videlicet ; divites ; platas , ser- velleriam , gorgeriam, ensem et balistam. Mediocres: spalleriam cum servelleria , scutam , ensem et balistam vel lanceam. Minores vero : scutum , lanceam vel ensem. Compt. cour. fo. 103.
de servir à cheval, obligation qui , on le sait, n'existait que pour les nobles. Par un juste dédommagement, les armes étaient une chose sacrée. Le clavaire ne pouvait les prendre en gage, pour contraindre les citoyens au paiement de leurs dettes (1). Après la fin tragique d'André de Hongrie (1345), la reine Jeanne, accusée par la voix publique de n'être point demeurée étrangère au meurtre d'un époux qu'elle détestait, vit s'élever contre elle une foule d'ennemis : les uns, comme le roi de Hongrie, frère d'André, poursuivant les auteurs du crime; les autres, indignés ou feignant de l'être, et tous profitant de la fâcheuse situation où cet événement plaçait la reine, pour envahir ses états et pour la dépouiller (2). Dans cette extrémité, les habitants de Sisteron coururent aux armes. Mais le conseil ne sachant plus à quoi s'en tenir sur la population du pays, depuis que
(1) Audivimus... quod in presens, clavarius pro debitis quibus cumque tenentur cives civitatis ipsius curie reginali arma seu arnesia capi mandas pignorare in ipsorum civium grande prejudicium et gravamen , illa nihilominus demandando , super quo... volumus.... et tibi mandamus expresse quod dictos cives , occasione premissa, in ipsis armaturis seu arnesiis pignorari facere ulterius non attemptes... Lettre du sénéch. aux officiers de la cour royale du 30 juin 1349. Liv. vert. fo 33 .
(2) Domina nostra regina... multos vicinos habet inimicos et alios inimicos machinationibus quorum ante tempus bonum videtur obstare debitis remediis .... Délibér . du 30 janvier 1348.
la terrible peste de 1348 (1) l'avait décimée, fit procéder à un recensement général, afin de s'assurer du nombre de défenseurs qui lui restaient. Il s'en trouva encore 453. On en forma aussitôt autant de divisions de dix hommes commandées, chacune, par un dizenier, et au moyen de cette milice citoyenne, la ville put espérer d'échapper aux dangers qui la menaçaient. Elle y échappa en effet. Mais, combien d'autres épreuves il lui restait à subir! combien d'alarmes et plus vives et plus pressantes lui réservaient et l'archiprêtre Cervole, à la tête de ses aventuriers (2), et le fameux Bertrand Duguesclin lui-même, ce redoutable guerrier, devant lequel tout fuyait, et à qui, dit une chronique contemporaine, on fermait les portes des villes, en criant que le diable venait (3) et enfin, cet audacieux Raymond de Turenne, l'infâme rebelle (4), ainsi que le qualifient nos registres, qui, durant près de dix ans, remplit la Provence de désolation et de ruines, notamment le bailliage de Sisteron (5). Un demi-siècle suffit, à peine, à voir la fin de ces tristes dissensions. Il n'y eut, pour ainsi dire, pendant
(1) Quia propter jam transactam mortalitatem , major pars homi- num dicte civitatis aptorum ad defensionem ipsius civitatis mortui cavent in illâ ... Ibid.
(2) 1357. Reg. des délibér. passim.
(3) 1368-5 juin. Reg. id.
(4) Nefandissimum rebellum.
(5) 1390-91-92-93 - Reg. des délibér, et infrà. p. 83.
ce temps, pour la ville de Sisteron, ni paix, ni relache. Il lui fallut être constamment sous les armes, et , réduite à ses propres ressources , pourvoir d'elle-même à sa surêté. Car les souverains ne firent jamais rien pour elle . Cependant Sisteron était une des places les plus importantes de leurs états . Il en était comme la clef, du côté du Dauphiné (1). Tout ce que le conseil pouvait faire, lorsque le péril devenait imminent, c'était de se liguer avec les villes voisines (2), et lorsque les tours de garde revenaient trop souvent, bien que nul, avocat, chevalier, clerc ou oblat (3), n'en fût exempt et que chacun, sous peine d'amende, fût obligé de payer de sa personne, tout ce que pouvait faire le conseil, c'était d'appeler des mercenaires. Il traitait, alors, avec des compagnies de brigands Italiens, (tramontanos) lesquels , moyennant salaire, s'engageaient pour un mois, à défendre la ville et à n'en pas franchir les portes, sous peine de perdre leurs gages(4). Dans l'impuissance où ils furent presque toujours de secourir leurs sujets, et, en cela, plus à plaindre
(1) Cum civitas ipsa in confinibus comitatûs Forcalquerii situata sit, clavis et limitibus Dalphinatûs... 1359 - Liv. vert. fo. 18 et 19.
(2) 1357 – 20 août. Reg . des délibér .
(3) Quod omnis persona cujus cum que conditionis existat , sive advocati , milites clerici vel donati ( Donnés ou oblats, laïques consacrés à l'église ) , aut alii cujusvis statûs , faciat gardiam per se personaliter et non per substitutum , sub penâ u solid. Délibér. du 10 octobre 1357.
(4) 1357. - 12 octobre - 1368-9juin. Reg.des délibér .
qu'eux peut-être, les comtes de Provence, c'est une justice à leur rendre, n'oublièrent rien du moins, pour se les attacher par la sagesse et la douceur de leur gouvernement. Voici des monuments qui pourront servir à faire apprécier des siècles que l'ignorance et un reste de mauvais goût se plaisent encore quelquefois à appeler barbares.
Statuts de Louis de Tarente et de la reine Jeanne son épouse, concernant la justice.
La reine Jeanne venait à peine de détourner l'orage qui grondait sur sa tête depuis le meurtre de son premier mari , qu'elle se hâta de se faire couronner, conjointement avec Louis de Tarente son nouvel époux (1). Dans cette circonstance les états de Provence chargèrent des députés de porter à Naples l'hommage et les vœux du pays. La ville de Sisteron fournit à cette députation un de ses plus honorables citoyens, le notaire Lantelme Jarente. Après avoir rendu leurs premiers devoirs aux souverains, les envoyés eurent, dans l'intérêt de leurs commettants , une mission plus importante à remplir ; ce fut d'appeler la réforme des abus qui, à la faveur des calamités publiques, s'étaient
(1) 22 mai 1352.
introduits dans l'administration de lajustice. En conséquence , il fut rédigé , sur leur demande , un certain nombre de statuts où l'on retrouve , suivant les belles paroles du préambule , ces principes d'éternelle » justice , véritable semence d'ordre et de paix pour >> les princes qui ont la sagesse d'en faire la règle du >> gouvernement de leurs peuples (1 ) ». Ces statuts , qu'aucun de nos historiens ni commentateurs n'a connu , et dont l'original est sous nos yeux , sont à la date du 5 novembre 1352. Ils commencent par rétablir la juridiction des appels qui était presque tombée en désuétude , investissant , comme au temps du roi Robert, les juges des premières et secondes appellations du droit de prononcer en dernier ressort sur les causes jugées en première instance , par tous officiers ecclésiastiques et seigneuriaux. Ils consacrent ensuite le maintien des droits réguliers; ils déclarent que pour la saisie et l'emprisonnement des prévenus , les concierges et les sous-viguiers n'ont rien à exiger. « Car , il ne faut point aggraver le malheur, ni ajouter aux rigueurs de la prison qui , n'ayant pour objet que de s'assurer de la personne des détenus, ne saurait servir de prétexte å des violences (2). »
(1) In virtute legis civilis et statutorum regalium principes subjectos regunt populos et seminaria pacis et quietis radicant.
(2) Nihil recipiant ab illis quos eorum tenet carcer inclusos , non est enim afflictis danda afflictio , nec ad extorsionem sed custodiam carcer est inventus.
Il y a incompatibilité entre les fonctions des clavaires et celles des notaires. Ceux-ci , dont il est urgent d'arrêter l'insatiable cupidité (1), n'auront droit à aucune rétribution en inventoriant les biens des criminels ; ils ne peuvent contraindre le prévenu à la levée des sentences absolutoires. Ils doivent stipuler brièvement et désigner dans la procédure les dénonciateurs par leurs noms et prénoms (2). Ils tiendront régulièrement leurs écritures, ne déplaceront point leurs protocoles, afin que les parties intéressées puissent y recourir au besoin, et transmettront fidèlement à leurs successeurs tous les titres et documents relatifs à leurs offices . Le juge ne recevra ni argent, ni présents , sous peine de restituer le double de ce qu'il aura reçu ; si , sur le dire d'un seul témoin, il rend une sentence, il paiera une amende de cent livres, et de vingt-cinq livres , si , à l'expiration de ses fonctions, il n'a pas terminé les procès commencés, réservant en outre, à la partie lésée par ce retard, le droit de le poursuivre en dommages-intérêts (3).
( 1 ) Notariorum voraginem et ambitum tollere cupientes.
(2) Cette même disposition est rappelée et développée plus loin 1387 Voy. Liv. vert fº 85 .
(3) Les juges subalternes différaient souvent de rendre leurs sentences, dans la crainte d'encourir l'amende dont ils étaient passibles , lorsque les juges supérieurs réformaient leurs jugements : aussi , aux états-généraux de 1356, les députés du tiers-état demandèrent-ils que les juges qui laisseraient les affaires indécises et différeraient de prononcer leurs sentences , fussent contraints par corps et privés de leurs offices . ( Contin. de Velly, tom. ix. in 12. p. 227 ) .
Enfin, les blasphémateurs des noms de Dieu, de la Vierge et des Saints, continueront à être punis suivant les anciens règlements. Les peines portées par un règlement récent contre les blasphêmes , étaient des amendes depuis quarante sols jusqu'à vingt-cinq livres, et ces peines , les juges les appliquaient souvent à tort et à travers. Sur les plaintes du pays, le sénéchal de Provence révoqua non seulement sa première décision, mais arrêta que désormais ne seraient plus réputées blasphêmes les paroles dans lesquelles il entrait plus de légèreté et de mauvaise habitude que d'intentions coupables envers la divinité (1), C'est entre ces deux excès de rigueur et de tolérance que les nouveaux statuts , ne voyant pas la nécessité de rien innover à cet égard , reviennent tout simplement à l'application des anciennes lois (2). Outre les garanties que ces statuts offraient aux citoyens de Sisteron, chez eux la liberté individuelle était encore protégée par la faculté de ne pouvoir être retenus en prison s'ils donnaient une caution, à moins qu'ils n'eussent encouru la peine de mort ou de mutilation de membres (3) .
(1) 1352 2 août. Liv. vert fo. 35. v°.
(2) Quod provida predecessorum nostrorum statuti editio introduxit, non videmus corrigendum.... volumus nostro etiam tempore observare roboris firmitatem , nec majori penâ prefatos puniri... blasfemantes penis legitimis proùt civilibus legibus sunt statuti , volumus per nostros judices comdempnari .
(3) 1314-25 novembre. Pièce orig. en parch.
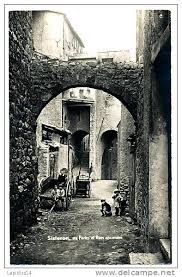
Chez eux aussi, les injures entre particuliers n'exposaient à des poursuites qu'autant qu'elles étaient accompagnées de voies de fait, ou que les parties refusaient de se rapatrier dans les dix jours (1). Après avoir obtenu les règlements de justice que nous venons de faire connaître , Lantelme Jarente sollicita et rapporta également de Naples la confirmation des priviléges dont ses compatriotes étaient en possession de jouir, ensemble une déclaration royale portant que la ville de Sisteron et son territoire, avec ses franchises, juridictions, hommes' , honneurs , prérogatives , etc., ne seront jamais aliénés du domaine comtal ; autorisant au besoin les habitants à se maintenir par la force dans cette disposition de leur antique droit, sans avoir pour le fait de leur résistance , aucune poursuite à redouter de la part des officiers royaux (2).
Charte de la reine Marie . ( 1386. )
Dans le conflit qui, après la mort de la reine Jeanne
(1) 1358 et 1359. - Liv. vert. 17 - 29.
(2) Dantes tunc et in eum casum , potestatem liberam hominibus civitatis ejusdem... quod possint se impune defendere et jus ipsorum domanii sive nostri , pro viribus , manu tenere... nec prétexta dicte defensionis et resistentie ob dictam causam domanii tuendi, possint per nostros officiales puniri... 1352. Liv. vert , fos 15 et 16 .
s'éleva entre son meurtrier (Charles de Duras ) et Louis d'Anjou que cette princesse avait appelé à lui succéder, conflit qui livra la Provence à la plus déplorable division, la ville de Sisteron n'hésita point éntre le souverain légitime et son odieux compétiteur. Par surcroît de malheur, Louis d'Anjou suivit de près Jeanne au tombeau ( 1384 ). Il ne laissait pour héritier qu'un enfant hors d'état de régner par lui-même ; et la situation du pays, déjà si grave, vint se compliquer encore d'une minorité que Louis par son testament reculait jusqu'à 21 ans. Dans la vue d'en abréger la durée, les habitants de Sisteron demandèrent au pape une dispense d'âge pour le jeune roi (1), En attendant ils s'adressèrent à la reine-mère ( Marie de Blois ), à qui la régence fut déférée en même temps que la tutelle de son fils, pour obtenir de cette princesse , outre la confirmation de leurs anciens priviléges , quelques concessions nouvelles. Dans la position où se trouvait la reine, il était peu à craindre qu'elle se montrât difficile à l'égard de quelques légères prétentions de la part de ses nouveaux sujets . Bien que Marie ne compte pas Guillaume de Sabran parmi les prédécesseurs légitimes de son fils (2), elle commence néanmoins à renouveler la disposition de
(1) Si supplere velit etati regis Ludovici minoris etatis , vel ne in formâ debitâ et juridicâ... 1386 - 28 mai. Reg. des délibér.
(2) Potestatem legitimam habentes.
la charte de 1212 , relative à l'engagement de ne point fortifier Sisteron et de n'y point loger de gens de guerre. Puis, attendu les malheurs qu'a éprouvés cette ville, la dépopulation qui s'en est suivie et l'importance de sa situation, à l'extrême frontière du côté du Dauphiné, la régente, de son propre mouvement et par des considérations de pure bienveillance, y ajoute l'abolition des cavalcades , tant en nature qu'en argent (1), et la remise générale de tous délits, peines, condamnations et dettes fiscales à la charge des habitants, ordonnant que pour leur plus grande satisfaction, tous les titres, procédures et papiers y relatifs , sauf en ce qui touche les causes civiles entre particuliers, soient incontinent brûlés sur la place publique, au-devant du palais (2) . Les vingt livres de couronnats que le domaine est dans l'usage de percevoir à Sisteron, sur les fours, l'étalage, le tonnage, le riverage et la chasse, sont convertis en une redevance annuelle et perpétuelle
(1) Déjà , depuis la destruction des faubourgs, les cavalcades avaient subi une diminution considérable ; la reine Jeanne, par ses lettres données à Averse , le 21 octobre 1359 , les réduisit de 200 à 50. Liv. vert. fos, 19 et 20.
(2) Precipimus et mandamus omnia cartularia criminalia et parlamentorum , latarum ac penarum falhitarum dicte curie regie civitatis Sistarici , existentia pro presenti , exceptis cartulariis de causis civilibus pendentibus inter partes , in platheâ ante curiam suprà dictam , illico penitus et omninò ignis incendio comburi et totaliter concremari , ad consolationem et gaudium ipsorum Sistaricensium nostroruin et regiorum fidelium dilectorum.
d'une paire d'éperons dorés , et il ne sera établi ni gabelle, ni aucun nouvel impôt ordinaire ou extraordinaire. Le bailliage, dans aucun cas, ne doit éprouver de démembrement, et les citoyens de la ville, comme ceux du faubourg la Baume, ne peuvent être arrachés à leur juridiction naturelle, si ce n'est pour des crimes dont la connaissance n'appartient point au juge ordinaire (1). Il est interdit au juge, sous les peines les plus sévères, d'intenter deux actions pour le même délit ; et afin qu'une parfaite équité ne cesse point de présider à ses jugements, il ne doit taxer les frais des procès criminels qu'après s'être enquis avec soin des facultés de chaque prévenu, se trouvant , pour tout ce qui concerne les habitants, dans l'obligation d'appeler et de consulter les syndics et de s'en rapporter aux renseignements que ces magistrats lui donneront. Avant d'entrer en fonctions les officiers royaux jureront , en présence des syndics , d'observer les priviléges, franchises et libertés de la ville, sous peine de n'être point obéis.
(1) On adéjàvu cette importante disposition consacrée dans la charte de Charles d'Anjou , en 1257. Depuis , elle fut renouvelée par Louis I ( Lettr. du 14 octobre 1399 - id. du 22 août 1408 ) et par François 1er. ( Lettr . du 26 janv. 1525 , données à St. Just près Lyon ) . Voir encore , pour ce privilége , les lettres d'extradition d'un habitant de Sisteron, détenu dans les prisons d'Aix, à la date du 20 décem . 1436. Orig. en parch.
Il est défendu à la cour d'appliquer la confiscation aux habitans de Sisteron, ainsi qu'à ceux de la Baume et d'Entrepierres, pour cause de retard dans l'acquit des services dont ils sont redevables , la peine de payer double devant , en ce cas , suffire. Les préposés aux droits de péages qui ne se trouvent point à leur poste, lorsque les marchands de la ville et du bailliage de Sisteron passent avec leurs marchandises, sont tenus de s'en rapporter à eux, s'ils déclarent, sous la foi du serment, avoir déposé le droit auquel sont soumises leurs marchandises, dans la boîte (socha) ordinairement disposée , à cet effet, sur la route . Le domicile des citoyens est inviolable, et lorsque par l'exigence de leurs fonctions , les officiers de la cour seront dans le cas d'entrer la nuit dans quelque maison de la ville, ils ne pourront y procéder, sans être accompagnés de deux ou trois personnes ayant qualité pour une telle assistance et prises parmi les plus probes du voisinage (1 ).
(1) Pravam consuetudinem que per subvicarios et alios officiales et servientes curie regie dicte civitatis Sistarici qui , quâdam pretensa suspicione , intrant ut plurimùn et intrare consueverunt de nocte et horis suspectis in domibus civium et habitantium utriusque sexûs civitatis ejusdem eorum officium exercentes , per cujusdam extorsionis abusum extitit usitata penitûs extirpantes , subvicarios , officiales aut servientes tales , de nocte seu horâ suspectâ intrare eorum officium exercendo infrà domum aliquam predictorum Sistaricensium , nisi tamen secum priùs adhibitis et associatis duobus vel tribus propinquiorbus vicinis talis domus , probis et ydoneis, perhempni nostra provisione , vetamus , quotiens autem facient contrarium , penam gravem arbitrio curie se noverint incurrisse.
Les peines portées contre les concierges qui extorquent de l'argent aux prisonniers, sont non seulement rappelées et de nouveau consacrées, mais encore, elles donnent lieu à une lettre interprétative fort étendue et qui est également insérée dans le Livre vert (1). C'est à Sisteron même, que Marie de Blois accorde aux habitants la charte dont il est ici question, charte qu'elle s'engage à faire ratifier et confirmer, en son entier, par le roi Louis son fils , aussitôt qu'il aura atteint sa majorité (2) ; promesse qui fut religieusement tenue (3). Pour compléter le tableau de nos anciennes institutions judiciaires , nous allons réunir ici diverses dispositions que nous trouvons éparses , notamment dans le Livre vert ; car, nous l'avons dit, il y a peu d'ordre dans ce recueil, et la table qui, on se le rappelle , y fut jointe en 1387, n'a pu faire disparaître ce défaut, qui n'est pas moindre pour les pièces postérieures à cette époque. Ces dispositions méritent d'être connues; les voici à leur date. Il y a de cette mêmeannée 1387, un règlement qui
(1) 1387-9 septembre fo . 62.
(2) 1386-29 juillet. Orig. en parch. et Liv. vert. fos. 57 - 61. ۷۰
(3) Le 14 octobre 1399. Liv. vert, fo. 66.
limite à la simple connaissance des faits, la compétence des cominaux, attribuant au juge seul l'exécution des décisions prises par ces magistrats (1). En 1408, les maîtres rationnaux rappellent au clavaire, sous peine de cinquante livres d'amende, que le droit imposé au débiteur en retard, droit connu sous le nom de latte, doit se percevoir seulement à raison de deux sols par florin, lorsqu'il s'agit d'un habitant de Sisteron, et du tiers en sus, si ce droit est supporté par un étranger. Il est dit que ce tarif est celui du livre Leopardus conservé aux archives du roi, à Aix. Le registre dont il est ici question, et qui ne se trouve plus parmi ceux de l'ancienne cour des comptes, était spécialement consacré aux titres relatifs à la ville et au bailliage de Sisteron. Il avait été écrit en 1332, par Léopardde Foligno, archiprêtre de Bénévent, conseiller chargéde la réformation des droits du roi, et inspecteur des officiers du trésor (2). Tout juge qui aura reconnu l'innocence d'un accusé est tenu, sous de graves peines, de condamner le dénonciateur à des dommages-intérêts envers la partie
(1) Liv. id. fo. 84 vº et 85 .
(2) In quodam regestro quod Domini Leopardi regestrum dicitur.... hoc est regestrum regium de civitate Sistarici et ejus bajulie factum et assumptum per venerabilem circunspectum virum Dominum Leopardum de Fulgineo , archipresbyterum beneventorum , regium consiliarium et in civitatibus provincie et Forcalquerii super reformatione jurium regiorunı et contrà officiales generales inquisitor.... Liv. vert.
lésée ; et si, par une légèreté indigne de son ministère ou autrement, il porte une sentence contraire à l'équité, et qui par suite soit réformée en appel , ce magistrat payera les dépens occasionnés par l'appel et y sera contraint, s'il y a lieu, par son successeur immédiat (1). Il est défendu de prendre en gage les chevaux de guerre, les harnais et les bœufs de labour, à moins qu'il ne reste pas autre chose au débiteur (2). Les ecclésiastiques n'ont point le droit d'arracher à la juridiction civile les laïques qui leur doivent des cens et des services (3). Il est permis au créancier de faire arrêter un étranger pour dettes contractées par lui à Sisteron, jusqu'à la concurrence de trois florins (4). Les habitants de Sisteron ne peuvent être cités à Lurs par-devant l'official (5), ni devant le conservateur des juifs (6).
(1) Sub pena formidabili , ut tales denunciatores , quicumque sint condempnent in expensis , per denunciatum passis , ratione talis temerarie denunciationis et condempnatos ad illas solvendum denunciatis compellant.... In causis civilibus et criminalibus decidendis transeunt sicco pede ... vel alias inique pronunciando... In sumptibus et expensis per appellationem passis et ad illos solvendum possit et debeat per suum successorem astringi et compelli. 1414-24 janv. id. fo . 92. v° 93 .
(2) 1427 - 26 octobre . Id. f 99. v°.
(3) 1429 16juin .
(4) 1435 4 août. Lettr . de la reine Isabelle .
(5) 1440-5 septembre . D'après un article de la réforme du chapit . de 1431 , lajuridiction épiscopale devait se tenir à Sisteron et non àLurs.
(6) 1452-10 avril. Liv . vert. fo 55 vº. Le conservateur des juifs connaissait des crimes commis ou soufferts par cenx de cette nation; et nul juge soit séculier , soit ecclésiastique n'avait le droit de s'immiscer dans la justice judaïque . A l'appui de cette définition , Ducange à qui nous l'empruntons, cite un diplôme du comte de Provence, de l'an 1424.
Nulle cause, de quelque nature qu'elle soit, ne doit être jugée par des commissaires, mais par les voies ordinaires (1). Si le juge est suspect , on lui donne un adjoint (2), mais il ne peut avoir de lieutenant. En cas d'absence il est remplacé par le plus ancien jurisconsulte (3). Le juge, avant de prononcer une sentence, levait les yeux au ciel pour y puiser, comme à l'unique source de toute justice, ses inspirations . Il débitait ensuite quelques lieux communs de droit , arrivait à l'affaire et finissait par le signe de la croix , jurant sur l'Évangile, en témoignage de son impartialité , que sa main ne se portait pas plus à droite qu'à gauche (4)
(1 ) lbid.
(2) Lettr. de Charles VIII du 4 octobre 1486. Pièce orig .
(3) 1543-2mars . Id.
(4) Notum facimus universis quod eterni providentiâ judicis a quo recta proceduntjudicia ordinavit ut justi judices eligantur in orbem qui rectè judicent , justitiam diligant et eorum intentiones et opera soliinhereantequitati... nam materias jurgiorum reprimit , delinquentes punit et unum ledi ab altero non permittit.... attendentes quod is quem labes non inficit nulla debet dampnati penâ plecti , quin ymò juri sanctius est nocentem absolvere quàm innocentem condemnare in dubio.. Sacroque santis evangeliis nobis positis in conspectu , ut de vultu Dei rectum prodeat judicium et oculi nostri solam videant equitatem , munientes nos signo venerabilis sancte crucis , dicentes : in nomime patris , etc. , non declinantes plus ad dextram quàm ad sinistram ... 1360-7 décembre. Liv. vert . f . 27 et 28.
Droit de Cité.
Depuis la catastrophe qui enleva à la ville ses faubourgs, et la peste qui fit si une profonde plaie à sa population, le conseil offrit, à diverses reprises, ua asile et des garanties aux étrangers qui, à cause des dangers de la guerre, voudraient transporter leur domicile à Sisteron (1). Dans ces temps de troubles , de telles offres n'étaient point à dédaigner. Où trouver en effet une ville qui , mieux défendue et par la nature et par les ouvrages de l'art, présentât plus de sûreté , et où , en même temps il régnât plus de liberté, plus d'égalité et plus de respect pour les droits des citoyens ? Aussi, attirés par tous ces avantages, les étrangers se montraient-ils fort empressés de venir en profiter. Les seigneurs du bailliage, malgré la triste nécessité où ils étaient de vivre sous le niveau du droit commun, avaient pour la plupart une maison d'habitation à Sisteron ; quelques-uns même , comme les
(1) Attendentes pericula guerrarum que hodiernis temporibus occurrunt , volentesque presentem civitatem replere bonis hominibus pro tuetione dicte civitatis ... ordinaverunt quod quicumque volens venire ad hanc civitatem eum inibi commorandi et majorem partem bonorum suorum ibi mutare , venire possit salvè et securè cum lavoribus suis et vino quod haberent ubicumque dùm tamèm illa habeant de vineis suis propriis, aut de redditibus suis , dùm tamen prestent sa- cramentum fidelitatis ... 1390-20 novembre . Reg. des délibér.
d'Agout , les Ventayrol , les Valavoire , les Justas , les Gombert-Saint-Geniés y faisaient leur principale résidence. A leur exemple, le grand sénéchal de Provence, Raymond de Glandevès, seigneur de Faucon, désirant lui aussi acquérir le titre de citoyen de Sisteron, exposa au conseil l'intention où il était d'avoir une maison et quelques biens dans la ville ou le territoire, et d'y supporter sa part des contributions. Cette demande n'ayant rien que de conforme au droit et aux usages établis , le sénéchal fut autorisé à acheter des propriétés jusqu'à laconcurrence de deux mille écus , à la charge par lui de payer un écu d'or pour venir en aide à la communauté (1). La réception des nouveaux citoyens était un acte plein de solennité. Voici comment on y procédait. Après avoir exprimé , dans une humble supplique , le désir de devenir citoyen de Sisteron , le récipiendaire,
(1) In quo qui lem consilio fuit expositum quod spectabilis et magnificus Dominus Raymundus de Glandéves Dominus de Falcono, magnusque comitatum Provincie et Forcalquerii Senescallus intendit esse civis presentis civitatis pro se et suis et emere domum et alias possessiones sibi necessarias et vult solvere pro ratâ suâ subsdiorum et omnium occurrentium ipsi universitati .... et quod dictum consilium sibi taxet ea que videbitur faciendi sive solvendi. Dictum consilium attendentes voluntate ipsius Domini de Falcono consilium ipsum taxavit eumdem Dominum de Falcono et suos quod ipsi et teneantur et debeant solvere in adjutorium onerum dicte universitatis et talhiarum unum scutum auri et quod emat in presenti civitate et ejus territorio , usque summum duorum millium scutorum... 1482-29 octobre . Reg. des délibér.
introduit devant le conseil assemblé et en présence du bailli, se mettait à genoux et là,jurait sur le livre des Évangiles qu'il tenait en main, de se conduire en bon et loyal citoyen , d'agir constamment dans les intérêts de la communauté, et d'empêcher, ou s'il ne le pouvait , de révéler soit les paroles , soit les faits qui, à sa connaissance, y seraient contraires, promettant formellement de ne s'attacher qu'à l'utile et de s'abstenir de tout ce qui ne tendrait pas évidemment à ce but (1). Le nouveau citoyen s'engageait ensuite à transférer dans l'année la majeure partie de ses biens à Sisteron, et d'y contribuer aux tailles à l'égal des autres habitants, moyennant quoi il était admis à jouir de tous les priviléges , libertés et franchises de la ville ; et en outre , à titre d'encouragement , de l'exemption pendant cinq ans de toutes charges communales. Entouré de telles formalités, le récipiendaire se pénétrait aisément de toute l'importance du droit qui lui
(1) Qui quidem flexis genibus et corporali juramento prestito per eumdem libro tacto ... promisit et convenit ad sancta Dei Evangelia juravit .... esse bonum et legalem.... utilia dicte universitatis perpetuò agere et inutilia pretermittere et non esse in loco vel locis , in quo vel quibus aliquid contrà universitatem predictam re, verbo vel opere fiat vel tractetur, quin ymò si premissa ad ipsius veniant noticiam , pro suo posse obviabit , et ubi obviare non posset , quam primo potuerit , re- serabit universitati predicte . ( Voy. délibér. des 19 juill. et 10 janv. 1356-13 septembre 1357 - 15 mai 1378-7 novembre 1390, et délibér . du dernier février 1392, pour la réception de noble Isnard de Justas, seigneur de Peipin ).
était conféré. Il en comprenait mieux aussi l'étendue de ses devoirs envers sa nouvelle patrie. Il savait du reste ce qu'il avait à craindre s'il s'en écartait ; car il y allait de la perte de son droit de cité. Si , après les avertissements qui devaient lui ètre donnés, le contrevenant n'en tenait aucun compte, le conseil prononçait la sentence qui le privait à perpétuité, lui et les siens, de tous les honneurs , prérogatives et immunités dont il avait joui jusques là en sa qualité de citoyen de Sisteron (1). Telle est la peine qu'encourut en 1393 Pierre Henrici, pour avoir accepté l'office de notaire de la cour royale, contrairement au privilége qui ne permettait à aucun habitant du pays d'exercer des fonctions près cette cour (2). En réunissant la Provence à leur couronne, les rois de France prirent l'engagement solennel de maintenir sa constitution intacte. Sur la demande des États ( 1480 ), le dernier comte avait déclaré que, là où
(1) Ordinaverunt quicumque venerit vel venit contrà privilegia , immunitates , statuta , libertates , utilitates , usus et consuetudines et franquesias , commoda universitatis predicte , notificetur et inhibeatur eidem ac requiratur per syndicos et consiliarios dicte civitatis quod a talibus desistat et non contra faciat , dicat vel veniat , aliquo modo , vel ingenio , quod si post sibi semel notificatum et dictum fuerit , nolit desistere , ab omni honore , privilegiis , immunitatibus et franquesiis dictam universitatem tangentibus , perpetuò sit exclusus et sui nullatenùs gaudere possit nec sui. 1388 - 18 septembre. Publication dans le Reg. des délibér.
(2) 19. janv. Reg. des délibér.
des statuts particuliers ne dérogeaient point au droit commun, la loi romaine continuerait à servir de règle. Il n'y avait donc plus , après d'aussi sages précautions, qu'à se reposer entièrement sur la fidélité des nouveaux souverains à garder leurs promesses. On ne saurait, on l'a vu, s'y engager avec plus d'empressement et de meilleure grâce. Heureux, si des circonstances plus fortes sans doute que leur volonté , n'étaient venues quelquefois en arrêter l'effet ; et si, à côté des nombreux témoignages que nos archives conservent du respect de ces princes pour nos libertés, nous ne devions rencontrer aussi des actes qui ne s'accordent guère avec ces manifestations. Parmi les documents qui nous restent de la période française, le plus remarquable est la belle charte de François Ier dont nous avons parlé plus haut. Cette pièce est d'autant plus intéressante, qu'elle reproduit textuellement la plupart des anciens priviléges, et que, dans le nombre des titres renouvelés , il en est , tel que le traité conclu avec Guillaume de Sabran , dont l'original ne se retrouve plus . Toutefois , comme ce document, ainsi que tous ceux qui lui sont postérieurs (1), ne sont plus, en fait de garantie , que la confirmation
(1 ) Lettres d'Henri 11. - mars 1547. ( N'existent plus que pour mémoire , dans les anciens inventaires ) . - Lettr. de Charles IX . - novembre 1564 - id. d'Henri IV. juill. 1600, et de Louis XIII . novembre 1622. En orig. aux archives
de ce que nous avons déjà vu, nous n'aurons plus qu'à jeter un coup d'œil sur la constitution particulière du bailliage et sur les actes émanés du concours des trois états.
III
LE BAILLIAGE, SA CONSTITUTION, SES TROIS ÉTATS.
Le Bailli dont il est fait mention dans la charte de 1212 atteste que dès lors, ainsi que la commune, le bailliage de Sisteron était constitué. Ce ressort était originairement plus étendu qu'il ne le fut depuis. Nous avons la preuve que la vicomté de Tallard et le village de Barles réuni plus tard au bailliage de Seyne, en faisaient partie (1). S'il fallait même en croire le dénombrement publié à la suite du burlesque poème d'Antonius de Arená, sur l'entrée de l'empereur Charles-Quint en Provence ( 1536 ), quelques dépendances du Serrois, comme Orpierre , Arseliers , Ribiers , Eourres , St.Pierre-Avès y auraient été également comprises. Mais quelle autorité, en fait de statistique , que celle d'un poète, et d'un poète tel que l'auteur de la Meygra entreprisa (2)! Il semble, à la vérité , plus sûr de son fait , à l'égard du bailliage de Sisteron, qu'à l'égard de plusieurs autres qu'il ne donne qu'accompagnés de cette formule : Segum mateste, segummonavis, segum mon breviaire et usage de ma teste. Toutefois entre sa nomenclature et celle des anciens affouagements , il y a encore trop de variantes, pour qu'il ne soit pas permis de douter qu'il ait eu ici de meilleurs guides. Il est certain du moins , que longtemps avant la révolution de 89, la viguerie de Sisteron, qui avait remplacé le bailliage, au lieu de 81 communautés,
(1) In loco de Talardo bajulie Sistarici ( 1385 - 28 août. Reg. des délibér ) député à l'assemblée du bailliage , pro vice comitatu talardi Raymumdusde Fonte ( 1391-28 août. Reg. id. ). Quant per lo castel de Barles que a mes e tresportat en la bayllia de Seyne , ben que fos en la bayllia de Sestaron ... ( 1391 id. et à la fin du vol. Pièce A).
(2) Meygra entreprisa catoliqui imperatoris etc. in Avenione 1537. In 8º . Goth.
que lui assigne le poète macaronique, n'en comptait que 62, et 64 , d'après l'affouagement de 1776 qui est le dernier. Il nous reste de Raymond Bérenger, dernier comte de la maison de Barcelone, un règlement fait avec les barons et les nobles du bailliage de Sisteron (1237), dont l'objet est de fixer la limite et les droits des juridictions respectives, ainsi que la nature des services dus au souverain. L'importance de ce document se révèle dans les dispositions qu'il renferme , au sujet des habitants des campagnes ; car dans ces dispositions est toute la jurisprudence applicable alors à ces populations qui, ne relevant point directement du domaine comtal, avaient particulièrement à se défendre, et contre les abus de la force, et contre l'arbitraire d'un gouvernement exceptionnel. Suivant ce règlement , les crimes publics, tels que l'homicide, le vol sur les grands chemins, la violation des maisons religieuses sont punis par le prince, soit selon le droit commun, soit d'office par la confiscation des biens des condamnés (1), et les barons , chacun dans ses terres , ont àjuger les injures , les querelles , les voies de fait sans effusion de sang , et les délits ruraux.
(1) Sive jure ordinario , sive ex officio in bonis dampnatorum.
Les barons connaissent aussi de toutes les causes civiles dans l'étendue de leur juridiction, sans empiéter sur celle que le comte exerce dans les villes ou dans ses propres terres. Si le vassal d'un seigneur manque à des engagements pris dans une ville de la dépendance du comte, le juge de celui-ci prend connaissance de l'affaire, et le seigneur est tenu de faire comparaître l'accusé dans le délai de dix jours . Sur le refus ou la négligence du seigneur de rendre la justice, le comte y pourvoit . L'adultère qui, pour ce fait, a encouru les foudres de l'Église, est, ainsi que sa complice, chassé du lieu où le crime a été commis , et si , dans les dix jours qui suivent l'excommunication , l'expulsion n'a pas été prononcée , la cour du comte a le droit de faire exécuter la sentence. Pour ce qui est des obligations du service militaire, il est dit que les barons, les chevaliers et leurs hommes (1) doivent au prince et à leurs frais, un service de quarante jours, dans l'étendue du comté de Forcalquier, à raison de six lieues de marche par jour ; après quoi, si le service se prolonge, il est à la charge du comte. Toutefois, si le pays est envahi, ou si une ville vient à être assiégée, alors dans ce cas extraordinaire, un service extraordinaire est également dû (1).
(1) Barones et milites et homines.
Le nombre d'hommes à fournir pour le bailliage de Sisteron est fixé à 75, dont quarante-sept fantassins qui sontles hommes des communautés, et vingt-huit cavaliers . Ceux-ci doivent être armés de toutes pièces et avoir haubert, cuirasse, chaussure, pourpoint et casque en fer (1). Tout chevalier, avec son cheval armé, reçoit dix livres viennoises pour les quarante jours de service, et cent sols, avec un cheval non armé (roncino). Si un chevalier ne se rend point à l'appel, il perd son cheval et ses armes ; et si son cheval lui est pris, le cheval ou la valeur lui en est restitué, par laville ou le village pour lequel il marchait. Le prince ne peut contraindre un chevalier à se racheter du service pour de l'argent. Le droit d'albergue ou de gîte sera acquitté tous les ans le jour de St.Michel, et payé double, en cas de retard; moyennant quoi, le comte et ses baillis doivent se loger à leurs frais. Le comte n'a de subsides à prétendre que dans les cas impériaux. Si les services dus par les seigneurs châtelains ne sont point acquittés, ils restent à la charge des communautés (2).
(1) Lorica et caligis , albergo , porpunto , scuto et capello ferreo.
(2) Statuta bajulie Sistarici. Reg. pergamenorum , fo 14 ( arch. de l'anc. ch. des comptes à Marseille).
En 1296, les communautés, ainsi que les seigneurs châtelains et toutes personnes exerçant une juridiction dans le bailliage, furent convoqués à une assemblée qui devait se tenir dans les premiers jours de janvier, à Valensole. Aucun historien n'a parlé de cette assemblée dont le but est resté inconnu. Il est dit seulement qu'arrivés à Valensole, les députés y recevront communication des intentions du roi (1) , Charles II était alors en Provence, où il employait les premiers moments que lui laissait la paix à faire oublier à ses sujets les inévitables maux d'une longue guerre. Une des conditions de cette paix, qui venait à peine d'être conclue (1294), était le mariage de sa fille Blanche avec Jacques, roi d'Aragon, événement qui, étant au nombre des cas impériaux, autorisait, à ce titre, la demande d'un subside. Il est à présumer que c'est à quoi les états de Valensole eurent à pourvoir. Presque toujours malheureux dans ses expéditions
(1) Omnes nobiles Castellanos et alias quascumque personas jurisdictionem habentes in bajulia.... ut ab hodie in xv diebus compareant coram nobis , vel altero nominato in villa Valensolie ad audiendum ea que ex parte majestatis regie eisdem duxerimus referenda ... Volumus etiam et mandamus quatenùs universitati Sistarici et cuilibet ville jurisdictionis vestre denuncietis et nihilominus precipiatis ut quelibet ipsarum universitatum , die predictâ , mittat duos syndicos legitime constitutos.... ad audiendum et faciendum quidquid coràm nobis per predictos fuerit faciendum... ( Lettre écrite par' Ermengaud de Sabran , conjointement avec Hugues de Vins , grand sénéchal de Prov. au bailli et au juge de Sisteron , le 27 décembre 1296. Roul. en parch).
au delà des Alpes, le roi Robert sentit de bonne heure son ambition se refroidir. Les affaires même où son incontestable habileté lui procura des succès qu'il n'obtint jamais par les armes, n'avaient plus pour lui le même attrait. S'étant résolu d'appeler Jean, duc de Calabre, son fils unique à partager le poids et les soucis du gouvernement, il le fit reconnaître , en cette qualité , par ses sujets. A cet effet, le député de la ville et du bailliage de Sisteron, (terre Sistarici) arrive à Aix. Il y rend hommage-lige au jeune prince, et lui prête le serment de fidélité, sous la réserve des priviléges et franchises du pays. Papon prétend que cet acte d'association eut lieu en 1311 (1). Mais en 1311 le duc de Calabre avait à peine quatorze ans. Il semble que cette seule réflexion aurait dû avertir Papon de sa méprise. Le titre sur lequel nous nous appuyons est en date du 1er mars 1320 (2). C'est surtout dans les dernières années du xıvº siècle , lorsque Raymond de Turenne a envahi la partie orientale du bailliage ( 3), que les trois états prennent
(1) Hist. de Prov. tom. 111 , p. 53 , preuv.
(2) Chart. orig. en parch.
(3) Raymond de Turenne était neveu des papes Clément vi et Grégoire xı. Sa famille devait , à la faveur de ces pontifes et à la faiblesse de la reine Jeanne ,sur certain nombre de terres aliénées du domaine Comtal , contrairement aux lois du pays. Mais après la mort de cette princesse , le premier acte de son successeur fut de revenir sur ces aliénations . C'est pour s'opposer à cette revendication que Raymond prit les armes et qu'il se jeta principalement sur le bailliage de Sisteron, où, parmi les terres données à sa famille , se trouvaient celles de Valernes , de Vaumeil , de la Motte , de Bayons , de Bellaffaire et de Gigors . ( Voy. Papon. Hist . de Prov . Tom. III . p. 194 , 256 , et aux Preuv. p. 64 ) .
une active part aux affaires. C'est qu'il y va de l'intérêt de tous ; c'est que jamais intérêt ne fut plus pressant. Clergé, noblesse, communautés , tous sentent que ce n'est point trop de leurs efforts réunis pour conjurer l'orage qui les menace et repousser l'ennemi public. Déjà , lors de l'apparition des tards-venus ( 1364), le pape, à l'exemple de quelques-uns de ses prédécesseurs dans des circonstances analogues, avait dérogé aux priviléges de la cléricature , en ordonnant aux ecclésiastiques de contribuer aux charges nécessitées par la défense du pays (1). Les dispositions de cette bulle sont remises en vigueur (2) . Dans une assemblée du 28 août 1391 , où le
(1) Depuis la bulle clericis ad laïcos fulminée par Boniface VIII , en 1296 , le clergé ne pouvait être imposé que du consentement du St. siége.
(2) Voici , d'après la bulle d'Urbain V, quels étaient les excès auxquels se livraient ces misérables : Quando ecclesiarum et monasteriorum aliorumque piorum locorum incendia , hominum cedes et personarum ecclesiasticarum , nec non nobilium et ignobilium exilia miseranda , violationes pudicie ( sic ) matronarum vincula et carceres , execrabiles rapíne et destructiones secularium et ecclesiasticarum facultatum , aliaque mala tam animarum quam corporum , impietas quorumdam virorum crudelium quos sub titulo comitivarum, seu societatum immunitas aggregavit , in vici nis et remotis partibus pervenerunt hactenùs et proh dolor ! perveniendo non desinunt. (Bulle du 11 des kal. de déc. 1364 , adressée par le pa- triarche de Jérusalem à l'official de Sisteron et au prieur des dominicains de la Baume , en orig. aux arch . )
clergé a ses représentants, la ville de Sisteron compte six députés parmi lesquels les deux syndics ; la vicomté de Valernes, trois bourgeois , Pierre Amielh , Jean Motte et Marquis Bonet ; la vicomté de Tallard , Raymond de Lafont, et Astoin, Jean d'Ancelle. Les autres lieux sont représentés par les seigneurs respectifs, agissant tant en leur nom qu'au nom des communautés (1). Cette assemblée eut pour objet le rachat du Caire tombé au pouvoir de l'ennemi, et les instructions à donner aux députés qui devaient se rendre auprès de la reine Marie (2). Mais une affaire plus grave vient bientôt occuper les états. Le bailliage est accusé d'avoir entretenu des intelligences avec les rebelles et de leur avoir fourni des vivres. Il est obligé de se justifier de cette fâcheuse inculpation. Énumérant ensuite tous les sacrifices qu'a exigés de lui la défense du pays, il se croit en droit d'en demander la compensation avec un subside de trois francs par feu qui venait d'être établi , et dont le sénéchal pressait vivement la rentrée . « Puissant et redoutable seigneur, répondent les
(1) Nomine nobilium et popularium ( Délibér. du 20 juin 1391) .
(2) C'est en langue vulgaire , in romancio , dit la délibération , que sont écrites ces instructions comme monument de notre ancien droit bailliager , et comme specimen de notre langue vulgaire au xive siècle .
états du bailliage au sénéchal, vous nous menaces d'exécution militaire, si nous différons d'acquiter le nouveau subside. Que votre seigneurie daigne se rappeler que c'est sur nous qu'a pesé tout le fardeau de la guerre, dans l'étendue du bailliage: guerre honorablement terminée et aussi glorieuse, nous osons le dire, à notre souverain , qu'aucune de celles qui ont été soutenues dans le reste de la Provence. Tandis que sur d'autres points, avec des forces considérables et à grands frais, on obtenait à peine de faibles avantages, livrés à nous-mêmes et sans autre assitance que celle de Dieu et de MM. du bailliage de Seyne, nous avons heureusement triomphé de tous les obstacles et réduit l'ennemi à traiter , lorsqu'il a été impossible de le vaincre. Il n'est à la vérité, aucun sacrifice qui nous ait coûté pour arriver à ce but. Nos dépenses sont immenses. Parler d'une somme de douze cents francs (1) et de l'entretien de cent quatre-vingts chevaux, aux sièges de Briançon (2) et de Tournefort, indépendamment des frais énormes, occasionnés par le siège de Lazer, c'est dire que ces dépenses excèdent de beaucoup notre contingent dans la dernière taxe de trois francs par feu, à laquelle on veut nous soumettre.
(1) D'après le marc d'argent qui valait, à cette époque, 6 liv. 5 sols, ce serait environ dix mille francs de notre monnaie.
(2) Château situé non loin de Dromon, sur la route d'Auton et détruit alors par le feu.
Voilà pourquoi nous n'avons pas cru et nous ne pouvons croire encore que cette taxe doive nous atteindre, aussi longtemps du moins que nos propres avan ces employées, comme celles des autres bailliages, à la défense commune, n'auront point été, comme elles, admises en ligne de compte et généralement réparties sur tout le pays. D'ailleurs, dans l'impossibilité où se sont trouvés nos députés de se rendre aux derniers états, ne sommes-nous pas demeurés étrangers aux subsides votés sans notre participation ? Cependant un de vos lieutenants a exercé envers nous d'excessives rigueurs. Nous avons porté nos plaintes au pied du trône. Nous les portons aujourd'hui aux pieds de votre seigneurie. Ces plaintes sont justes ; elles ne seront point rejetée . Et quant aux soupçons élevés sur notre fidélité, mieux éclairé, redoutable seigneur , vous n'y ajouterez aucune foi. Nous n'avons jamais eu, et nous n'aurons jamais dans le cœur d'autre désir que de faire notre devoir et votre bon plaisir. Ainsi, nous ne saurions craindre d'être punis pour avoir bien fait et de recueillir les fruits amers de l'injustice pour prix de nos services et de notre sincère dévouement (1).
(1) 1392 - 21 Mars - 1393-15 juin . Reg. des délibér. Ces deux pièces assez longues et dont nous n'avons pu présenter ici que la substance , sont également en idiôme provençal. Non moins curieuses que les instructions précédentes, nous en donnons aussi le texte, à la fin du volume. Lett . B. С.
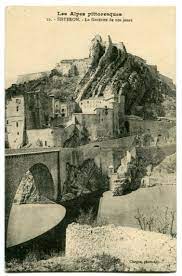
Devenus, à leur tour, le théâtre de la guerre, les bailliages d'Apt et de Forcalquier demandent du secours à leurs voisins de Sisteron. Mais ceux-ci y mettent une condition; c'est qu'il leur sera fait remise de tous les arrérages de subsides votés dans les assemblées générales d'Avignon, de Marseille et d'Aix. L'évèque est requis de veiller à l'exécution de la bulle relative à la contribution des ecclésiastiques (1) . Vers le même temps, sur la demande des trois états du bailliage, la reine Marie rappelle diverses dispositions souvent mal observées , telles que l'uniformité des mesures pour l'aunage des marchandises, l'obligation où sont les officiers royaux de ne proroger, sous aucun prétexte , leurs fonctions , au delà d'une année ; et de ne visiter soit les chemins, soit les châteaux fortifiés du domaine, sans une réquisition expresse des communautés, ou un ordre formel du roi ou du sénéchal (2). Ces visites étaient une source d'abus et de vexations de la part des agents de la cour. Les communautés qui en supportaient les frais avaient donc un grand intérêt à ce que tous les écarts de ce genre fussent sévèrement réprimés. Le bailli de Salignac s'étant avisé, nonobstant
(1) 1394 - 13 avril. Leg. id.
(2) Pro parte dilectorum fidelium nostrorum trium statuum , prelatorum , Baronum , nobilium et universitatum civitatis Sistarici et locorum bajulie ejusdem. 1391 6 sept . Liv. vert. fo 65 vº.
les règlements, de condamner à une amende de quinze sols couronnats chacun des habitants du lieu, pour n'avoir pas réparé leurs remparts , ainsi qu'il prétendait le leur avoir prescrit, bien qu'il n'y eût point été autorisé par les syndics de Sisteron, le juge , sur la plainte qui lui en est portée, casse la sentence du bailli , se contentant d'écrire en marge : Vu les priviléges et les libertés de la ville de Sisteron que nous sommes particulièrement tenus d'observer (1) . Voici encore un exemple de la sollicitude avec laquelle le conseil de Sisteron, placé à la tête des communautés du bailliage (2), veillait sur elles, et ne souffrait point qu'aucune atteinte fut portée à leurs droits. En 1392, Jean Eyssautier de Bellaffaire et Pierre Marco de Turriers , passant par Sisteron, y sont arrêtés , contrairement aux priviléges du pays, par ordre des officiers de la cour. Le conseil charge aussitôt les syndics de les réclamer, ordonnant en même temps , qu'en cas de non réparation de cette violence, il soit fait un exemple, et qu'à l'époque de leur syndicat , ces officiers soient poursuivis , selon toute la rigueur des lois (3) .
(1) Visis privilegiis et libertatibus universitatis Sistarici ad quorum observantiam proprie astringimur .... 1391 10 mars .
(2) In capite bajulie et loco insigni... 1417 - 25 sept. Orig. en parch .
(3) Quod tempore syndicatûs illorum de permissis omnibus fiat petitio et questio ut ceteris eorum successoribus talia attemptare vel similia presumentibus cedat publico in exemplum..... ( Délibér. du 2 sept) .
Il paraît, néanmoins , que les communautés n'eurent pas toujours à se louer du chef-lieu, en ce sens du moins qu'il les négligeait et que souvent une partie d'entr'elles n'était point convoquée aux assemblées bailliagères, bien que le concours de toutes y fût également nécessaire, et qu'il n'y eût rien de plus abusif, rien de plus opposé au principe constitutif du pays qu'un tel arbitraire. Les états du bailliage s'en plaignent à la reine Yolande qui accueille favorablement leur demande, reconnaissant avec eux que là où tout le monde a intérêt, là aussi tout le monde doit être appelé, de peur que par des omissions injurieuses et contraires au droit, les délibérations prises par des assemblées incomplètes ne deviennent un sujet de discorde (1). Les états demandent, en outre, et obtiennent l'autorisation d'avoir un ou plusieurs syndics chargés de suivre , à Sisteron, les affaires du bailliage et d'y défendre ses droits contre les entreprises des officiers de la cour ; car ces agents se portent sans cesse à des excès de pouvoir. Là où le ministère d'un simple sergent
(1) Ut quandocumque contingeret consilium bajulie qualitercumque et quâcumque ratione vel causâ in ipsa civitate vocari , ut omnes tàm prelatos quàm barones , nobiles ac universitates faciant evocari , ut quod omnes tangit ab omnibus approbetur , et nemini fiat injuria cum omittendo et ne înter eos posset super ordinandis discordia oriri... (1411-27 février. Liv. vert. fo 91 vº.
suffirait, le sous-viguier exploite, et en raison de sa qualité, aggrave les frais de justice. La reine défend à cet officier de sortir de ses attributions , et , dans le cas contraire, de recevoir au delà de ce qui est dû à l'agent dont il usurpe les fonctions . Elle déclare que les prélats, les barons et les communautés ne doivent rien pour leur convocation aux assemblées du bailliage, et que, pour eux, le droit de latte est le même que pour les citoyens de Sisteron (1) . Ces fréquentes violations des priviléges dont aucune , on le voit, ne passe inaperçue, avaient du moins un avantage : elles servaient à fixer de plus en plus le droit privé comme le droit public du pays , en provoquant des explications au moyen desquelles finissaient par disparaître les ambiguités, et , avec elles , tout prétexte à la mauvaise foi. A la mort du roi Louis II (1417), une grande cérémonie funèbre devant avoir lieu à Sisteron, le conseil de la ville ne veut rien ordonner , qu'au préalable les nobles et les communautés du bailliage n'aient été convoqués ; car , cette cérémonie , expression du deuil public, et une partie des frais qu'elle doit occasionner,
(1) Ibid. Après la mort de Louis 11, et pendant la minorité du jeune Louis III son fils, la reine Yolande accorda au pays la confirmation de tous ses priviléges et l'abolition de divers impôts induement établis (1419-14 sept. ) Orig. en parch. sac des priviléges.
les regardent également, et il est juste qu'ils soient consultés (1). Si éviter l'impôt est impossible, le réduire n'est pas souvent chose plus aisée. N'y aurait-il pas du moins, dans le mode de perception, quelque moyen de l'adoucir? C'est dans cet espoir que, sur les instances du pays , Louis II autorise les communautés à s'imposer comme elles l'entendront, et sans qu'il soit besoin de nouvelles lettres, pendant dix ans (2). Le roi Réné avait perdu , depuis deux ans , sa première femme, Isabelle de Lorraine, lorsqu'il se remaria (10 septembre 1454) avec Jeanne de Laval. Par la lettre que cette princesse écrivit d'Angers, à cette occasion, aux syndics de Sisteron, elle leur témoigne le regret de ne pouvoir se transporter par-delà, ce que grandement désirions, car très voulentiers vous eussions veuz et il est douteux, malgré la bienveillance
(1) Ordinaverunt quod attentis novis flebilibus et mestis per dominum senescallum presenti civitati per litteras suas missis de morte Domini nostri regis cujus anima in pace requiescat , fiat cantare sollempne , sed ante ea convocentur nobiles et plebey bajulie , quia causa presens tangit . 1417 17 mai. Reg. des délibér.
(2) Per plus laugierament portar los cares que an a portar , portan cascun jorn puestan et ad ellas sia licit de impausar et mettre sus revas impositions , gabellas, vinsens , quinsens , desens , juxta que miels lur semblara , per vigor d'aquest capitol et sensa autra concession de lettras à x ans contador de lo jorn que saran impausadas a en avant. ( Stat. de Louis It , donnés à Salernes le 28 oct. 1427. Liv. vert. fo 102) . Peu de jours auparavant ( le 21 oct. ), le même prince avait corfirmé au pays tous ses priviléges. Liv. id. fº 97. v°
de ces expressions, que la bonne reine mit autant d'intérêtà voir ses très chiers et bons amis les syndiques de Sisteron, ainsi qu'elle les appelle, qu'à les préparer tout doucement à une demande qui allait être faite au bailliage, de la part de son très redoubté seigneur et époux. Rien dans la lettre de Jeanne n'indique cette demande. Renfermée dans le ministère des grâces, elle se borne à offrir, dit-elle, à ses amis de bon cuer en tout ce que pourriez avoir à faire et besongne, envers mon dict seigneur, toute ayde et possible faveur; mais moins réservés, son amé fils Ferry de Lorraine, le sénéchal d'Anjou et le seigneur de Precigny (Bertrand de Beauvau), maître d'hôtel du roi, annoncent bientôt à la ville de Sisteron que le mariage du roi étant cas privilégié, ils avaient ordre de requérir , par chef de vigueries et baillies de Provence, ung don ou subside de cent mille francs (1). Cette somme fut donnée sans le concours des états : aussi , René s'empressa-t-il d'écrire pour déclarer que c'était sans tirer à conséquence et sans préjudice des priviléges, libertés et coutumes du pays (2) . Les députés de la ville et du bailliage de Sisteron étaient en possession d'occuper la quatrième place
(1) 1455. Reg. des délibér.
(2) Non posse pro futuro in aliqualem nocivam consequentiam trahi , aut privilegiorum , libertatum et consuetudinum..... infractionem..... Liv. vert fo. 114.
états de Provence. Les députés de Grasse ayant élevé la prétention d'y siéger et d'opiner avant eux, il s'en suivit une contestation fort vive , comme le sont d'ordinaire celles où la vanité des corps est intéressée , mais qui se termina par le maintien, à leur rang, des députés du bailliage de Sisteron. L'assemblée qui eut à prononcer sur ce débat et qui se tint à Aix , était présidée par l'évèque de Digne ( Antoine Guiramand ), prélat distingué et qui ne devait qu'à son mérite le suffrage de ses concitoyens (1). Les états , à cette époque , jouissaient encore du droit d'avoir un président de leur choix. Mais ce droit précieux, inséparable de toute représentation sincère, ils ne devaient plus le conserver longtemps. En 1535 (2), la présidence exclusive des états fut conférée à l'archevêque d'Aix, et cette atteinte grave, portée à la constitution du pays, ne fut malheureusement pas la dernière. Car, il était dans la destinée de ces vieilles libertés, jusque là objet de tant de respect, de n'être désormais pour le pouvoir qu'un sujet continuel de défiance et d'attaque ; triste fruit de cet esprit de licence que le xvı siècle jeta tout-à-coup au sein de la société, comme pour aplanir les voies au despotisme (3).
(1) 1503 10 décembre . Pièce orig. en parch.
(2) Edit du mois de septembre.
(3) On sait que Richelieu voulant se débarrasser des états qui gênaient son autorité , mais n'osant pas les supprimer , cessa de les convoquer ( 1639 ) et ne permit plus à la province pour toute représentation , que les assemblées des communautés.
Les besoins du trésor ayant fait imaginer de mettre à prix les charges, François 1er profita de cette ressource essayée par un de ses prédécesseurs ( Louis XI), pour créer, en Provence, des offices de Viguier (1). Sisteron est au nombre des villes qui dûrent avoir un de ces officiers. Dès lors, avec le nom de bailli, disparaît le nom de bailliage, pour faire place à ceux de viguier et de viguerie (2). Nous avons recueilli tout ce qui nous a paru propre à jeter du jour sur l'ancienne administration bailliagère, administration peu connue, ou du moins jusqu'ici, bien plutôt présumée que prouvée, faute de
(1) Édit du mois de mars 1541.
(2) L'office de Viguier subsista jusqu'en 1749 qu'il fut supprimé, comme office de judicature. Le dernier titulaire réclama contre cette qualification, prétendant que le viguier n'exerçait point de fonctions judiciaires. Mais, nonobstant sa réclamation, un arrêt du conseil du 13 oct. 1750 , porta la liquidation de son office à 2,400 livres, dont un quart payable par la sénéchaussée , et le reste à la charge de l'administration municipale ; d'où l'on peut juger, par les attributions complexes de cet officier, quelle était la part de chacune d'elles . Le juge royal créé, ainsi qu'on l'a vu dans le XIIIe siècle, comme le viguier, fut élevé dans le xvie siècle ( 1529 ), à titre d'office ( anc. ch . des comptes , reg. scipionis fo 76 ). De cette dernière époque seulement , date l'institution du procureur du roi . Au juge royal avait succédé, en 1640, la sénéchaussée, tribunal composé d'un lieutenant général, de deux lieutenants particuliers, l'un civil , l'autre criminel , d'un avocat et d'un procureur du roi. Il y avait, en outre, un lieutenant aux soumissions, tribunal particulier, reste de l'ancienne chambre rigoureuse de Provence, et qui exerçait la contrainte sur les biens et les personnes qui, aux termes de leurs contrats, s'étaient soumis à sa juridiction.
documents spéciaux qui s'y rapportent. Ceux que nous produisons fournissent, ce nous semble, assez de données pour justifier l'antiquité, comme le mécanisme de cette division importante de notre ancien système administratif, système que nous achèverons de faire connaître, en rappelant succinctement en quoi il consistait dans les dernières années de son existence. Suivant le dernier règlement (1), les assemblées de la viguerie sont annuelles . Elles se tiennent au chef-lieu, pendant le cours du mois de mai. Elles sont convoquées par les maires et consuls chefs de viguerie. Les assemblées ont pour objet les impositions, la construction et réparations des ponts et chemins et autres travaux à la charge de la viguerie. La nomination d'un receveur pour les impositions donne lieu à une assemblée extraordinaire ; il en est de même, lorsque l'administration supérieure désire avoir le vœu de la viguerie, sur quelque affaire importante. Le premier consul de chaque communauté assiste de droit à l'assemblée ; à son défaut , le 2º et le 3º consul, et en empêchement d'eux tous un des plus forts allivrés. Les trois consuls présents à l'assemblée n'y ont qu'une voix ; si l'un d'entr'eux diffère d'opinion avec ses collègues, deux l'emportent sur un, et la voix du premier consul prévaut, s'il est seul de son avis , contre chacun des
(1) Fait par l'assemblée générale des communautés tenue à Lambesc , au mois de déc. 177
deux autres également divisés. On opine à haute voix et à la pluralité des suffrages; en cas de partage, la voix du chef de la viguerie est prépondérante. Le maire, premier consul du chef-lieu, et à défaut le 2º ou 3º, fait les propositions à l'assemblée. Les députés des communautés présentent ensuite les demandes qui les intéressent. Les délibérations rédigées par le greffier du chef-lieu, lequel est greffier-né de la viguerie, sont signées par les maires et consuls chefs de viguerie et par ceux des deux communautés les plus affouagées. Une expédition est adressée aux procureurs du pays , pour être déposée aux archives de la province. L'assemblée ne donne lieu à aucuns frais . Les députés des communautés reçoivent seuls une indemnité pour leur déplacement. L'assemblée ne doit durer que deux jours. A la majorité d'une voix , les délibérations sont valables . La viguerie nomme son réceveur. Elle doit répartir sur les ponts et chemins les 24 francs par feu , votés annuellement par l'assemblée générale. Au-dessus de ce taux, toute imposition doit être soumise aux procureurs du pays. Le trésorier fait sa recette au chef-lieu. Il ne paie que sur les mandats du maire et consuls chefs de viguerie. Tous les six ans , le bail de la trésorerie est renouvelé, soit aux enchères , soit au choix , suivant que le juge l'assemblée. Le trésorier rend compte annuellement de la gestion devant les maires et consuls chefs de viguerie, et deux maires et consuls de communautés délégués à tour de rôle. Les comptes doivent être en triple original : le premier pour la viguerie, avec les pièces justificatives ; le deuxième pour le comptable, et le troisième pour être déposé aux archives de la chambre des comptes. Les frais, pour l'audition du compte du trésorier, sont à la charge de la viguerie, à raison de trois livres pour chacun des consuls du chef-lieu , de six livres pour chacun des consuls des communautés, et de douze livres pour le trésorier, y compris la dresse des trois originaux. Enfin , toutes les pièces relatives à l'administration de la viguerie sont conservées dans les archives de la ville chef-lieu. Un grand événement se prépare. Muries dans les intelligences, les idées de réforme vont passer dans les faits. Le roi a convoqué les états généraux (1er mai 1789). Les consuls d'Aix, procureurs du pays, écrivent aux consuls de Sisteron pour leur faire connaître les intentions de Sa Majesté. Ils leur adressent des instructions, en vertu desquelles les communautés du ressort doivent s'assembler en conseil général de tous chefs de famille, dans l'ordre des communes, et sous l'autorité du magistrat local. Il s'agit, pour les communautés , de nommer, chacune dans un bref délai , un député à l'assemblée de la viguerie et de procéder en même temps , à la rédaction des cahiers d'instruction et de doléances qu'elles désirent faire porter aux états généraux (1).» Les cultivateurs de la ville et banlieue
(1) 1789 - 10 Février , reg. des délibé.
de Sisteron, convoqués en particulier sous la présidence du second consul, sont représentés à cette assemblée par six députés de leur choix (1). L'assemblée de la viguerie, fixée au premier avril, se tient, suivant l'usage, au chef-lieu. Son objet à elle , est d'envoyer à son tour, à l'assemblée des sénéchaussées, indiquée pour le 15 du même mois à Forcalquier, huit députés (2), avec des instructions, parmi lesquelles on remarque les suivantes : L'assemblée désire qu'avant toute chose la constitution du royaume soit reconnue, et que les états généraux reçoivent une organisation régulière, pour le présent et pour l'avenir, de façon que le tiers-état s'y trouve en égalité parfaite de représentants librement et légalement élus. Elle demande qu'en même temps que les états généraux seront assemblés, les trois ordres soient également réunis, dans chaque province, afin de pouvoir s'entendre plus facilement et plus promptement sur l'interprétation des divers mandats et pour la conciliation des intérêts opposés. Les députés réclameront contre les abus qui ont vicié la constitution provençale, notamment contre l'édit qui, au mépris des imprescripibles droits de la province
(1) Id. 22 Mars. Reg. id.
(2) Règlement du 2 mars 1789 , avec le tableau y annexé.
,a imposé un président né aux états et contre l'union de la procuration du pays au consulat de la ville d'Aix. Il est dans les vœux de l'assemblée que d'inviolables garanties soient données à la propriété, à la liberté individuelle, au maintien de chaque citoyen dans sa juridiction naturelle, et que les juges de police ordinaire aient la connaissance de toutes les affaires dites au petit criminel, ainsi que des affaires civiles sommaires n'excédant pas cinquante livres, en principal. Elle désire également que l'armée soit réduite, que la loi qui exclut la bourgeoisie du service militaire soit révoquée ; que le tirage de la milice, s'il doit être conservé, soit confié aux seuls officiers municipaux, et que, dans aucun cas, pas même pour la levée des subsides, la milice nationale ne puisse être employée contre les citoyens ; Que les conseils municipaux soient toujours présidés par le premier officier municipal, au lieu et place des juges et lieutenants des juges des seigneurs ; Que les impôts librement consentis et accordés n'aient de durée que l'intervalle de temps fixé jusqu'aux plus prochains états généraux ; que les comptes de recettes et de dépenses soient annuellement livrés à l'impression, et que, dorénavant responsables , les ministres rendent compte à la nation assemblée des deniers publics, ainsi que de leur conduite ; Que l'impôt de la gabelle, désastreux pour l'agriculture et le commerce, soit détruit, et qu'il y ait pour tous les droits du fisc un tarif clair et intelligible à tous, principalement pour ceux du contrôle des actes ; Que les évêques soient tirés indistinctement de l'ordre de la noblesse et de la bourgeoisie; qu'ils ne soient promus à l'épiscopat qu'après avoir exercé, pendant dix ans au moins, les fonctions de curé ou de vicaire ; que leurs revenus actuels soient réduits et la portion congrue des curés augmentée, afin de rendre possible la suppression du casuel ; Que les dîmes soient supprimées et remplacées par une prestation en argent, uniforme et fixée une fois pour toutes ; Que les droits féodaux, odieux, avilissants ou oppressifs, soient anéantis, et que ceux qui ont une cause et un titre légitimes soient rachetables à prix d'argent. Les députés demanderont, en outre, la liberté de la presse, sauf les règlements que les états généraux seront dans le cas de faire à ce sujet(1) . C'est ici le dernier acte de nos anciennes assemblées de viguerie. Ici aussi se termine la tâche que nous nous étions imposée. Aurons-nous atteint notre but?
( 1 ) Cahier des instructions, pouvoirs et doléances des communautés du ressort de la sénéchaussée de Sisteron , du 1er avril 1789. Noms de Messieurs les commissaires rédacteurs: Teissier, Mévolhon , Hodoul , Hodoul ( de la Motte ) , Chabrier , Penchinat , Rochebrune Reynaud - la-Crose , Bucelle , Bon , Fichet, Réguis. ( Tiré des reg. de l'anc. sénéchaussée ) .
nous l'ignorons. Mais le sujet nous a paru susceptible d'un haut intérêt. Des institutions nées des besoins d'une civilisation lente, mais incessante, et qui toujours dans les mœurs, avant de passer dans les lois, obtinrent par cela même, la consécration des siècles ; des institutions qui ne laissèrent aucuns droits garanties et qui, on peut le dire, avaient résolu tous les grands problêmes sociaux; de telles institutions prises à leur origine, et suivies à travers les âges dans leurs développements successifs, à l'aide d'une série de documents, unique peut-être dans son genre et jusqu'ici restée inconnue; de telles institutions , disons-nous , forment , si nous ne nous abusons point , un tableau éminemment propre à appeler les méditations des esprits graves. Et combien n'est-il pas aujourd'hui d'esprits de cette trempe, même parmi nos plus jeunes hommes? Vit-on jamais et plus d'émulation et plus d'ardeur pour les travaux historiques ? N'est-ce pas à qui fouillera plus avant le sol de la patrie, ce sol où, sous de vastes ruines , se cachent les fondements de l'ancien ordre social , et , l'on peut ajouter hardiment, de tout ordre social durable ? car, on l'a dit, avec raison : « La force du présent, c'est le passé (1). » Puissent ces recherches que nous offrons à notre pays , répondre au désir que nous aurions de lui être utile !
(1) Antiquitas robur est novitatis. ( St. Ambr. in Tim. 3 ) .
Nous n'avons rien négligé pour mettre dans tout leur relief les monuments qui font l'objet de cette étude. Nous nous sommes attachés surtout à leur conserver leur expression native. Le grand nombre de textes et de citations dont nous avons surchargé ces pages, prouve jusqu'à quel point nous avons poussé, à cet égard, le scrupule, plaçant ainsi, sous l'autorité d'irrécusables témoins, la faible part qui peut nous revenir dans cette œuvre, avant tout, nous osons le dire, œuvre de conscience et de dévouement historiques.

APPENDICE.
CHARTE DE GUILLAUME DE SABRAN , USURPATEUR DU COMTÉ DE FORCALQUIER ( 1 ) . 1212. Nones de Février .
In nomine Domini nostri Jesu- Christi , anno ab incarnatione ejusdem M. CC. XII, notum sit omnibus hominibus tam presentibus quam futuris quod ego Guillermus Dei gratia , comes Forcalquerii pro servitio et honore quod mihi fecistis et facturi estis et per recognitionem dominii
(1) L'original de cette charte n'existe plus aux archives . La transcription même qui en avait été faite sur le premier feuillet du Livre vert a disparu. On dirait qu'une main ennemie s'est attachée à en effacer les traces. Il est certain du moins qu'à raison de son origine ce titre , ainsi qu'on peut se le rappeler , ne cessa d'ètre le point de mire de tous ceux qui avaient intérêt à en contester la validité. En 1601, suivant ce qu'on lit dans un ancien registre , il fut envoyé à Aix , où sa production était nécessaire dans un procès que soutenait la communauté. Peut-être n'en revint il plus. Heureusement , la charte de François 1r ( 1515 ) l'a recueilli et nous l'a conservé en entier. C'est de là que nous l'avons tiré . Le texte de cette pièce nous a paru assez important pour mériter place ici .
mei , bono animo et spontanea voluntate , omni fraude omnique dolo remoto , ut melius et sanctius potest intelligi , dono laudo et concedo vobis militibus , consulibus burgensibus et universo populo Sistaricenci , ac posteritati vestre in perpetuum per me et per omnes successores meos et bona fide promitto quod si comes Provincie vel aliquis pro eo petitionem vel appellationem vobis facere , quod ego respondebo ei et stabo rationi , quod si non facerem et per me staret , solvo vos ab omni conventione quam mihi fecistis et nullo modo mihi teneamini et consulatum confirmo vobis et ratum facio in perpetuum ; cocias quo- que volo et statuo quod habeat consulatus , clamores omnes et questiones veniant ante consules , exceptis homicicidio , furto , sanguinis fusione et criminibus . Item libertatem meram concedo vobis per totam terram meam quam habeo et habiturus sum , per aquam , per terram sine omni pedagio et usagio . Item , promitto quod nullum edificium seu munitiones aliquas faciam vel permittam fieri , infra civitatem Sistarici vel extra in territorio Sistarici . Item , contentus ero in cavalcatis C. peditum et V. militum infra comitatum meum per unum mensem in anno , ita dico si opus mihi fuerit. Item , promitto quod si aliquando mainatas alienas habuero , non hospitentur infra Sistaricum . Item , promitto quod justicias quas accipiam de hiis que ad me pertinent , quod cum consilio consutum et procerum accipiantur. Item , confirmo et corroboro notarium , item quem nullum hominem hujus ville bajulum faciam Sistarici fideliter promitto. Item ,dono et promitto quod vallem de nogeriis , vel aliquod castrum vallis nulli donem, nec à juridictione mea dividam. Item , si aliqua dissencio sive discordia inter me et milites hujusce ville sive proceres aliquos oriretur de possessionibus vel de aliis , ego promitto in consules et compositionem quam inter me et eos ponerent ratam habere et firmam. Item , si in aliquo contra Dominum meum avunculum sive me deliquistis , bonam pacem et bonum finem facio vobis omnibus et singulis . Item , confratriam vestram confirmo . Item , si in predictis omnibus que bona fide dono vobis aliquando infrangerem , vel irritarem , solvo vos omnes et singulos ab omni pacto et sacramento et fidelitate qua mihi tenenimi . Factum fuit in nonas februarii , infra aulam comitis , hujus rei testes sunt V. Sistaricencis episcopus (1) , R.
(1) L'Évêque de Sisteron, qui paraît ici sous la simple initiale V. n'est pas indiqué dans le Gallia Christiana : il en est de même du Prévôt R. Quant aux autres noms, souscrits en toutes lettres au bas de cette charte, tous ne semblent pas également corrects ; mais sans le secours de l'original , quel moyen de les rectifier ? Force nous est donc de prendre ces noms tels que le copiste du XVIe siècle , assez mauvais lecteur peut- être des écritures du XIII , nous les a conservés.
prepositus . V. D. Lamura guigo alamannus. Raibaudus dagoudo. Helyasaptensis. R. de Sancto Martino. Pelestrit Frosulus . pe.de Belloafar. pe. Garfanus, Tubanus . R. Isoardus pe . Eleemosinarius dicti comitis , notarius Baudoinus Johannes Rainaudus , Ugo Johannes notarius publicus , mandato Domini comitis presentem cartam scripsit et signum suum apposuit quam Dominus comes sigilli sui impressione voluit roborari .
ALLIVREMENT DES HABITANTS DE SISTERON (1)
1327. 12. Juillet .
Anno ab incarnatione Domini millesimo trecentesimo vicesimo septimo , die duodecima mensis julii Xº indictione. Noverint universi et singuli quod convocata universitate Sistarici ad sonum tube voce preconis , ut est moris mandato circumspecti viri Domini Petri de Fundis judicis Sistarici autoritate quarum dum litterarum viri magnifici 1
(1) Cahier recouvert en parchemin et composé de 24 feuillets de beau et bon papier, où l'on remarque, avec les traces bien distinctes des vergeures et des pontuseaux, une cloche avec son battant. (Vid. supra p. 16. )
Domini Raynaudi de Scaleta militis , comitatuum Provincie et Forcalquerii Senescalli , quarum tenor infra describitur , ad instantiam Johannes Tornatoris , Francisci Audeardi , Raynaudi Berengarii et Johannis amfocii de Sancto Vincentio syndicorum universitatis predicte. Sane quidem universitas in publico parlamento congregata infra curiam regiam civitatis jam dicte , coram dicto Domino judice ; eo ipso Domino judice volente et consentiente unanimiter et concorditer , nemine discrepante , elegerunt infra scriptos homines dicte civitatis quibus dederunt plenam generalem cum libera potestate reformandi libram . Raynaldus de Scaleta miles , comitatuum Provincie et Forcalquerii Senescallus , officialibus Sistarici , salutem et amorem sincerum. Habuit sapplicatio facta nobis noviter pro parte universitatis hominum dicte terre , fidelium regiorum , ut cum tempus reformande libre juxta quamtallie que indicuntur , juxta normamjuris et equitatis , reformari mandare , quorum supplicationibus , in hac parte benignius annuentes volumus et vobis expresse precipiendo mandamus quatenus libram ipsam ,juxta quam tallie ipse fiunt , ut prefertur , sic reformari , ut convenit protinus faciatis , quod per reformationem ipsam in contributione talliarum ipsarum, pro singulorum facultatibus facienda , quantum erit factibile , servetur equalitas inter cives .... Datum Aquis per virum nobilem Dominum Petrum de ultra Marinis de janua ; consiliarium Regium et familiarem , majorem et secundarum appellationum judicem , comitatuum predictorum , die vi mensis julii. x. indictione. Subsequenti anno et indictione quibus supra , die tertia decima dicti mensis julii , predicti electi supra nominati juraverunt ad sancta Dei Evangelia corporaliter , libromanu tacta , ordinata et disposita per eos juxta potestatem eis concessam , tenere secrete et nemini revelare sine concensu omnium vel majoris partis , et donec omnia fuerunt publicata , et publicam utilitatem , pro posse , preferri private et utilitatem ipsius universitatis facere et inutilia pretermittere , suo posse deinde ad predicta exequenda et ordinanda , ut infra sequitur processerunt. piendum extimationem ipsius libre , Johannes Chalvini ; Raynaudus Berengarii et notarius Johannes Tornatoris .... Anno incarnationis Domini millesimo trecentesimo vicesimo septimo , die quinta decima mensis julii x indictione , dicti Raynaudus Berengarii , Johannes Chalvini una cum dicto Johanne Tornatori notario inceperunt recipere extimam libre dicte civitatis et deinde successive continuis diebus complere , ut sequitur :
suit une très longue liste de nom que je ne reproduit pas ici.
Voilà donc la ville divisée en huit quartiers ou sections ! l'ordre dans lequel sont nommés ces quartiers marquerait au besoin la situation de ceux qui n'existent plus, si l'on ne savait d'ailleurs que le faubourg de En viis et Valgelé remplissaient , en avant de la porte de la Saunerie, cette enceinte qu'indiquent encore des restes apparents de fortifications et où figurait au centre l'église de Saint-Jacques . Enviis , In viis ou En vies , ainsi qu'on le trouve écrit , tirait peut-être son nom de ce qu'on était là comme sur la voie des diverses communications qui, du côté des Alpes, viennent aboutir à Sisteron ; et quant à Valgelé, comment ne pas reconnaître l'origine du sien, à l'aspect de ces lieux battus presque sans cesse par les vents du nord et couverts, une partie de l'année, des ombres glaciales du château (1) ? On ne sait pourquoi le faubourg de Saint-Etienne (2), à l'entrée de la vallée des Combes, remarquable par ses tanneries qui donnèrent leur nom à une des portes de la ville (aujourd'hui fermée à l'emplacement même qu'occupe la fontaine du Jallet), et Foralpra, qui étalait vers le pré de la foire et les cordeliers, ses vastes et hautes maisons et ses jardins fertiles (3); on ne sait pourquoi, disons-nous , ces bourgs ou faubourgs n'ont pas , comme Font chaude, obtenu dans l'allivrement les honneurs d'une section particulière et ne s'y trouvent que confondus avec le Rieu. Quoiqu'il en soit, malheur à toutes ces habitations extra murales ! car le moment approche , où leur existence, devenue incompatible avec la sûreté de la ville, va leur être impitoyablement sacrifiée.
(1) En 1416 , Guillaume Chaix prend en emphitéose un hermas situé hors des remparts : loco dicto en viis retro eeclesiam Sancti-Jacobi , confrontatum de supra juxta viam publicam vocatam in valgilay... (Registre du notaire Guillaume d'Aigremont, alias planta vignas , fº 29 , vº , au greffe du tribunal , où sont déposés les registres des anciens notaires) .
(2) Estimation des édifices qui doivent être démolis , in carriera burgi SanctiStephani , extra menia ( 1368-3 mai , registre des délibérations. Voir aussi registre de Guillaume Aspilhe, 1427 , fº 124 , où il est question d'une maison située in burgo Sancti-Stephani, au greffe du tribunal) .
(3) Quoddam burgum vocatum Foralpra , pluribus diversisque domibus et hospitiis altis et magnis..... Propter altitudines dictarum domorum quin etiam fertilitatem burgi predicti in quo tanta pars gentis dicte civitatis habitabat... (1359-20 octobre , liv. vert , fº 18.)
S'il n'est pas ici question de la Baume, c'est que ce faubourg ne faisait point encore partie de la ville à laquelle il ne fut réuni qu'en 1445. Après avoir subi la rectification d'un certain nombre d'erreurs presque inévitables dans un travail de cette nature , et laissé , il faut l'avouer , quelque confusion dans les sommes additionnées au bas des pages , l'allivrement se résume heureusement en toutes lettres , ainsi qu'on l'a dit à 106,108 livres réforciat , ou environ onze cent mille francs de notre monnaie. Il n'est pas sans intérêt de voir comment cette somme était distribuée dans les huit quartiers de la ville. En d'autres termes, pendant que Valgelé , la Coste , En viis et Font chaude, sont portés pour le modeste allivrement de 8-18-38 et 47 livres par chef de maison (nous négligeons les fractions), et que le Rieu et Bourg-Raynaud. élèvent le leur à 60 et 89 livres, la Rue droite et la Saunerie atteignent le chiffre de 240 et 280, possédant ainsi à elles seules les deux cinquièmes de la fortune de la ville. Ce n'est pas tout: cette fortune se concentre encore de telle manière que sur 164 habitans de ces deux quartiers réunis, 17 sont inscrits pour 20,000 livres, c'est-à-dire pour un cinquième de l'allivrement total. I l n'est pas étonnant, d'après cela, que les quatre coins où se forme la jonction de la Saunerie et de la Rue droite portasssent anciennement le nom de Place des Riches (1) . Malgré les réclamations de quelques nobles contre leur inscription dans l'allivrement, le fait seul de cette inscription opérée, en toute connaissance de cause, puisque le titre miles l'accompagne (2) , n'en est pas moins la consécration du principe qui ne donnait à personne le droit de s'exempter de l'impôt, sauf, comme nous l'avons fait observer, le cas où le souverain prenait sur lui de décharger le pays des franchises qu'il accordai . Ainsi , lorsque le seigneur de Lachau , Raybaldus de Calma et Guillaume de Sabran Domicellus, prétendent se prévaloir de leur noblesse
(1) Plathea divitum hominum. ( Registre des délibérations. Passim , notamment , Registre de 1368 , délibération du 30 juin ) . Pour l'honneur de l'étymologie , nous ne pouvons nous dispenser de rappeler à la police que la Saunerie, et non Sonnerie, ainsi qu'elle souffre qu'on l'écrive, dérive son nom des magasins de sel qui étaient exclusivement établis dans cette rue. Columbi avait déjà dit au sujet du quartier de Manosque qui porte le même nom : Saunariam vero dixerant a sale e salariis (vulgo Saunariis , seu hospitiis , seu tabernis , saleriam sive , salinariam latine diceremus. ( Hist. de Manosque dans les opuscula varia. In fº 1668 , f 444.)
(2) Dominus Petrus Celley miles , p. 165. Dominus Johannes de Remusato miles p. 169.
pour se soustraire à l'obligation commune, le collecteur se borne à constater leur refus de payer, sans reconnaître qu'ils y soient fondés (1) . Ils ne l'étaient point en effet. La franchise dont les seigneurs jouissaient dans leurs terres , se conçoit ; elle était juste, elle était le prix des sacrifices que la guerre leur imposait. Mais le service militaire n'était-il pas également obligatoire pour les villes qui, comme Sisteron, ne relevaient que du souverain ? est- ce que dans ces villes, les habitants ne payaient pas aussi de leurs personnes ? tous sans distinction, ne s'équipaient-ils pas à leurs frais, et ne servaient-ils pas même comme les nobles, à cheval (2) ? il n'y avait donc pas de privilége possible au milieu de telles populations, ni de charge que tous ne dussent supporter également. Ce n'était là, du reste, qu'une conséquence du principe de la taille réelle qui régissait le pays , et il ne faut pas s'étonner si la commune ne voulut jamais souffrir qu'il y fut dérogé, aussi longtemps du moins que ses libertés conservées dans leur pureté primitive lui permirent de les invoquer. Les clercs seuls, depuis la fameuse bulle de Boniface VI (1296), ne pouvaient être imposés sans le consentement du pape (3) ; aussi toutes les fois qu'il y a un clerc dans une maison, l'allivrement ne manque pas d'ajouter : excepto clerico.
(1) Item nobilem Raybaudum de Calma quia non vult solvere ( Liv. des compt. cour. fº 57) . Item Guillelmum de Sabrano domicellum quia non vult solvere ( Liv. fº 17) . Item Guillelmum de Sabrano, quia contestationem habet cum predicatoribus de domo pro qua ponitur in talliis. (Ibid. f° 56.)
(2) Supra. p. 96-97.
(3) Supra. p. 126.
Deux noms se présentent à Bourg-Raynaud, affublés chacun, de la qualification de questor. Inutile, on le pense bien, de songer à l'acception latine de ce mot qui , loin de là, par une étrange contraste , se trouve n'exprimer ici que le dernier degré de l'échelle sociale; car le Questor Bertrandus Caslari de Alesto et son confrère Raymundus Vallati (1), ne sont que de pauvres hères qui ont amassé, dans leur métier de mendiants (questorum), les six livres dont, n'importe l'origine , l'allivrement n'a pas cru devoir leur faire grâce. On demandera peut-être , comment les frères Cassini de Florence (2), et Antoine de Casalortio (3), également étranger, se trouvent jetés à Sisteron. Ce dernier était un jurisconsulte napolitain , arrivé sans doute à la suite de quelqu'un de nos rois . Son mérite l'avait fait nommer juge de la baronnie de Mévouillon ; à peine si dans Chorier , qui a occasion de parler de lui et qui l'appelle Chastellort (4) , il est possible de le reconnaître . Quant aux Cassini, c'était une de ces familles cosmopolites que l'Italie envoyait alors partout disputer aux juifs le monopole de l'argent. L'allivrement les atteint, parce qu'en s'attachant au sol, ils devaient naturellement en subir les charges. Plus adroits d'autres Italiens que nous voyons à la même époque à Sisteron, se tinrent constamment en dehors de la propriété , connaissant déjà l'art plus commode de vivre aux dépens
(1) Supra 180.
(2) Id. 163.
(3) Id. 201.
(4) Hist. du Dauph. Tom. 1.

de ceux qui l'exploitent. C'est ainsi que, devenus malgré eux propriétaires de quelques pièces de terre aux Combes et au plan de Saint-Etienne de Ribiers , les trois frères nobles Gandolphin , Boniface et Etienne de Soler d'Asti en Piémont ( cives Astenses ), au lieu de garder ces tristes dépouilles de la misère, se hâtent de les revendre (1), pour se livrer tout entiers aux opérations bien autrement lucratives de leur maison de banque. Cette maison subsista long-temps à Sisteron, et y fit , à ce qu'il paraît , d'assez bonnes affaires . Mais elle disparut à la suite d'un jugement qui condamne ces nobles Piémontais , pour divers faits d'usure, commis tant par eux que par leurs agents , notamment pour un prêt au 25 p. 020 , en force duquel ils retenaient en prison, depuis quatre ans, deux malheureux qu'ils avaient réduits à l'impuissance de se libérer (2). Nous remarquons qu'il y avait alors à Sisteron 20 notaires, dont huit à la Saunerie , trois dans la Rue droite , six à Bourg-Raynaud et trois au Rieu , et que sur 192 femmes, veuves ou filles majeures comprises dans l'allivrement, 21 quoiqu'en puissance de mari , y figurent, et qu'il en est même, comme Gilète , femmede Jean Després , qui supportent des estimations assez élevées, indépendantes de celles de leurs maris (3).
(1) Acte du 20 avril 1343.
(2) Tam per ipsos quam ceteros procures ipsorum , usuras de suis pecuniis reccpisse et suas pecunias sub usurarum voragine mutuasse, ipsos que nobiles Gandolphiņum et Bonifacium de Solerio fore de dicto usurarnm crimine difiamatos .... (Sent. du 8 août 1564. Orig. en parch. )
(3) Supra 191-192.
Presque tous les noms de l'allivrement de 1327 avaient déjà paru dans la charte de 1296 (1) ; ce qui prouve à l'honneur des citoyens qu'il n'y eut à signaler dans cette grande réunion que les absences inévitables ; car, en retranchant Ics femmes qui n'y étaient point admises et toutes les personnes retenues pour cause de maladie ou autre empêchement légitime, il serait difficile, sur une population de 1200 chefs de famille, d'obtenir un plus grand nombre de votants que n'en mentionne le procès-verbal de cette mémorable assemblée. Suivant l'auteur d'une des dernières histoires de Genève, cette ville comptait au commencement du xv° siècle, 1298 feux ou familles , ce qui , ajoute l'historien , vu la >simplicité des mœurs et le grand nombre d'individus qui étaient communément réunis dans le même appartement, peut faire supposer une population d'environ dix à douze mille âmes (2). Si l'on adopte ces données , l'allivrement de 1327 pourra servir également à faire connaître quelle était alors la population de la ville de Sisteron. Il est vrai que c'est là sa plus brillante époque. L'avenir ne lui réserve plus que des
(1) Un grand nombre de ces noms subsistent encore, surtout dans la classe du peuple. Indépendamment du vif intéret qu'offre à la génération actuelle de Sisteron la résurrection de ces vieux noms patronymiques, le fait mérite d'être constaté, s'il est vrai, comme l'assurent des écrivains modernes , qu'au XIV siècle , les gens du peuple , en Italie , n'avaient pas de noms de famille, et que même de nos jours encore, certaines populations de cette belle contrée, berceau de la civilisation européénne, ne les connaissent pas . (MM. Sismonde Sismondi. Biogr . Univers. art. Rienzo, et Eusèbe Salverte, Essai Hist. et Philos. sur les noms d'hommes. Tom. 1 p. 300.)
(2) Picot , Hist. de Genève. Tom. 1. p. 109.
malheurs et ce triste état de médiocrité auquel semblent l'avoir condamnée son éloignement des grandes communications et un sol trop souvent rebelle à tous les efforts du travail. Pour rencontrer dans nos archives un document analogue à celui qui nous occupe, il faut arriver, d'un trait, à l'année 1503 , où apparait le premier cadastre régulièrement exécuté , ou du moins le plus ancien qui se soit conservé. Mais quelle différence entre les deux époques, et quel déplorable terme de comparaison nous présente la dernière ! Les 1224 chefs de maison de 1327 sont ici réduits à 494. Ces chiffres n'ont pas besoin de commentaires; ils parlent d'eux mêmes. On dirait deux villes différentes, et tout un abîme que deux siècles d'intervalle ont mis entr'elles (1).
(1) Sisteron compte aujourd'hui ( Recensement ds 1836 ) 1047 ménages agglomérés , et 1206 avec la banlieue , donnant une population de 4546 âmes , dont 3454 pour la ville seule. C'est donc à peu près le même nombre de ménages qu'en 1327 ; mais ces chiffres, on le sent , ne sauraient avoir la même valeur pour exprimer , aux deux époques , la population du pays. Reste à savoir celle qu'il convient d'attribuer aux 1224 noms del'allivrement. On vient de voir les considérations présentées sur ce sujet, par l'historien de Genève. Ces considérations sont justes ; elles ont acquis plus de poids encore, depuis que la législation nouvelle, au lieu de veiller, comme l'ancienne, à la conservation des familles, tend au contraire incessamment à les brisør et à les multiplier à l'infini. Aussi , à défaut de données plus certaines, on peut, ce nous semble, et on le peut sans crainte d'être taxé d'exagération , supposer que les mille et quelques ménages qui vivent aujourd'hui dans l'enceinte de Sisteron, et qui sont à la population totale , comme 1 est à 5,50 , ne représentent que la moitié de ce qu'ils représentaient au XIV° siècle ; ce qui donnerait pour cette dernière époque, de huit à neuf mille âmes, y compris les faubourgs, dont la population seule pouvait être de douze à quinze cents
PIÈCES EN LANGUE ROMANCE OU VULGAIRE, DU XIV SIECLE .
( 1391. 28 août. Reg. des délibér. f° 5. )
A.
Sequuntur res et causa pro quibus ambaxiatores prefati vadantad excellentiam reginalem , juxta ordinationem consilii , E des tres istas de la Bayllia. Permierament sus lo tractament del fach del cayre per so quar son vengut à Sestaron Philipot Robert e Marot de Channac de part Mossen Tristan de Belfort quossi lo pays es de entendement de pendre acort e avenensa anbels cossi que puesta an los deniers promesses per esquivar maiors damages quar Raybaudet de Remusat a ben tant de bens desquals ma dama pot aver aytre tant e plus , e sus ayso plassa alla siena maiestat de consertir es aver per recet so que sen pagara del pays (1 ) . Item cosin lo pays est de entendement de far autramens la melhor guerra que poyra daquels deniers contra aquels del Cayre e non de denar los deniers en autra maniera . Item que en lo cas que lo Cayre se poyra recobrar per lo dich tractament que sia baylas e assignas de comandament de ma dama , en mans de que ma dama e lo pays sen puestan contentar. M Item que coma la ciutat de Sestaron e sa bayllia sia aguda taxada a pagar III. XL francs per cascuna paga de la rata tocant de xx. francs consentis juxta la forma des capitols en lo conselh général days e razonabtamens non toque tant la dicha cieutat ni sa bayllia per la diminucion daquella tant per lo fuoc quant per guerras e mortalitas quant per lo castel de Barles que a mes e tresportat en la bayllia de Seyne quon ben que fos en la bayllia de Sestaron , e quar la dicha bayllia a certs castels desabitats sus cert nombre que plassa a ma dama sus ayso far remediar. Item , far e procurar an ma dama que lo dich castel de Barles retorne alla bayllia de Sestaron eneysi quant tos
(1) Une partie de la terre du Caire appartenait à Raybaudet de Remusat qui livra, à ce qu'il parait, le château aux rebelles, après avoir fait assassiner un de ses cosseigneurs. C'est à ce crime qui entraînait la confiscation des biens que font allusion les instructions données aux députés du bailliage. Nostradamus, entre tous les historiens de Provence, est le seul qui parle de l'assassinat du Seigneur du Caire, et qui serve ainsi à jeter du jour sur ce passage. Voy. sa chronique.
temps es agut a sus ayso plassa a ma dama de observar los priveleges promesses consentis e donas alla dicha cieutat et a sa bayllia. Item supplicar a ma dama que com tot lo pays de Sestaron et de Seyna e de lur bayllias aian suffert grant damages e grans despens , tant per lo ceti quant per las establias e per la redempcio del dich castel del Cayre , que plassa alla siena maiestat de consentir e donar immunitat als ditz luocs e a lur bayllias , de non pagar aquipayge de denguna causa. Item , supplicar a ma damaque li plassa de far observar alcun capitol per ella consentit al conselh général des officials annuals e sus ayso consentir lettras opportunas que totz officials que aia istat plus de un an en la dicha cieutat, non tenga plus lo offici , mas as aquel passat lan non deian los subgietz obezir . Item , que com sian alcuns que recuson de pagar aquestos fays , que antreve letra que tuch deian par en destinctamens , an bona pena . Item , que suppliquen a madama sobre lo fach de la Canna que sia e se mezure alla costuma days , justa la ordenensa dalcun conselh general tengut en proença per mossen Folco de Agout Senescal . Item , que aian sal conduch de part ma dama a Bertran de la Pessa per far tractamens an bel sus lo Cayre . Item , que suppliquen ama dama que com sia causa que lo sus viguier et los autres officials de Sestaron viziton trop e sens causa los castels del domani e des gentilshomes , que li plassa de consentir que li dich officials non deian vizitar castels denguns de la bayllia sens requesta des luocs , es o fan que li castel non sian tengut de ren donar aquels.
B.
Lettre adressée au grand Sénéchal par les trois états du bailliage de Sisteron , au sujet de l'invasion de Raymond de Turenne. (1392. 21 mars. Reg. des délibér. fo 82. )
Réverent e tresque especial Senhor, nos nos recomandam humilment a la vostra magnificencia a la qual plassa de saber que nos avem vist estant ensemps acampat à Sestaron per recobrar lo luoc de Brianson josta la ordenansa de tota la baylia , doas letras patens e doas clausas lasquals vos aves mandadas a vostras officials de Sestaron et als sindegues e concelh del dich luac , e quant es a las letras patens en lasquals en una se conten que nos mandem encontenent tres francs per fuac que son estat ordenat al concelh général tengut a Marcelha per deffensa dal pays , etc. En P'autra patent se conten que vos es enformat que contra la ordenansa per vos facha nos devem aver donat vioures e deniers e pategat e comersat ambe las gens estant à Brianson , etc. E en las dichas letras clausas lasquals venian als sindegues e concelh de Sestaron se contenia que tantost degessan mandar al grant thesauriar de Prohensa tres francs per fuac que lur tocava josta la dicha ordenansa de Marcelha, e el quas que non o feran aguda la resposta del present portador , vos nos feras executar per maniera que nos pagaram e a nostres despens , etc. A lasquals causas nostrare verent Senhor , nos vos respondem an la reverencia laqual se conven , premierament à las letras patens e clausas del fach dels tres francs per fuac que son quays de una tenor que nos non avem consentit en donar los ditz tres francs per fuac , ni hi sem istat à la ordenansa per laqual causa aysi quant vos avem mandat per nostres enbaysadors en Avinhon, nosnoncresem ni pensam esser tengut , e per so quar nos avem agut en aquesto baylia , l'establida de Lazer , premierament laqual a fach gran damages en aquesta baylia , apres avem agut Guillen Gassias an totas sas companhas , aprés la establida de Brianson e de Thornafort , en lasquals establidas de Brianson et de Thornafort avia plus de CLXXX cavals. En lasquals causas avem despendut , aysi quant es a tot lo mont notori e manifest plus de v francs per fuac , sens aver secors ni ajuda de pays ni de persona que sia al mont , si non de nos meseys e de la baylia de Seyna , quant ben que en ayam requist diverses voutas lo capitani general e des autres diverses senhors e ambe la ajuda de diau e lo bon concelh e vertut de nostre capitani e des autres gen- tilshomes daquesta baylia , nos avem recobrat lo dich luac de Lazer e avem dampnagat grandament las dichas doas establidas de Brianson et de Thornafoart , enfra lurs propres allinamens que non lur avem laysat rauba ni cavals si non en petita quantitat , et lur avem mes e cremat , los borcs dels dichs dos luacs per tal maniéra e forma que non lur son remas , si non li donion , per laqual causa es estat de necessitat que sian vengut à bon acord ambe nos autres an vostra volontat e licencia , caysint quantpar per vostras letras an grans carcs e despenssas e damages de nostras baylias , loqual acord se es fach per volontat e ordenation de nostra baylia et an volontat e licencia de nostra capitani vesent que non aviam secors ni ajuda de persona que sia al mont , e las pauras gens avian estat enclaus per l'espasi de vi mes sensa far denguna besonha , e non podian ni yolian plus pagar las establidas lasquals nos costan plus de *1. francs . X Per que , nostre reverent senhor , a nos par ben aver pagat mays que non vendria dels tres francs per fuac e cresem que nostre argent sia a honor del rey Loys nostre senhor e a ben istament del pays aysi ben despendut quant l'argent que ses despendut en las autras baylias et vigarias de Prohensa , à grant cost e petit de profiach del pays e tot jort sens apparelhat quant gent nos vendran de sobre a far nostre dever e vostre ben plaser ; quant es aso , nostre réverent senhor , que vos nos mandas que vos nos fares executar à nostres despenses e cost al quas que non vos mandem la moneda , nos avem tanta confiansa en vos e en vostra justicia que vos non nos fares tort ni nos tractares piays que l'autre pays que an fach lor guerra daquestos deniars e sensa nos demandar , an fachas lors ordenansas e lors gens darmas a lasquals nos non entendem a consentir ni avem consentit per diverses razons et causas lasquals vos ayram mandat per nostres enbaysadors , quant poguessan annar segurement per lo pays , per laqual causa sem sertan que nos aures per excusats e non nos fares ni suffertares esser fach causas per que nos calgues aver recors ad autra persona , quar aquesta es nostra confiansa , quar ayso seria per ben fach aver avol guiardon e per so , nostre reverent senhor , nos es estat ordenat dengut collector sobre aquel fach ni tal ordenar. Equant es , nostre reverent senhor , à la autra letra patent dels vioures non vos notificam e vos fazem sertan que de puays que nostre capitani venc aysi e las establidas foron messas , aquel de Brianson non an agut concelh confort, ajuda, vioures per denguna causa daquestas doas baylias fin a tant que l'acord es estat fach , que nos an cambiat blat per vin e per autras besonhas , de qual blat illi avian e an ancors grant quantitat e mays fromages e cars saladas , mas de vin , ella non avian gota. De las autras baylias que an fach nos non nos enpacham , mas vos es senhor e enformas vos entrebares quonsi vay , nostre réverent senhor , lo sant esperit sia garda de vos e vos plassa de aver nos totjort per recomandats. Escrichas a Sestaron lo XXI de mars .
Mossen Agout Dagout Lo senhor de Ventayrol Lo senhor de Puaypin Lo thesaurier de Valerna Messiar Guis Crespin (pour le clergé) E los sindegues e concelh de Sestaron . Magnifico et potenti viro domino Georgio de Marlio militi regio in comitatibus Provincie et Forcalquerii senescallo eorum specialissimo domino.
C.
Autre lettre des syndics et conseil de la ville de Sisteron , au même et sur le même sujet. (1393. 15 juin. Reg. des délibér. fº 93. )
Magnific e poysant senhor, non nos recomandam humilment a la magnificencia vostra a laqual plassa de saber que nos avem reseuput alcunas letras de part vos a nos mandadas contenen en effect consin vos non creses que nos ignorem la ordenansa facha en lo concelh redier celebrat a Marcelha per lo subsidi del tres francs per cascun fuac exigire coma nos en em pogut esser enformatz per los sindegues nostres adonc en lo dich conselh istant e que vos vos meravilhas grandament , quar nos nos mostram esser renuent a pagar lo dich subsidi e per so nos comandas que encontenent tota appellacion e escusacion remogudas la dicha moneda deiam pagar al thesaurier general ho a son luaga tenent en aquestas pars , quar si aquo non fazem las gens darmas vostras de nos se entendon contentar quo sins que sia e pagar. Per que , nostre redoutable senhor , nos vos respondem an la humilitat laqual si conven que nostres sindegues ni nos non avem consentit en lo dich subsidi ni sem ponch istat en lo dich concelh per los grans perils dels camins que adonc occurrian coma fan a present. Totas vegadas , mossenhor , nos non cresem la vostra magnificencia ignorar aysint coma es istat enformat per nostres enbaysadors, losquals sobre aquesta causa anneron expressament à la presencia vostra en Avinhon los grands despens els grans damages e las grans exactions de monedas per nos e nostra baylia fatz e sosportatz tant per lo castel des Cayre loqual tenia Filipot Robert permossen Raymon de Thorena, quant per la redemption del castel de Lazer loqual tenia chamisart enemic del rey Loys nostre senhor , quant per la redemption deł castel de Brianson loqual tenia Rigalt de Montomat per la part des dich mossen Raymon de Thorena en losquals castels e en cascun de aquellos avem tengut los setis a despens nostres e de la baylia desquals avem agut honor fin al jort de huey ; de lasquals causas , mossenhor , cresem aver fach aytant ahonor del rey Loys nostre senhor es a fidelitat nostra quant luac de Prohensa segon nostre istat e sensa adjutori de l'autre pays , en lasquals causas , mossenhor , avem despendut plus que non monta la rata de se que nos toca dels tres francs per fuac , laqual causa em apparelhat mostrar devant ma dama la Reyna davant la qual pent la appellacion per nos facha de alcunscomandament exessieus a nos fatz de part Mossen Carle alba aysint coma vostre luagatenent o davant la magnificentia vostra quant vos plassa de ausir nos . Per que , mos senhor , quant es de so que a la vostra magnificencia plas de mandar que los gendarmas son de entendament de pagar si aysins coma dessus es dich nos non cresem que atendent la amor et la grant affection que vos , nostre redoutable senhor, aves a nos e al pays que volguesses suffertar quedampnage nos fos fach , sensa ucayson e especialment attandut que de ben fach nos auriam avol guiardon (1), quar largent que nos avem despendut en aquellas dichas causas es aysint ben despendut coma largent que es istat despendut per al cuns autres del pays loqual es istat pres en compte. Autra causa , mossenhor , non vos escrivem a present mas que dieus sia garda de vos e comandas nos aysint coma a vostres fizels subjetz . Los tot vostres fizels subjetz los sindegues e concelh de Sestaron . Magnifico viro et potentiviro Domino Georgio de Marlio militi regio in Comitatibus Provincie et Forcalquerii Senescallo eorum speciali Domino.
(1) Le savant M. Raynouard à qui nous avions communiqué ces pièces , y remarqua quelques termes particuliers dont il se proposait de faire usage dans son dictionnaire de la langue romane. De ce nombre est l'expression proverbiale que nous signalons ici , et qui est également employée dans la lettre précédente. Nous croyons qu'il n'y a pas à se méprendre sur le sens de ces mots Perben fach aver avol guiardon; avol est l'adjectif du substantif roman ayolessa qui signifie , tort , dommage (Roquefort , Gloss.de la lang. Rom.)
AFFOUAGEMENT DE LA VIGUERIE DE SISTERON. ( Du 7 Décembre 1776.)
Sisteron, 35 feux (1) compris Consonoves pour 114 de feu , réduit à 35 feux toujours y compris Consonoves. Astouin , 114 de feu , réduit à 125 de feu . Aubignosc , un feu 314 , réduit à un feu 315 . Auton , 2 feux 112 , réduit à 2 feux 115 .
(1) En 1788 , la valeur du feu était de 55,000 liv. soit 1,275,000 liv. pour l'évaluation totale du territoire de Sisteron. En 1728 , les 35 feux dont se composait alors l'affouagement de la communauté, furent estimés 629 livres cadastrales, cinq onces , un huitième, un soixante quatrième, ou 620,508 liv.: 15 sols. 9liv. tournois. On sait que la livre cadastrale avait une valeur convenuede 1000 liv.: elle se divisait en 16 onces, chacune de 62 liv. 10 sols , et l'once en quarts, demi quarts , 16°. 32° et 64
Bevons , 314 de feu . Bayons , 3 feux. Bellafaire et les nobles 2 feux 114 , réduit à 2 feux. Baudument , 123 de feu . Barret , 2 feux 112 , réduit à a feux. Barcilonnette , 1 feu 314 . Chardavon , 113 de feu , réduit à 125 de feu . Châteaneuf-Val-St- Donat , un feu 314 , réduit à un feu 124. Château- fort , 112 feu . Clamensane , 1 feu 314. Curban , 2 feu 123 . Claret , 2 feux 126 , réduit à 1 feu 175. Châteauneuf- Miravail , I feu 314 , réduit à un feu 174 . Chateau-Arnoux , a feux 314 , réduit à 2 feux . Cornillac , I feu 118 . Cornillon , demi feu 123 . Dromon , I feu 213 , réduit à 1 feu 215. Esparron la Bastide , 1 feu , réduit a 1 feu 215. Entrepierres , 3 feux , réduit à 315 de feu . Esparron de Vitrolles , 1 feu 118. Eygalaye , 2 feux , réduit à 1 feu 215 . Faucon , trois quarts 128 de feu , réduit à 315 de feu . Gigors , I feu. Gueissel , un douzième de feu . Jarjayes , demi feu . L'Escalle , 3 feux 213 , réduit à 2 feux 315 . Lamotte , 3 feux 213 , réduit à 2 feux 315 . Le Caire , I feu 126 , réduit à 1 feu . Le Charce , demi feu . Lens , un feu 1112 . Melve , 2 feux , réduit à 1 feu 213. Montfort , I feu réduit à 415 de feu. Mison , 7 feux. Nibles , 213 de feu , réduit à 315 de feu . Noyers , 3 feu 314 , réduit à 3 feux 112 . Piégut , I feu et 114 , réduit à 425 de feu. Peipin , a feux 118 , réduit à 2 feux. Piousin , un douzième de feu. Pomerol , 215 de feu . Reynier , 213 de feu. Remusat , I feu 112. Salignac , 4 feux 112 , réduit à 3 feux 3210 . Sourribes , feu , réduit à 415 de feu . Sigoyer , I feu . St. -Simphorien , 314 de feu , réduit à un demi feu . St. -Vincens , a feux. Sederon , 2 feux 314 , réduit à a feux. St. -Mari , demi feu 1120 . Teze , deux feux 122 . Turriers , 4 feux , réduit à 2 feux 315 . Volonne , 6 feux 314 , réduit à 5 feux 516 .. Villosc , 314 de feu , réduit à 315 de feu. Valernes , 3 feux na , réduit à 3 feux . Vaumeil et les nobles , 2 feux 223 . Valavoire , 213 de feu . Venterol , I feu 213 . Urtis , 122 de feu , réduit à 125 de feu . Vitrolles , 2 feux 116 , réduit à 1 feu 415 . Valbelle , 2 feux 1112 , réduit à 2 feux . Licu nouvellement affouage. St.Didier , un vingtième de feu . Total de la viguerie de Sisteron : cent quarante-six feux , un demi et un tiers : et suivant les réductions ou suspensions , cent vingt-un feux un quart un cinquième et un quinzième.
FIN DE L'APPENDICE.
TABLE DES MATIÈRES PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE.
Abrégée.
A
ACHAT et vente des grains soumis à la surveillance municipale . Астe public , maintenu , s'il n'est détruit par un acte postérieur. ADJOINTS, membres adjoints au conseil. ADULTÈRES , excommuniés . AFFLORINEMENT des consuls , du greffier et des auditeurs des comptes. AFFOUAGFMENT déchargé en raison des franchises accordées par le prince. Dernier affouagement , à quelle époque. AGENTS subalternes de la cour obligés de contribuer aux tailles. AGNEL d'or , monnaie de France. AGOUT (d) , les d'Agout ont une maison d'habitation à Sisteron . AGOUT d'Agout assiste à l'assemblée des trois états du bailliage. AGULHENC (Louis), offre dans le conseil de payer les messes de son argent , si les Huguenots s'y refusent. AIGREMONT (Jehan d' ) , greffier du conseil pour le parti catholique , en même temps que maître Simon Robert pour le parti protestant. AIX. Les syndics de Sisteron adoptent la forme du chaperon des syndics d'Aix . L'ARCHEVÊQUE d'Aix devient président né des états. ALBERGUE (droit d' ) ou de gîte . ALLIVREMENT doit avoir la précision d'une balance. ALLIVRÉS , leur nombre en 1327. AMBROISE (Saint). Belle pensée de ce père de l'église . ANCELLE (Jean d') , représente la communauté d'Astoin aux états du bailliage. ANDRÉ de Hongrie , premier mari de la Reine Jeanne . ANDRONNES , défense d'ouvrir des andronnes . ANJOU ( Charles Ier , duc d' ), comte de Provence , accorde des statuts. ANNÉE , établie d'après l'indiction. ANNÉE. Les officiers royaux ne peuvent proroger leurs fonctions au- delà d'une année . APPEL. Juridiction des appels rétablie. Libre à chacun d'appeler au comte des décisions du juge. APT. Le bailliage d'Apt demande du secours à celui de Sisteron . ARBALÈTE , les citoyens obligés de se munir d'arbalètes . ARBRES. Faculté à chacun de couper et d'emporter les arbres non échenillés. ARCHIVES de la mairie, riches d'une belle série de documents. ARENA (Antonius de) , dénombrement des bailliages et vigueries de Provence publié par cet auteur. ARMAGNAC (comte d'). Les débris de son armée vaincue en Italie , désolent les environs de Sisteron . ARMES. Les citoyens tenus de s'armer à leurs frais . Le clavaire royal ne peut prendre en gage les armes des habitants de Sisteron . ARMURE , Se modifie suivant le rang . ARPILHE ( Franç.) marchand, membredu conseil municipal (1334). ARSELIERS , placé par Antonius de Arena dans le bailliage de Sisteron , 120 . ARTISANS admis au conseil , 19 , 45 . ASSEMBLÉE générale de la commune , en 1296. ASSEMBLÉES des trois états du bailliage. ASSESSEUR du conseil ; son origine . Supprimé , remplacé par le troisième consul. ASTOIN , communauté du bailliage , . AUBERGES , leur origine , 27. AUDITEURS des comptes , leur institution .Ne sont point parents des consuls ni du trésorier Ne peuvent être réélus qu'après deux ans . Leur afflorinement. AUNAGE , uniformité des mesures pour l'aunage des marchandises. AUVANS. On ne touchera point aux auvans ni aux fenêtres des particuliers sans leur consentement. Avocats obligés de monter la garde en personne , 99 . Avocats et procureurs exclus des charges municipales , comme mauvais ménagers des deniers publics , y rentrent à la faveur des troubles de la fin du xvie siècle. Avol guiardon , expression proverbiale de la langue romance , sa signification , 219 .
B
BAILLI , Tiré de l'ordre des chevaliers. Ne peut-être du pays . Jure d'observer les priviléges de la ville .Fournit caution devant la chambre des comptes. N'a pas voix délibérative . Son attache nécessaire pour rendre exécutoires les peines pécuniaires et autres statuées par l'autorité municipale. Remplacé par le viguier. BAILLIAGE , sa constitution , 119. Envahi par les bandes de Raymond de Turenne , 125.- Accusé d'être d'intelligence avec les rebelles , se disculpe, documents en langue vulgaire à ce sujet. BALANCES et mesures , doivent être vérifiées tous les trois mois. BALAYURES , défense d'entasser des balayures devant les maisons. BALUZE , ses vies des papes d'Avignon citées . BANNIÈRE. Levée par le conseil. Mise par le valet de ville les jours de marché sur la place. BANSINI (Dominique), orfèvre chargé de vérifier les poids et balances. BARBACANE. Sorte de monnaie inconnue. BARLES (village de) , autrefois du bailliage de Sisteron . BAUME (faubourg la) , représenté au conseil par deux de ses habitants. Habitants de la Baume ne peuvent être arrachés à leur juridiction naturelle . BÉATRIX, comtesse de Provence , épouse de Charles Ier . BEAUVAU (Bertrand de) , seigneur de Précigny , maître d'hôtel du roi René , écrit pour demander un subside. BÉRENGER (Raymond) Ive du nom , hérite du comté de Forcalquier . Fait son testament dans le couvent des cordeliers de cette ville. BESTIAUX. Peines contre ceux qui exposent des bestiaux malades à la foire . BIRON (Armand de Gontaut , baron de) fait exécuter à Sisteron l'édit de pacification (1564) . BLEDS. Libre sortie des bleds . BOEUFS de labour ne peuvent être pris en gage . BOMBARDES , gros canons. Les syndics en disposent . BON , un des douze commissaires rédacteurs du cahier des doléances des communautés de la sénéchaussée en 1789. BONET ( Marquis) de Valernes , député à l'assemblée du bailliage. BONNET Époque où il remplace le chaperon . BOUCHE (Honoré) , historien de Provence . BOUCHE avocat. Son étymologie du mot latte . BOULANGERS Soumis à la surveillance des inspecteurs municipaux . BOURGEOIS d'argent. Monnaie de France . BOURGEOISIE. L'assemblée de la sénéchaussée demande la révocation de l'édit qui exclut la bourgeoisie du service militaire . BOURGOGNE ( Dominique) , citoyen de Sisteron , député vers Charles Ier pour obtenir la confirmation des priviléges (1257). BOURG- RAYNAUD un des quartiers de la ville. BRIANSON. Château dans la vallée de Dromon pris par les bandes de Raymond de Turenne , racheté et incendié . BRIGANDS. Compagnie de brigands au service de la ville , doivent être italiens. Bucelle , un des commissaires rédacteurs des doléances de la sénéchaussée , en 1789 .
C.
CAIRE ( château du ) au pouvoir de Raymond de Turenne. Racheté. CALABRE (Jean duc de), fils du roi Robert , associé par son père au gouvernement de l'état. Le député de Sisteron lui prête foi et hommage sous la réserve des priviléges du pays. CAPITAINE général du bailliage. Le conseilde la ville concourt à sa nomination . CASALORTIO (Antoine de) , jurisconsulte napolitain établi à Sisteron . CASLARI (Bertrand) Questor. CASSINI ( les frères) , de Florence , banquiers à Sisteron . CAUTION. Nul habitant de Sisteron ne peut être retenu en prison , s'il donne une caution . CAVALCADES , service militaire . Le nombre d'hommes que doit fournir la ville . Les citoyens ne peuvent être contraints à donner de l'argent pour les cavalcades. CELLEY (Pierre) miles. Compris dans l'allivrement de 1327 . CELLEY (Jean) chevalier , membre du conseil . CERVOLE (Arnaut de) surnommé l'archipêtre , jette l'alarme à Sisteron. CHABRIER , un des commissaires rédacteurs du cahier des doléances des communautés de la sénéchaussée en 1789 . CHAIX (Maître Raymond) , avocat , s'oppose à ce que le conseil fasse dire la messe . CHAMBON (Guillaume) , organiste de la cathédrale , habile calligraphe. Ecrit le livre vert . CHARGES municipales. Nulle charge perpétuelle ni héréditaire. Vénalité des charges , quand introduite , 137. CHARLES II convoque les états à Valensole . Son ordonnance sur l'imposition de la taille au marc la livre (1306). CHARLES du Maine , dernier comte de Provence , lègue ses états à Louis XI. Déclare la loi romaine , loi du pays , sauf les statuts qui y dérogent . CHARLES VIII . Lettre de ce prince aux habitants de Sisteron . CHARLES IX confirme les priviléges de la ville. CHARTES municipales ne remontent pas au-delà du XIIIe siècle . CHARTE de Guillaume de Sabran , attaquée comme émanée d'un pouvoir usurpé . L'original perdu se retrouve en entier dans la charte de François I. CHATEAU de Sisteron. Détruit . CHAUVIN ( Jean) , mercier , membre du conseil municipal ( 1334). CHENILLES. Obligation d'écheniller les arbres. Peines contre ceux qui négligent d'écheniller . CHEVAUX. Les citoyens de Sisteron obligés de se munir de chevaux. Nombre de chevaux employés aux sièges de Brianson et de Tournefort. Chevaux de guerre ne doivent être pris en gage . CHICANE. Barrière aux envahissements de la chicane. CHIENS , doivent être menés en laisse. Tout citoyen doit accepter les charges municipales sous peine de cent marcs d'argent fin. CLAIRE (monastère de Sainte-Claire) . Sa fondation approuvée par l'assemblée générale des habitants , 10. CLASSE. Citoyens de la seconde et de la troisième classe , armes qu'ils doivent se fournir. CLAVAIRE de la cour royale , 32 . CLAVAIRE Communal. Son institution . Doit présenter , chaque mois , l'état de sa caisse et tenir ses comptes à double , 41. CLERCS tenus de monter la garde en personne , 99.-Exceptés de l'allivrement , 205. CLERGÉ représenté aux états du bailliage . CLOCHE. Le conseil s'assemble au son d'une des cloches de la cathédrale . COEUR. Monnaies dites Jacques cœur , en usage à Sisteron . COLUMBI , historien de Manosque , cité. COMINAUX. Magistrats municipaux. Leurs fonetions , id. Leur compétence limitée à la simple connaissance des faits . COMMUNAUTÉS se plaignent de n'être pas convoquées aux états du bailliage.Ne doivent rien aux sergents pour leur convocation , id. COMMUNE. Son origine inconnue , mais antérieure au XIIIe siècle , 7 , 8,71 . COMPARANT présenté par de simples citoyens pour demander des réformes . COMPTES de l'état. Les communautés de la sénéchaussée demandent que les comptes de recette et de dépense soient annuellement livrés à l'impression . CONCIERGES ne doivent point extorquer l'argent des prisonniers . CONFÉRENCE. Chambre de la conférence fermée à double clé sur les nominateurs pendant les élections . CONFISCATION ne doit être appliquée aux habitants de Sisteron , ni à ceux de la Baume et d'Entrepierres . CONFRATRIA , mot équivalent de commune .-Les membres obligés de s'y rendre sous peine d'amende Doivent rester jusqu'à la fin des séances . Ne peuvent parler qu'à leur tour. Doivent garder le silence sur ce qui se passe au conseil. Placé à latête des communautés de bailliage . Fait partie des conseils de guerre . A le droit d'infliger des peines corporelles. CONSEILS municipaux. L'assemblée de la sénéchaussée demande qu'ils soient toujours présidés par le 1er officier municipal. CONSEILLERS au nombre de douze, puis de quarante , de cinquante , de soixante , etc. Réduits à trente-quatre . CONSTITUTION. Nouvelle constitution municipale , prorogée , 44. CONSTITUTION du royaume. L'assemblée de la sénéchaussée demande que la constitution du royaume soit reconnue par les états généraux , 141 . CONSULAT. La justice civile attribuée au consulat , participe aux jugegements des causes criminelles réservées au comte, 74, 76. CONSULAT d'Aix. L'assemblée des communautés de la sénéchaussée de Sisteron , réclame contre l'union de la procuration du pays au consulat d'Aix , 141 , 142. CONSULS , remplacent les syndics , 49. CORNET , florin au cornet , monnaie des princes d'Orange , 92 . COSSES (droit de), attribué au consulat , ce que c'était , 74 . COSTE ( la) , quartier de la ville , 19 , 154 , 170 , 203 . Cour royale. De combien d'officiers se compose , 32.- La cour obligée de donner connaissance à domicile des poursuites dirigées contreles citoyens de Sisteron , 80 . CRÉANCIER ne peut être contraint à prendre des biens s'il préfère de l'argent , 80 . CRESPIN (Gui) . Représente le clergé aux états du bailliage , 216. CROSSÉ (gros) . Monnaie des abbés et évêques . CRUIX (chapitre de). Ses différends avec la communauté , 9 . CULTIVATEURS de la ville , représentés à l'assemblée de la viguerie par des députés de leur choix , 140 , 141 . CURETI (Jehan) , cosseigneur de Saint-Vincent , devient maître rational , refuse de payer la taille , y est contraint .
D.
DÉBIT du vin soumis à des inspecteurs , nommés courtiers. DÉBITEUR en retard paye le droit de latte. DÉCADENS. Exclus des charges municipales . DÉCENNIERS , chefs de dix hommes armés . DÉLIBÉRATIONS du conseil écrites par un officier public , Basées sur des adages . Dix-huit membres sur trente-quatre suffsent pour les valider. DÉMEMBREMENT. Le Bailliage , dans aucun cas , ne doit éprouver de démembrement. DENIER valois . DÉNONCIATEUR , son nom doit être connu. Est condamné, s'il suc- combe , à des dommages-intérêts envers l'accusé0. DENRÉES , en temps de foire ne doivent être renchéries . DÉPUTATION aux états dévolue au premier consul par la province , 68 . DESPOTISME. Troubles religieux amènent le despotisme. D'ALLONS( Le sieur) prend part aux débats élevés dans le conseil au sujet de la messe . DIZAIN ou provençal d'argent. Monnaie . DOLÉANCES ( cahier de) à porter aux états généraux . DOMAINE. Son inaliénabilité, permis aux habitants de Sisteron de le défendre à main armée . DOMICILE des citoyens inviolable . DROIT Romain. Etude du droit Romain répandue à Sisteron dès leXII siècle. Lieux communs de droit débités par le juge. DROIT Commun. Les nobles soumis au droit commun. Reconnu par la reine Yolande . DROIT public , 133 . DROIT privé , 133 . DROIT qu'ont les simples citoyens de demander des réformes . DROITE ( rue ) un des quartiers de la ville . DUCANGE. Son glossaire cité . DUGUESCLIN ( Beetrand ) jette l'effroi à Sisteron .
E
ECCLÉSIASTIQUES obligés de contribuer aux frais de la guerre. Ne peuvent arracher les laïques à la juridiction civile . ÉDIT qui introduit en nombre égal au conseil les partisans des nouvelles doctrines. Troubles à ce sujet. ÉDIT de 1535 vicie la constitution provençale. Le député de la ville aux états chargé de demander sa révocation , ÉGALITÉ des charges entre les citoyens . ÉLECTIONS municipales à deux degrés . Depuis le XVI siècle souvent faussées par l'intervention du pouvoir. ÉLIGIBITITÉ sans condition d'allivrement jusqu'en 1619.ENCHÈRES. Le bail de la trésorerie adjugé aux enchères. EOURRES. Placé dans le bailliage de Sisteron par Antonius de Arena . ÉTIENNE ( bourg de St. ). Son emplacement. ÉTATS . Trois états du Bailliage prennent une part active aux affaires. Lees étrangers peuvent faire paître leurs bestiaux dans le territoire . ÉVALUATION la plus forte de l'allivrement de 1327. . La plus faible. ÉVÊQUE réclame envain des droits sur les maisons des faubourgs détruits. N'a aucune autorité temporelle dans la ville , id. -La sénéchaussée demande que les Evêques soient tirés indistinctement de l'ordre de la noblesse et de la Bourgeoisie. . Excès commis par les chefs de maison , hommes et femmes , sur les membres de leur famille , ne sont passibles de poursuites , qu'autant qu'ils sont graves et causent du scandale . EXCOMMUNICATION lancée par le vice-gérant d'Avignon contre ceux qui ont détourné des papiers appartenant à la communauté . EXEMPTION de la gabelle et des bans pour la vente du vin . EXTORSIONS. Les prisonniers ne doivent point être soumis à des extorsions . EYSSAUTIER ( Jean ) de Bellaffaire , arrêté contrairement aux priviléges du pays , réclamé par les syndics ( 1392 ) .
F
FAILLIS , ne peuvent être consuls .FANTASSINS. Levée de cent fantassins. Nombre qu'en fournit le bailliage . Leur nombre dans l'allivrement de 1327 7. FÉODAUX (droits) . Les communautés de la sénéchaussée demandent la suppression des droits féodaux avilissants et oppressifs, et le rachat, à prix d'argent , de ceux qui ont une cause et un titre légitimes. FICHET, un des commissaires rédacteurs du cahier des doléances des communautés de la sénéchaussée en 1789. FIEF . La ville maintenue dans le droit de nommer des officiers dans les fiefs qu'elle possède. . FILLES publiques ne peuvent séjourner dans les cabarets . FLORINS de diverses valeurs , FONT CHAUDE(quartier de) , allivré en 1327. FORCALQUIER (comté de) . Sisteron en dépend. Réuni au comté de Provence.Bailliagede Forcalquier demande du secours à celui de Sisteron. FORT (Mathieu et Guillaume du) , jurisconsultes distingués. FORTERESSE. Il ne sera élevé aucune forteresse à Sisteron . FORTIFICATIONS (restes de) , des anciens faubourgs apparents. FORTUNES bouleversées par l'affaiblissement des monnaies . FOUAGE , impôt . Quelle somme dépensée aux siéges de Brianson et de Tournefort . FRANCE. Rois de France promettent de conserver intacte la constitution provençale . FRANÇOIS I confirme les priviléges de la ville. Établit la vénalité des charges . FRANCHISES des droits de cosses et de leyde . FRÉDÉRIC Barberousse , empereur d'Allemagne , établit, en Italie, l'usage de ne point placer les officiers royaux dans le lieu de leur naissance . FROISSART. Passage de sa chronique relatif à l'archiprêtre Cervole qu'il appelle Canolle.
G
GABELLES . Il n'y aura point de gabelles à Sisteron. GAGES. Le clavaire ne pourra prendre en gage les armes des habitants. GARANTIES sociales. Aucune ne manquait à nos anciennes institutions. L'assemblée des communautés de la sénéchaussée en demande le rétablissement . GARIN Anthoni , médecin , membre du conseil (1334). GILÈTE , femme de Jean Després , portée dans l'allivrement de 1327 , séparément de son mari . GILHAC ou carlin d'argent , monnaie . GIRAUD Coassa , savetier , membre du conseil municipal (1334) . GLANDEVÉS (Raymond de) , seigneur de Faucon , grand sénéchal de Provence , reçu sur sa demande citoyen de Sisteron , autorisé à acheter pour deux mille écus de biens dans la ville ou le territoire , moyennant un écu d'or pour sa part des charges communales . GOMBERT Saint-Geniés. Cette famille a une maison d'habitation à Sisteron . GORGERIN . Partie de l'armure des citoyens de Sisteron Le Gouverneur de la province exige de faire l'élection consulaire sur une liste triple de candidats , et viole ainsi la plus précieuse des libertés communales . GRAINS (vente des) sur la place publique , soumise à des inspecteurs. GRASSE. Préséance aux états de la ville de Sisteron sur celle de Grasse . GROTIUS (de jure belli et pacis ) , cité par les consuls dans un procès contre le seigneur de la Brillanne . GUILLAUME IV , dernier comte de Forcalquier , fait à Sisteron un règlement touchant les successions ( 1170) Affranchit les habitants de cette ville de tous droits de péages par eau et par terre . GUIRAMAND (Blaise et Esprit) . Leurs biens mis en franchise et l'affouagement général déchargé d'autant . GUIRAMAND (Antoine) , évêque de Digne , préside les états (1503)
H
HABITS Syndicaux , à la charge des syndics. HABITANTS de Sisteron distingués , dès le XII siècle , en nobles , consuls , bourgeois et peuple, vont devant leur juge naturel (1257) . Peuvent se porter impunément à des excès envers les membres de leur famille. Ne payent qu'à Sisteron la taille des biens qu'ils possédent dans les villages. Obligés de se fournir d'armes et de chevaux. HAUBERT. Partie de l'armure des cavaliers du bailliage. HENRI II , roi de France. Édit de ce prince qui exclut les avocats et les procureurs des charges municipales. Confirme les priviléges de la ville. HENRI 1V confirme les priviléges de la ville . HENRICI ( Pierre) , privé de ses droits de citoyen pour avoir accepté l'office de notaire de la cour royale , contrairement aux priviléges de la ville . HODOUL , un des commissaires rédacteurs du cahier des doléances des communautés de la sénéchaussée. HONGRIE ( roi de) , poursuit la reine Jeanne , pour venger la mort d'André de Hongrie son frère . HOTEL- DE- VILLE. Projet de règlement exposé à l'Hôtel-de ville pour que chaque habitant ait la faculté de l'examiner . IMMONDICES. Défense d'entasser des immondices au-devant des maisons . INALIÉNABILITÉ du domaine reconnue ( 1352 ) . INCOMPATIBILITÉ entre les fonctions de clavaire et celles de notaire. INJURES sans voies de fait ne sont point poursuivies par la cour, si les parties se rapatrient dans les dix jours. INSTITUTION municipale. Sagesse de cette institution appréciée par les comtes de Provence . INTÉRÊT de l'argent au 25 p. 010.VIES ( Faubourg de ) . En avant de la porte de la Saunerie. Son allivrement. Détruit par les habitants ( 1357 ). ISABELLE. Lettres de la reine Isabelle sur le droit des habitants de Sisteron , à l'égard de leurs débiteurs étrangers.
J
JANSEN. Son essai sur l'origine de la gravure cité . JARENTE ( Lantelme ) , notaire, député à Naples. En rapporte la confirmation des priviléges , des statuts concernant la justice et une déclaration royale portant que la ville et le territoire de Sisteron ne seront point aliénés du Domaine comtal. JEANNE première , reine de Naples, comtesse de Provence , confirme le conseil. Le privilége en vertu duquel nul citoyen de Sisteron ne peut être retenu en prison s'il donne une caution (1344 ). Déclarée innocente du meurtre de son premier mari . JEANNE de Laval , 2e femme du roi René. Jure d'observer les priviléges, ne fait point partie du corps municipal . Ne prend ni argent, ni présents , sous peine de rendre le double de ce qu'il a pris . Obligé avant l'expiration de ses fonctions de terminer les procès commencés ibid. S'il est suspect on lui donne un adjoint. Reçoit les lettres patentes que lui présentent les syndics , à genoux , la tête découverte et inclinée pour plus de respect vers la terre. A la fin de son exercice tenu de faire son syndicat . Elevé à titre d'office ( 1529 ) , remplacé par la sénéchaussée ( 1640).Les habitants de Sisteron ne peuvent être cités devant le conservateur des juifs. JURIDICTION. Citoyens de Sisteron ne seront point arrachés à leur juridiction naturelle. JURISCONSULTES ne doivent se charger d'aucune cause sans l'autorisation de la cour. JUSTAS. Anciens seigneurs de Peipin. citoyen de Sisteron . JUSTICE (principes de) . Véritable semence d'ordre et de paix .
L
Laboureurs font partie du conseil. LA FONT (Raymond) , député pour la vicomté de Tallard aux états du bailliage de Sisteron. LEOPARDUS, ancien livre de la chambre des comptes relatif aux affaires de la ville et du bailliage de Sisteron , aujourd'hui perdu . . LEVÉE de cent fantassins et de cinq cavaliers. LEYDE ( droit de ) . Les habitants de Sisteron affranchis du droit de leyde. LIBERTÉ ( la) plus précieuse que l'or. La liberté et l'égalité règnent à Sisteron . LICENCE. Esprit de licence répandu dans le XVI siècle , nuisible à la liberté. LIEUTENANT. Interdit au juge d'avoir un lieutenant , remplacé en cas d'absence par le plus ancien jurisconsulte. LIEUTENANTS. Les membres du conseil s'adjoignent des lieutenants. LIVRE. Ancien livre des comptes ( 1315 ) , en papier mélangé de coton . LIVRE des priviléges , ou livre vert , écrit en beaux caractères. Sa lecture fatigante par le défaut d'ordre qui y règne. Manque d'une table des matières . Le conseil ordonne qu'il en soit fait une. Obscurités qu'il présente , signalées et soumises à l'interprétation royale.Confié chaque année à un garde spécial. LONGUE. Monnaie longue ou Viennoise . LORRAINE (Ferry de) écrit pour demander un subside au bailliage . LOUIS I , chef de la 2e maison d'Anjou . Ne laisse qu'un fils mineur dont il fixe la majorité à 21 ans. LOUIS II Ratifie les priviléges accordés par la Reine Marie , sa mère , aux habitants de Sisteron .Son service funèbre aux frais des trois états du bailliage4. LOUIS III Confirme les priviléges du pays.- Permet aux communes de s'imposer comme elles l'entendront , pendant dix ans , Louis XI essaie d'introduire la vénalité des charges . LOUIS XII confirme à la ville ses libertés . LOUIS XIII confirme les priviléges de la ville. Louis XIV crée des charges municipales. Louis XV porte atteinte aux libertés des communes de Provence. Retire son édit , sur les énergiques représentations du pays. LURS. L'official ne peut citer les habitants de Sisteron à Lurs.- L'évêque , prince de Lurs , y fait sa résidence habituelle .
M
MAIN du juge , en faisant le signe de la croix , ne se porte pas plus à droite qu'à gauche. . MAISON (chefs de) tenus , sous peine d'amende, d'assister aux assemblées générales de la communauté . Peines contre les maraudeurs . MARCHANDS de la ville obligés , comme les marchands étrangers , d'étaler , les jours de foire , dans les lieux qui leur sont assignés . -Crus sur leur serment , lorsqu'ils déclarent avoir déposé les droits dûs pour leurs marchandises , dans la boite placée à cet effet sur la route . MARCHÉ. On ne doit acheter les comestibles arrivant du dehors que sur le marché . MARCO(Pierre) de Turriers , arrêté contrairement aux priviléges du pays , réclamé par les syndics de Sisteron . MARIE ( la reine ) accorde des priviléges aux habitants de Sisteron . MATRICES des poids et mesures déposées à l'hôtel de ville. Gens de guerre ne logent point dans la ville . MÉTIERS (gens de) , entrent au conseil municipal . MEURTRIERS , ne peuvent venir aux foires . MÉVOLHON , un des commissaires rédacteurs du cahier des doléances de la sénéchaussée en 1789. MILICE ( tirage de la) . L'assemblée de la sénéchaussée demande qu'il ne soit confié qu'aux seuls officiers municipaux et que la milice nationale ne soit point employée contre les citoyens. MINEURS ne peuvent être consuls. MINISTRES. L'assemblée de la sénéchaussée émet le vœu que les ministres rendent compte , devant la nation assemblée , des deniers publics ainsi que de leur conduite. MOLLET ( Pons) , mercier , membre du conseil municipal (1334) . MONITOIRE contre ceux qui détiennent les papiers de la communauté. MONNAIES. Monnaie barbacane inconnue. MOTTE ( Jean ) , de Valernes , député à l'assemblée des trois états du bailliage ( 1391). MURA (Raymond de) , le plus riche habitant de Sisteron , en 1327.
N
NAPLES. La ville envoie des députés à Naples . NEGLIGENCE des conseillers à lire le livre vert . NOBLES , contribuent aux tailles , NOSTRADAMUS. Sa chronique citée. NOTAIRES de la cour royale ne peuvent être du pays.-Jurent , en entrant en fonctions , d'observer les priviléges de la ville.- Leur cupidité signalée . -Rappelés à leurs devoirs. NOTAIRE, Greffier du conseil , ne doit pas rédiger ni sceller des pièces officielles , en l'absence et sans l'aveu du conseil . NOVERS ( la vallée de ) ne sera point démembrée de la juridiction du bailliage de Sisteron (1212) .
0
OBÉISSANCE. Les habitants de Sisteron déliés de leur serment de fidélité et d'obéissance , si Guillaume de Sabran ne tient pas lui-même ses promesses . OBLIGATION de servir à cheval , pour les habitants de Sisteron , comme pour les nobles. OBOLE , moitié du denier . OBOLE d'argent de cinq deniers. OBJETS vendus assurés à l'acheteur jusque dans sa maison. OBLATS tenus de monter la garde en personne. OFFICIERS royaux. Leur nombre.-Doivent être étrangers au pays.- Ne peuvent même y être mariés.- Jurent d'observer les priviléges de la ville.- Ne doivent , en cas d'absence , se faire remplacer que par des personnes de leur rang.-N'achètent point leur emploi.-Passibles d'amende . OFFICIERS ecclésiastiques et seigneuriaux. Appel de leurs jugements devant les juges des premières et deuxièmes appellations. ORANGE. Monnaies des princes d'Orange . OREILLE. Pièce de monnaie déposée dans l'oreille d'un porc donne l'impunité à celui qui le tue . ORGANISTE de la cathédrale chargé d'écrire le livre vert ( 1364). ORPIERRE, du bailliage de Sisteron, dans le dénombrement d'Antonius de Arena. ORTHOLAN ( Durand ) , cordonnier , membre du conseil municipal (1334).
P
PAPE. Le conseil demande au pape une dispense d'âge pour le jeune roi Louis 11 . , 106. PAPON cité. Erreurs de cet historien , 78 , PARLEMENTS. Assemblées générales des citoyens , Parlamenta publica . PARLEMENT royal à Sisteron (1591), y donne un nouvel état de la ville. PASQUIER (Étienne) . Ses recherches de la France citées . PAYs. Le plus bean privilége du pays est d'élire les dépositaires de sa confiance . Paysans du bailliage de Sisteron appelés au conseil du comte Guillaume de Forcalquier ( 1170). PENCHINAT , un des commissaires rédacteurs des doléances des communautés de la sénéchaussée en 1789 . PICOT ,historien de Genève cité . PIERRE-AVÈS (Saint), du bailliage de Sisteron , suivant Antonius de Arena. PITE , quart du denier , et moitié de l'obole , . PLACE . Obligation de vendre et d'acheter les denrées sur la place (1358). POIDS et mesures. Règlement sur les poids et mesures , . POISSON. Inspecteurs ou regardeurs du marché au poisson . L'assemblée de la sénéchaussée demande que le juge de police ordinaire ait la connaissance des affaires dites au petit criminel et des affaires civiles n'excédant pas cinquante livres en principal . POPULATION de la ville. Sa grande diminution depuis 1327 . Porcs trouvés errant dans les rues ; peuvent être tués impunément . PORTES . Clefs des portes de la ville. Les syndics en disposent . POURPOINT. Partie de l'armure des cavaliers du bailliage . PRESSE (liberté de la) demandée par l'assemblée de la sénéchaussée . PRÉVENUS. En justice ne peuvent être consuls . PRÉVOT de la cathédrale de Sisteron , témoin dans la charte de Guillaume de Sabran , inconnu aux auteurs du Gallia christiana . PRINCE ne peut accorder des franchises de tailles , aux dépens du pays . PRIVILÉGES. Table des priviléges affichée sur les murs du palais. PROBLÈMES Sociaux résolus par nos anciennes institutions . PROCURATION du pays unie au consulat de la ville d'Aix , excite les plaintes des communautés de la sénéchaussée de Sisteron . . PROCUREUR du roi de la commune érigé en office . PROCUREUR du roi de la police nommé par les consuls . PROPRIÉTAIRES obligés d'entretenir les communications vicinales . PROTOCOLES des notaires ne doivent point être déplacés . PROVINCE. Le gouverneur de la province autorise la création d'un troisième consul .
Q
Quartier. La ville divisée en huit quartiers ou sections . QUATRE coins appelés autrefois place des riches . QUERELLESsans voies de fait punies par les barons dans leurs terres . QUINTALON ( Raymond ) , laboureur , membre du conseil municipal (1334 ) -Allivré en 1327 sous le nom de Raymond Raoul (Rodulphi)dit Quintalon RÉGALIENS ( droits ) maintenus . REGARDEURS ou inspecteurs chargés de surveiller la boucherie , le marché au poisson , les boulangers , etc . RÈGLEMENTS Sur les monnaies appliqué mal à propos à la monnaie valois , 94. RÈGLEMENT. Dernier règlement de la communauté ( 1770) . RÉFORCIAT ( livre) , plus forte d'un 5e que la livre ordinaire . RÉFORMES. Droit qu'ont les simples citoyens de demander des réformes . RÉGUIS, un des commissaires, rédacteurs du cahier des doléances des communautés de la sénéchaussée en 1789 . RELIGIEUX. Leurs biens mis à la taille. RELIGION catholique attaquée. REMUSAT ( Jean de ) Miles , compris dans l'allivrement de 1327. RÉNÉ ( le roi ) confirme les priviléges de la ville .Approuve la réforme du conseil.- Lève un subside sans le concours des états, déclare que c'est sans tirer à conséquence. REVELLI ( Jean ) , boucher , membre du conseil municipal (1334). REYNAUD-la-Croze, un des rédacteurs des doléances des communautés de la sénéchaussée, en 1789. RIBIERS, du bailliage de Sisteron, selon le dénombremeut d'Antonius de Arena . RICHELIEU . Le cardinal de Richelieu suspend les états de Provence ( 1639 ) . RICHESSE de la ville en 1327. RICHES . Armes qu'ils sont obligés de se fournir , . RIEU , un des quartiers de la ville . ROBERT ( le roi). Dons gracienx que la ville lui accorde4.-Autorise l'organisation du conseil municipal ( 1333 ).-Associe le duc de Calabre son fils unique au gouvernement. ROBERT(Simon), notaire et co-greffier du conseil pour les protestants ROCHEBRUNE, un des commissaires rédacteurs des doléances de la sénéchaussée , en 1789. RUFFI ( Raymond ) , jurisconsulte , membre du conseil.
S
SABRAN (Guill.e de) usurpe le comté de Forcalquier.-Transige avec les habitants de Sisteron ( 1212). Obligé de reconnaître les droits du comte de Provence. SABRAN (Ermengaud de) , de concert avec le sénéchal, écrit au bailli et au juge de Sisteron , pour la convocation des communautés , à Valensole ( 1297 ). SABRAN (Guill.e de) compris dans l'allivrement de 1327. SALIGNAC (bailli de) , condamné pour avoir exigé des habitants une prestation irrégulière. SALVERTE (Eusèbe) . Son essai historique et philosophique sur les noms d'hommes cité . SANG. Querelles sans effusion de sang , jugées par les barons dans leurs terres . SAUNERIE , un des quartiers de la ville. SCOFFIER ( Baudoin) , citoyen de Sisteron , député vers Charles I pour obtenir la confirmation des priviléges de la ville (1257). SEIGNEURS des villages veulent empêcher leurs vassaux de cultiver les terres appartenant aux habitants de Sisteron Soumis au droit commun à Sisteron. - Sur le refus ou la négligence du Seigneur de rendre la justice dans ses terres , le comte y pourvoit SÉNÉCHAL ( le grand ) de Provence. Autorise la création d'un ou plusieurs syndics , pendant 3 ans . -Assemblée des sénéchaussées à Forcalquier . SENTENCES réformées en appel rendent le juge passible de dépens . SERGENTS. Il ne leur est rien dû pour la convocation aux états du baillage .Signe de la croix , les conseillers font le signe de la croix.- Le juge , en faisant le signe de la croix, déclare que sa main ne se porte pas plus à droite qu'à gauche. SISMONDI (Sismonde) , un de ses art. de la Biogr. universelle cité . SISTERON . Ville celtique- Appelé clef de la Provence du côté du Dauphiné. SOLER ( les frères de ) , nobles Piémontais , banquiers à Sisteron , sont condamnés pour usure. STATUTS du comte Guillaume de Forcalquier ( 1170 ). - De Charles 1er (1257).-De la reine Jeanne (1352). SUBSIDES répartis par des prud'hommes. -Ne sont dûs que dans des cas déterminés. - SYNDICS. N'ont d'abord que des pouvoirs spéciaux . Commencent à recevoir un traitement - Portent des habits distinctifs de leur charge .-Obligés de les faire à leurs frais , ibid. Syndics de l'année précédente feront partie du nouveau conseil -Sont remplacés par les consuls . SYNDICS chargés des intérêts du bailliage.
T
TABLE raisonnée des matières jointe au livre vert , 39 . TALLARD ( vicomté de ) dépendante du bailliage de Sisteron . TARENTE ( Louis de ) , 2e époux de la reine Jeanne. TAVERNIERS . Règlements sur les taverniers (1290) , 10. TEISSIER , un des commissaires rédacteurs du cahier des doléances des communautés de la sénéchaussée en 1789 . TIROIRS adaptés à une gorge de loup pour recevoir les élections consulaires . TOURNEFORT , village du bailliage de Digne , ruiné par les bandes de Raymond de Turenne . TOURNIAIRE (Jean) Tornatoris , notaire, membre du conseil (1334) , 20. - Commissaire pour l'allivrement , 156 . TOURNOIS fabriqués à St. Remi , . TRÉSORIER nommé d'office , forcé d'accepter , doit tous les ans déposer son compte dès le 4 janvier. TRIBUNAL (greffe du) . Les registres des anciens notaires y sont déposés. TRESSEMANES , tres septimanas ( Guill. Bertrand et Raymond), compris dans l'allivrement de 1327. TROMPETTE de la ville. Cette charge mise en finance. TURENNE (Raymond de) désole le bailliage , 98. - Noms des terres que sa famille y possédait . TUTELLES. Les consuls pourvoient aux tutelles .
U
USURE punie . USURPATEUR. Actes de souveraineté d'un usurpateur subsistent , pour cause d'intérêt public.V VALLAT (Raymond) porté dans l'allivrement de 1327 avec la qualification de questor.VALAVOIRE (anciens seigneurs de) , ont une maison d'habitation à Sisteron.VALERNES. Le trésorier de Valernes assiste à l'assemblée des trois états du bailliage. VALET de ville. Edit qui met ces fonctions en finance . VALGELÉ. Faubourg allivré en 1327 . VALOIS. Monnaie décriée. VASSAL d'un seigneur jugé par la cour du comte , pour les engagements pris dans les lieux de sa juridiction . VELOURS. Chaperon de velours noir , doublé de satin rouge , que portent les consuls. VENTAYROL (les) ont une maison à Sisteron. . VIENNOISE (monnaie) , ou monnaie longue. VIGNES. Défense d'introduire des bestiaux dans les vignes . VIGUERIE , remplace le bailliage ( 1541). VIGUIER. Substitué au bailli VIGUIER (Sous) , agent de la cour.- Ne doit point visiter les chemins et les châteaux fortifiés du bailliage , sans y être autorisé. Ne doit point remplir les fonctions de sergent . VILLES de Provence. La plupart ignorent leur origine municipale . VINCENT ( St.) Ses mémoires sur les monnaies cités . VIN. Exemption des bans pour la vente du vin . VINS ( Hugues de) , grand sénéchal, écrit aux officiers de la cour pour la convocation des communautés aux états de Valensole ( 1296). VIOLATION des maisons religieuses punie par le prince . VISITES domiciliaires interdites aux agents de la cour , sans l'assistance de deux ou trois voisins hommes de bien. Les catholiques réduits , dans le conseil , à la majorité d'une voix. VOL sur les grands chemins punis par le comte . VOLEURS ne peuvent venir aux foires .
Y
YOLANDE (la reine ) reconnaît les droits qu'ont toutes les communautés d'être appelées aux assemblées des trois états du bailliage . Confir- me les priviléges du pays.
FIN DE LA TABLE .
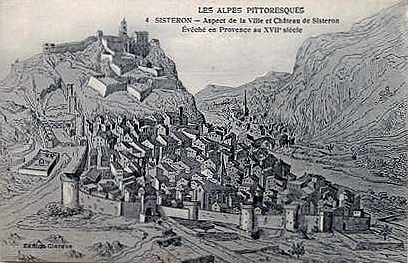
FIN DE L'OUVRAGE
![]()