Collège et lycée de Digne :
étude historique
par
Jules
Arnoux
1888
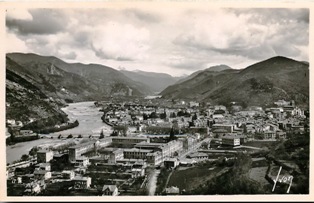
A
M, MARIUS SOUSTRE
INTRODUCTION
Au moment où les questions d'instruction publique intéressent si vivement tous les bons citoyens dans cette oeuvre de relèvement que la France poursuit avec une noble passion depuis dix-sept années, l'Université se plaît à regarder vers ses origines, à colliger ses titres anciens et nouveaux. Elle y cherche des enseignements, non pour imiter servilement le passé, mais pour accommoder ses méthodes aux exigences du temps présent, sans toutefois renier les littératures classiques, dont l'étude fortifiante est nécessaire à une éducation vraiment libérale.
Je veux apporter une modeste pierre îi cet édifice en cours de construction et raconter, à l'aide de documents originaux, l'histoire du Collège de Digne depuis 1474 jusqu'à nos jours. Cet établissement m'est resté cher à plus d'un titre. J'y ai professé la classe de huitième en 1868, la rhétorique de 1870 à 1885 ; j'ai pu collaborer à sa transformation en Lycée, comme conseiller municipal et comme inspecteur d'académie. C'est une dette de coeur que j'acquitte en lui consacrant cette étude, que j'eusse voulue plus complète, et à laquelle j'ai travaillé avec autant de plaisir que de persévérance. J'ai tenu toutefois à inscrire dès le début le nom du magistrat dignois qui, ayant le plus contribué à doter sa ville natale d'établissements d'instruction, mérite à tant de titres la respectueuse gratitude de l'Université. Nul de ceux qui l'ont vu à l'oeuvre ne sera pour me démentir.
J. A.
Inspecteur d'Académie, Agrégé des Lettres.
Draguignan, 1" juillet 1888.
PREMIÈRE PARTIE
LE COLLEGE
I.
Origines et première période.
1474-1611.
Pendant le moyen âge et jusqu'à la mi du seizième siècle, l'on n'a pas établi de distinction précise entre l'enseignement primaire et secondaire; le même régent, prêtre le plus souvent ou clerc tout au moins, était chargé d'enseigner les éléments de la lecture, de l'écriture et du latin (1).
(1) Pendant longtemps la classe de latin et la classe primaire ne formèrent, pour ainsi dire, qu'une seule classe.. On s'aperçut à la longue des incoménients de ce systèmeet la séparation fut décidée (1776).
Dans les villes importantes, les écoles étaient séparées et le personnel n'était pas le même, mais il était placé sous l'autorité d'un seul chef, appelé Grand Maître, ou Recteur. D'ailleurs, les collèges régulièrement constitués comprenaient, comme aujourd'hui, une classe primaire.
Les choses se passèrent de la sorte en Provence, et en particulier à Digne. Le premier document relatif à l'enseignement dans cette ville est une délibération des conseils communaux (11 juin 1410) et concerne l'instruction primaire; c'est un ordre de payer les gages» de deux maîtres d'école :
" Et premierament es estât ordenat, présent lo dich mossen lo baylle et consentent, que se pague al mestre de l'escola per l'estudi de Paschas, que dura entro a saut Juan, los gages que li son degus per lo dich estudi. Item es estât ordenat que lo maistre de l'escola de Chastellana (1) se mande querre e que governe las escolas entro a l'estudi de sant Michel, et si el se governe ben en lo régiment que governe mays al bon plazer del conselh » (Arcli. corn., B. B.3.)
(1) Castellane.
Cette pièce nous prouve que les écoles existaient depuis longtemps à Digne. Il est probable que les maîtres dont il s'agit donnaient aussi l'enseignement secondaire; Il est même permis de l'affirmer, en procédant par analogie. Quant au collège proprement dit, nous connaissons exactement la date de l'achat de la maison où il fut installé, au XV° siècle: il est encore considéré comme une « école », mais il est évident qu'il existait de fait déjà auparavant. Le 9 novembre 1474. les conseils communaux prirent la délibération suivante :
« .... Item plus es estât ordenat que sian acceptas al dich tresauiier florins set, que ha pagal al noble Juan Chaussagros et sa molher (femme) per comandament dels senhors sendegues (syndicts), et aquo en diminution del près dei l'ostal de l'escola, que la villa ha comprat de elles....Item mays (de plus) es estât ordenat que los senhors sendegues. ainbe Elzias Raos, lo senhor d'Anlragelles et autros que bon semblara en lor companhîa, deian donar a preffach a mestre Bernart ho autre mestre, al melhor marchât que pognon, de fayre reparar et adobar l'ostal per l'escollo que la villa ha comprat de sen Juan Chaussagros et sa molher, et aquo en maniera que lo dich ostal sia segur et que si fassa tota réparation necessaris. Item mays es estât ordenat que lo tresaurier pague a Juan Chaussagros et sa molher XXIII florins, que li son degus per comprat de l'ostal de Solhabuous (quartier de la préfecture et du tribunal), »
(Arch. corn.. BB. 8.)
Ainsi, la ville achetait au prix de 30 florins (en deux payements) la maison du sieur Chaussegros pour y établir l'école, c'est-à-dire le collège, et prescrivait les réparations nécessaires; l'immeuble était situé rue Mère-de-Dieu (no 34) ; après une série de transformations dont nous parlerons plus tard et dont la dernière est toute récente, il est occupé actuellement par l'aumônier du pensionnat des Ursulines. .En 1476, les registres des trésoriers constatent que la maison a été appropriée à sa nouvelle destination ; en 1499, il est dit, au compte d'Honnorat Gassendi, que 10 florins ont été payés à Elzêar Aguillenc, clavaire de la cour royale, pour les droits de lods (ou de mutation) de la maison d'école. (Arch. coin., G. G.) Le collège atteignit rapidement une certaine prospérité, puisqu'on 1481 la chaire de rhétorique et sans doute la direction en étaient sollicitées par un latiniste élégant, tel qu'Antoine Ferrier, de Mousliers. Cet aspirant au principalat écrivait aux consuls de Digne, le 12 avril, une lettre, dont l'original nous a été communiqué par l'aimable et érudit archiviste des Basses-Alpes, M. Isnard. Cette lettre est intéressante à plus d'un titre. L'école est appelée ludus litterarius, ce qui implique l'enseignement des humanités; le professeur que Ferrier désire remplacer est un véritable régent de rhétorique, rhetor ludi Utlerarii. Il étale naïvement, dans un latin tout cicéronien et à grand renfort de citations classiques, son érudition et ses principes aux magistrats dignois, qu'il accable d'épilhèles redondantes.Il fait l'éloge de l'instruction: il compare la vie humaine à une mer orageuse et la science à un vaisseau qui nous permet d'y voguer dans une sécurité complète; la science, dit-il, est le bien le plus honorable et le plus sûr. Nous ne dirions pas autrement aujourd'hui. Il fait ensuite l'éloge de la vertu, compagne indispensable de l'instruction, et il est convaincu que les consuls et les nobles habitants de Digne voudront laisser à leurs enfants un aussi glorieux héritage. En terminant, il s'offre pour expliquer aux élèves qu'onl lui confiera Térence, Virgjle, les offices et lettres de Cicéron, Juvénal, Perse, Boèce et Horace, indépendamment d'une foule de grammairiens.
Ce programme peut nous paraître ambitieux, mais il nous atteste que, dès cette époque, l'enseignement vraiment secondaire était donné au collège de Digne.
Nous ignorons si Antoine Ferrier fut agréé par les consuls. Pendant plus d'un siècle, nous n'avons que de maigres renseignements tirés des comptes des trésoriers. En 1500, Honnorat Gassendi paye à Jeanne Martin et à maître Vincens Roman, recteurs des écoles l'année précédente, 37 florins. En 1518, François Nadal paye les gages ordinaires à maître Blase Clavau, magister de l'escollo de l'an passat, 20 florins.
En 4530, maître Arnaud reçoit 20 florins pour les gages et le premier quartie. En 1546, il est donné à Johan Bertrand, recteur des écoles, pour son traitement dle
l'année précédente, la somme de 75 florins. C'était déjà, pour l'époque, une dépense importante. Plus tard enfin, en 1580, maître Olivari Jay touche 188 florins.
On remarquera la progression constante dans les gages des maîtres du collège. Il est probable toutefois que plusieurs régents étaient attachés à l'établissement et que leur traitement était compris dans les chiffres cités.
Arrivés au commencement du XVIIe siècle, nous trouvons des documents plus nombreux et moins espacés : 1601. Estienne Clary, régent des écoles, et Maynac, autre régent, 48 écus, « revenant à 144 livres ». 1607. Roustan, pour le dernier quartier, 17 écus. Camatte, prêtre,pour le premier quartier,12 écus. 1603. Le même, pour l'année, 50 écus. 1609. Le même,régent du collôge ;(l), 36 écus. Jean Bruno, avocat en la cour, 34 écus. 1610. Jean Bruno, 50 écus. 1611. Brun, régent du collège, principal des école et collège, 51 écus. Bouteillon, autre régent, 24 écus.
(1) Le mot de collège est employé pour la première fois.
L'organisation de l'établissementa fait un pas important, puisqu'il y a un principal chargé à la fois de la direction de l'enseignement primaire et secondaire. Les gages n'étaient pas élevés sans doute, mais ceux des autres employés de la commune ne l'étaient pas davantage. D'ailleurs, on percevait au profit des maîtres une rétribution sur les élèves. Il est bien difficile de se faire une idée exacte de ce qu'était l'enseignement au collège de Digne pendant cette première période; il fut sans doute assez modeste, au début; mais, à l'entrée du XVIIe siècle, il parcourait évidemment le cycle complet des études lalines, puisque Gassendi en prit la direction en l'année 1612,
II.
Gassendi,
La " dispute" ou concours. — Les Jésuites.
1612-1743.
Les biographes de l'illustre Gassendi n'ont pas manqué de rappeler son enseignement au collège de Digne. Nous citerons les passages les plus caractéristiques et nous établirons, à l'aide de documents nouveaux, les dates et les faits les plus importants. Nous lisons dans son oraison funèbre, prononcée en 1655 par Nicolas Taxil :
« Son premier vol fut dans Digne, où, en poursuivant ses estudes par le seul effort de son génie, il fit part à plusieurs jeunes hommes qui vivent encore avec esclat dans cette ville des lumières qu'il avoit apportées de sa solitude (1).
(1) Du village de Champtercier où il était né en 1592.
Ils admirent encore sa facilité à les instruire, sa docilité à les corriger et sa constance à passer ordinairement les nuits à la lecture des bons livres. Il quitta Digne et fut à Aix, où il acheva sa philosophie sous le P. Fesaye, qui m'a dit cent fois que M. Gassendi, estudiant sous luy et n'ayant encore que 15 ans commencés, il estait assez capable pour estre son maistre plutôt que son escholier. Il revint à Digne sur la fin de cette année (1607). pour se trouver à la dispute générale du collège, en laquelle il parut si esclairé en toutes les sciences qu'il gagna le prix sur les sçavants qui se trouvèrent au concours, comme il estait très petit de corps, il renversa, à l'imitation du petit David, ces montagnes de chair, ces gros géants venus des Alpes pour conduire les escholes de Digne. Les arbitres de la dispute ayant remarqué que celuy qui ne paraissait quasi point au milieu de ces grands Régens avait jette des lumières si fortes qu'elles avaient fait perdre la veue, l'esprit et selon leur terme la carte à ceux qui le surpassaient de toutes les espaules. D'abord qu'il eut acquis par son mérite le gouvernement du collège (1), il se rendit si recommandable par les leçons qu'il y faisait tous les jours et qu'il continua pendant quelques années, que les doctes de cette ville, dont le nombre a été grand de tout temps, le regardaient comme un homme miraculeux (2). »
(1) A. de la Poterie nous montre Gassendi principal du collège en 1612. (Documents inédits, p. 8.)
(2) Bulletin de la Société littéraire des Basses-Alpes: Oraison funèbre pour messire Pierre Gassendi, prestre, docteur en théologie, conseiller, lecteur et professeur du roy aux mathématiques, prononcée dans l'Eglise Cathédrale de Digne, le 14 uovemhro 1655, par messire Nicolas Taxil (Publiée par< M, Tamizey de Larroque.)
A ce témoignage naïf et touchant d'un contemporain, nous ajouterons celui du P. Bougerel :" Retourné (d'Aix) à Champtersier. ses parents n'eurent pas longtemps la consolation de l'avoir auprès d'eux. Une dispute annoncée pour la chaire de rhétorique le leur enleva bientôt; il court à Digne, se met sur les rangs, remporte la chaire quoiqu'il n'eût encore que seize ans. Ce fut au grand regret de toute la ville qu'il quitta son emploi un an après (1609). "
Un des derniers biographes du philosophe, Firmin Guichard, prétend qu'il fut ne pas nommé professeur de rhétorique au concours, mais que ce fut plus lard, après son cours de théologie qu'il fut placé à la téte du collège de celte ville On n'avait pas l'habitude d'établir des concours pour choisir les professeurs; on était à cette époque bien content d'en trouver qui consentissent à se dévouer à celte tâche ingrate et difficile. Sur ce point, l'exactitude ordinaire de Guichard est en défaut; il nous sera facile d'établir que les concours étaient antérieurs même à Gassendi.
Les registres des comptes nous donnent sur les points précédents des indications précieuses. Sébastien Fabre, trésorier en 1612, " pareillement se descharge et fait yssue de la somme de 24 escus qu'il a payé en deux diverses fois à messire Pierre Gassend, à présent principal régent i des escoles de ceste ville, en déduction de ses gages et pour deux quartiers à eschoir à la fin de mars dernier, ainsi qu'appert des mandats et aquits qu'il en a concédé au bas d'iceux en date des 23 et 26 novembre 1612, Geptiesme et treiziesme dudil mois de mars, et J XXIV escus."
En 1613, Gassend, régent des escoles, reçoit 12 écus pour un quartier (trimestre). En 1614, Gassend, chanoine théologal et régent du collège, touche 60 écus pour 5 quartiers. En 1615, " payé à messire Gassend, chanoine théologal, cy-devant régent des escoles. et à messire Michel Ollivier, cessionnaire dudit messire 24 écus pour 2 quartiers ».
11 résulte de ce qui précède que le principal du collège, Pierre Gassendi, recevait 48 écus. soit 144 livres par an. Il est même probable que ce traitement était partagé entre les régents, dont le nombre, d'ailleurs, devait être fort restreint. Nous n'avons aucune donnée sur l'enseignement que recevaient les élèves et sur l'organisation des études : ce qu'il y a de certain, c'est que les leçons de Gassendi avaient laissé une impression profonde parmi ses auditeurs. Il nous reste à établir combien d'années il demeura au collège,et à quel titre, A la suite d'un concours, il professa la rhétorique à l'âge de 16 ans,.au commencement de l'année 1608, mais nous ignorons la durée de cet enseignement, « principal régent des écoles » jusqu'en 1615. époque où il , fut remplacé par Michel Ollivier ; son principalal avait été de trois ans. Il n'est resté aucune trace de cette période de la vie de celui qui devait plus tard s'illustrer comme mathématicien au .Collège de France, comme philosophe et adversaire de Descartes. Ce n'est pas un des moindres titres de gloire du collège de Digne de l'avoir compté au nombre de ses professeurs et de ses principaux. L'immeuble était des plus modestes, môme pour l'époque, et il paraîtrait aujourd'hui à peine suffisant pour une école de village. Au XVIIe siècle, on n'était pas difficilesur ce point: les élèves, d'ailleurs, ne devaient pas être nombreux. Et puis la parole du brillant professeur donnait à l'établissement un éclat des plus enviables ; ce souvenir protégea pendant longtemps la réputation du collège. Il y a toutefois un fait earactéristique dans l'organisation des collèges et des écoles à cette époque, c'est le recrute*merit du personnel enseignant, Les régents sont désignés chaque année â « la dispute » ou concours, Dès 1611, les registres des comptes mentionnent une dépense de 5écus faite dans une auberge par les écoliers et les régents pour « la dispute >. Cet usage était commun, du moins en Provence (1).
(1) A Troyes, vers 1600, le principal était élu pour cinq ans par les trois corps de la cité, réunis en assemblée sous la présidence de l'évèque ; il nommait ensuite lui-méme les régents.
« Le régime de l'école est en général baillé pour un an commençantà la Saint-Michel...Le maître est choisi par le conseil de ville, qui s'entoure quelquefois de l'avis des pères de famille, sans autre garantie que sa bonne réputation et ses services antérieurs. Quant à l'agrément de l'autorité ecclésiastique, il a cessé d'être requis, tout au moins à partir du XVI« siècle S'il y a plusieurs candidats, le plus capable est nommé après un concours ou dispute présidé par un jury composé de notables, docteurs en droit canon, en droit civil ou en médecine, et les étrangers qui y prennent part sont libéralement hébergés aux frais de la commune. Mais cette disposition, prescrite par un arrêt de règlement du Parlement de Provence, basé sur la loi romaine et l'ordonnance de Charles IX, n'est légalement obligatoire que pour la direction des grandes écoles (1). »
(1) L'enseignement primaire en Provence, Mireur, pp. 2 et 3.
Jusqu'en 1631, nous ne trouvons aucune pièce qui nous permette d'indiquer nettement les conditions de ces concours dans la ville de Digne. Le conseil général tenu le 14 septembre de cette année est intéressant à plus d'un titre :
" Auquel conseil a été représenté par le sieur premier consul que, par le défaut de pouvoir avoir des régents suffisants et capables pour le collège, les enfants ne profitent pas, et que pour l'instruction d'iceux il est» important à la commune d'établir un collège par des personnes régulières (Sans doute des religieux), qui enseigneront depuis la cinquième classe jusque à la philosophie inclusivement puisque ledit établissement peut être fait sans qu'il en coûte beaucoup à la communauté par dessus la somme qu'elle a accoutumée de donner pour la régence du collège, et que le moyen pour établir le collège se trouve facile; requérant le conseil, au cas qu'il agrée l'établissement dudit collège, de commettre des personnes telles que bon lui semblera pour traiter avec les Pères (Prêtres réguliers, les Jésuites sans doute.) qui seront choisis par ledit conseil, de convenir et traiter avec eux soit pour le rétablissement, soit des paches, marchés et précautions qu'il faudra prendre avec eux. Plus ledit consul a représenté qu'ils ont mis la régence des classes du collège à la dispute, en présence de plusieurs apparants (notables) de la ville et bailler à ceux qui se sont trouvés les plus capables, requérant le conseil de le ratifier et leur donner pouvoir de passer le contrat audit régent aux gages accoutumés
(1)"
(1) Arch. com., BB. 23.) — En 1683 (29 novembre), le conseil ratifie des dépenses faites au collège; 12 li\res 13 sols et 8 livres 11 sols pour réparation.
En 1684, le 30 juillet, le conseil se réunit pour le même objet : " Comme aussi a esté délibéré et donné pouvoir aux sieurs consuls de mettre toutes les classes du collège de ceste ville à la dispute et pour ce subjet faire recherche des personnes les plus capables qu'ils pourront pour s'en acquiter et faire mettre des affiches aux villes de ceste province (1) pour advertir de la dispute qu'il sera i faite au jour qui sera assigné par les sieurs consuls et la régeance desdites classes donnée à ceux qui s'en trouveront les plus méritants sans aulcung suport après laquelle dispute le confract leur sera passé par lesdits sieurs consuls aux gages pactes et conditions des précédants (2.) »
(1) Cette particularité est à noter; elle indique que les concours étaient très sêrieux.
(2) Arch. com.
Ces deux délibérations nous prouvent qu'après le principalat de Gassendi la prospérité du collège ne s'était pas soutenue et que le recrutement des professeurs laissait à désirer ; l'on espérait être plus heureux en s'adressant à des clercs réguliers, mais sans renoncer au concours annuel fait en présence de plusieurs notables, probablement sous la présidence d'un consul. L'intervention de l'autorité ecclésiastique n'est pas mentionnée, mais elle ne nous paraît pas douteuse, puisque les candidats étaient gens d'église. L'on voulait rendre toute son importance à l'établissement, en y enseignant les humanités et la philosophie et en donnant une grande publicité à la é dispute".
Le 20 octobre 1686, le conseil approuve le choix qui a été fait par les consuls ; puis il " délibère d'achepter des livres pour chasque classe pour estre donnés à celluy des escoliers qui en sera trouvé le plus digne jusques au » prix de 12 livres" (1).
(1) Arch.com.
Pour la première fois, à cette date, il est question de récompenser les élèves et de faire ce que nous appelons une distribution de prix ; le meilleur élève de chaque classe devait recevoir un ouvrage.
Les contrats relatifs aux régents désignés par la voie du concours sont mentionnés, quant à la période qui nous occupe, jusqu'en 1692: il est dit, pour cette année (comme en 1681), que le pacte est conclu " pour la régence des classes depuis la cinquième jusqu'à l'humanité". Il est probable que les classes inférieures n'étaient pas comprises dans le concours.
Les sacrifices faits par la ville avaient augmenté en proportion du personnel : en 1633 et 1684, 480 livres pour les gages des régents ; en 1689, le chiffre était moins élevé: 230 livres pour six régents (1).
(1) Arch. com., Registre des Comptes.— Au collège de Verneuil, en 1599, les quatre régents avaient de 20 à 150 écus par an, outre certaines redevances que payaient les élèves,
Quant aux bâtiments, ils étaient bien exigus; nous lisons ce qui suit dans un dénombrement des biens communaux établi le 4 mars 1673 :
" Plus une autre maison appelée le Collège, où on tient les écoles dudit Digne, consistant en quatre chambres au carlier de Soleihebeuf, dans le terroir dudit Digne, confrontant dessus et dessoubs le chemin public, jardin du sieur lieutenant Daleric et le bastiment et tannerie de Claude Bellort, mouvant aussi de la directe
de ladite majesté et dudit seigneur ôvesque de Digne, chacun par moitié, laquelle maison du Collège ladite communauté possède aussy de toute ancienneté, sans
en avoir jamais tiré aucun revenu." Quatre chambres ! Nous voilà bien loin des vastes édifices construits de nos jours pour l'instruction de la jeunesse. Qu'on nous permette ici un rapprochement : le collège de Port-Royal transféré à Paris, rue Saint-Dominique, en 1647, ne comprenait que quatre chambres, peut-être cinq, devant contenir six élèves chacune",
Les Jansénistes évitaient, avec raison, les grandes agglomérations d'élèves. Les consuls de Digne partageaient-ils en principe cette manière de voir? Nous l'ignorons.
Quant au nombre d'élèves présents, nous n'avons malheureusement aucune donnée pour l'établir.
Ici, nous sommes obligés de revenir sur nos pas pour dire quelques, mots des Jésuites, qui, d'après M. l'abbé Féraud. auraient gardé la direction du collège depuis 1652 jusqu'en 1762, époque de leur suppression. Cette dernière date est fort contestable. Les documents que nous possédons n'ont pas toute la précision désirable ; mais ce qui est certain, c'est que la célèbre compagnie dirigea le collège avant l'année 1651, sans préjudice des concours annuels pour la régence des
classes. Nous lisons dans la délibération du conseil particulier tenu le 16 septembre 1651 :
" Encore à ratifier l'acte de la régence du collège en faveur du sieur Touret, à condition qu'il souffrira la direction et le soin que les R. P. Jésuites en ont."
Il est impossible de déterminer nettement en quoi consistaient "la direction et le soin" des Jésuites, puisque le conseil communal se réservait toujours le choix et la
nomination des régents. Il y eut des tâtonnements et de longues hésitations, car l'on délibéra plusieurs fois sur l'établissement d'un nouveau collège qui serait placé
entièrement sous la main des Jésuites, mais sans aboutir.le conseil municipal aurait demandé la fondation d'un collège de Jésuites à Digne: le général de l'ordre ne voulut prendre aucune décision avant d'en avoir conféré avec le P. Provincial ; il promettait toutefois son concours le plus bienveillant. A la même date, le P. Antoine Richeome assurait aux consuls qu'il userait, à Rome, de toute son influence pour la réussite " d'une si noble négotiation". Le 6 juin, le P, Guillaume de Lange écrivait d'Aix aux consuls dans le même sens,
Quatre jours après, le premier consul, sieur de Trévans, communiquait cette lettre au conseil, lequel donnait pouvoir aux magistrats municipaux de dresser la minute des articles pour l'établissement du collège, avec telles personnes qu'ils trouveront à proposi. Dans le conseil général tenu le 17 juin, il est dit que " le sieur consul a représenté, ensuite de l'assemblée qui avait été t tenue l'année dernière de presque tous les apparants, à laquelle fut délibéré de moyenner d'avoir un collège des R, P. Jésuites dans cette ville, et dont fut député huit ou dix personnes pour travailler incessamment à ce glorieux dessein et d'autant qu'il est à propos de faire savoir
au conseil les avantages que la communauté doit donner, c'est : 1° 3.000 livres de pension annuelle, à ce compris le revenu des biens qu'ils possèdent en cette ville, Aiglun et Mirabeau, à eux légués par la dame d'Espinouze et le sieur de la Robine ; lesquels biens étant vendus seront d'autant pour la quittance des 3,000 livres. Il faut aussi leur bâtir un collège et le meubler suivant la portée de la ville, qui coûtera plus de vingt mille livres. " Le conseil donnait tout pouvoir aux consuls pour mener cette affaire à bonne fin.
On revint, le 22 septembre 1656, sur cette question :
"— Encore a été proposé que le collège étant fort éloigné de la ville la jeunesse est fort incommodée soit par le chaud, soit par le froid ou en temps de pluie ; et
d'autre part que n'y ayant que quatre classes il faut d'ordinaire prendre à louage deux chambres pour les deux petites classes ; de sorte qu'il serait nécessaire de
pourvoir à faire bâtir un autre collège et vendre les autres bâtiments anciens. De quoi (les consuls) ont conféré avec les R. P. Jésuites, qui ont offert de bailler la grange et jardin qui est au devant de leur maison (1),
(1) Nous ignorons où était située cette maison. Le collège était simplement un externat et les régents se logeaient en ville.
ce qui sera un moyen plus propre pour avoir plus de soin de la direction qu'on leur donne dudit collège. Sur lesquelles propositions a été délibéré que les consuls pourront faire mettre à l'enchère la vente des bâtiments du collège et donne pouvoir à iceux de traiter de la place par eux désignée el faire mettre la bâtisse à l'enchère pour la délivrer à celui qui en fera la condition meilleure".
La vente de l'ancien collège et la construction du nouveau n'eurent pas lieu. En 1681, le conseil envoya une dôputation vers les P. R. de la Mission à Marseille pour
les prier de se départir en faveur du collège du legs de la dame d'Espinouse fait à eux, ainsi qu'aux Pères Jésuites et au Pères de l'Oratoire, dans le but de fonder à Digne une maison d'éducation religieuse . En 1682, on entra en pourparlers avec les Pères de la Doctrine chrétienne pour la direction du collège et la construction d'un bâtiment, neuf; le tout sans résultais. En 1718, nous trouvons mentionné l'enregistrement d'une ordonnance royale autorisant le sieur évêque de Digne à rétablir toutes les classes du collège et lui donnant le pouvoir de nommer pour régents les personnes qu'il jugera les plus convenables.
C'est pour la première fois que les ecclésiastiques, au détriment des magistrats municipaux, sont clairement investis d'une autorité souveraine sur le personnel enseignant. Il n'est plus désormais question des Jésuites; nous ignorons à quelle date ils quittèrent la direction du collège. L'ancienne prospérité de l'établissement semble n'être plus qu'un souvenir. Il est temps que les consuls avisent ; il ne le feront qu'en 1743 (1).
(1) 11 n'est pas sans intérét de mentionner qu'en 1738 la commune envoie un placet à M. de La Tour, intendant, pour obtenir l'autorisation d'établir deux frères de l'école chrétienne. La demande est rejetée parce que la ville est déjà trop endettée. Mais, en 1743, nous constatons la fondation d'une maison dirigée par deux frères de l'école chrétienne pour apprendre les garçons à lire et l'arithmétique, avec une rétribution annuelle pour chacun (frêre) de 200 liues payables à l'avance et par quartieir. (Arch. com, B B.) Dès lors, l'enseignement primaire est donné à part.
III.
Réforme du Collège et construction d'un nouvel établissement,
1744-1786.
Les consuls résolurent de tenter un grand effort et de réorganiser les classes du collège; le 6 octobre 1743, le conseil général de la commune délibérait sur la situation du collège. Le sieur Francoul, premier consul, "représente qu'on a depuis longtemps le désagrément de voir que le collège de cette ville, qui anciennement était un des meilleurs collèges de la Haute-Provence et des plus fréquentés, devient d'année en année plus désert et ne donne que fort peu des (sic) bons écoliers. Les émoluments attachés à chaque classe étant devenus trop modiques par la vicissitude des temps qui a tout enchéri ot ne permettant plus d'employer à l'éducation de la jeunesse des ouvriers tels qu'un soin aussi important le demanderait, l'insuflsance de ceux sur lesquels on était forcé de se rabattre, était la seule cause de ce dépérissement. Dans ces justes idées, comme il n'y a rien qui intéresse davantage une communauté, qui est la mère de ses habitants, que l'éducation de la jeunesse; que c'est de ce point que partent les bons juges, les bons prêtres, les bons administrateurs, en un mot les bons citoyens, on a cru que, pour rétablir le collège dans son ancien lustre. il fallait aller à la source du mal et attribuer à chaque classe en particulier des émoluments proportionnés au travail, capables non seulement d'attirer des (sic) bons régents, mais encore de les retenir"
Il propose donc de donner au régent de sixième 120 livres, à celui de cinquième 130, a celui de quatrième 140, à celui de troisième 150, à celui de seconde 160 et à celui de rhétorique 200, soit un total de 910 livres, au lieu de 510 comme précédemment.
Suivent des propositions que nous trouverons dans une autre délibération, qui sera transcrite à cause de son importance. Toutefois, dans cette dernière, n'est pas mentionnée une prescription ainsi formulée :" Les consuls laisseront à l'arbitrage des régents le soin de faire faire de temps à autre à leurs écoliers quelque exercice littéraire pour rompre la timidité naturelle aux enfants; bien entendu que ce sera sans préjudice du travail ordinaire, s'en reposant à cet effet sur leurs attentions et leurs bonnes volontés."
Les excellentes intentions du conseil ne sont pas suivies d'effet. Une nouvelle délibération est prise cinq ans après, le 18 août 1748; elle renferme un véritable plan
d'études ; la voici; en entier :
"L'an mil sept cent quarante-huit et le dix-huît du mois d'aoust à Digne, dans la salle de l'hôtel de ville, de l'autorité de messieurs les maire, consuls, lieutenants généraux de police de cette ville de Digne, le conseil général de la communauté a été convoqué et assemblé à leur requête par Joseph Espitalier, trompette ordinaire
de la ville, qui a fait précéder les criées et proclamations par tous les lieux et carrefours de la mémo ville accoutumés, par devant M. Me Hiacinthe Corriol (1),
(1) Après avoir fait ses études au collège, il devintt un jurisconsulte de mérite et composa des vers estimables. Il e'st pemis de supposer qu'il a rédigé cette remarquable délibération, D'aplès l'abbé Féraud, il naquit à Digne en 1710 et y mourut en 1751.
avocat en parlement, sieurs Hiacinthe Agnely, bourgeois, Jean-Joseph Besson, maître apothicaire, sieurs consuls modernes, lieutenants généraux de police, autorisant ledit conseil en absence de M. le Maire, auquel conseil ont été présents avec Mrs les consuls : Me Jacques-Etienne Francoul, sieur de la Javie, avocat, Me Louis Yvan, notaire royal et procureur au siège, Sr Jean-François Magaud, marchand, sieurs consuls vieux, Sr Joseph-Dominique Jouine, bourgeois, Mes Gaspard Guilton, sieur de Barras, Jean-Pierre Amoureux, avocats, Joseph Trabuc à feu Joseph, cordonnier, Gaspard Nicolas, bourgeois, Joseph Esmiol, négociant, Gaspard Mayet, marchand, Pierre Michel, négociant, Jean Mégy, ménager, François Arnaud, revendeur, Me Pierre Guieu, greffier ea la sénéchaussée, Me Joseph Mcyronnet, avocat, Joseph Chaix, ménager, François Lombard, négociant, Jacques Marrot, marchand, Augustin Bully, négociant, Pierre Gassend, revendeur, Honoré Magaud, serrurier, et Gaspard Civatte, boulanger, tous conseillers au dit conseil ou subrogés à yceluy.
Rétablissement du Collège.
Auquel conseil il a été représenté pat Mrs les consuls de la bouche du sieur Corriol, premier consul, que depuis l'interruption ou pour mieux dire la cessation du collège, on voyait journellement la dissipation, l'ignorance et les vices, enfants de l'oisiveté, gagner la jeunesse de la ville; que tout ce qu'il y a de pères et de gens à méme de le devenir, tout ce qu'il y a de gens sensés et amis du mérite et de la vertu soupiraient après le rétablissement de ce même collège; que l'intérêt de la communauté ne saurait être ni plus réel ni plus pressant que de pourvoir à un besoin aussi essentiel, puisque ce n'est que dans le collège, où se jettent les semences d'une bonne éducation, qu'elle peut trouver cette pépinière toujours renaissante de bons sujets et de bons citoyens en tout genre, qui seuls peuvent en être l'honneur et l'appuy; que monseigneur l'évêque désirant concourir à une oeuvre dont il sent mieux qu'un autre toute la conséquence, il (sic) était entré avec eux en connaissance de ce qui avait pu en occasionner la décadence et la chute, et qu'ils avaient reconnu que d'un côté les émoluments étaient encore trop modiques dans chaque classe, quoique la totalité en eût été portée à neuf cents livres par délibération du conseil du sixième octobre 1743; et que de l'autre la séance publique, où l'on disputait les classes et où elles étaient distiibuées, étant indistinctement composée de toute sorte de personnes entendues et non entendues, cette assemblée était souvent indécente et tumultueuse, de sorte que la plupart des régents ne trouvant pas au fonds un intérêt qui pût répondre à la peine et étant par surcroît rebutés par la forme, il ne fallait pas être surpris qu'il ne se présentât pas un nombre suffisant de sujots capables pour remplir le collège. Dans ce point de vue, Mrs les consuls auraient formé un plan de rétablissement par lequel, sans blesser le droit de la ville touchant la dispute des classes, on ne laisse pourtant pas que de réformer et de rendre la séance publique d'ycelle, plus régulière, plus décente et mieux entendue, et par lequel avec une légère augmentation, on pourvoit suffisamment aux honoraires de chaque régent, au moyen de quoi on a.lieu de se flatter que la double cause du mal étant otée, on verra renaître dans la ville un collège remply par de bons régents et féconds en bons écoliers. Voici le plan que Mrs les consuls se sont proposés de faire agréer au présent conseil, et sur lequel il s'agit aujoind'hui de délibérer.
Nouveau plan. — Honoraires.
1° Au lieu de cinq cent dix livres par an que la communauté donnait anciennement et qui ont été portées à neuf cents livres par la délibération dont on a parlé ci-dessus, elle donnera annuellement mille livres qui seront distribuées de la manière suivante :
Au régent de rhétorique deux cent quarante livres, ci. 240 » (1)
Au régent de seconde cent quatre-vingt-dix livres, ci. 190 »
Au régent de troisième cent soixante-cinq livres, ci.. 165»
Au régent de quatrième cent cinquante livres, ci..... 150 >
Au régent de cinquième cent trente-cinq livres, ci.... 135 »
Au régent de sixième cent vingt livres, ci 120 »
Total 1,000 »
(1) Au collège de Montpellier, en 1791, le principal avait 1,200 livres, le professeur do philosophie 900 tt les autres 800. — A Vire (Calvados), en 1747, le
régentt de rhétorique avait 500 lhies et les autres 400. — An collège de Dôle, en 1765, après l'expulsion des Jésuites, le prinçipal avait 800 livres et les régents de 400 à 600. (Le Collège de Dôle, p. 80.)
'Lesquels honoraires seront payés à chaque régent en particulier en quatre payements égaux, dont trois de trois en trois mois, et le dernier après la clôture du collège, sur Lls mandats que MM les consuls en adresseront au trésorier de la communauté. Chaque écolier qui répétera chez son régent donnera vingt sols
par mois en sixième et en cinquième, vingt-einq sols en quatrième et en troisième, trente sols en seconde et en rhétorique, sans que les régents puissent rien prétendre ni exiger au delà. Et afin que l'augmentation des honoraires des régents sur le pied ci-dessus soit moins à charge à la communauté, chaque écolier indifféremment, soit de la ville, soit étranger, payera six livres par chaque année qu'il étudiera dans le collège/ lesquelles six livres seront exigées par le trésorier de la communauté par tout le mois de novembre de chaque année, suivant l'état et le rôle qui sera arrêté par MM. les consuls et par eux remis audit trésorier, sauf de comprendre dans ledit rôle les écoliers qui pourront entrer au collège après ledit mois de novembre, lesquels payeront également six livres, et sans espoir, à ceux qui n'achèveront pas l'année d'étude, de répétition desdites six livres au prorata du temps qu'ils n'auront plus fréquenté le collège.
Dispute des classes. —Séance publique de la dispute des classes.
1 Le jour de la dispute des classes sera tous les ans indiqué suivant l'usage, au temps ordinaire, et par affiches de l'autorité de MM. les consuls et à leur diligence.
2 Les régents et candidats seront tenus de se présenter dans la maison de ville au jour indiqué et ne seront reçus (Admit.) au concours que ceux qui rapporteront par écrit l'aprobation de Mgr l'évêque. 3 MM. les consuls convoqueront l'assemblée qui devra connaître du mérite des compétiteurs et prononcer sur la distiibution des classes et y inviteront par billet douze personnes capables d'en juger sainement et avec impartialité, qu'ils choisiront indifféremment dans tous les oidres de la ville, laïques et ecclésiastiques, séculiers et réguliers desquelles personnes procéderont conjointement avec eux à l'examen des candidats, soit en les interrogeant, soit en leur faisant expliquer les auteurs classiques, soit en leur donnant à faire des vers, des thèmes, des amplifications,etc.
4 Les Srs consuls piésideront à cette assemblée et y auront voix délibérative de même que chaque examinateur en particulier, en observant néanmoins qu'en cas de pailage la voix de MM. les consuls sera pondéralive. 5 Le tiavail qu'on aura donné à faire à chaque concurrent une fois fini, les sieurs consuls en retireront les copies, qu'ils mettront toutes sous une même enveloppe à laquelle chaque examinateur pourra mettre son cachet et si bon lui semble, pour être ladite enveloppe ouverte le lendemain dans une autre séance à laquelle les mêmes personnes seront priées de se trouver pour faire la lecture et l'examen des copies y contenues, et être ensuite prononcé sur icelles à la pluralité des voix, et les classes distribuées en conformité des sufrages.
Les classes ainsi distribuées, MM. les consuls feront appeler les candidats en présence des examinateurs; ils leur donneront connaissance du jugement qui aura été porté par rassemblée et de l'adjudication qui aura été fait de chaque classe ensuite de l'examen et du résultat des opinions.
Règlement pour la conduite de la police du collège.
1 Chaque régent entrera dans la classe depuis le jour et fête de St Luc (18 octobre.), jour de la rentrée du collège, jusques à Paques à huit heures du matin précisément jusqu'à dix heures, et depuis Pâques jusques à la clôture des classes à sept heures du matin précisément jusques à neuf, et l'après midi pendant toute l'année à deux heures précises jusques h quatre heures, de façon que la classe dure toujours deux heures le matin et deux heures le soir. 2 II n'y aura de congé depuis la rentrée du collège jusques à Pâques que l'après midi de chaque jeudi, et'depuis Pâques jusques à la clôture du collège que le jeudi entier.
3 Chaque régent aura soin le jour de congé de donner à ses écoliers un devoir suffisant pour les occuper, de façon qu'il ne leur reste ni trop de temps à perdre ni assez pour se dissiper. 4 Chaque régent dans sa classe faira composer ses écoliers tous les vendredis au soir et tous les samedis au matin et distribuera les plaees avec connaissance de cause et sans parcialité, rien n'abaissant plus le courage (coeur, sentiments) des enfants que des préférences injustes, dont, malgré leur jeunesse, ils ne s'aperçoivent que trop.
5 Il y aura annuellement deux compositions générales, savoir : une lors de la rentrée, pour distribuer les écoliers chacun dans la classe pour laquelle il sera jugé propre, et l'autre quelques mois après, selon que MM. les consuls l'indiqueront, pour voir si les écoliers profitent et si les régents en ont tous les soins qu'on doit en
attendre.
6 MM. les consuls assisteront, si bon leur semble, à l'une et à l'autre de ces compositions, de même qu'à l'examen des copies, sauf à eux de proposer des petits prix lors de la seconde composition pour exciter l'émulation des écoliers et faire naître dans leur coeur le désir de gloire si capable d'enfanter des merveilles.
Fixation du congé des classes.
7 Les régents ne pourront congédier les écoliers, savoir celui de rhétorique avant le vingt-cinq août, fête de St Louis, celui de seconde avant le premier septembie, celui de troisième avant le huit du même mois et fête de la Ste Vierge, et les autres avant le vingt-un dudit mois, fête de St Mathieu, à peine de perte du dernier
quartier de leurs gages.
8 Tous les régents seront au moins clercs tonsurés et le régent de rhétorique prêtre, tant que faire se pourra. 9 Le régent de rhétorique sera préfet du collège, et en cette, qualité il aura inspection sur les autres régents, droit d'entrée et de visite dans leur classe, en un mot la direction ordinaire du collège, bien entendu cependant qu'il sera libre à MM. les consuls de nommer tel autre préfet qu'ils aviseront, s'ils le jugent nécessaire pour le plus grand bien du collège. 10 Aucun régent ne pourra faire la répétition en classe, les deux heures de temps qu'il y passera étant plus que nécessaires soit pour la dispute des places, soit pour la dictée des thèmes ou autre travail, soit enfin pour la lecture des copies et l'explication des auteurs.
10 Chaque régent parlera à ses écoliers avec toute la politesse possible et aura soin de leur en faire observer exactement les règles parmi eux; il les reprendra avec douceur et avec gravité et sévira contre eux que pour des fautes grièves cl après avoir tenté inutilement les voies douces qu'on lui conseille, rien n'étant plus propre à dégrader le conir que les coups (1).et ennoblir le sentiment que la douceur.
(1) Réfléxioni à remarquer dans un siècle oti les châtiments corporels étaient d'un usage général et fréquent.
12 Enfin, comme l'éducation de la jeunesse a deux parties essentielles qu'on doit faire marcher de front, qu'il serait inutile et même nuisible de cultiver l'esprit si l'on négligeait le coeur, MM. les régents élèveront à la vertu plus encore qu'aux belles lettres la jeunesse qui knr sera confiée. Ils n'ont qu'à lire la manière d'enseigner de M. Rollïn (1) ; ils ne peuvent guère en ce genre choisir de meilleur maître que lui.
(1) Le Tiaité des éludes est de 1725 1728.
Règlement concernant les moeurs que monseigneur l'évêque a donné pour être inséré dans la présente délibération et à la suite de ceux de la ville,
1 Tous les matins, après la classe, tous les écoliers, de deux à deux, iront dans une église des plus prochaines entendra dévotement la Ste messe, qui sera dite par un des régents et à. laquelle les autres .régents assisteront pour contenir la jeunesse dans le respect que demande le St sacrifice. 2 MM. les régents saisiront avec attention toutes les occasions qui se présenteront pour inspirer à leurs écoliers les sentiments de piété et de religion qui sont capables de leur former le coeur et l'esprit, pour leur insinuer l'amour qu'ils doivent avoir pour Dieu et pour le prochain, la fidélité aux commandements de Dieu et de l'église, le recueillement et le respect dans les églises, la modestie dans leur démarche et la pureté dans leurs paroles comme dans leurs actions. 3 Outre les petits traits d'instruction qu'on peut faire glisser fréquemment et insensiblement en conversation, MM. les régents leur feront régulièrement le catéchisme chaque samedi de la semaine pendant la dernière demi-heure du soir, et ils ne finiront jamais sans les exhorter à se confesser souvent et à recevoir la Ste eucharistie. 4 Ils exigeront des écoliers qu'ils se confessent au moins une fois chaque mois et ils les obligeront de rapporter un billet de confession ; ils ne laisseront passer aucune fête mobile ou du Sauveur ou de la Sle Vierge sans les exhorter et les presser même à se sanctifier par l'approche des sacrements, ainsi qu'aux fêtes de leur patron. 5 Ils exigeront encore d'eux qu'ils assistent tous les dimanches aux prônes et aux catéchismes qui se font à la paroisse, et il y aura toujours uu de MM. les régents qui y assistera avec eux tant pour
observer les écoliers qui manqueront que pour contenir dans le respect ceux qui y assisteront; en un mot, ils n'épargneront rien de tout ce qui peut contribuer à les faire croître en piété et vertus chrétiennes, ainsi qu'en science. 6 MM. le préfet et principaux régents défendront à tous les écoliers, en conséquence de la défense qui leur est faite à eux-mêmes, toute entrée dans les cafés, jeux publics, chasse et cabarets, comme encore de se dépouiller tous nuds pour se baigner en compagnie dans la rivière, sous peine : la première fois d'être avertis avec correction, la seconde, être sévèrement punis, et la troisième d'être honteusement chassés et mis hors de la classe ; et si messieurs les régents apprenaient de certains désordres, ils en avertiraient avec prudence Mr le préfet ou les autres supérieurs ou grand vicaire qu'ils trouveraient bon, pour y être par eux remédié. Tel est le plan que MM. les consuls proposent au présent conseil pour parvenir efficacement au rétablissement du collège, requérant qu'il y soit par ledit conseil délibéré. Délibération touchant le rétablissement du collège.
Sur quoi le conseil, parfaitement convaincu de la nécessité qu'il y a de rétablir le collège et piaillement informé du plan et du règlement dont en la proposition pour en avoir entendu la lecture, après avoir remercie Mgr l'évêque de l'intérêt qu'il veut bien prendre à l'éducation do la jeunesse de la ville et des règlements vraiment digues de sa sagesse et de sa sollicitude pastoiale, qu'il souhaite de faire insérer dans la présente délibération avec ceux de la communauté, a unanimement délibéré de porter jusqu'à mille livres par an la totalité des honoraires de tous les régents, lesquelles seront dislribuées et payées en conformité du susdit plan, et afin que cette augmentation soit moins onéreuse à la communauté, le conseil a délibéré d'imposer sur chaque écolier, soit de la ville, soit étranger, une taxe de six livres pour chaque an qu'il étudiera, laquelle sera exigée annuellement par le trésorier de la communauté, ainsi et de la manière qu'il est porté dans le même plan; ci à l'égard de l'assemblée publique de la dispute des classes, le conseil a fixé à douze le nombre des personnes qui y assisteront, non compris MM. les consuls; lesquelles douze personnes seront par eux invitées à ladite assemblée et procéderont conjointement avec eux à l'examen des candidats et à la distribution des classes aussi en la forme et à la manière portée par le susdit plan; et lesdits règlements, lesquels le conseil agrée et approuve dans tout leur contenu et veut être inscrits dans la présente délibération aussi bien que ceux de monseigneur l'évêque pour être exécutés dans toute leur étendue selon leur forme et teneur, donnant le pouvoir à MM. les consuls de s'adressar à monsaignenr l'intendant ou par devant qui il appartiendra pour faire homologuer la délibération du présent conseil afin que, munie ilu sceau de l'autorité, elle ne puisse souffrir aucune difficulté dans l'exécution Et plus n'a été délibéré; fait et publié au lieu et en présence que dessus et ont MM» les consuls signé avec le greffier de la communauté. Signés : CORMOI,, consul; ÀGNËLLY, consul; UKSSON, consul; MAUÏIN, greffier.
Ce document dont l'importance est évidente, peut donner lieu à un certain nombre d'observations. La subvention de 510 livres allouée précédemment par la ville est portée à 1.000. Outre le traitement indiqué plus haut, chaque régent recevra de chaque élève une rétribution variant de 20 à 30 sols par mois.Chaque année, suivant l'usage, les professeurs sont nommés au concours, en séance publique, devant un jury de douze personnes siégeant à la maison de ville et prises indifféremment parmi les ecclésiastiques ou les laïques, sous la présidence des consuls. Les candidats ne peuvent se présenter sans l'agrément de l'autorité épiscopale ; ils doivent être, d'ailleurs, au moins clercs et tonsurés, Le système de la dispute annuelle ne manquait pas d'originalité et d'imprévu: il maintenait une émulation salutaire
entre les régents et il offrait des avantages sérieux, à une époque où l'État n'avait encore rien centralisé et où il n'avait pas sous sa main un corps universitaire chargé de distribuer l'enseignement au degré primaire, secondaire et supérieur. Les municipalités, obligées de veiller elles-mêmes à ce soin important,ne pouvaient compter que sur les ressources propres de la commune, et elles s'ingéniaient, celles de Digne du moins, à les ménager sans compromettre l'instruction des enfants. Sans nul doute, le concours annuel ne donnait pas la stabilité au personnel, mais il paraît en avoir assuré le bon recrutement, ce qui est capital. Il est certain, d'ailleurs, que, dans la pratique, le jury, composé d'hommes instruits, tenait compte des services déjà rendus au collège et qu'il n'éliminait par les bons régents désireux d'être maintenus à leur poste ; de plus, il savait mettre en relief les aptitudes des concurrents jeunes, par exemple celles d'un Gassendi. Nous reconnaissons sans peine que l'organisation actuelle est bien préférable et que la fin de ce siècle marquera dans l'histoire par les progrès accomplis dans l'organisation et la diffusion de l'enseignement. Et. sans parier ici de l'instruction primaire, l'État, au moyen des examens du baccalauréat, de la licence, du doctorat et par les concours d'agrégation, recrute régulièrement des professeurs capables, auxquels il assure des situations honorables et définitives. Mais les bienfaits du présent ne sauraient nous rendre injustes pour le passé et nous faire méconnaître les efforts tentés jadis pour l'instruction et l'éducation des jeunes Dignois. Reprenons notre analyse. Les classes sont de deux heures le matin et le soir, La rentrée a lieu le 18 octobre ; congé chaque jeudi, dans l'après-midi, depuis la rentrée jusqu'à Pâques, et toute la journée jusqu'à la fin de l'année classique : composition le vendredi soir et le samedi matin ; vacances pour la rhétorique à partir du 25 août, pour la seconde avant le 1° septembre, pour la troisième avant lo 8, et pour les autres classes avant le 21,
Depuis lors, les choses ont été bien changées; nos écoliers ont deux mois, indépendamment des sorties, des congés du jour de l'an, de Pâques et de la Pentecôte:
oserait-on dire qu'ils soieni satisfaits ? On assure, d'ailleurs, qu'ils sont "surmenés" et qu'il y a urgence à leur donner des vacances plus longues et des classes plus courtes, Mais revenons à l'année 1748.
Le régent de rhétorique est préfet du collège et en a la direction effective. Tout nous indique que l'établissement ne recevait que des externes. Il est recommandé aux maîtres de reprendre les élèves avec douceur et gravité, de ne recourir aux châtiments corporels que dans des cas exceptionnels et de ne pas négliger
l'éducation proprement dite. Sur ce point, les conseils donnés rappellent ceux du « bon Rollin », dont on invoque l'autorité et dont « la manière d'enseigner »
guidera les régents. De cette façon, MM. les consuls n'ont pas besoin d'entrer dans de longs développements; le Traité des Études constituait, comme on dit aujourd'hui, une méthode et un programme. Mais, d'autre part, les prescriptions relatives aux devoirs et à l'enseignement religieux sont établies avec précision
et détail par l'autorité ôpiscopale et acceptées avec reconnaissance par les magistrats municipaux.
En somme, nous reconnaissons volontiers que les consuls et les conseillers dignois s'intéressaient très vivement aux études secondaires et qu'ils étaient animés d'intentions libérales. En effet, si aujourd'hui les théories de Rollin nous paraissent timides et entachées parfois de routine, il ne faut pas oublier que beaucoup de gens, au XYIIIe siècle, même parmi les univeisitaires, les regardaient comme hardies et dangereuses. Nous ignorons quels furent les résultats de cette réorganisation
des études et du personnel. Les documents nous font défaut jusqu'en 1763.
C'est à celle époque que l'on s'occupe à nouveau de construire des bâtiments plus spacieux. En réponse à une lettre du procureur du roy (près la communauté) datée du 13 mars 1763, les consuls publient un mémoire où il est dit que le collège comprend six classes jusqu'à la philosophie exclusivement, dirigées par six prêtres séculiers (1) désignés au concours; on voudrait augmenter les revenus de l'établissement (2) en le réunissant au séminaire fondé par le testament de Me Pierre Gassendi du 1° décembre 1710.
(1) A quelle date les séculiers avaient-ils remplacé les religieux ? Nous l'ignorons.
(2) L'époque de l'établissement de ce collège est tellement ancienne qu'on n'a pu la trouver.
D'après M. Fisquet, ce séminaire occupait les bâtiments d'un ancien couvent des Frères de la Trinité et de la Rédemption des Captifs ; c'est là qu'on installera plus
tard le collège d'une manière définitive. Pendant cette période, le collège n'est pas inscrit sur l'état des charges et nous ne relevons que deux indications ; le 3 avril 1781, mandat de 285 livres à MM. les régents pour les deux premiers quartiers: le 14 avril 1784, mandat de 292 livres 10 sols pour deux quartiers « d'honoraires «
" En 1782, nous dit M. Bondil, le collège était au faubourg de Soleihe-Boeuf, vers l'extrémité de la rue Mère-dc-Dieu (1).
(1) Nous lisons dans un rapport (de 1808) à l'appui d'une demande en vue d'obtenir l'autorisation de vendre des immeubles communaux: " Le domaine
de l'ancien collège, situé rue de Soleilhe-Boeuf, consiste en un bâtiment construit sur deux voûtes servant de cave, appartenant à deux particuliers. Il confronte du levant la maison de François Granoux, du midi le chemin, du couchant le jardin possédé par J.-B. Chaspoul et du septentrion la place dite du Collège. (Suit le nombre des pièces : deux au rez-de-chaussée,du côté de la place, quatre au 1er étage, par-dessus un galetas; surfacce 120 mètre." En 1810, le 16 mars, cet
immeuble fut vendu pour 2,000 francs à M. Joseph Raimond.
C'est là qu'en 1632 la jeunesse du pays avait commencé de recevoir les doctes leçons de quatre Pères de la Compagnie de Jésus. A peine arrivé dans
son diocèse, M. de Villedieu, jugeant qu'il serait avantageux au collège et au séminaire (1) que ces deux» établissements fussent réunis, autant du moins qu'il
serait possible, fit agrandir les bâtiments des anciens Trinitaires, secondé en cela par la ville, qui, à la sollicitation de M. d'Issmivy d'Auribeau, inaire en 1785,
contribua pour une somme de 5.000 livres environ.
(1) C'est seulement en 1807 que le grand sémiuaire fut transféré dans le couvent des Cordeliers, où il est encore.
Le collège fut donc réuni au séminaire, et il ne resta qu'une petite école dans la première maison." La construction d'un nouveau collège fut donc résolue d'un commun accord entre les consuls et l'autorité êpiscopale; nous n'avons malheureusement pas retrouvé la délibération importante du 1er avril 1785, dans laquelle les conditions furent établies. Nous savons seulement ceci: l'architecte, M. Goby, toucha 190 livres pour le plan de construction, dont le devis s'élevait à 3,800 livres; le 25 septembre 1785, le conseil d'État autorisa la communauté de Digne (suivant la délibération du 1er avril) à emprunter 6,000 livres " pour faire construire dans un emplacement contigu au séminaire des salles destinées à recevoir les enfants que les supérieurs seront chargés d'enseigner". D'après les pièces communales, les dépenses soldées au 20 septembre 1786 s'élevaient à 6,400 livres. Aussi, le 29 octobre, la délibération suivante était prise : "Après quoi, il a été représenté au conseil par messieurs les maires et consuls ,de la bouche de Laserre, maire; que, suivant le devis et adjudication, le nouveau collège devait être composé d'un rez-de-chaussée pour trois classes et d'un étage au dessus pour servir dans le cas où l'on admettrait à l'avenir quelques pensionnaires (1) ;
(1) Il est ici question pour la première fois d'un pensionnat.
que la clôture de la cour, portes et fenêtreset bien d'autres dépenses majeures n'étaient point comprises dans ce devis; que Mgr l'évêque a bien voulu faire élever un second étage à ses dépens propres et personnels pour rendre l'édifies plus agréable et plus utile; que les six mille livres délibérées se trouvent entièrement consommées et qu'il reste
encore bien des choses à faire; qu'à cette occasion les Srs consuls ont été remercier Mgr l'évêque et conférer avec lui sur les besoins ultérieurs de cet établissement, qu'il a été reconnu que la cour en fausse équerre était trop petite pour qu'on pût y placer un logement de portier ni aucun autre bâtiment qui pourroit être jugé utile à
l'avenir sans masquer l'édifice principal et occuper une grande partie de la cour, et qu'il serait bien nécessaire d'allonger cette cour de vingt-six pieds du côté de la llléone. —- De plus, il a été encore observé que le petit passage dû au public et l'égont des eaux corrompues toucheraient immédiatement l'encognure du bâtiment du collège, ce qui seul est un inconvénient majeur pour une maison d'éducation et qu'il serait bien important d'acquérir non seulement les vingt-six pieds dans tonte la longueur correspondante au terrain actuel du collège, mais encore, pour éviter qu'à l'avenir des constructions trop voisines du collège n'en rendent l'habitation désagréable ou malsaine, il serait encore nécessaire d'acquéu'r les trois jardins contigus savoir celui appartenant à madame de Brenon, celui de Saurin, maréchal à forge, et celui de Bonffigue, ferblanquier, et de donner l'écoulement des eaux et le passage derrière les murs qui enclorront ces terrains. Toutes lesquelles choses reconnues très importantes au bien général, messieurs les consuls ont représenté à Sa Grandeur qu'il était impossible dans ce moment de proposer à la communauté une dépense aussi grave que l'acquisition des terrains susdits, et les enclotures qui en sont la suite. Sur quoi Mgr l'évêque leur a répondu que, persuadé du grand bien religieux, civil et politique qui doit résulter de la renaissance d'une bonne éducation publique, il se ferait un plaisir de témoigner dans cette occasion à la communauté de Digne et au diocèse son attachement et bonne volonté; qu'en conséquence, si messieurs les consuls fesaient les acquisitions ci-dessus expliquées, il consentait a en payer le montant de ses deniers, et que même il les ferait enclorre de murs; mais à une condition qui lui semble raisonnable et tendante
au bien général. C'est à sçavoir que tout le terrain à acquérir qui servira à allonger la cour du collège jusques vis-à-vis l'encognure dudit collège la plus au nord, appartiendra à perpétuité audit collège sans pouvoir être aliéné, et que tout le terrain derrière le mur dudil collège exposé vers le nord, à partir dudit mur jusques
et compris les trois jardins ci dessus dénommés, appartiendra au séminaire, que la ville en payera l'amortissement s'il y a lieu, et que le cas arrivant où le séminaire ne serait plus chargé de l'enseignement et manutention du collège, il sera fait un mur de l'encognure ci-dessus désignée allant directement au mur de clôture suivant la
direction dudit mur du nord, Dans le cas cy-dessus prévu où le collège cesserait d'être gouverné par le séminaire, ce dernier établissement continuera de jouir du second étage du dit collège, mais à la charge par le séminaire de pratiquer un passage pour aller du séminaire audit second étage réservé, sans aucune autre communication avec le collège dont l'escalier montant audit second étage sera fermé par une cloison en plâtre ou buget; le séminaire serait tenu de tontes réparations dudit étage seulement, suivant l'usage en pareil cas, les murailles et couvertures demeurant à la charge du collège (1),"
(1) Arch. com, BB. 33.
Nous ne pouvons rien dire sur l'organisation des études, ni sur le recrutement du personnel, dès l'installation du collègp au bout de la rue Pied-de-Ville; combien y avait il de régents en dehors des professeurs du grand séminaire? A qui appartenait la direction effective ? Nous ne saurions rien préciser. Mais il convient de remarquer avec quelle bonne grâce l'autorité épiscopale facilita aux magistrats munieipaux la création du nouvel établissement. L'on était à la veille de la Révolution.
IV.
Période révolutionnaire.
1787-1804
Les débuts de la Révolution n'amenèrent aucun trouble à Digne, et les écoliers purent à l'aise continuer leurs études dans le nouvel établissement. Le 8 juillet 1790, un décret de l'Assemblée nationale fixa " irrévocablement " à Digne le siège épiscopal, le séminaire et le collège, Le 14 janvier 1792, le conseil municipal délivre un
mandat de 500 livres aux régents. Il y a plus : le 21 octobre de la même année, le maire, plein de sollicitude pour les études, expose au conseil qu'on attend " avec impatiencet l'organisation de l'éducation nationale", mais, comme elle tarde à venir et que le temps de l'ouverture des classes approche, il propose d'ouvrir le collège comme par le passé ; " la municipalité et le conseil général distribueront les places au concours dans une séance publique" ; le premier régent aura 350 livres, le deuxième 300 et le troisième 250; les écoliers payeront 20 sols par mois; sur les 100 livres qui restent (de l'allocation de 1,000 livres), on distribuera des prix aux élèves ci une gratification aux professeurs.
Si les magistrats étaient si bien disposés à l'égard des maîtres du collège, c'est qu'ils avaient donné des gages aux idées nouvelles, comme le prouve la pièce ci-dssous :.
Prestation de serment des sieurs professeurs du collège de la commune.Au
Ce jourd'huy 27 mars 1791, jour de dimanche, à sept heures du matin, après la Ste Messe et dans l'église principale de cette dite ville. En présence du conseil général de la commune et des fidelles assemblés, les sieurs Guieu, Martin et Jaume, tous les trois prêtres et professeurs du collège de cette commune, ont dit qu'en exécution du décret de l'assemblée nationale du 27 novembre dernier, sanctionné par le roi le 26 décembre suivant, et publié en cette municipalité le 30 du mois de janvier dernier, ils s'empressoient de prêter le serment civique prescrit par le dit décret, et de fait les dits sieurs Guieu, Martin et Jaume, chacun individuellement ,après avoir exprimé à la grande satisfaction des assistants un sincère dévouement à la nouvelle constitution, ont prononcé à haute et intelligible voix et la main levée le serment solennel de remplir leurs fonctions avec exactitude, d'être fidelles à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tout leur pouvoir la constitution décrétée par l'assemblée nationale et acceptée par le roi. Ce fait, et aucun ecclésiastique ne se présentant plus pour prêter le même serment, avons, nous, maire, officiers municipaux et notables, dressé le présent procès verbal et avons signé, à Digne, le dit jour et an que dessus. Et avant se retirer serait comparu sieur Antoine Juglar, eclésiastique et un des régents des écoles de cette ville, qui nous a prié de recevoir le serment" (Suivant la même formule que ci-dessus.)
Mais, en 1793, la ville de Digne fut menacée dans la possession de son collège au profit de Manosque; le conseil général de la commune envoya, le 13 mars, à la
Convention nationale une adresse dans laquelle elle démontrait longuement et avec passion que la centranlité, la population, la contribution et les motifs de convenance, tout concourait à faire établir à Digne l'institut principal proposé pour le département, Tout alla pour le mieux, puisque Digne garda son collège et que
la ville de Manosque finit par avoir le sien. Dans le tableau des charges de la ville dressé le 2 février (1793), sur un total de 13,561 livres, la régence des écoles (primaires) figure pour 150 et celle du collège pour 1,000. De plus, le 27 juillet, le conseil décide qu'on écrira à Olivier, diacre à Mousticrs, pour lui offrir la régence des petites écoles et un logement gratuit au collège. Toutefois les troubles suscités par la révolution amènent le licenciement des élèves et l'interruption des études secondaires; mais nous ne pouvons en préciser la date. Le 22 octobre 1796, la municipalité traite avec le citoyen Jacques Honnorat, du Brusquet, " pour faire
construire une fabrique de savon dans le local du ci-devant collège, soit trois magasins au rez-de-chaussée et trois pièces au premier étage, pour trois années, au prix annuel de 200 livres en espèces métalliques". Comme le "domaine" a été dégradé par défaut d'entretien, Honnorat y fera les réparations nécessaires en déduction du loyer (1).
(1) 1er Brumaire an V. (Arch. com, Registres des actes.) Il est probable que le collège était fermé depuis assez longtemps. Ajoutons que ledit Honnorat est autorisé " à faire boucher les issues qui aboutissent au ci-devant séminaire, à l'effet d'empêcher quo les enfants ne continuent d'en faire un cloaque et particulièrement les toits où ils avaient établi leur théâtre d'amusement". M. Fisquot assure que, pendant la Révolution, le collège " devint la prison des prêtres qui refusaient de participer au schisme "et que, plus tard, on y logea des soldats. {France pontificale, p-12)
Le 30 mars 1797, le second étage est encore loué pour trois ans à Etienne Jourdan. " chandellier", pour 50 livres en numéraire, Le 30 avril 1800, le même citoyen était déclaré adjudicataire à 250 francs, pour la même durée, Arrivés au seuil du XIXe siècle, nous croyons qu'il est bon de jeter un regard en arrière et de rappeler les lois d'enseignement votées pendant la Révolution ; notre récit y gagnera.
La Convention avait voté, en 1793 (30 mai), un décret relatif à l'établisement des écoles primaires. Le décret du 29 frimaire an II (19 décembre 1793). ou décret Bouquier, assura la liberté et la gratuité de l'enseignement primaire, mais ne s'occupa point de l'enseignement secondaire et supérieur, qui étaient abandonnés à l'initiative privée.
Sur la proposition de Lakanal, le décret du 7 ventôse an III (25 février 1795) créa, les écoles centrales pour donner le second degré d'instruction. Le 25 octobre 1795, Dannon fit voler une loi organique (3 brumaire an IV) qui diminuait l'importance des écoles centrales et consacrait l'existence des écoles spéciales.
Sous le Consulat, la loi du 1" mai 1802 (11 floréal an X) supprima les écoles centrales et les remplaça par les écoles secondaires (ou collèges communaux) et les<
lycées.
Nous venons de constater que les bâtiments du collège avaient été loués depuis 1796 jusqu'en 1803, Mais il est certain que le dernier bail fut résilié dès 1800, ou tout au moins en 1801, puisque, le 25 mai 1802, le conseil général des Basses-Alpes demandait le maintien de l'école centrale existante, menacée par un projet d'école secondaire. A quelle date cette école avait-elle été fondée (1) ?
(1) Elle occupait les bâtiments du collège.
Nous ne saurions le dire, Mais la délibération du conseil général nous fournit un certain nombre d'indications importantes : c'est le premier établissement créé pour donner aux enfants l'instruction dont ils étaient privés depuis la Révolution ; un pensionnat y est annexé et la pension est modique; il est dirigé par trois professeurs, un pour les langues anciennes et modernes, un pour les mathématiques et un pour le dessin, et l'on en demandera deux de plus pour enseigner l'histoire naturelle, avec les éléments de l'agriculture, et les belles lettres.
Dans les écoles secondaires, l'instruction sera "très bornée", et le personnel moins capable, puisqu'il dépendra du nombre des élèves. Le conseil général demande donc formellement que l'on maintienne l'école centrale, en y apportant des améliorations et en fixant à cinq ou à six le nombre des professeurs. Ce voeu fut adopté. Le 18 avril 1803 (28 germinal an XI), Fourcroy, ministre de l'instruction publique, écrivant au préfet, applaudissait aux succès des élèves de l'école centrale, mais ne pouvait accueillir la demande qu'il avait faite d'un lycée: " L'intention du gouvernement, disait-il, est de ne former pour le moment de ces établissements que dans les communes d'une population supérieure à celle de Digne." Quand la suppression de l'école centrale serait décidée, la ville pourrait la remplacer par une école secondaire.
C'est dans le courant de l'année suivante que l'école centrale fut transformée, elle avait duré environ quatre ans (1).
(1) De 1800 (ou 1801) à 1804.
V.
Dernière période.
École secondaire et collège,
1804-1886.
L'école secondaire fut créée par un décret de Napoléon 1° (15 thermidor an XII, ou 3 août 1804). L'article 2 portait : " Les bâtiments de l'ancien séminaire et collège, actuellement occupés par l'école centrale, dont la suppression est définitivement arrêtée au 1° vendémiaire prochain, sont concédés à cette commune pour l'usage de son école secondaire (1)"
(1) Le 13 juillet 1811, M. Martel, receveur de l'enregistrement et des domaines à Digne, fit, en vertu de ce décret, remise au maire " de la propriété d'un bâtiment, jardin, église, deux basse-cours, patègues (emplacement) et toutes leurs dépendances, le tout contigu, situé au quartier du Pied-de-Ville, provenant tant du séminaire, de l'ancien évêché que du collège". (Arch, départ.)
Le 13 décembre, un arrêté du préfet autorisait la ville à consacrer 3,000 francs au traitement de trois nouveaux professeurs (belles-lettres, mathématiques et dessin), outre les trois maîtres en activité, " afin de la mettre à même de former un jour un pensionnat, conformément aux intentions du gouvernement". En 1805, l'établissement, dirigé par M. Pary, prêtre, compte quatre professeurs ; les externes payent aux régents une rétribution variant de 2 à 3 francs par mois. L'année suivante (3 août), le bureau d'administration désigne lui-même M. Rippert comme directeur, pour remplacer M. Pary, décédé; le 30 septembre, il .approuve un prospectus annonçant qu'un pensionnat sera établi près de l'école et il fixe le prix de l'internat à 450 francs. Nous n'avons pas d'autres renseignements à fournir, sinon qu'en 1808 un arrêté préfectoral délègue les maires de Digne et de Seyne pour visiter les écoles secondaires de ces deux villes.
A partir de 1811, le directeur de l'établissement est appelé principal. Quant au pensionnat, il ne réussit pas du premier coup, puisque en 1812 nous ne trouvons que
des externes (au nombre de quarante-deux) dirigés seulement par deux professeurs, au traitement de 950 francs ; le budget s'élève en recettes et en dépenses à 2,416 francs. Néanmoins le bureau d'administration demande au recteur de l'Académie d'Aix " un professeur de rhétorique qui serait en même temps directeur". Le principal, M. Marie, sollicite en 1814, un quatrième professeur; son administration n'est pas heureuse en 1810, le collège a fort peu d'élèves et une partie des bâtiments est occupée par les ateliers de la légion de la Lozère, en garnison à Digne. Mais M. de Fontanes, prié par l'évêque de transformer le collège en une école secondaire ecclésiastique4 répond que l'établissement restera collège communal. En 1817, le bureau d'administration demande le
déplacement de M. Marie ; il invite le conseil municipal
" à doter le collège d'une manière convenable et progressive", afin que les élèves ne payent pas plus de 2 fr. 50 c.
par mois ; le directeur, outre sa classe, sera préfet (des
études) ; il y aura deux heures de classe matin et soir, une
heure d'étude le matin et le soir; les élèves seront conduits
aux offices de la paroisse les dimanches et les fêtes.
Le conseil approuve ces voeux et ce règlement.
M. Geory, professeur au collège de Lorgues, dans
le Var, est nommé principal sur la proposition du bureau ;
son administration est prospère et dure jusqu'en 1827.
Pendant cette période, nous relevons une réclamation du
recteur, revendiquant, au nom de l'Université, la propriété
du bâtiment contigu au collège et connu sous le nom de
séminaire et chapelle (1),
(1) Chapelle actuelle du collège,
Le 18 juin 1818, M. du Chaffaut, maire, adresse un mémoire au préfet pour réfuter cette prétention: " II faut, dit-il, distinguer le bâtiment dit le collège d'avec celui du séminaire. Le collège fut bâti en 1785 et 1733, au frais de la ville. "Le bâtiment du séminaire fut détourné de sa destination première pour servir tantôt de logement à la gendarmerie, tantôt de magasins militaires, tantôt pour le culte, " Le décret du 15 thermidor an XII concède à la ville le bâtiment de l'ancien séminaire et collège pour l'usage de son école secondaires quant au bâtiment du collèges cette concession était inutile, puisqu'il était déjà la propriété de la commune," En 1820, le collège a soixante élèves, quatre professeurs et un maître d'études; le traitement du principal est de 800 francs. En 1823, un crédit de 80 francs est affecté à la distribution des prix ; il y a six professeurs : le principal est chargé de la rhétorique (1).
(1) En 1823, M, Hippolyte Fortoul, né à Digne, était élève de troisième en qualité d'externe. Il fat plus tard doyeni de la Faculté des lettres d'Aix, député des Basses-Alpes et ministre de l'instruction publique.
En 1827, nous comptons
cent quatre élèves, dont quarante-quatre pensionnaires;
pour maintenir cette prospérité, le conseil municipal,
sous l'administration de M. du Chaffaut, vote environ
20,000 francs applicables à des travaux de réparation.
En 1831, un arrêté du recteur réorganise le bureau
d'administration et désigne MM. du Chaffaut, Bassac,
Soustre), Raymond et Yvan. En 1834, le crédit affecté
à la distribution des prix est de 200 francs, Le 24 novembre
1835, le bureau proteste énergiquement contre le projet
de translation du petit séminaire de Forcalquier à Digne.
En 1838, nous comptons quatre-vingt-onze élèves, dont
vingt-cinq pensionnaires; l'on s'occupe enfin de l'enseignement
des sciences physiques, et un crédit de 500 francs
est demandé pour achats d'instruments; le personnel
est de sept professeurs.
De 1839 à 1849, nous avons peu d'événements à signaler.
Une ordonnance royale du 21 novembre 1841 annexe aux
collèges communaux les écoles primaires supérieures et place les directeurs sous l'autorité des principaux;
mais c'est seulement en 1844 que le conseil municipal vote
l'annexion au collège de l'école supérieure dirigée par
M. Gibert. L'année suivante, une chaire d'histoire est
fondée à l'aide d'une allocation de 1,200 francs donnée par
l'État (1). En 1847, la création d'un cabinet de physique
est décidée par le conseil et approuvée par le recteur.
L'année 1818, nous remarquons une plainte du recteur au
préfet, au sujet des troupes qui avaient été logées au
collège. En 1849, l'enseignement classique était donné par
neuf régents ; il y avait, de plus, un professeur de langues
vivantes (M. Menc) et un professeur d'enseignement
spécial (M, Bressant), directeur de l'école primaire
supérieure annexée (2).
(1) En 1846, cebt quarante-deux élèves, dont soixante pensionnaires.
(2) Les écoles primaires supérieures ont été créées par la loi du 28 juin 1833, puis supprimées en fait par celle du 15 mars 1850 et rétablies par le décret du 15 janvier 1881.
La réaction qui précéda et suivit le coup d'État eut son contre-coup au collège de Digne; l'administration supérieure choisit des hommes dévoués à l'Empire pour diriger l'enseignement. Immédiatement après le vote de la loi du 15 mars 1850, M. l'abbé Fortoul, principal, avait été nommé recteur départemental, Les professeurs suspects de libéralisme étaient révoqués, ou tout au moins surveillés de près; dans les discours de distribution de prix, épurés soigneusement, on interdisait aux orateurs d'admirer même le style de Jean-Jacques ou de Voltaire; défense de fréquenter les cafés, de danser les jours de fêtes et même de donner des leçons particulières; ordre formel de se raser la barbe et d'assister aux offices religieux ; enfin tracasseries de tout genre et de tous les instants. En décembre 185l, l'insurrection contre la violation de la Constitution républicaine troubla et suspendit les études (1) pendant quelque temps, puis elles reprirent péniblement leur cours ordinaire.
(1) Cent vingt-cinq élèves.
M. Fortoul, devenu
ministre de 'instruction publique, s'intéressa au collège,
où il avait fait une partie de ses études, et augmenta
les allocations de l'État ; il fit même des propositions à 1a municipalité pour l'établissement d'un lycée; on
m'assure qu'il chargea (signe des temps) un général,
M, Carrelet, envoyé en inspection politique dans les
Basses-Alpes, de prendre des notes sur la situation du
collège ; mais ce projet (sur lequel nous reviendrons plus
loin) n'aboutit pas.
En 1855, le personnel comprenait le principal et dix
professeurs ; en 1859, le budget était ainsi formé : la ville,
6,380 francs ; l'Etat, 4,700 francs ; le principal, 8,700 francs ;
total, 18,780 francs (1).
(1) L'internat a été de tout temps au compte des principaux.
Nous notons, en 1861, la création d'une nouvelle chaire
de français. En 1868, les traitements sont relevés et forment un total de 15,800 francs pour onze maîtres; le
collège prospère, sous la direction de M. Bénit.
Nous arrivons rapidement aux dernières années du collège; elles ne sont marquées par aucun événement
important. De sérieuses réparations sont faites aux bâtiments
en 1882 (5,000 francs); l'enseignement se complète
peu à peu et s'adapte aux exigences contemporaines et
aux nouveaux programmes d'études. Cette période,
d'ailleurs, est trop près de nous pour qu'il soit nécessaire
d'entrer dans aucun détail, et il ne convient pas de juger
des personnes encore vivantes et mêlées aux affaires
administratives.
Avant de dire adieu à ce collège où ont enseigné tant de
maîtres distingués et où ont été formées tant de générations
d'élèves dans les études secondaires, il faut indiquer
ce que sont devenus les bâtiments construits en 1786,
agrandis successivement et abandonnés un siècle après,
le 1» août 1887.
A la suite d'une décision du conseil général adoptant le
transfert à Digne de l'école normale d'instituteurs de
Barcelonnette, le conseil municipal de Digne, dans la
séance du 26 août 1838, conformément à ses résolutions
antérieures sur la cession des bâtiments du collège pour
l'installation de l'école normale, a pris l'engagement de
contribuer pour la moitié aux dépenses que l'internat
pourrait mettre à la charge du département; il a ensuite
prié M. le préfet d'ordonner l'exécution immédiate des
travaux.
Un arrêté ministériel du 27 septembre a ordonné le
transfert de l'école, qui a été ouverte au mois d'octobre.
DEUXIÈME PARTIE
LE LYCÉE

I
Projet d'un lycée sous le ministère Fortoul.
1854
Le 10 janvier 1854, le conseil municipal se réunît pour
délibérer sur la transformation du collège en lycée ;
M. Bailly, recteur départemental, et M. de Bouville, préfet,
assistent à la séance. M. Allibert, maire, expose que le
ministre de l'instruction publique, M. Fortoul, a proposé à
la municipalité de créer un lycée à Digne. Le recteur
donne ensuite quelques renseignements: en utilisant le
mobilier et les bâtiments actuels, la dépense s'élèverait à
103,000 francs ; mais il faut prévoir une somme plus
élevée. Le conseil vote 120,000 francs.
Le projet semble en voie d'aboutir promptement, mais
des difficultés imprévues surgissent. Le 10 février, le
préfet écrit que la Caisse des dépôts et consignations fait
des conditions onéreuses à la ville pour un emprunt. Le
conseil nomme une commission chargée de réduire les
dépenses de construction.
Le 17 du même mois, sur l'avis de cette commission,
estimant qu'il n'y a pas lieu de modifier les décisions déjà
prises, le conseil vote une deuxième fois la somme de
120.000 francs.
Mais, le 25, le préfet, invitanl le maire â convoquer le conseil municipal el les plus fort imposés pour ratifier
ce vote, présente des observations sur la situation financière
de la ville, qui a déjà plusieurs projets en voie
d'exécution. Le 10 mars, après une longue discussion, le
maire met aux voix la question suivante : " L'assemblée veut-elle voter un emprunt de 120,000 francs et une imposition extraordinaire de 20 centimes pour l'élablissement d'un lycée?" Sur la demande de plusieurs
membres, on a recours au scrutin secret, et la proposition
est rejetée par 21 voix contre 12. Le projet avait avorté.
Il est juste toutefois de reconnaître que la municipalité
avait fait preuve d'une bonne volonté incontestable et
d'une activité peu commune, puisque, les négociations
n'avaient duré que deux mois. Vingt-huit ans plus tard,
l'affaire devait être reprise et menée à bonne fin. Création du Lycée.
II
Création du Lycée.
1882-1887.
C'est le 14 août 1882 que le conseil municipal fut assemblé
à l'hôtel de ville pour délibérer sur la création d'un lycée
de garçons, sous la présidence de M. Soustre, maire. M. le maire présenta la proposition suivante :
"Messieurs,
Au mois du mai dernier, j'avais l'honneur de vous exposer que
notre ville ne pouvait se relever et trouver les éléments d'une
prospérité nouvelle que dans le développement des établissements d'instruction. Je vous soumettais en même temps un projet d'organisation
pour le cours secondaire de filles. Vous êtes entrés dans mes
vues et vous avez approuvé mes propositions à l'unanimité. Quelques
jours après, le 1er juin, grâce à la libéralité de l'État et au zèle de
l'administration académique, les cours étaient inaugurés, de telle
façon que la prospérité en est assurée dès aujourd'hui.
De plus, notre école primaire de garçons va être mise en adjudication;
nous nous sommes occupés d'un emplacement pour l'école
primaire de filles, qui compte déjà. cent élèves, mais dont l'installation
ne saurait être que provisoire. Ajoutez à cela que les travaux
de l'école normale de filles vont être commencés bientôt aux frais du
département et de l'État.
Toutes ces améliorations profiteront non seulement à l'instruction,
mais encore au bien-être matériel de notre cité.
Pour achever cette série de travaux que nous avons projetés
ensemble, pour faire de Digne véritablement un centre universitaire,
il nous reste à tenter un coup hardi et age à la fois. Ce sara notre
mérite le plus indiscutable devant nos concitoyens et nos .successeurs,
si nous réussissons, et, si nous échouons, on nous rendra cette
justice que nous avons fait notre devoir en essayant. Je veux palier
de l'établissement d'un lycée de garçons.
Pour être clair dans une proposition de cette importance, j'exposerai
d'abord les arguments d'ordre administratif; en second lieu, je
traiterai la question purement financière.
Sans doute, notre collège communala d'honorables états de service,
el je ne médirai jamais de l'établissement où moi-même et beaucoup
d'entre nous avons fait nos études. Mais les procès de la science et
la rénovation des méthodes amènent des changements inévitables.
Notre modeste collège autrefois était à peu près suffisant: il est
aujourd'hui hors d'état de faire face aux exigences de l'instruction
secondaire, bien que chaque année, il en sorte des bacheliers. De
plus, on a créé dans les Basses-Alpes des établissements nouveaux,
Le système qui réduit les principaux à faire quelquefois les
eommerçants amène avec lui des abus inévitables et que vous connaissez
bien; je me hâte de dire qtïe ces abus sont imputables au système lui-même plutôt qu'aux personnes honorables qui dirigent
un collège dans de telles conditions. De plus, le personnel est
trop restreint; toutes les classes sont doublées, ce qui n'a pas lieu ici
à côté de nous (1).
(1) Au Petit Séminaire.
Il n'y a, chez nous, que douze professeurs, quinze
fonctionnaires en tout, avec le principal et les surveillants. Un lycée,
quelque modeste qu'il soit, comporte au moins trente personnes,
professeurs et surveillants.
Si notre collège n'est pas transformé en lycée, l'État et la force des
choses nous imposeront des améliorations nouvelles dans le personnel,
les bâtiments et le matériel; sans doute, nous aurons des
subventions, mais elles seront proportionnelles aux sacrifices que
nous aurons faits nous-mêmes. C'est un argument qui me paraît
capital et que je recommande à votre attention. Avec le collège, nos
dépenses iront toujours en s'aggravant, tandis que, si la création
d'un lycée exige des sacrifices considérables, on les fait en quelque
sorte d'un seul coup et pour n'y plus revenir.
Tout fait présumer que le Gouvernement sera amené à proposer
un lycée par département. Ai-je besoin de dire que Digne, étant le
chef-lieu et un point central, ayant un collège de plein exercice,
sera, si nous le voulons, choisie de préférence pour l'établissement
d'un lycée ? Vous ne vous laisserez pas devancer, je l'espère, par
aucune autre ville du département. Il importe donc que nous demandions
pour notre ville l'avantage et l'honneur du lycée et que nous
le demandions tout de suite, D'ailleurs, les formalités seront multiples,
et les plans sont longs à faire, Ainsi, à Gap, entre la date de
la première délibération du conseil municipal et le décret ordonnant
la création, il y a un intervalle de deux ans et trois mois; à Aix,
l'intervalle n'a été que de dix-huit mois. Faut-ill vous rappeler que notre département a toujours occupé un
rang honorable dans les statistiques faites sur l'instruction en
général? Il convient de ne pas déchoir et de ne pas nous laisser
dépasser par des dêpaitements qui n'ont guère plus d'impoitance que
le nôtre» La Corse va avoir deux lycées; l'Ardèche, les Landes, la Creuseen ont un; les Hautes-Alpes, la Corrèze et le Cantal en auront un bientôt. Il ne reste plus que la Lozère et les Basses-Alpes. A mon
avis, pour l'honneur de notre pays et du chef-lieu, nous ne devons
pas rester plus longtemps en dehors de ce mouvement.
Quand l'école normale de filles aura été construite et que nos
cours secondaires auront pris l'extension que nous en attendons,
notre personnel enseignant sera-t-il suffisant, en tant que nombre
du moins, pour donner des leçons si multiples en dehors du collège?
Je ne le crois pas.
Ici, on pourrait me faiie l'objection suivante: « Notre département
est pauvre ; la pension et l'externat du lycée seront à des prix trop
élevés; les avantages d'un lycée ne profiteront qu'aux familles les
plus aisées. » Ma réponse sera décisive, le Gouvernement de la
République a prévu le cas; les prix do la pension et de l'externat
varient suivant l'importance et les ressources de chaque région.
Ainsi, au lycée d'Aix, d'après le décret du 4 septembre 1880, les
prix seront les suivants :
Pension : 700, 750, 800 francs par an ;
Externat : 100, 125. 150 francs.
Le décret qui s'applique an lycée- d'Aurillac est bien différent
(11 janvier 1882):
Pension : 600, 550, 500 fiancs par an;
Demi pension ; 400, 350, 300 francs;
Externat : 80, 70, 60 francs,
Nous obtiendrons, je l'espère du moins, les mêmes conditions que
la ville d'Aurillac. L'État, sans doute, tiendra compte de l'exiguïté
des ressources dans notre département mettra à la portée du plus
grand nombre l'accès de notre lycée.
L'on peut se demander maintenant si notre futur lycée aura des
élèves en nombre suffisant et s'il nous rendra en proportion de nos
sacrifices. Je réponds oui, sans hésiter. Notre ville est un point
central où aboutissent les routes principales et le chemin de fer;
une foule de gens sont obligés d'y venir pour des affaires de toute
nature.
D'après un tableau qui m'a été fourni, les établissements d'instruction
secondaire des Basses-Alpes comptent environ, à l'heure qu'il est, quatre cents pensionnaires et huit cents externes. Le chiffre
des externes est considéiable parce qu'il comprend beaucoup d'élèves
des classes primaires annexées à divers collèges. D'après ces données,
je crois qu'il conviendra de faire un avant-projet de lycée dans les
proposions suivantes :
200 pensionnaires.
50 demi-pensionnaires.
150 externes.
Total 400 élèves.
L'État n'autorise la construction que pour ce chiffre minimum
de 400. Tout nous fait espérer que notre futur lycée aura une population
de 300 élèves au moins, dans les premières années.
Vous parlerai-je des avantages généraux qui résulteront de la
construction projetée? Le niveau intellectuel s'élèverait bientôt dans
notre pays; nous aurions un établissement modèle où l'on pousserait
les études classiques plus loin que le baccalauréat, où les jeunes gens
qui se destinent au commerce ou à l'industiie trouveraient un enseignement
en quelque sorte universel. Comme les élèves sont entassés
outre mesure dans les grands lycées, beaucoup de familles des villes
du Midi enverraient leurs enfants à Digne.
Nous aurions un personnel de professeurs distingués qui suffirait
amplement aux cours qui sont faits en dehors du collège ; des conférences
publiques seraient organisées sans peine au profit des ouvriers,
des industriels et même des gens du monde, de façon à rehausser le
niveau des connaissances générales et à inspirer de plus en plus à nos
concitoyens le goût de l'étude et des expériences scientifiques.
Ainsi, Digue deviendrait un centre intellectuel, avec ses cours de
sciences et de lettres, avec son école normale, ses cours secondaires
de filles, avec les examens de toutes sortes qui ont lieu à la préfecture
et dont la proportion s'accroît sans relâche, puisque, en 1876-1877,
les candidats étaient 405 et, en 1881-1882, ils ont atteint le chiffre
de 705.
Messieurs, de telles créations sont durables, on peut même dire
indestructibles. Elles assureront, n'en doutez pa«, la prospérité de
Digne pour l'avenir. Permettez-moi maintenant de passer à la question financière et
veuillez m'excuser si je fatigue si longtemps votre attention bienveillante.
Le sujet en vaut la peine.
Eh bien ! la construction d'un lycée coûte, en moyenne, 1 million
700,000 francs; celui de Gap a coûté 1 million 800,000 francs. Je
crois que le nôtre ne coûtera que de 1 million 200,000 à 1 million
500,000 francs; l'architecte chargé du devis me fait espérer cette
réduction. Généralement l'État ne contribue que par moitié à la
dépense ; mais, vu l'exiguïté des ressources du département des
Basses-Alpes et la pauvreté de notre commune, j'espère qu'il se
montrera plus généreux.
Voici donc les conditions dans lesquelles je vous propose de tenter
cette grande entreprise. Nous ofliirons 400,000 francs, et nous
demanderons au département, aussi intéressé que nous à la construction
de ce lycée, un sacrifice do 100,000 francs, et le reste à l'État.
La ville de Digne aurait donc à pourvoir :
1° Pendant trente ans, aux intérêts de la somme de 400,000 francs,
qui serait empruntée à la caisse des lycées et collèges, amortissement
compris, soit 16,000 francs par an;
2° 5,000 francs, représenlant l'entretien, que j'évalue à 1,700 fr.
et six hours communales obligatoires, dont la moyenne serait de
550 francs, soit 3,300 francs; total : 5,000 francs.
En résumé, une somme annuelle de 21,000 francs,
nous payons actuellement pour notre collège 9,000 francs de
personnel et 1,000 francs d'entretien, soit 10,000 francs qui seront
dès lors retranchés de notre budget; il nous resterait donc à pourvoir
à 11,000 francs.
Ces 11,000 francs, nous pourrons les prendre :
l° Sur nos ressources annuelles. Notre budget primitif de 1883
porte, en effet, à l'article 87 du chapitre II des dépenses extraordinaires,
une somme de 6,000 francs pour solde de l'agrandissement du
cimetière. Cette somme sera donc libre en 1884, du moins en partie.
Notre budget de 1883 se soldant par un déficit de 1,400 francs environ,
la somme disponible ne peut donc être que de 4,000 francs.
2° Au moyen du vote que je vous propose des 11 centimes, dont
vous pouvez encore disposer conformément à la loi. Le centime produisaiit dans notre commune 600 francs, les 11 centimes produiront
6,600 francs qui, joints aux 4,600 francs, donneront un total de
11,200 francs.
Une imposition de 11 centimes de plus va, je le comprends, être
une énorme charge pour nos pauvres populations, déjà si lourdement
grevées, mais elles le supporteront, je l'espère, avec patriotisme, en
songeant aux avantages considérables que cette entreprise procurera
à notre pays.
Je sais bien que, sur le budget de 1883, on pourrait réduire
encore :
la somme un peu forte portée à l'article 79 du même chapitre II
des dépenses extraordinaires, article relatif aux cessions do terrains
par suite d'alignement, la somme de 6,000 francs environ, poitée
pour le même objet au budget supplémentaire de 1882, étant suffisaute
pour faire face à la dépense do vos alignements projetés;
2° La somme de 800 francs portée à l'article 80, même chapitre,
la dépense que nous devions faire au collège devenant, par la construction
elle-même d'un lycée, moins considérable.
Mais les réductions que l'on pourrait faire sur ces deux articles
seront à peine suffisantes pour faire face aux intérêts à payer
résultant :
1° De la somme de 25,000 francs récemment volée par vous pour
l'exposition départementale de 1883;
2° De celle de 10,000 francs que je vais vous proposer de voter
pour notre quote-part dans l'avant-proje tde construction d'aqueducs
sur la route départementale de Digne aux Bains, du pont du Pigeonnier
au collège, présenté par AIM. les ingénieurs;
3° De la somme de 10,000 francs qui nous incombera en sus
pendant l'année de construction du lycée.
Si de telles charges sont très lourdes, les avantages que la ville de
Digne en retirera seront considérables. Los voici, je crois que vous
serez convaincus et que l'intelligente population dignoise saura les
apprécier.
Dans trente ans, notre dette étant liquidée, au lieu de payer les
10,000 francs que nous donnons actuellementnu collège, nos successeurs
n'auront plus qu'a payer 5,000 francs ! 1,700 francs pour l'entretien el 3,300 francs destinés à des bourses communales en
faveur des enfants du peuple. De plus, la ville sera propriétaire d'un
immeuble magnifique, Cette construction procurera, au point de vue
matériel, du travail à nos ouvriers et une augmentation dans la
recette de nos octrois ; au point de vue intellectuel, je vous l'ai déjà
dit, un surcroît d'instruction qui permettra aux enfants des Basses-Alpes de lutter plus avantageusement avec les élèves des lycées. Cette
lutte est chose difficile dans les conditions actuelles, car les programmes
des examens ont été modifiés de telle façon que les élèves
auraient en vain les meilleures dispositions naturelles, s'ils ne sont
pourvus d'un certain ensemble de professeurs et s'ils ne trouvent
sous la main des collections littéraires el scientifiques.
Je finis, Messieurs, ce long exposé par une dernière considération.
Le voeux que nous allons formuler aujourd'hui, si vous êtes de mon
avis, ne vous engage pas définitivement. Vous voyez sans peine que
dans ma proposition nous atteignons la limite des sacrifices possibles.
Si l'État ne voulait pas nous accorder un secours suffisant, c'est-à-dire
plus de la moitié de la dépense totale, si nous nous exposions à
faire des frais exorbitants et disproportionnés avec nos ressources,
nous dirions respectueusement à M. le ministre :" La ville de D'igné se saigne à blanc en quelque sorte ; elle offre
tout ce qu'elle peut donner. En présence de tels sacrifices, le Gouvernement
de la République viendra sans doute à son aide d'une
façon décisive, car enfin l'instruction secondaire aussi bien que
l'instruction primaire est indispensable à un département. Il ne
voudra pas que notre cité, si républicaine, si passionnée pour le
progrès, soit réduite à reculer au dernier moment et à retirer sa
demande par l'impossibilité de suffire aux frais de constiuclion"
Tout me fait espérer, Messieurs, que nous n'en viendrons pas à
de telles extrémités. C'est donc avec la plus entière confiance que
je vous soumets, au nom de la municipalité, les résolutions suivantes :
l° Le conseil municipal émet le voeux que son collège communal soit érigé en lycée
national et soit établi pour 400 élèves;
2° Vote à cet effet un emprunt de 400,000 fiaucs à la caisse'des
lycées et collèges ; 3° Vote 11 centimes recouvrables pendant trente ans, pour faire
face aux intérêts de l'emprunt, à partir du jour de la mise en
adjudication ;
4° Charge la municipalité do solliciter, auprès du conseil général
des Basses-Alpes, le vote d'une somme de 100,000 francs;
5° L'invite à préparer un avant-projet et à pousser activement les
négociations avec M. le ministre de l'instruction publique, afin
d'obtenir les subventions nécessaires à la transformation proposée."
Après une discussion à laquelle plusieurs membres ont
pris pari, le conseil vole la prise en considération.
Puis M. le maire propose de nommer une commission
spéciale pour étudier la question.
Le conseil estime que la question paraît mûrie suffisamment.
Toutes les propositions de M. le maire sont votées successivement
et dans l'ensemble, à l'unanimité.
Dès ce moment, la municipalité se met à l'oeuvre avec
la plus grande activité; le conseil municipal la seconde
admirablement et il ne prend pas moins de vingt délibérations
pour arriver au terme de ses décisions). Nous nous
contenteronsd'indiquer les principales.
Le 10 octobre, adoption des plans et devis de M. Jacob,
architecte, et acceptation de l'emplacement Dedoue, au
quartier des Chauchels.
En 1883, le 30 mars, la ville s'engage à contracter un
emprunt de 500,000 francs à la caisse des lycées et prend des engagements fermes et irrévocables. Le 4 août, un
décretérige le collège de Digne en lycée. Le 29 septembre,
achat de toute la propriété Dedoue. Le 18 octobre,
MM. Bertrand et Silvestre, entrepreneurs, sont déclarés
adjudicataires des travaux de construction.
En 1886, le 18 octobre, le conseil adopte le devis du
mobilier scolaire.
Enfin, en 1887, le 4 mai, M. Soustre, maire, annonce au
conseil municipal l'ouverture du lycée pour le mois d'octobre
et propose de faire une cérémonie d'inauguration à
laquelle seront invités en particulier M. Spuller, ministre,
M. Zévort, directeur de l'enseignement secondaire, et
M. Belin, recteur de l'Académie d'Aix. Une commission est
nommée le 10 (1) pour organiser des fêtes et un banquet
aux frais de la ville.
Cette grande entreprise venait d'être terminée après
six années de laborieux efforts ; il né restait plus qu'à
inaugurer rétablissement.
(1) Pour être complet, mentionnons le décret du 13 mars 1888 réglunt le nombre de bourses à entretenir pendant dix ans : deux d'iutemat, deux de demi-internat et onze d'externat.
III.
Inauguration du 6 octobre 1887.
Cet événement est encore trop présent à la mémoire de tous pour qu'il soit utile d'entrer dans le détail des fêtes ; il nous suffit de dire que la ville de Digne a reçu somptueusement ses hôtes et s'est montrée fidèle à ses vieilles traditions de courtoisie. Les trois discours prononcés à la cérémonie d'inauguration par M, Soustre, maire de Digne, par M. Belin; recteur de l'Académie d'Aix, et par M, Spuller, ministre de l'instruction publique, se rattachant directement à notre sujet, nous les donnons sans commentaire, et nous renvoyons aux récits des journaux les lecteurs désireux de connaître tous les incidents de la cérémonie et du banquet offert par la ville.
Discours de M. Soustre.
Monsieur le Ministre, Messieurs,
En prenant aujourd'hui la parole devant vous et devant un tel
auditoire, je sens l'importance et les difficultés du rôle qui est échu au maire de Digne. Je le ferai simplement, tâchant d'exprimer avec
sincérité les sentiments donl je suis l'interprète.
La ville de Digne me semble dédommagée des lourds sacrifices
qu'elle s'est imposés, en considérant le résultat obtenu, affirmé
aujourd'hui par la présence des hauts personnages réunis dans cette
enceinte.
Ce résultat considérable est dû d'abord au conseil municipal, qui
n'a pas hésité devant une entreprise qui pouvait à l'origine paraître
téméraire ; à M. le recteur, qui nous a prêté l'appui de ses lumières
et de sa grande expérience et auquel il me tardait d'exprimer publiquement
notre vive gratitude; aux trois inspecteur d'Académie
qui se sont succédé à Digne depuis que la création d'un lycée a été
piojetée ; au conseil général des Basses-Alpes, qui a bien voulu
encourager une oeuvre d'un si haut intérêt pour le département;
enfin au concours généreux de l'État, dont la large subvention a
permis de réaliser l'exécution des travaux.
J'aurais élé heureux de dire à M. Zévortf l'éminenl directeur de
l'enseignement secondaire, combien nous lui sommes reconnaissants
de l'appui décisif que nous avons trouvé auprès de lui, et je regrette
que son état de santé ne lui ait pas permis d'assister aujourd'hui à
cette fête universitaire, où sa place était toute marquée.
Je ne veux pas oublier M. l'architecte Jacob, qui a conçu le plan
de ce magnifique monument et en a dirigé la construction avec un
zèle et une intelligence au-dessus de tout éloge.
La population des Basses-Alpes aime l'instruction sous toutes les
formes; l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire y sont
florissauts, et je suis fier de constater que la ville de Digue, avant
de construire son lycée, a organisé un cours secondaire de filles,
bâtie une école primaire de garçons, et qu'elle se dispose à élever une
école primaire pour les jeunes filles et des écoles dans les sections.
Toutefois, au moment où nous disons un dernier adieu au vieux
collège, où beaucoup d'entre nous ont fait leurs études, je tiens à
rappeler qu'il a fourni une longue et très honorable carrière, depuis l'époque lointaine où Gassendi enseignait dans la rue de la Mère-de-Dieu et où l'enseignement fut transporté dans les bâtiments que nous
voyons d'ici ; il a rendu les plus grands services en formant des
générations d'hommes instruits et libéraux.
Nous espérons fermement que le lycée en rendra de plus
grands encore, avec une installation qui ne laisse rien à désirer à
tous les points de vue, avec un personnel plus nombreux et pourvu
des plus hauts grades universitaires.
Monsieurle Ministre, au nom de la ville de Digne, je vous remercie
do l'honneur que vous nous faites en venant présider cette cérémonie,
qui laissera dans nos coeurs un souvenir ineffaçable. La
présence du Grand Maître de l'Univeisité portera bonheur à cet
établissement ; elle sera un précieux encouragement pour les élèves
qui vont y commencer leurs études et pour les professeurs chargés
de les instruire el de préparerà la France des citoyens.
Tous trouveront dans ce pays, avec l'air vivifiant de nos montagnes,
les meilleures traditions de travail el de dévouement aux
institutions démocratiques.
Quant à moi, comme maire, je suis doublement heureux et d'avoir
contribué, avec le concours du conseil municipal, à la réalisation de
cette oeuvre si utile et d'avoir eu l'honneur de vous exprimer la
profonde reconnaissancede mes concitoyens.
Discours de M. Belin.
Monsieur le Ministre,
Je vous remercie, au nom des universitaires ici présents, de
l'honneur que vous avez bien voulu faire au lycée nouveau de Digne,
en acceptant de présider à son inauguration. Des six départements
de l'Académie d'Aix, le département des Basses-Alpes était le seul
qui ne possédât point d'établissement national d'enseignement
secondaire, et la municipalité républicaine de Digne n'a reculé
devant aucnn sacrifice pour faire cesser ce qu'elle regardait comme
une sorte d'infériorité. Mais sa pensée a été plus haute ; elle a cru, avec raison, que
l'instruction à tous ses degrés devait, pour ne jamais demeurer
stérile, être mise à la portée de tous ; que les établissements d'enseignement secondaire,
que je n'ai pas à louer ici, devaient être rapprochés
des plus médiocres fortunes, afin de susciter et d'éveiller ces
énergies intellectuelles, qui, au grand dommage du pays, risquent,
faute de culture, de rester endormies dans les couches profondes de
la démocratie.
Elle est également convaincue que l'éducation du caractère et de
l'esprit, complément indispensable de toute instruction, se donne
plus sûrement dans ces maisons d'importance modeste, où l'enfant
et le jeune homme sont bientôt connus de ceux qui sont appelés à
les diriger el à les former, où des relations réellement quotidiennes
fortifient la confiance de l'écolier dans son maître et où les
sympathies, si nécessaires au perfectionnement comme au progrès,
naissent sans peine et d'elles-mêmes entre les élèves et leurs
professeurs.
Enfin, devançant les voeux parfois bruyants de nos hygiénistes
modernes, elle a voulu que son lycée s'élevât en pleine campagne,
afin de ne point être dans l'obligation de mesurer la lumière et,
l'espace ; les enfants de nos montagnes, accoutumés aux lointains
horizons, ne se sentiront point ici enfermés à l'étroit, et les enfants
des villes voisines trouveront, dans ce vaste établissement, l'air
vivifiant et salubre qui leur est ailleurs trop souvent refusé.
Quand une cité comprend de cette façon le rôle assigné aux
communes de France dans l'oeuvre de la diffusion et du relèvement
de l'enseignement public, elle a droit à toute la sollicitude du
Gouvernement, et votre présence ici, Monsieurle Ministre, prouve que
cette sollicitude ne lui fait point défaut. Aussi, dans cette solennité,
comme récompense de ses efforts, attend-elle de vous, qui n'avez
vécu que pour la démocratie, qui avez grandi par elle et pour elle,
attend-elle avec nous quelques-uns de ces généreux conseils qui
encouragent et soutiennent, quelques-unes de ces patriotiques
paroles qui autorisent l'espoir et la foi en un avenir meilleur que
le passé, et nous savons tous que notre attente ne sera point
aujourd'hui trompée,
Discours de M. Spuller.
Monsieurle Maire,
Monsieur le Recteur,
Mes chers Concitoyens,
J'éprouve une satisfaction, que j'aurai sans doute quelque peine à
traduire, à me trouver au milieu de vous. C'est avec empressement
que j'ai accepté l'invitation de me rendre à cette fête tout universitaire.
Je ne pouvais manquer au devoir d'acquitter la dette de
reconnaissance du Gouvernement de la République pour tous les
sacrifices que la ville de Digne s'est imposés afin de se mettre au
niveau de toutes les villes de France, dans cette grande oeuvre
vraiment nationale qu'on a appelée, tout à l'heure, l'oeuvre de la
diffusion de l'instruction publique dans notre démocratie.
M. le maire a rappelé que cet édifice que nous inaugurons
aujourd'hui n'est, en quelque sorte, que le couronnement des efforts accomplis
par la ville de Digue. On a d'abord songé aux besoins les
plus pressants, en fondant des écoles normales où viendront se
former les maîtres qui donnent l'instruction primaire ; on a ouvert
ensuite des cours pour l'enseignement des jeunes filles ; on médite
d'augmenter le nombre des écoles publiques dans la ville ; mais, en
même temps, comptant sur le concours et la sollicitude de l'État,
on a voulu que, dans le domaine de renseignement secondaire, la
ville de Digne pût marcher à l'égale des autres villes de l'Académie
d'Aix, Le bâtiment que nous venons de fonder est bien vaste ; il ne
l'est pas trop. Il permet les longs espoirs. Je dirai plus, il est fait
pour les inspirer.
Vous commencez, Messieurs les Professeurs du lycée de Digne,
avec un nombre d'élèves relativement faible ; mais j'ai été heureux de recueillir de receuillir bouche l'assurance que le petit nombre, tel
qu'il est, offre déjà la garantie de progrès qui ne se feront pas
attendre. Déjà vous avez pu voir, dans les entretiens que vous avez
eus avec les familles, quel effet heureux une installation comme
celle-ci produit sur l'esprit de ceux qui confient à l'État l'éducation
de leurs enfants. Il arrive souvent, Mes chers Concitoyens, que
l'on se demande si ces dépenses de constructions et d'aménagement,
que parfois on feint d'exagérer, répondent bien à un objet utile.
Personne ne peut faire une meilleure réponse que ceux qui sont en
communication directe avec les pères et les mères de famille.
Personne, mieux que les chefs d'établissements ne peut dire que les
écoles ne sont jamais assez belles pour les parents. Aussi bien,
les critiques qui ont été adressées à cet égard au Gouvernement de
la République l'ont-elles laissé toujours indifférent. II n'est pas vrai
que le suffrage universel, il n'est pas vrai que les Français qui songent
à l'avenir de la patrie se plaignent des dépenses faites pour
l'éducation des enfants dn pays. Il n'est pas vrai qu'on trouve trop
belles les maisons où les fils de la France sont appelés à passer les
premières années de leur jeunesse et où ils se préparent à devenir
des hommes et des citoyens.
Tous, vous désirez, au contraire, que ces maisons soient construites
de manière à rendre la science aimable. Vous voulez que le lycée,
que l'école attirent les enfants au lieu de les repousser et que les
maisons d'éducation qui, pendant si longtemps, ont eu toute
l'apparenceextérieure de vraies maisons de correction, deviennent des
demeures gracieuses et attrayantes, où l'on aime entrer et à rester
pour y bien travailler.
Celle que nous inaugurons aujourd'hui se distinguera entre toutes,
non seulement par la beauté du site où elle est placée, par l'air
vivifiant et pur que l'on y respire, mais aussi par l'heureux aménagement,
par la commode distiibution que nous devons au talent de
son habile architecte, M. Jacob. Messieurs, quand je parcourais tout à
l'heure les salles d'étude, les réfectoires, les dortoirs, en pensant au
petit nombre d'élèves qui vont les occuper, quant à présent, une
autre idée me venait à l'esprit, c'est que cet établissement n'aura
rempli son objet et atteint définitivement son but que lorsque tous ceux de nos concitoyens qui désirent faire instruire leurs enfants,
pour les élever au-dessus de leur condition actuelle, auront tourné
les yeux vers ce lycée pour les y amener.
A ce point de vue, Messieurs, l'ouverture d'un lycée dans une
ville est une oeuvre sociale et démocratique par excellence. Dans ce
département des Basses-Alpes, républicain d'ancienne date, il n'est
pas un bon citoyen qui ne s'associe profondément à cette préoccupation
de la France de 1870, qui, après avoir été si cruellement
éprouvée, a mis sa confiance dans une rénovation totale de l'enseignement
public à tous les degrés, pour se reconstituer et se refaire. Je dis que, lorsque la France a voulu donner pour base aux
institutions nouvelles tout un vaste système d'instruction publique,
elle a fait ce qui avait été indiqué et tenté à une époque antérieure,
mais ce qui n'avait jamais été abordé avec la résolution, avec l'esprit
de suite qu'on y a apportés depuis 1870.
Messieurs, la politique joue un grand rôle dans la vie publique et
privée do chacun de nous, et ce n'est pas sans raison. On dit même
que la politique touche à tout et se glisse partout. On a encore
raison, mais c'est à la condition do comprendre que la politique, pour
avoir le droit de se mêler à tout, soit faite avec liberté, sans
doute, mais aussi avec un sérieux esprit d'ordre et de bonne et sage
conduite. Je répète donc que, dans ma conviction, le jour où le pays
a voulu que la République reposât sur un enseignement national,
repris, agrandi, développé suivant un esprit vraiment nouveau, tous
les Français ont dû comprendre que les méthodes et le caractère de
l'enseignement public devraient subir de profondes modifications, Il
est de toute impossibilité que la démocratie puisse accepter pour
l'enseignement de ses fils des méthodes qui convenant à toutes les
monarchies, ont été suivies et appliquées par toutes successivement.
Républicains, nous sommes obligés par la nature des choses, par le
cours naturel du temps, par le progrès des lumières, de donner à
l'enseignement républicain, à l'enseignement de notre société démocratique
de tout autres caractères que ceux qui convenaient à une
société monarchique, qui a définitivement cédé la place à un monde
nouveau. C'est donc ici un établissement d'instruction secondaire
destiné a former des hommes qui occuperont dans la société une situation, je ne dirai pas prépondérante, rien n'est plus éloigné de
ma pensée, mais qui leur permettra d'exercer sur leurs concitoyens
une action plus directe ct plus efficace, grâce à leurs lumières.
Quel sera au juste cet enseignement secondaire ? Voilà le problème,
et tout le monde sait qu'il n'est pas facile à résoudre.
Messieurs, que cette préoccupation n'aille pas choquer ceux qui
font de l'égalité le principe exclusif de la société moderne. Je veux
dire seulement que l'enseignement public est appelé à se transformer
précisément pour donner satisfaction à ce principe même de l'égalité.
Ce qui pouvait être bon pour l'enseignement secondaire d'une petite
élite, d'une société restreinte, ne saurait plus convenir à une grande
et forte démocratie qui envahit tout. Il nous faut chercher un
enseignement qui réponde à notre état social nouveau.
C'est bien là ce qui m'empêche de trouver que votre nouveau
lycée est trop vaste et trop beau, C'est le lycée de l'avenir; on y
viendra chercher la science et ses bienfaits, et plus il est grand,
meilleur il est.
Pourquoi la science est-elle devenue, dans les démocraties, un
intérêt politique et social de premier ordre? C'est que la science est
pour l'homme qui vit en société le plus puissant, le plus précieux et
le plus fécond de tous les instmments de travail, et que les démocraties
sont avant tout des sociétés de liberté et de travail. Et quand
je contemple d'ici cet établissement qui ressemble si peu à nos
anciens collèges, qui a déjà le caractère d'une maison de travail et
de production industrielle, je ne puis m'empêcher de songer au
courant nouveau qui entraîne notre société moderne.
Cette construction, où cependant on n'a pas ménagé l'argent, ne
se recommande pas, dans sa forme extérieure, par une architecture
fastueuse; mais, en entrant bien dans la pensée de l'architecte, on
devine, on pressent que les générations d'écoliers se succéderont
dans cette maison pour apprendre à travailler et à soutenir le grand
combat de la vie.
Tel doit être, permettez-moi de le dire, le caractère de l'enseignement
secondaire dans l'avenir, et je ne crois nullement le rabaisser en
disant qu'il doit s'approprier de lui-même à tous les besoins de
notre démocratie laborieuse et agissante. Qu'on le veuille ou non, il n'y a plus rien aujourd'hui en dehors de la démocratie; aussi, dans
ce pays, tout doit tourner à son avantage, à ses progrès, à son
élévation matérielle et à sa grandeur morale.
Je suis loin de penser que l'enseignement secondaire ne devra plus
préparer des hommes pour ces professions libérales dont notre
société démocratique peut se passer moins encore que les autres.
J'oserais encore moins dire que l'on doit transformer les lycées en
écoles professionnelles ou d'apprentissage où l'on ne fera que des
contremaîtres. Non; je ne dis pas cela. Ce que nous devons
demander avant tout à l'enseignement secondaire, ce n'est ni des
contre-maîtres, ni des chefs d'établissements, ce sont surtout des
hommes, des citoyens.
Qu'est-ce qui fait qu'un homme est véritablement digne de ce
nom ?
C'est la noblesse de son coeur, la hauteur de son intelligence,
l'énergie de sa volonté ; c'est son esprit orné en même temps qu'armé.
Pour que l'enfant devienne un homme, il faut que son intelligence
soit fermement préparée par une culture scientifique et littéraire de
plus en plus solide. Aussi est-il de plus en plus nécessaire que cet
enseignement nouveau et destiné à agir sur les intelligences d'une
maniera vigoureuse et féconde soit doublé d'un enseignement moral
qui élèvera les coeurs, en les ouvrant aux plus nobles sentiments.
Enfin, il importe qu'on apprenne dès le lycée que, suivant le mot
profond du plus grand de nos maîtres du XVIIIe siècle, la vie, c'est
l'action. Aussi, la principale qualité pour l'homme doit-elle être
l'énergie qui trempe les caractères. Le caractère d'un homme est ce
qui assure son indépendance personnelle; à son tour, cette indépendance
fait de l'homme un citoyen. Et de bons et fermes citoyens
peuvent seuls faire bonne garde autour des institutions républicaines.
Aujourd'hui, tous les Français s'intéressent aux questions d'éducation
nationale, et le ministère de l'Instruction publique est devenu
le plus populaire de tous ; mais, en même temps que la popularité et
les honneurs sont venus à ce ministère, ses charges ont augmenté
et sa responsabilité s'est accrue.
Pourquoi? Parce que les pères de famille ont maintenant les yeux
fixés sur la direction qui est imprimée à l'enseignement national, L'État a reconnu le principe de la liberté. Usant de cette liberté
les adversaires de la démocratie ceux qui se défient d'elle élèvent
leurs enfants dans des écoles qui leur semblent plus propres à
sauvegarder les anciennes idées.
Au contraire, tous ceux qui appartiennent à la démocratie, ceux
qui sortent de ces couches profondes dont parlait tout à l'heure
M. le recteur ont maintenant pour principal souci de savoir quelle
est la direction qu'on veut donner à la société de l'avenir.
Cette direction, vous la connaissez, Mes chers Concitoyens; il
s'agit de faire que la France continue à être ce qu'elle a toujours été,
c'est-à-dire le porte-flambeau de la civilisation dans le monde.
C'est en dirigeant les générations nouvelles vers ce grand idéal
qu'on relèvera notre pays. Nous ne pouvons, nous ne devons pas
penser à faire de notre France une société exclusivement industrielle,
comme l'Amérique; nous ne pouvons, nous ne devons pas davantage
nous attarder dans l'ornière du passé, en faisant de la France une
nation de pédants et de mandarins.
Non, la France est une nation libre, vive, douée d'une incomparable
puissance de rajeunissement et de transformation, qui a de
glorieuses traditions, une grande histoire et un noble passé à soutenir,
mais qui a aussi son rôle à jouer parmi les peuples de l'avenir.
Notre nation reste, malgré ses malheurs, l'objet de l'envie passionnée
de l'univers. Il y a devant nous, pour nos enfants, des perspectives
de grandeur morale et matérielle à nulles autres pareilles. Malgré
l'obscurcissement momentané de sa gloire, la France n'a pas cessé
de marcher à la tête des peuples civilisés; mais, pour garder son
rang, il faut qu'elle se renouvelle incessamment elle-même dans ses
enfants.
Telle est la haute pensée, Messieurs, qui a porté la République et
les républicains à tout sacrifier à l'instruction générale. Voilà
pourquoi les établissements comme celui-ci doivent être entourés de
la faveur publique. Voilà pourquoi aussi, s'il m'est permis de l'ajouter,
le Gouvernement ne pouvait être absent d'une pareille fête, et je
saisis cette occasion de déclarer que le ministre de l'instruction
publique n'est pas venu dans cette ville pour faire de la politique
de parti, mais de la politique nationale. Il y a quelque chose qui est au-dessus de nos discussions, de nos
divisions et de nos passions, c'est l'avenir de la Fiance et de la
civilisation générale,
Cet avenir, Mes chers Concitoyens, il sera ce que le feront les
élèves de nos lycées; nos destinées futures sont entie leurs mains,
Quand on élève sa pensée vers toutes ces grandes choses, on écarte
bien loin de soi, et non sans quelque dédain, certains reproches que
d'ailleurs on sent injustes et immérités, Des telles accusations ne
sauraient atteindre des hommes convaincus au fond de leur conscience
que, depuis la première jusqu'à la dernière heure de leur vie active,
ils n'ont cherché qu'à servir leur cause, afin d'ajouter à la liberté, à
la force, à la grandeur de leur pays,
Qu'est-ce donc que leur cause? C'est celle de la France. El pour
qui voulons-nous de la gloire, sinon pour la patrie?
Il serait téméraire de vouloir rien ajouter.
Restons sous l'austère et fortifiante impression des belles
paroles qu'on vient de lire : elles forment la conclusion de
notre modeste histoire du collège de Digne et nous permettent,
sans rougir d'un passé qui n'est pas sans gloire,
de diriger complaisamment nos regards vers les perspectives
que le nouvel enseignement nous ouvre sur l'avenir,
PIÈCES JUSTIFICATIVES
I.
Adresse du conseil général de la commune de Digne, chef-lieu du département des Basses-Alpes, à la Convention nationale,
Représentans d'un peuple libre,
Nous avons pris lecture du rapport qui vous a été fait au nom du
comité d'instruction publique, et nous avons vu avec surprise que
dans le projet de décret qu'il vous a proposé il s'agit d'établir à
Manosque le seul institut principal destiné pour les Basses-Alpes.
Laissons à part l'intéiêt de la ville de Digne, chef-lieu de ce département,
Les nouvelles institutions ne sent point en effet créées pour
favoriser telle ou telle ville, tel ou tel district plutôt que tel autre,
mais pour l'avantage de la généralité, pour la commodité du plus
grand nombre.
Il faut donc, en les plaçant dans un arrondissement, chercher un
point central à portée de tout le monde et auquel on puisse arriver
de toutes les extrémités par une distance à peu près égale.
Jettons un coup d'oeil sur la carte et examinons si Manosque est
dans une position favorable pour y fixer l'institut proposé.
Notre département comprend cinq district, Digne au centre,
Barcelonnette au nord, Castellane au levant, Sisteron au couchant et
Forcalquïe rau midi. C'est dans ce dernier district que se trouve la
ville de Manosque, située à l'extrémité du département et presque sur
la limite du territoire des Bouches-du-Rhône.
Le seul institut principal destiné pour les Basses-Alpes serait
donc fort mal placé à Manosque ; il serait hors de la portée de la généralité du dépatement, disons mieux les trois quarts de ses
habitantb seraient privés d'en profiter, non seulement par le motif
de l'éloignement, mais encore par la difficulté qu'auraient les
districts de Digne, Castellane, Barcelonnette et une partie de celui
de Sisteron pour se rendre à Manosque dans certains temps de
l'année, Manosque et le district de Forcalquicr sout en effet séparés
du reste du déparlement par la rivière de Durance, qui ne peut se
traverser que par un bac dangereux dans les temps ordinaires et
souvent impraticable lors des crues d'eau, surtout lorsque la rivière
est divisée en plusieurs branches. Aussi existe-t-il peu de relations
entre les habitans d'en deçà de la Durance et ceux du district de
Forcalquier; on ne se rend dans le district qu'avec répugnance même
pour des affaires faciles ; jugés donc combien il en coûterait aux pères
de famille d'être obligés de conduire leurs enfants en delà de cette
rivière et dans un pays si éloigné, La plus part ne pourraient s'y
résoudre et dès lors le but de la Convention nationale, qui est de
raprocher des étudians les moyens d'instruction, serait absolument manqué dans ces contrées. Des cinq districts dont notre département
est composé celui de Forcalquier serait le seul à portée de profiter
de cette instruction et il n'y aurait en cela ni justice ni égalité.
Législateurs ! notre déparlement n'est pas riche, il est surchargé
d'impôts ; c'est bien le moins que vous facilitiez à ces pauvres habitans
les moyens d'acquérir les lumières que vous voulez propager partout,
et que vous ne les surchargiez point par des frais de voyage et de
déplacement.
La carte à la main, cherchons donc le point central, le mieux à
portée de tous et où on puisse trouver le plus de ressources possibles
pour l'instruction de la jeunesse.
Or nous pouvons vous assurer sans crainte d'être démentis ou
d'être accusés de parler pour notre intérêt particulier, que la ville de
Digne est la seule qui puisse remplir les indications (sic) : La position vraiment centrale n'a pas besoin d'être attestée ;
elle a été formellement reconnue par les premières assemblées
électorales et administratives, puisque c'est d'après leur voeu que
l'Assemblée constituante y fixa définitivement le siège de l'administration
supérieure sans aucun alternat, le même hommage lui a été rendu par toutes les sociétés populaires du département réunies par
députés en assemblée fédérative le 14 juillet 1792 et en dernier lieu
par une assemblée générale des mêmes sociétés tenue à Digne le
7 mars 1793, Toujours on a reconnu que Digne par sa position était
la seule où on peut fixer les établissements d'utilité générale.
Il faut observer que le district de Digne forme à lui seul au
delà du tiers de la population des Basses-Alpes, puisque sur trois
cent quinze électeurs que donne le département le district en fournit
cent onze, et que la même proportion se trouve dans le payement de
l'impôt,
A ces moyens victorieux se joignent une infinité de convenance : c'est dans un chef-lieu de département, là ou siège
les administrations supérieures et les tribunaux, que se trouve
toujours une masse de lumières et que les éfudians rencontrent le
plus de moyen d'instruction en tout genre ; de combien de ressources
ne seraient-t-ih pas privés si l'institut était placé dans une ville où il n'y aurait aucune administration ?
Ainsy la centralité, la population, la contribution et les motifs de
convenance, tout concourt à faire établir à Digne l'institut principal
proposé pour le département.
L'importance particulière de Digne ne doit pas moins contribuer
à appuyer notre réclamation. Cette cité a en effet toujours figuré,
même dans l'ancien régime, comme une ville principale ; elle était
regardée comme la capitale de la Haute Provence ; avant la peste
arrivée en 1629, elle comptait dans son enceinte plus de douze mille
âmes. La dépopulation fut si grande que le célèbre Gassendy ne put
retenir ses larmes à son retour de Paris dans sa patrie.
Malgré ces pertes considérables, Digne, par son commerce, par la
faveur de sa position et par ses relations avec toutes les contrées
voisines, a toujours été la ville la plus conséquente de cette partie de
la cy-devant Provence qui forme aujourd'huy le département des
Basses-Alpes. Les entraves de l'ancien régime l'ont empêché de
réparer toutes ses pertes, mais elle espère trouver dans le nouveau
des moyens de reprendre son ancien lustre.
En deux mots, nous sommes situés au centre géographique et de
la population du département. Notre climat est fort tempéré; la situation de notre ville assez agréable; nous y respirons un air pur
et nous y jouissons de tontes les ressources pour recouvrer la santé,
ne fut ce que par le moyen de nos Bains, qui sont très connus. Que
faut-il de plus pour engager la Convention nationale à placer h Digne
l'institut principal qu'il s'agît d'établir dans les Basses-Alpes? Nous
offrons encore à la République de fournir à nos frais et dépens un
local des plus propres et des plus commodes pour cet établissement.
Tout nous fait espérer que la Convention nationale nous rendra la
justice que la localité el l'intérêt gênerai du déparlement semblent
nous assurer.
Délibéré à Digne en conseil général, le 13 mars 1793, l'an II de
la République française, et ont sigué tous les membres dudit conseil
à la minute.
II.
Surveillance municipale,
.
Plusieurs personnes ayant portés des plaintes à la municipalité
qu'un grand nombre d'enfants s'assembloient au pred de la foire et
une autre troupe au nouveau grand chemin qui conduit au grand
pond de pierre pour se lencer des pierres avec la fronde les uns
contre les autres;
Une pareille guerre est intolérable, et il est inoui que des républicains
se bâtent parmi eux.
Comme ou saurait envisagé cette inconduite que du coté de
défaut de vigilance et d'instruction des parents de ces enfants, que
sils étoient bien instruit de notre sublime constitution, ils y aprendraient
à aimer et à secourir les français comme des frères.
Pour lors au lieu de se batre parmi eux, ils se chériroient, ils
s'amuseraient ensemble, ils s'exerceroient parmi eux au maniement
des armes pour se rendre invincibles contre nos perfides ennemis,
lorsqu'ils auront atteint l'âge et la force suffisantes pour les aller
combattre.
En concéquence tous les parens qui ont des enfants veilleront
sur eux avec grand soin et les dégoûteront en leur faisant connaitre le ridicule de leur conduite.
Faute de quoy les parents sont responsables des événements
fâcheux qu'il pourroit en résulter, et louis les enfants qui ont atteint
l'âge au dessus de dix ans qu'ils seront trouvés sur le fait de jetter
des pierres avec leur fronde, dans les chemins autour de la commune, soient dans Jes promenades, soient dans les places
publiques, seront arrêtés, et mis pendant vingt quatre heures en
prison.
Fait à Digne, dans la maison commune le 24 messidor, l'an 2'
(12 juillet 1794) de la république française une et indivisible.
III.
Extrait des délibérations du conseil général de l'an 10. Séance du 5 prairial (25 mai 1802).
INSTRUCTION PUBLIQUE.
Le conseil général ne répétera point ici tout ce qu'il a dit dans
les verbauxde ses précédentes sessions pour faire sentir les avantages
et surtout les besoins de l'instruction dans ce département : ils sont
généralement reconnus aujourd'hui. Ils avaient tellement frappé le
préfet, que ce magistrat, pour se rendre aux voeux bien prononcés
du conseil, et des habitants des Basses-Alpes, n'avait négligé aucun
moyen, et n'avait épargné ni peine ni soins pour organiser l"École
centrale dans ce département.
Il était enfin parvenu à ce but si désiré : et pour faciliter les
moyens d'instruction pour toutes les parties du département, un
pensionnat, dirigé par une personne éclairée, était établi près l'École
centrale où des élèves nombreux étaient à portée de recevoir une
éducation soignée : moyennant une pension modique et compatible
avec la médiocrité des fortunes des habitants. Ceux-ci commençaient
à jouir du fruit des travaux et sollicitudes du préfet et de ses
coopérateurs et se félicitaient de pouvoir enfin donner à leurs enfants l'instruction dont ils étaient privés depuis la Révolution.
Trois professeurs, un des langues anciennes et modernes, un des
mathématiques et un troisième de dessin, étaient déjà en exercice.
On se serait borné, pour compléter l'enseignement, à demander encore
deux professeurs, dont un d'histoire naturelle, qui aurait montré les
éléments de l'agriculture, et l'autre aurait professé les belles lettres.
Voilà nos espérances tout-à-coup déçues; voilà ces établissements si
longtemps désirés et formés avec tant de peine, soudainement
paralisés et frappés de nullité par le nouveau projet d'organisation de
l'instruction publique,
Ce projet, quoique conçu avec des idées libérales, renferme des
défauts remarquables. Les écoles secondaires seront la seule ressource
des habitants de ce dépaitement, parce que la modicité de leurs
fortunes ne leur permettra pas d'envoyer leurs enfants dans des
licées qui ne pourront être fréquentés que par les enfants des
favoris de la fortune.
Dans les écoles secondaires, on ne pourra donner qu'une instruction
très bornée. On n'y trouveia jamais des professeurs doués du mérite
qui doit distinguer ceux qui se vouent à ces pénibles et honorables
fonctions, attendu qu'on fait dépendre leur existence du nombre des
élèves, et que ce nombre ne pourra jamais leur procurer un traitement
suffisant.
Si le nouveau plan était adopté, ce département serait privé des
avantagés de l'instruction, parce qu'on ne pourrait jamais parvenir
à y organiser les écoles secondaires, autant par le défaut de ressources
des communes, que par l'impossibilité de trouver des sujets. Cependant
ce pays ne doit point être négligé : ses habitants, naturellement
vifs et spirituels, sont susceptibles de cultiver les sciences et les
lettres avec succès. Il a produit l'immortel Gassendy et le savant
Papon, historien de Provenez; ii est le berceau des Mirabeau, et
plusieurs écrivains qui, quoique moins connus, se sont rendus utiles
aux lettres par les connaissances qu'ils ont transmises, y ont pris
naissance. Le Gouvernement ne peut mieux développer les germes que la
nature se plaît à répandre dans l'esprit des habitants des Basses-Alpes, et y former des sujets capables de remplir les diverses fonctions
de la société, qu'en laissant subsister l'École Centrale, avec les
réformes et les modifications que cet établissement paraît exiger, et
surtout en le soumettant à une surveillance sévère et telle qu'elle pût
exciter le zèle des professeurs et l'émulation parmi les élèves. Si les
dépenses qu'entraîne l'établissement de l'École Centrale, même avec
une réduction dans le nombre des professeurs formaient un obstacle,
on trouverait aisément les fonds suffisants par la suppression de
l'agence des contributions qui est réclamée par le voeu général.
D'après cet exposé, lo conseil général exprime le voeu formel que
l'École Centrale soit conservée et maintenue dans ce déparlement,
comme l'établissement qui convient le mieux aux localités ; que le
nombre des professeurs y soit réduit et fixé à cinq ou à six, en y
comprenant le bibliothécaire ; que le pensionnat établi près l'École
centrale soit investi de toute la protection du Gouvernement et
qu'une surveillance rigoureuse soit le gage da la prospérité de
l'instruction.
IV.
Discours de distributions de prix.
1838. M. Raine, principal. — Sur le danger des utopies et des
théories bizarres en politique.
1840. M. Auphan. — Sur la langue française.
1841. M. Collivet, professeur de troisième, — Sur les récompenses
et les prix.
1843. M. Henri. — Sur l'éttude des auteurs classiques (sortie contre
le romantisme).
1846. M. Camatte, régent de troisième.— Sur le choix d'une carrière.
1848. M. Reynaud. professeur d'histoire. — Sur l'éloquence.
1849. M. Ser, professeur de rhétorique. — L'Université et le collège
sont des institutions bien appropriées à l'espût d'une républiquc.
1851. M. Colomb, régent de seconde. —
Tableau de l'histoire
littéraire.
1852. M. Neyreneux, régent de rhétorique — Sur le travail.
1852. M. Faure, professeur d'histoire. — De la nécessité de l'étude.
1854. M. Colomb, régent de rhétorique. — Importance et utilité
des différentes branches de l'enseignement universitaire,
1855. M, Roger, professeur de seconde. — L'enseignement universitaire.
1856. M, Couslalet, professeur de tioisiême. — Sur l'esprit d'ordre
et de discipline.
J857. M. Barrés, principal. — Des principes d'une bonne et solide
éducation chrétienne.
1858. M. Bénit, professeur de rhétorique. — Des auteurs grecs et
latins.
1859. M. Imberl, professeur de mathématiques. — Influence des
sciences sur le développementde l'intelligence.
1861. M. Roberty, professeur d'histoire.— Origine et développement
des sciences historiques.
1862. M. Chabrier, professeur de seconde.—Sur l'histoire de Digue.
1863. M. Ferry, professeur de rhétorique.— Sur l'activité, vertu
indispensable pour triompher dans la lutte pour la vie.
1864. M. Pons, professeur d'histoire. —
Élude de l'histoire.
1865. M. Bénit, principal. — Des avantages de l'instruction.
1866. M. Bourbon, piofesseur de rhélorique. — L'élève de nos jours
et l'élève d'autrefois.
1867. M. Pinelli, prufasseur de seconde. — L'éducation et
l'éducation privée.
1868. M. Déruelle, professeur d'histoire. — Utilité de l'institut.
1869. M. Courtalon, professeurde seconde.—Des travaux du collège.
1871. M. Arnoux, professeur de rhétorique. —Influence de renseignement
sur l'avenir de notre pays.
1873. M. Désiré Martin, professeur de mathématiques. —
Éloge des
sciences.
1874. M, Barnave, professeur de physique. — Découvertes du
XIXo siècle.
1878. M. Foujols, professeur d'histoire. — Sur le progrès.
1876. M. Bénit, professeur de philosophie. — Sur l'esprit d'obéissance.
1877. M. Guizou, professeur de cinquième et sixième. — Sur la
lecture.
1878. M. Payan, professeurde physique.— Sur l'étude de l'histoire
naturelle.
1879. M. Arnoux, professeur de rhélorique, — Sur Honnorat, Bondil
et l'orateur Manuel.
1880. M. Bernard, professeur de l'enseignement secondaire spécial.
— De renseignement secondaire français.
1881. M. Balland, piofesseur de philosophie.— De l'élude dp la
philosophie,
1882. M. Bonfanti, professeur de philosophie. — Sur Gassendi.
1883. 51. Mène, professeur de cinquième et sixième. — Sur
Montaigne.
1884. M. Briand, professeur de troisième et quatrième. — Sur
l'énergie et la fermeté du caractère.
1885. M. Granier, professeur de philosophie. — Sur la dignité
humaine.
1886. M. Dagan, professeur de rhétorique. — Sur le pédantisme.
1887. M. Jean, professeur de philosophie. — Sur Rabelais.
V.
Décret érigeant en lycée national le collège de Digne. (I août 1883.)
Le Président de la République Française,
Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre de l'Instruction
publique et des Beaux-Arts,
Vu les délibérations, en date des 11 août, 10 octobre 1882 et
30 mars 1883, par lesquelles le conseil municipal de Digne a émis le
voeu que son collège communal fût érigé en lycée et s'est engagé :1° à fournir des bâtiments conformes aux plans qui seront approuvés
par le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts et garnis
du mobilier usuel et scientifique déterminé par les règlements; 2° à
satisfaire aux obligations imposées par la loi du 15 mars 1850; 3° à
entretenir pendant dix ans un certain nombre de bourses;
Vu les délibérations, en date dos 23 cl 25 août 1882, par lesquelles
le conssil général des Basses-Alpes s'engage à contribuer, pour une
somme de 100,000 francs, aux frais de construction de l'établissement
,vu les rapports de M. le Recteur de l'Académie d'Aix, en date
des I" décembre 1882 et 23 juin 1883;
vu l'avis du Conseil supérieur de l'Instruction publique ;
vu la loi du 15 mars 1850;
vu le décret du 10 avril 1853;
DÉCRETE
ARTICLE PREMIER— Le collège de Digne est déclaré lycée
national.
ART. 2. — Le lycée de Digne sera organisé, après qu'il aura été reconnu contradictoirement par les délégués de l'administration municipale et par ceux du Ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts que les bâtiments sont complètement achevés conformémentaux plans approuvés et pourvus du mobilier usuel et scientifique déterminé par les règlements.
AKT. 3. Le prix de pension et d'externat seiont fixés ainsi qu'il
suit :
Division supérieure
— de grammaire
— élémentaire
Pension.Demi Pension, Externat.
650 » 425 » 100 i
600 » 375 » 80 »
550 » 325 » 70 »
ART. 4. — Les Président du Conseil, Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, est chargé de l'exécution du présent décret.
JUI.ES GRÉVY.
Par le Président de la République :
Le Président du Conseil,
Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts,
JULES FEBRY.
VI.
Bibliographie,
Archives communales de Digne, BB; registres des comptes, CC;
registres des actes: arrêtés du corps municipal.
Délibérations du bureau d'administration du collège (1805),
Archives départementales des Basses-Alpes.
Journal des Basses-Alpes(1837-1887).
Annuaire des Basses-Alpes(1833).
Vie de P. Gasseirti, par le père Bougerel. (Paris, imprimerie de
Jacques Vincant, 1737.)
Souvenirs historiques sur la ville de Digne, par F. Guichard.
(Digne, v Guichard, 1847.)
Dicours sur la vie et les vertus de Mgr de Miollis, suivi de notes,
par L.-J. Bondi!, chanoine théologal. (Digne, ve Guichard, 1843.)
Les Pédagogues du Port-Royal, par Carré. (Paris, Delagrave, 1887.)
348 pages.
Documents sur l'enseignement primaire en Provence avant 1789,
par Mireur, archiviste du Var. (Extrait de la Revue des Sociétés
savantes, 7« série, lome III, 1880.) 32 pages.
Bulletin de là Société scientifique et littéraire des Batses-Alpes,
(Imprimerie Chaspoul, Conslans, et veuve Baibaroux, Digne.)
Musée pédagogique, fascicule n° 7. —Schoîa aq\titanka, programme
d'études du collège ds Guyenne au XVI° siècle, léimprimé par Louis
Massebicau. (Paris, Delagiaveet Hachette, 1886.)xv-76 pages.
Musée pédagogique, fascicule n° 71. — Notes sur l'Instruction
publique de 1789 à 1808.
Reçue de l'Enseignementsecondaire cl supérieur.(Paris, Dupont.)
Cette revue a publié un certain no:nbes de documents relatifs
l'histoire des collèges.
FIN DE L'OUVRAGE
![]()