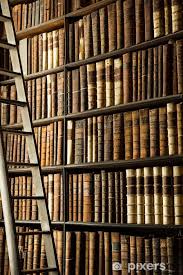
LA VOIE ROMAINE ENTRE SISTERON ET APT
PAR
Damase ARBAUD
1868
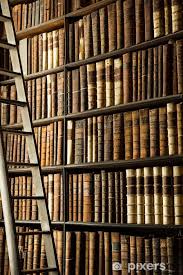
ALAUNIUM . CATUIACA .
I. La voie romaine qui allait de Turin à Arles, ou plus exactement d'Italie en Espagne, est bien connue dans sa direction générale et l'on est d'accord sur l'emplacement de presque toutes ses stations. Cependant des doutes se sont élevés sur le tracé entre Segustero et Apta-Julia, et par suite sur l'identification des deux stations intermédiaires. Cette note a pour but d'éclaircir ces doutes.
II . Il n'y a que deux directions possibles pour relier les deux points incontestés de Sisteron et Apt ; l'une, par le plan incliné que forme le versant méridional de la montagne de Lure, l'autre, par la vallée de la Durance et cette autre vallée que laissent entre elles les chaînes de Lure et du Léberon (1) ; la première,
(1) Je me sers de préférence des indications de la carte de Cassini, feuilles 122 et 153 ; à défaut, j'ai recours à la Carte du département des Basses-Alpes , dressée par les Agents- voyers.
III . De Segustero à Alaunium, les Itinéraires comptent 24 milles ; or en mesurant, à partir de Sisteron, 36 kilomètres sur l'ancien tracé de la route impériale n° 96 par Châteauneuf, et sur un ancien chemin dont j'aurai à parler plus tard, on arrive sur les bords de l'Auson, au point où, vers 1660, fut construit, autour d'une ancienne chapelle, un monastère de Recollets, sous le vocable de Notre- Dame-des-Anges. Là de nombreux débris qu'on découvre chaque jour attestent un séjour prolongé des Romains. Je ne note que les principaux, ceux surtout qui n'ont pas été dénaturés. Des restes d'un aqueduc formé d'un béton composé d'un mortier hydraulique très blanc dans lequel sont noyés des briques concassées et de très petits cailloux tirés du lit de la rivière, se retrouvent sur un grand nombre de points, jusqu'à une très belle source qui coule près du village de Sigonce, à 5 kilomètres au moins de N.-D.-des-Anges. A côté du moulin de Monesargues l'Auson, que longeait l'aqueduc, s'est frayé un passage à travers le rocher d'où il se précipite en formant une fort belle cascade. Là on retrouve l'aqueduc taillé dans la roche vive, avec les mêmes dimensions que la cunette en maçonnerie, et à un point que les plus hautes eaux de la rivière ne sauraient atteindre, preuve évidente qu'il ne peut s'agir d'une dérivation de ces eaux. Ces restes étaient bien plus nombreux à la fin du dernier siècle. Chappus, chanoine de Forcalquier, qui transmit à Papon et au marquis de Méjanes tous les renseignements qu'il put trouver sur l'ancien Alaunium, assure que, de son temps, on les voyait « servir de digue aux torrents, de muraille aux terres supérieures, de borne aux champs et aux chemins ( 1). » Les exigences de l'agriculture les font disparaître peu à peu, comme elles ont fait disparaître les ruines d'une tour qu'on voyait encore , il y a quelques trente ans, dans la terre qui joint le couvent de N. -D. - des-Anges. Mais si la charrue a détruit ces reliques, elle en a exhumé d'autres qui n'ont pas moins d'importance dans la question. Elles sont soigneusement recueillies par le propriétaire actuel du domaine de N. - D.- des- Anges, M. Roustan , notaire à Digne, qui a tout mis à ma disposition, avec une obligeanee dont je ne saurais assez le remercier. C'est d'abord une série de médailles romaines, dont quelques unes fort belles, qui s'étend depuis les consulaires jusqu'à Magnus Maximus, c'est- à-dire dans un intervalle de quatre siècles, preuve irréfragable que ce point a été longtemps habité. J'en donne, à la suite de cette note, la liste qui a été dressée par M. Laugier, le savant conservateur du musée des médailles de Marseille ; c'est pour le lecteur une garantie d'exactitude dans les attributions et la description. Une intaille sur cornaline, réprésentant un héron, du travail le plus fin et le plus délicat. Elle a dû être enchâssée sur une bague et servir de cachet. Trois doigts en beau marbre de Paros, ayant appartenu à deux statues différentes de trois mètres environ de hauteur. Le premier fragment, de beaucoup supérieur à l'autre par le travail et la qualité du marbre, se compose du médius et de l'annulaire de la main droite ; l'autre, qui est le petit doigt, présente à la face palmaire un empâtement élargi, reste d'un objet sur lequel s'appuyait la statue ou qu'elle soutenait, suivant la main à laquelle appartenait ce doigt qui paraît, à son extrémité grêle
(1) Conjectures sur la ville d'Alaunium. Note ms. dans le recueil 849 à la bibl. d'Aix.
et à la mollesse des tissus, être celui d'une statue de femme ( 1 ). On voit à la campagne de Pré-Bellon un hangar soutenu par trois colonnes en pierre tendre, qui ont été trouvées dans son ténement sur la rive droite de l'Auson, en face de N. - D. -desAnges. Dans l'enclos qui joint les bâtiments de l'ancien monastère on a découvert, il y a deux ans, un grand sarcophage en pierre de 1 mètre 90 c. de longueur sur 0 m. 60 c. de large. Le couvercle arrondi dépasse les bords de 0 m. 05 c . dans tous les sens et présente à son milieu une petite ouverture de 0 m. 11 c. de longueur ; il est sans inscription, sans ornement, et ne renfermait que quelques débris d'ossements. Un petit cippe funéraire, très bien conservé, ayant 0 m. 60 c. de hauteur sur 0 m. 25 c. à la base, avec le mot SILVAN surmontant une ascia de 0 m. 16 c. de hauteur. Ce nom de Silvanus n'est pas rare en Provence. Un fragment d'inscription, en très beaux caractères, de 0 m. 075 millim. de hauteur, portant le mot CENSOR La pierre, brisée en bas et sur les côtés, offre en haut une moulure de 0 m. 09 c. Il serait puéril de voir dans ce fragment la preuve de l'existence d'un censeur ou d'une fonction municipale analogue à Alaunium. Le mot Censor, comme nom propre, se rencontre dans les inscriptions. On lit notamment sur une pierre conservée au Musée d'Aix : C. GEMINIO CENSORI
(1) Ces deux fragments appartiennent à M. le curé de Lurs, à qui je dois beaucoup d'utiles indications.
L. GEMINIO MESSIO - M. GEMINIUS NASICA - FRATRIBUS (1) . Si on compare le mot Censor de cette inscription avec celui de l'inscription de N.-D.-des-Anges, on acquiert la certitude que, tant pour la forme que pour la dimension des lettres, ils sont exactement semblables, et on est tenté de voir dans l'une d'elles la reproduction de l'autre. Serait-il bien étonnant qu'un citoyen de la colonie des Eaux Sextiennes eût une maison de plaisance sur les bords de l'Auson et qu'il eût consacré le même monument de sa tendresse fraternelle dans sa maison de ville et dans sa maison des champs ? Enfin, un fragment d'inscription de 0 m. 28 c. de large sur 0 m. 20 de hauteur, actuellement encastré dans le mur nord de la chapelle de N. -D.-des-Anges, porte : ... VS TACITVS ALAVNIO PV.... (2) Ou je me trompe fort, ou cette inscription serait de nature à lever toute difficulté si sa précision même ne rendait son authenticité quelque peu suspecte. Heureusement j'ai en mains une pièce qui me paraît probante de sa légitimité. En 1730, les Recollets voulant agrandir leur monastère et leur église, mirent à profit les ruines encore considérables qui les entouraient. Au milieu des débris de toute nature qu'ils remuaient, on trouva cette inscription, qui fut placée dans le mur en construction au point qu'elle occupe encore aujourd'hui, et ce fait
(1) Musée d'Aix, 378. J'ai pu comparer les deux inscriptions graces à un estampage de celle d'Aix que je dois à l'obligeance inépuisable du savant M. Rouard . Cette inscription fut trouvée en 1572, auprès du sanctuaire de N. -D. -de- la-Seds, à Aix.
(2) Plus trois sigles à peu près indéchiffrables peut- être PVOTV. Voir le fac simile sur la carte.
fut consigné dans le livre de raison du couvent. Je transcris cette note dans toute sa naïveté, car cette naïveté même est un gage certain de la bonne foi de celui qui l'a écrite . NOTA CURIEUX. Ça été icy une colonie des Romains. La ville s'appeloit Aulon, et on dit aujourd'huy par corruption Aurion, attendu que l'on change len r. Augusta Tacite (7e empereur avant Constantin- le-Grand) qui ne régna guere, avait fait bâtir un temple ou un arc de Triomphe, dont toutes les pierres de taille ont servit à bâtir cette église et le couvent : pierres qu'on a trouvé dans la terre. A cent pas devant la porte de l'église, j'ai trouvé moy même le sueil ou escalier de la porte dudit temple, (qu'on avait ignoré jusqà aujourd'huy) fort rongé, de dix pieds de long, ce qui marquait qu'on y avait passé longtemps dessus ; j'ay des morceaux des colonnes, des pieds d'estail , et autres pièces avec architecture, et des pierres de dix pieds de long par quatre de large et deux d'epesseur. J'y ay trouvé de pièces de monoye de différents Empereurs payens avec des divinités gravées d'un cotté. Quand la religion chrétienne eut pris le dessus, il y a apparence qu'on bâtit la sainte chapelle qui est dans l'enceinte de notre église , et la ville subsista jusqu'au 7e ou 8e siècle que les Provenceaux appelerent les Sarrazins a leur secours pour subjuguer le joug des empereurs et s'établir en royaume : mais il leur en arriva mal, car les Sarrazins s'étant rendu maîtres du pays, pillèrent et ruinèrent toutes les églises et revenus des évéchés, et le pays fut quelque temps sans religion, ou bien peu ; ils furent ensuite chassés par Guillaume Leydet, lieutenant pour les Empereurs à Gap, et fonda la paroisse de Leurs dans le dixième siècle . Voyés pour le reste le premier thome de l'histoire de Provence par Louet ; car pour tout ce qui est cy devant persone n'en saurait rien dire, n'ayant pas trouvé ce que j'ay trouvé jusque à aujourd'huy. Le nom de Tacite et de la ville était écrit sur le frontespice du dit temple et le morceau de pierre que j'ay trouvé est enchassé dans la muraille d'une des chapelles que j'ay fait faire sur le chemin. Voyés la chronologie de Gautier pour cet empereur. F. HUBERT PALUN, GARDIEN. 1730. (1) Or, je le demande, ce bon père gardien dont la science historique s'élève jusqu'à Louvet et à la chronologie du R. P. Gautier était -il capable d'inventer cette inscription ? et s'il l'avait fait , se serait-il borné à un simple fragment, se serait-il attaché à un empereur qui ne régna guère ? n'aurions-nous pas au contraire, une belle inscription bien complète, où les noms de César ou d'Auguste s'étaleraient à côté de celui d'Alaunium? dans quel but d'ailleurs cette imposture ? pour donner plus de lustre à son couvent en le rattachant à une colonie romaine ? Mais alors la pierre eût été placée bien en vue, dans un lieu honorable, au lieu d'être employée comme un simple moellon à trois mètres du sol; mais alors il eût prôné assez haut sa découverte pour qu'elle ne fût pas complètement oubliée après moins d'un demi-siècle ; et c'est cependant ce qu'il est arrivé, puisque quand Chappus vint visiter les lieux et rechercher Alaunium, il n'eut aucune connaissance de cette inscription qui resterait peut-être encore ignorée, grâce à l'identité de nature et de teinte de la pierre qui la porte avec celles qui l'entourent, si un heureux hasard n'avait fait découvrir chez un épicier le Livre archivial du couvent et si, par les soins éclairés de M. le curé de Lurs, ce registre n'était rentré à N.- D.-des-Anges . Je n'ai pas besoin d'observer qu'en défendant la bonne foi du père gardien, je suis très loin d'adopter ses opinions. Il ne s'agit pas plus de l'empereur Tacite que du frontespice d'un temple ou d'un arc de triomphe. Le nom d'un empereur ne se présente pas ainsi isolément, sans l'éuumération de toutes ses dignités
(1) Livre archivial du couvent des P. Récolletsde Notre- Dame-des- Anges.
consulaires et tribunitiennes ; sur le fronton d'un temple, on creusait plus profondément les caractères quand ils n'étaient pas en relief. L'inscription de N.-D.-des-Anges est le simple vœu d'un dévôt au génie tutélaire d'Alaunium, inscrit sur une modeste pierre. Ces divinités topiques sont nombreuses ; dans la Narbonnaise surtout chaque ville, chaque bourgade semble avoir eu la sienne (1), et sans quitter le pays des Voconces, je trouve à Vaison une inscription qui offre, avec la nôtre, une analogie frappante : MARTI ET VASIONI TACITVS . (2) Le prénom qui manque, le nom dont il ne reste que les deux dernières lettres à la première ligne de l'inscription d'Alaunium, laissent à la seconde assez d'espace pour associer au petit dieu Alaunius une divinité d'un ordre supérieur, Mars, Jupiter, ou tout autre, et l'inscription pourrait être par exemple : C. CORNELI VS TACITVS MARTI ET ALAVNIO PV....... Quelquefois aussi, et ce cas pourrait également s'appliquer ici, le nom de la localité s'ajoutait comme une sirople épithète au nom de la divinité qu'elle honorait plus particulièrement. J'indiquerai, entre autres, une inscription dédiée MARTI VINTIO,
(1) J'en cite plus loin des exemples. L'inscription de Marcus Vibius longus à la déesse Trittia, qui de Trest passa dans le cabinet de Peyresc, et de là est allée servir de support à l'étai qui soutient une grange à Pierrefeu, est très connue.
(2) BOYER, Hist. de l'église de Vaison, p. 2. Voy. litt . par deux Bénédictins, tome II , p. 293. MURATORI, tom. I, pag . cx. 6. BRETON, Mém. des Antiquaires de France, 1842, pag. 122, etc.
qui a été trouvée à Vence (1) ; et une, DEO MARTI -- AVG RVDIM -O, provenant d'un petit village de la Drôme, aujourd'hui St Etienne, dont le nom ancien était Rudimum (2). Notre inscription présente toutefois cette singularité, que le nom du dédicateur précéde celui de la divinité, contrairement à l'usage le plus généralement suivi. Cependant, la forme contraire est loin d'être sans exemple. Sans trop m'éloigner de la localité qui nous occupe, je relève dans Chorier : L. MATERNVS OPTATVS - VVLCANO AVG. (3) ; dans Bouche : SEXTIVS CALVINVS ... MERCVRIO (4) ; dans Millin: D. VESVCCIVS CELER CENTONDI v. s . (5) ; enfin j'indique l'inscription d'Eilia Faustina aux nymphes de Gréoux (6) . L'inscription subsiste donc dans toute sa force démonstrative pour fixer Alaunium auprès du lieu où elle a été trouvée, car ces ex-voto à un dieu topique dont le nom se confondait avec celui de la localité qu'il protégeait, ne sauraient guère être ailleurs que dans cette localité même.
IV. De tout ce que je viens de dire peut-on conclure que les Romains aient jamais eu à Alaunium un établissement de quelque importance? je ne le pense pas. Les stations n'étaient pour la plupart que des relais de poste autour desquels se groupaient quelques maisons pour servir de gîte aux voyageurs. La beauté même de quelques- uns des fragments que la terre nous a rendus me paraît être un argument contre l'hypothèse
(1) BOUCHE, Hist. de Prov , I , 283. MILLIN, Voy. dans le Midi, III, 10, et tous les auteurs cités par ce dernier.
(2) LONG, Recherches sur les antiquités romaines du pays des Vocontiens . Mém. de l'Acad . des inscript . savants étrangers, 2e série, tom. II, pag. 371 .
(3) CHORIER, Hist . du Dauphiné, pag . 238 .
(4) BOUCHE, Op . cit. , I, 196. Voir en outre 197, 280, etc.
(5) MILLIN, Op. cit . , tom. II, 557 et
(6) HENRY, Recherches sur la géographie ancienne et les antiquités du départ des Basses - Alpes . Forcalquier, 1818, pag . 154.
d'une opulente cité. Une ville qui aurait eu dans ses murs des statues colossales, comme celles dont j'ai les restes sous les yeux, n'aurait pas complètement disparu, sans laisser des traces dans l'histoire ou sur le sol. Ce qu'il devait y avoir, à côté de la station, c'était une de ces somptueuses villas où les riches d'alors étalaient un luxe qui étonne l'imagination. C'était dans ses jardins que se dressaient les statues ; c'était pour elle qu'avaient été construits les aqueducs ; dans son atrium, que Tacitus avait érigé son ex voto ; c'étaient ses ruines que déblayèrent les Franciscains. Le site était charmant pour une maison à la campagne, il eût été insuffisant pour une grande ville. Le passage, longtemps continue des voyageurs, explique naturellement la présence de médailles si diverses et d'époque et de type. Mais, est-ce à dire qu'il n'y avait point de centre de population à Alaunium. Ce nom, à physionomie celtique (1), devait être celui d'un oppidum gaulois, voisin de la station romaine qui le lui avait emprunté. Les Gaulois choisissaient pour leurs habitations des lieux facilement défendables. Quand Sextius Calvinus vint fonder sa colonie des Eaux Sextiennes, il trouva les Saliens sur les hauteurs d'Entremont, Caballio était sur le mont Caveau, Avenio sur le rocher des Doms, Aurasio sur la montagne à laquelle fut adossé le théâtre romain. Le bassin de N. -D.-des Anges, dominé de tous les côtés par des élévations aux pentes raides, protégé d'une manière bien insuffisante par une rivière presque à sec en été, guéable en toute saison, était une position qui ne répondait à aucune des conditions que recherchaient les Gaulois pour asseoir leurs bourgades. Mais lequel des coteaux qui l'entourent avait donc été choisi ? Est-ce
(1) « Tous les noms géographiques de l'ancienne Gaule, les Segalauni, Velauni, Alauna, Alaunium, et les noms actuels de nos rivières, l'Aune (Gascogne) l'Aulne ( Bretagne), Lone (Maine), etc, dérivent de la même racine celtique latinisée sous la forme de Launia . L. LALANNE, Bibl. de l'école des chartes, 2ª série, tom . I, pag. 169 .
le Puy d'Aulun sur lequel Henry prétend avoir reconnu l'assiette d'une ville (1), ou bien, sur la rive droite de l'Auson, le Thort de Olonio , où une charte du xi siècle nous montre un vieux bourg abandonné (2) ? L'un et l'autre sont rapprochés de N. -D.- des-Anges, l'un et l'autre sont d'une défense facile, tous deux commandent la vallée. Je serai donc réduit à de vaines conjectures, et j'aime mieux laisser à quelque heureux hasard le soin de résoudre le problême. Qu'il me suffise de bien fixer le point où était la station d'Alaunium, et si en présence des preuves que j'ai apportées jusqu'ici il pouvait rester quelque doute dans l'esprit du lecteur, la persistance de ce nom topique à travers le moyen- âge, pour arriver à nous à peine modifié, doit suffire pour les faire évanouir . Si donc nous suivons jusqu'à nos jours les transformations du nom d'Alaunium, nous trouvons, dans un échange de 1150, entre Pierre de Sabran, évêque de Sisteron, et les Templiers : Ecclesiam S. - Mariæ de Olonio, nom qui se reproduit encore dans une transaction de 1174, par laquelle l'église de Notre Dame de Olonio fit retour à l'évêque avec quelques terres acquises par les Templiers pendant leur courte possession, terres qui furent depuis possédées par l'évêque, et toujours affermées sous le nom d'Auluen. Ceux-là reprirent la Brillane qu'ils avaient donnée en échange (3). Par sa bulle donnée le 6 des Ides d'avril, la huitième année de son pontificat, 1152, Eugène III confirme entre autres choses, à l'évêque de Sisteron, Ecclesiam de Olonio (4). Des différends s'étant élevés sur la délimitation des territoires de Lurs et de Pierrerue, une enquête fut faite en 1274, et onze témoins déclarent que la séparation des deux territoires
(1) HENRY, Op . cit . , page 135.
(2 ) Cartde. St- Victor, no 677. Je reviendrai sur cette charte .
(3) COLUMBI , Opusc. varia, pag . 78, 133 et 135.
( 4) Extraits du livre vert de l'évèché de Sisteron, par GASTINEL, page 421 . Dans la bibl. de M. E. de la Plane.
est ad thort de Olonio (1) ; ce nom se retrouve dans les actes publics et dans les anciens cadastres de la commune de Lurs, avec les variantes de Olluon, Ollueng, Olon, Auruou, etc , nom que Cassini a écrit Dolun et Piedaulan, ce dernier nom se rapportant à une éminence qui domine la petite plaine de N.-D.- des-Anges, et qui porte le nom de Puy-d'Aulun. Il est à noter qu'alors que dans tous les environs ce canton est connu sous le nom de N. -D.-des-Anges, il n'est jamais appelé que le quartier d'Aulun par les habitants de Lurs. En résumé, pour nous, à N.-D.-des-Anges la station militaire et la villa de quelque romain opulent, et sur l'un des coteaux qui l'avoisinent, l'oppidum gaulois d'Alaunium, qui fut peut-être une de ces dix-neuf petites villes oppida ignobilia que Pline attribue au pays des Voconces (2) . V. D'Anville, avec qui il faut compter dans toutes les questions de géographie ancienne, place Alaunium à l'Hospitalet ; mais, il est bon de le remarquer, ce n'est qu'en hésitant qu'il propose cette identification. Je présume, dit- il, que la « route, en s'éloignant de Sisteron, sortait des monts de Lurs vers un endroit dont le nom d'Hospitalet désigne communément le passage d'une grande route, le débouché d'un col de montagne, et l'hospice ou la retraite préparée pour le voyageur dans ce passage (3). » Et de fait, sur la carte qui accompagne la Notice de la Gaule, il fait franchir à sa route la montagne de Lure et la conduit dans la vallée du Jabron par un col imaginaire. Pour qui connaît les localités, cette direction est tout bonnement impossible. La montagne de Lure ne présente, en
(1) Extraits du livre vert de l'évêché de Sisteron, par Gastinel, page 421 , dans la bibl . de M. E. de la Plane, page 450.
(2) PLINE, Hist. nat , III, 4 .
(3) D'ANVILLE , Notice de la Gaule , page 44. C'est par erreur que D'Anville appelle la montagne de Lure les monts de Lurs.
effet, qu'une longue croupe qu'aucune vallée, qu'aucun col n'interrompt, et de plus son versant nord, de Sisteron aux Omergues, est un immense escarpement de plus de mille mètres de hauteur, tout à fait inaccessible, tellement inaccessible que pour venir des Omergues dans le reste du département des Basses-Alpes, il faut forcément passer par le département de la Drôme, bien que cette commune ne soit pas, à la rigueur, une enclave. Il n'a donc jamais pu venir à l'idée de quiconque voit les lieux de faire passer une route à travers la montagne de Lure, si l'on ajoute encore à ces difficultés les neiges qui couvrent son sommet et le versant nord la moitié de l'année. Une fois engagé dans cette direction, D'Anville n'a plus su où placer l'autre station. « Je n'ai point de connaissance positive et bien distincte du lieu de Catuiaca. Je présume seulement qu'il faut le chercher aux environs du Calaon, en tendant d'Apt vers Sisteron. Honoré Bouche s'écarte de cette direction en s'attachant à un lieu nommé Céreste, qui d'ailleurs ne s'éloigne d'Apt que de 10 milles au plus, selon une grande carte manuscrite de Provence, et non de 12 ou de 15 (1) . » Or, ici, comme dans beaucoup d'autres circonstances, c'est Bouche qui a raison, et le géographe parisien a été induit en erreur par sa grande carte manuscrite .
VI. Si on se place sur un des contreforts du versant septentrional du Luberon, près du village de Villemus par exemple, on a sous les yeux une vallée largement ouverte, à peine ondulée par les berges de quelques cours d'eau qui la coupent, et qui se termine au levant par le coteau de Lurs, au pied duquel est l'ancien Alaunium, et au couchant par le rocher de Saignon, qui domine la ville d'Apt. Il est de toute évidence qu'on n'a pu chercher une autre direction pour relier ces deux points. Si donc
(1) D'ANVILLE, Notice de la Gaule, page 44. C'est par erreur que D'Anville appelle la montagne de Lure les monts de Lurs, page 215.
Alaunium était à N.-D.- des-Anges, et je crois l'avoir prouvé, c'est dans cette vallée qu'il faut chercher Catuiaca. Les itinéraires, les vases des Aquæ Apollinares, la Table de Peutinger, sont d'accord pour compter 12 milles entre Catuiaca et Apta-Julia . Or, 18 kilomètres séparent Apt du village de Céreste (15,400 mètres dans le département de Vaucluse et 3,000 dans les Basses-Alpes), et c'est en effet à Céreste qu'était Catuiaca (1). Les preuves pour établir cette identification ne manquent pas plus qu'à Alaunium. Je ne parlerai pas de restes de batisses romaines, de débris de poterie, de fragments d'inscriptions qu'on rencontre sur divers points du territoire de Céreste. Ce sont choses trop communes en Provence pour qu'on puisse, sur cette seule base, hasarder de fixer l'emplacement d'une ville, si d'ailleurs les anciens documents géographiques et des noms topiques bien constatés ne viennent corroborer les conjectures. En sortant de Céreste, du côté du levant, la route impériale passe sur un égoût voûté qui recueille toutes les eaux du village et les conduit à travers une faille de rocher dans le ruisseau de l'Encrême. Cet égoût et le fossé qui le continue portent le nom de Catuce. J'avoue que la voûte, au moins dans sa partie apparente, n'offre aucun indice de construction romaine, et je me suis demandé si ce nom, qui arrive d'une manière si opportune, ne serait pas dû à la fantaisie de quelque antiquaire de la localité. Des recherches faites dans les archives municipales m'ont prouvé que jadis le nom de Catuce ne s'appliquait pas seulement à l'égoût, mais à toute une partie du village, à celle, évidemment la plus ancienne, qui s'échelonne sur le versant Est du mamelon que surmontait le château féodal ; le reste du village s'appelait le bourg. Ainsi ce n'est pas un point isolé, mais bien la majeure
(1) La carte de Peutinger et les vases des Aquæ Apollinares portent Catuia cia, l'itinéraire d'Antonin Catuiaca. Ce dernier, qui a prévalu, paraît plus conforme au nom moderne Catuce.
partie de l'agglomération qui était connue sous le nom de Catuce (1), réminiscence évidente du nom de la station romaine. A quelques cent mètres de là , la route traversait, il y a peu d'années, le ruisseau d'Aiguebelle, à côté d'un pont à deux arches en plein cintre, en pierre de taille de grand appareil jointes par un ciment tellement dur, que la mine seule a pu en avoir raison, et dont l'origine romaine ne saurait être douteuse. Ce pont a été détruit et ses matériaux livrés à l'entrepreneur d'une rectification opérée sur cette route il y a moins de vingt ans. La première assise de la culée gauche a seule été conservée, et on a assis sur elle le pont moderne ; ce qui prouve, pour l'observer en passant, qu'on aurait fort bien pu conserver le pont romain ; mais , hélas, les ingénieurs ne sont pas tenus d'être des archéologues ! L'établissement d'un pont sur ce ruisseau d'Aiguebelle, à sec les trois quarts de l'année et qui a été franchi pendant très longtemps par la route impériale en passant sur le gravier, suppost une voie importante. Or, si l'on place Catuiaca à Oppedette, comme le veut Walckenaer, ce pont n'a pas de raison d'être, car ce n'est pas Aiguebelle, mais le Calavon qu'il faut traverser, et le traverser non pas à Céreste, mais au- dessus de Viens, si même on ne cherche pas à éviter ses berges abruptes en le contournant à sa source comme le fait la route départementale de Sisteron à Apt. La présence d'un pont romain sur Aiguebelle suffit donc pour renverser les opinions de D'Anville et de Walckenaer, et pour placer la voie romaine dans la vallée de l'Encrême. Les mêmes motifs doivent faire rejeter l'hypothèse de Papon (2), adoptée par Henry (3) et par le docteur Long (4),
(1 ) On trouve quelquefois l'orthographe Catusse.
(2) PAPON, Hist. de Provence, tome I, page 66.
(3) HENRY, Op . cit . , page 136. (4) LONG, Op . cit. , page 450.
qui placent Catuiaca à Carluec. Pour aller, en effet, d'Apt à Carluec, il n'était pas nécessaire, après avoir traversé le Calavon, de gravir les rampes escarpées de Céreste, et de franchir l'Aiguebelle et l'Encrême ; il eût suffi de suivre la rive droite de ce dernier cours d'eau . L'existence d'un centre de population préexistant à Céreste a pu seul faire adopter le tracé par la rive gauche, malgré les difficultés qu'on rencontrait. Et même en supposant qu'on s'y füt décidé, ce n'est pas sur Aiguebelle mais sur l'Encrême qu'un pont était nécessaire, car aujourd'hui encore, le chemin de Céreste à Carluec ne traverse pas l'emplacement du pont romain et ne passe pas devant le point où Henry a vu une pierre miliaire encore en place ( 1) . La position de Catuiaca est donc aussi claîrement déterminée que celle d'Alaunium ; bien plus la voie qui reliait les deux stations subsiste encore dans toute sa longueur. Mais avant d'en suivre le tracé, je crois devoir examiner de plus près les opinions émises sur cette position .
VII. Walckenaer, avec la pointe de son compas, avait fixé Alaunium à Montlaux ; il plaça, parle même procédé, Catuiaca à Oppedette (2) . D'Anville aurait souri, il faut en convenir, à cette identification à laquelle il était si naturellement amené que tous les auteurs venus après lui la lui ont attribuée, bien qu'il se fût abstenu de se prononcer. Mais, nous l'avons déjà remarqué, laposition du pont sur Aiguebelle repousse forcément toute position hors de la vallée de l'Encrême. D'ailleurs des restes incontestables de la chaussée romaine ont été exhumés dans ces derniers temps entre Céreste et Apt, c'est-à-dire en dehors de la voie directe entre cette ville et Oppedette (3), voie
(1) HENRY, Loc. cit.
(2) WALCKENAER, Géographie ancienne, historique et comparée des Gaules , I, page 159, et III, page 42.
(3) C. MOIRENC. Projet impérial d'une carte topographique de la Gaule, page 37.
qui oblige d'abandonner les bords du Calavon pour se jeter sur Gignac ou sur Viens. Si on voulait admettre en effet que la voie romaine suivait le cours du Calavon jusqu'à Oppedette, on arrive à un parcours qu'on ne peut plus faire cadrer avec les itinéraires, puisque, dans ce cas, il faut atteindre d'abord Céreste et remonter la rivière presque jusqu'à sa source, c'est- à-dire faire plus de trente kilomètres. Le seul argument spécieux qu'on peut faire valoir en faveur de cette direction, c'est que les Romains emplaçaient volontiers leurs chaussées sur les plateaux élevés, et que le flanc de Lure répond à cette condition. Mais il ne faut pas perdre de vue que cette voie d'Espagne en Italie, ce ne sont pas les Romains qui l'ont tracée ; quand ils occupèrent la Provence, elle était ouverte depuis longues années ; le témoignage de Polybe, qui la fait suivre par Annibal jusqu'au Rhône, est formel (1), et c'est peut- être ce chemin que cherchait Bellovèse pour entrer en Italie quand il vint avec ses bandes camper au bord de la Durance (2) ; on ne saurait donc appliquer rigoureusement à cette route les données que suivaient les Romains dans l'ouverture des voies nouvelles. D'ailleurs, de pareilles conjectures ne peuvent tenir devant l'évidence des preuves que fournissent et la concordance des noms topiques avec les itinéraires, et les restes que conserve encore le sol où furent les stations romaines. Papon qui, grâce aux notes de Chappus, avait fixé d'une manière exacte la position d'Alaunium, s'est laissé entraîner par une considération futile pour porter Catuiaca à Carluec. Il y a lå, dit- il , d'anciennes habitations. Je ne parle pas d'édifices romains, mais de ces autres indices qui, sans nous conduire jusqu'à l'âge romain, nous font remonter à des siècles assez reculés pour nous faire croire que, du temps des empereurs, ces lieux étaient habités. C'est précisément ce que l'on
(1) POLYBE, Hist. générale, liv . III , 39.
(2) AM. THIERRY, Hist . des Gaulois, tome I, page 37.
" trouve à Carluec (1) ." Ce qu'il y avait eu à Carluec, c'était un très ancien monastère, devenu plus tard un prieuré de Montmajour, que les invasions avaient détruit et qu'une bulle de Léon VIII ( de 963 à 965) appelle antiquum desertumque тоnasterium Horluc (2) ; ce que Papon avait pu voir, c'étaient les ruines de ce monastère primitif ou de celui qui lui avait succédé, ruines qui subsistent encore ; mais ce n'était pas, il l'avoue lui-même, des restes d'édifices romains ; et quand Henry ajoute aux ruines de Papon : un grand nombre de tombeaux taillés dans la pierre (3), je ne puis m'empêcher de penser à ceux qui entourent la chapelle de Ste Croix à Montmajour, bien que je n'ai aperçu aucun de ces tombeaux dans une visite à Carluec. Il est vrai qu'Henry a vu également, dans la plaine de Reillane, une ville qu'il appelle Aulania, ville qui je crois n'a jamais existé que dans son imagination féconde, et qu'il affirme gravement que Cesarista existait au même temps que Catuiaca perchait sur la hauteur de Carluec (4) ce qui ne fait pas moins de trois agglomérations dans un espace de quelques kilomètres carrés.
VIII M. C. Moirenc, dans le but évident de donner à la modeste peuplade de Vulgientes une importance qui la rendît digne d'avoir pour capitale la ville d'Apt, qu'il proclame du même coup une des principales villes de la Gaule celtique (5) , M. C. Moirenc leur attribue non- seulement Catuiaca mais encore Alaunium, mais encore le problématique Forum Neronis. Plus
(1) PAPON, Loc. cit.
(2) Polleare abbatiæs . Petri Montis Majoris, dans l'hist. de Mont-Majour, par Dom Chantelou ; ms. à la bibl. imp. St-Germain, latin, 1073. Je dois observer que Mabillon (Ann Bened. , III, 564) a supposé que cette confirmation s'appliquait au monastère d'Arluc, dans le diocèse de Grasse ; mais Arluc dépendait de Lérins et non de Mont-Majour, j'ai donc cru devoir adopter la version du pouillié de cette abbaye, d'autant plus que l'aspiration de Horluc donne très bien Corluc, comme Hlovis a donné Clovis .
(3) Loc. cit .
(4) HENRY, Loc. cit. (5) C. Moirenc, ap. at. p. 15.
modeste, le docteur Long se borne à réclamer Catuiaca pour les Vocontiens (1). Un texte formel de Strabon, tout en ne permettant pas à ceux-ci de s'étendre à l'ouest autant que le veut leur historien, réduit à leur juste valeur les prétentions du premier . Depuis Ugernum et Tarascon, en passant par la Durance et Cabellio, on mesure 63 milles jusqu'aux limites des Vocontiens, au point où l'on commence à monter les Alpes, et de là, jusqu'à l'autre limite de ce peuple, c'est- à- dire à l'état de Cottius et au bourg d'Embrun, on compte 99 milles (2) . » Ou soit un total de 162 milles, total qui, à un mille près, répond à celui de l'itinéraire d'Antonin. Si maintenant nous cherchons la distance de Catuiaca aux deux points extrêmes, nous trouvons 102 milles à partir d'Embrun, et 59 milles en partant de Tarascon, d'où la conséquence que la limite des Vocontiens coupait la voie romaine entre Alaunium et Catuiaca, à trois ou quatre kilomètres à l'est de cette dernière station, qui par conséquent dépendait des Vulgientes, tandis que le pays au-delà faisait partie du Vocontium. Céreste appartenait au diocèse d'Apt, et Reillane à celui d'Aix. S'il est vrai que, sauf quelques exceptions très rares, les diocèses doivent être considérés comme représentant les anciennes cités de la Gaule (3), on pourrait fixer d'une manière certaine, sur ce point, la ligne qui séparait les Vulgientes des Vocontii ; mais que de changements dans les Gaules entre l'époque où écrivait Strabon et le jour où les divisions ecclésiastiques vinrent s'enter sur les divisions civiles .
IX. Dans cette vallée, que je décrivais plus haut, existe un chemin, évidemment étudié dans sa direction générale, qui la parcourt dans toute sa longueur et qui offre la particularité
(1) LONG, Op . cit , pag . 287 el 450 .
(2) STRABONIS , Geographicorum, lib. IV .
(3) GUÉRARD, Essai sur le système des divisions territoriales de la Gaule.
remarquable de ne toucher à aucun des villages dont il traverse le territoire alors que, dans certains cas, une légère déviation eût rendu la chose facile, de ne mettre aujourd'hui en communication aucun centre de population et de servir à peine à l'exploitation des terres, preuve certaine que l'ouverture de ce chemin est antérieure aux agglomérations actuelles. Sa largeur est en moyenne de deux mètres, mais son inutilité même a rendu les usurpations faciles, bien que personne n'osât se hasarder à le supprimer, car les populations voisines l'entourent d'une espèce de respect ; et si, sur quelque point, un propriétaire jaloux de réunir deux coins de terre que le chemin séparait l'a mis en culture, ce n'a été qu'après l'avoir religieusement rétabli sur la lisière de son champ. C'est l'ancienne voie romaine. En sortant de Céreste, ce chemin traverse Aiguebelle sur le pont dont j'ai parlé, se sépare de la route impériale en face de Montjustin, remonte le torrent de Garebrun (1) jusqu'au dessus de la campagne de ce nom, passe au-dessous du château de Pinet, vient toucher l'ancien couvent des Observantins, traverse la route impériale un peu au-delà de sa jonction avec la route de Manosque, la rejoint encore à Notre-Dame-du-Pont, tantôt reste confondu avec elle et tantôt la suit parallèlement jusqu'au dessous du village de St-Michel, l'abandonne là définitivement et sous le nom de chemin Seinet, traverse la plaine de Mane aux Encontres, vient passer au nord de l'ancien village de Niozelles (l'église vieille, dans Cassini), franchit l'Auson en face de N.- D. - des-Anges, contourne à mi-côte le Puy- d'Aulun et vient se raccorder à la route impériale n° 96 à un kilomètre en avant de l'embranchement avec la route nº 100. Au-delà, les données positives font défaut ; mais quand on étudie la localité, quand on voit les coteaux presque inaccessibles de Lurs et de Ganagobie baignant leur pied dans la Durance et ne laissant qu'une étroite
(1) Cassini écrit Bellebrun. J'ai donné le nom véritable.
langue de terre où est assise la route actuelle, on est vite convaincu que la voie romaine n'a pas pu passer ailleurs, au moins jusqu'à Peyruis. Au dessus de ce village, elle devait suivre le tracé de l'ancien chemin royal passant par Châteauneuf et Peipin, chemin qui n'est abandonné que depuis moins de quarante ans ; et si le nom seul a décidé D'Anville à placer Alaunium à l'Hospitalet, ne nous sera- t-il pas permis de voir dans cet Hospitale pauperum quod est in Cabannis subtus Castrum поvum qu'on trouve dans une charte de 1272 (1), un souvenir de ces refuges préparés pour les voyageurs, surtout quand nous voyons que ce lieu des Cabannes joignait le chemin royal. Je me suis demandé toutefois si la voie romaine à partir d'Alaunium n'aurait pas remonté le cours de l'Auson jusqu'aux environs de Cruis, et ne se serait pas dirigée de là vers Sisteron, en passant par Malefougasse et Châteauneuf. Cette hypothèse avait l'avantage de nous rapprocher de Montlaux, où Walckenaer plaçait la station. Ce qui m'a fait préférer le tracé par Peyruis, c'est qu'il concorde mieux avec les distances fournies par les anciens documents géographiques, le circuit par la vallée de l'Auson allongeant le parcours de près de dix kilomètres, et que l'adoption de ce dernier rend tout à fait inexplicable l'existence du chemin Seinet au- delà de N.-D. - des-Anges . Les traces du séjour des Romains sont nombreuses le long de la voie qui réunit N. -D. - des-Anges à Céreste. Une ferme de la commune de Lurs porte le nom Tabourne, une autre, dans la commune de St- Michel, s'appelle Tavernoules ; toutes les deux, la dernière surtout, sont voisines de ce chemin et me paraissent rappeler ces tabernæ deversoriæ qu'on construisait au bord des routes pour la commodité des voyageurs. Une tradition
(1) LAPLANE, Hist . de Sisteron, tome I, page 463. Le prieuré d'Ardennes, dans la commune de St- Michel, doit son origine à un hôpital situé sur la même route.
constante veut qu'une bataille ait été livrée dans la plaine de Mane, au point dit les Encontres, tradition que justifie la découverte faite dans cette plaine, au domaine de St-Clair, de plus de quinze cents squelettes inhumés dans un espace fort restreint, découverte dont on peut voir les détails dans Henry (1). Je me souviens d'avoir vu, étant enfant, un casque qui avait été trouvé au même endroit et, quand je rappelle mes souveuirs, je crois pouvoir affirmer l'origine romaine de ce casque qui s'est perdu en servant à des mascarades de carnaval. Il y a quelque trente ans, on trouva, non loin de là, au-dessous de Dauphin, des substructions très importantes ayant évidemment appartenu à une villa. C'étaient des restes de murs, des aqueducs, des tronçons de colonnes, et une mosaïque grossière de cinq mètres de côté, qui sert aujourd'hui de pavé à la cuisine d'une grange qu'on a construit au-dessus il y a peu d'années. Il y a deux ans, le même propriétaire découvrit un grand dolium qui sert de réservoir pour arroser un petit jardin. A peu près à la même époque, on a sorti de terre, à Villemus, un cercueil de plomb contenant, outre le squelette, un fer de dard, une lampe sépulcrale qui fut brisée, et cinq ou six petits bronzes, dont un de Constance Chlore qui m'a été montré. A côté du tombeau, on rencontra une petite statère en bronze, admirablement conservée, sauf le peson qui manque, et un petit vase en poterie fine d'un galbe fort élégant. Papon cite une inscription provenant du territoire de Reillane (2), et c'est par là aussi que fut trouvée la belle inscription de Pompeia Rufina qui gît délaissée dans la cour de l'ancien couvent des Observantins (3) . Au-delà d'Apta-Julia, diverses portions non contestées de cette
(1) HENRY, Op. cit . , page 131 .
(2) PAPON, Op . cit. , tome I, page 218.
(3) Raymond Soliers, qui le premier a parlé de cette inscription, assure qu'elle a été trouvée à Céreste .
voie portent le nom de chemin Romieu ; le même nom est donné aujourd'hui encore à la partie qui traverse le territoire de Reillane. Je trouve dans le Cartulaire du prieuré de St- Mitre de Reillane (1) : Habet quandam terram scitam ad paradisium, subtus furcas Judeorum ; confrontatur cum magno itinere Romiev ; et dans un autre acte : Alia terra scita infra pratum Paradisii , confrontatur cum itinere publico Romieu. Le quartier de Paradis, le coteau des Fourches ont conservé leurs noms ; ils sont séparés l'un de l'autre par un chemin qu'on appelle toujours le chemin Roumieou. Or, si l'on admet que ce nom signifie, aux Baumettes (2) ou à la Tour- de-Sabran, chemin qui va à Rome, peut- on le contester à Reillane, alors surtout que celui-ci n'est que la continuation du premier?
X. Ce chemin, ai-je dit, porte, à partir du point où il abandonne la route impériale à St-Michel, le nom de chemin Seinet, ou, comme on écrivait au dernier siècle, de chemin Ségnès. Diverses étymologies ont été proposées : les uns, se souvenant des squelettes trouvés au domaine St-Clair et du choc des Encontres, le tirent de via Sanguinea ; d'autres ayant découvert, je ne sais où, un chemin Destéri, ont vu dans celui- ci la via Sinistris, et ont fait là-dessus manœuvrer l'aile droite et l'aile gauche des Romains avec un talent de stratégiste digne d'une meilleure cause. Je crois que l'origine de ce nom est fort simple et que
(1) Archives des Bouches-du- Rhône, fonds de Saint-Victor.
(2) Dans une charte de la fin du xr siècle, ce chemin est indiqué à ce point sous le nom de Iter Romuleum (Cart. St- Vict. , no 812) . Pour être certain qu'i s'agit bien de ce chemin et des Baumettes, il suffit de comparer cette charte avec celle qui porte le no 427, où le mot iter a été oublié, mais où il est dit formellement que l'alleu donné est in comitatu Cabilonensi in territoriis castri qui dicitur Agoldi. C'est aujourd'hui un chemin vicinal d'intérêt commun, classé sous le no 6 et le nom de chemin Romicu, qu'on lui a officiellement conservé. C'est un exemple très rare du respect pour les traditions qu'on ne saurait trop approuver.
chemin Seinet veut tout, bonnement dire le chemin vieux, via senex ou mieux via senica. J'indique cette dernière forme pour aller au- devant d'une objection que je prévois : senex ne se dit que des personnes. Cela peut être vrai dans la bonne latinité, bien qu'on pùt trouver des exceptions (1), mais il n'en est pas de même dans ce latin du moyen-âge où toutes les distinctions du goût sont oubliées ou perverties ; ainsi, on trouve à la suite des formules de Marculfe des formules intitulées cartæ senicӕ; senicæ, dit Bignon, quasi senes, et Baluse cite un manuscrit de notes tyronniennes qui les appelle notæ senicæ (2) ; pourquoi done n'aurait- on pas pu dire d'un vieux chemin ce qu'on disait de vieux diplômes ou d'un ancien système de sténographie ? Quoiqu'il en soit, quand Alaunium florissait, Forcalquier n'existait pas ou n'était que la réunion de quelques huttes de chaufourniers, Furnus calquerius, comme disent les titres du moyen-âge. Mais, après la destruction de la ville romaine, l'humble bourgade acquit peu à peu de l'importance. La voie, qui n'avait plus de motifs pour atteindre directement les ruines d'Alaunium, prit à gauche et vint toucher à Forcalquier, en suivant le tracé de la route actuelle jusqu'après les rampes de La Fare, puis se déviant au sud sur le plateau qui sépare Pierrerue de Niozelles, elle vint rejoindre la voie primitive au point où celle-ci commence à descendre vers les rives de l'Auson La portion abandonnée devint alors le chemin vieux, via senica . Une charte du Cartulaire de St-Victor porte : in via qua egreditur ab ecclesia sancti Probacii usque ad viam publicam de
(1) Ainsi on lit dans Martial : Multa fragrat testa senibus autumnis. Lib . III, ep . 58 .
(2) BALUZE , Capitularia regum Francorum, Paris, 1677, tome II, col. 509, 863 et 1297.
Roma, et on lit : via Romanu dans la charte suivante (1). Les terres dont il s'agit joignaient le prieuré de St-Promasse, et St-Promasse existe encore aux portes de Forcalquier. Un autre diplôme du même recueil fournit un renseignement précieux pour l'embranchement que j'ai indiqué. Dans ce titre, il est question d'un champ qui jacet juxta vicum vetus, et de alio latus via publica que vadit ad Forcalcarium (2). Ce vicum vetus est encore désigné dans les anciens cadastres de Niozelles sous le nom de Ville vieille ; le quartier qui le porte est borné au nord par le chemin Seinet, et là, au flanc d'un tertre appelé aujourd'hui les Potences, on retrouve l'ancien chemin qui venait de Forcalquier et qui a tout à fait la même physionomie que le chemin Seinet auquel il vient sejoindre. Au xí siècle, à l'époque où la charte a été rédigée, le village de Niozelles était sur l'autre rive du Béveron ; le vicum vetus, peut- être l'Alaunium gaulois , était abandonné, désert, et le chemin dont il est question n'aurait pas de raison d'être s'il n'était la continuation de celui qui passait à la station romaine .
XI. Vouloir que la voie ait toujours suivi cette direction et soit arrivée de tout temps à Alaunium par Forcalquier, c'est augmenter la seule difficulté que rencontrent nos identifications, savoir que de Céreste à N. - D.-des-Anges il ne peut y avoir moins de 30 kilomètres (26 à vol d'oiseau), et que les itinéraires, la table Théodosienne et les vases des Aquæ Apollinares s'accordent pour ne donner que xvi milles entre les deux stations. Rechercher Catuiaca plus près de N.-D.-des-Anges, c'est seulement déplacer la difficulté, puisqu'alors la distance d'Apta-Julia ne concorderait plus avec les documents géographiques, et on n'aurait plus ce nom de Catuce qui me paraît déterminant. On retrouve d'ailleurs la même difficulté, et plus grande encore,
(1) Cart.de St- Victor, nos 663 et 664.
(2) Cart. de St- Victor, no 677.
dans le tracé par la montagne, surtout si l'on veut atteindre l'Hospitalet, puisqu'il faudra loger dans les 52 milles des itinéraires, les 95 kilomètres qui, dans ce cas, séparent Apt de Sisteron. Une correction se présente naturellement à l'esprit et, avec elle, toute difficulté disparaît ; c'est de lire XXI milles au lieu de XVI entre Alaunium et Catuiaca, car alors ce chiffre correspond à la distance entre N. - D. - des-Anges et Céreste, comme correspondent les distances entre Catuiaca et Apta- Julia, et entre Alaunium et Segustero. La concordance des documents géographiques est, je l'avoue, une objection puissante à cette correction, mais il ne faut pas perdre de vue que ces documents ont dû se copier l'un l'autre, et que l'erreur, une fois glissée dans le plus ancien, a dù nécessairement passer dans les autres et arriver jusqu'à nous. Si une sage critique réprouve une modification des textes pour étayer une vaine hypothèse, elle admet volontiers celle que des monuments authentiques rendent indispensable.
XII. J'ai promis, en commençant, d'éclaircir les doutes qui existaient sur la direction de la voie romaine entre Sisteron et Apt ; je crois avoir déterminé d'une manière certaine les points qu'occupaient Alaunium et Catuiaca, et d'avoir donné le tracé précis de la voie entre ces deux stations. Il me semble que peu de localités disparues offrent un ensemble de documents aussi concordants. Au lecteur à juger si je ne me fais pas illusion.
Manosque, 10 janvier 1868.
![]()