Etudes sur la Révolution dans les Basses Alpes
La Formation de la Société Populaire de Sisteron
par
C. CAUVIN
Annales des Basses-Alpes :
bulletin de la Société
scientifique et littéraire des
Basses-Alpes 1901-1902
De nombreuses études publiées dans les différentes
revues historiques, notamment dans la Revue de la Révolution
française, se sont appliquées à déterminer le rôle
des sociétés populaires et ont fait justice des idées fausses,
répandues à plaisir, sans preuves à l'appui, sur les
membres des sociétés ou clubistes.
Trop souvent, ils ont été représentés comme des énergumènes,
poussant aux mesures violentes, prêts à verser le
sang pour le moindre motif, alors que, le plus souvent, ils
ont été les premiers à recommander le calme, le respect à
la loi, l'obéissance aux autorités, l'union, la concorde. Il
suffit, pour s'en rendre compte, de parcourir les registres
des sociétés classés dans nos archives départementales.
Si, après la période des sections, alors que les
patriotes ont été poursuivis, pourchassés, alors que les
Anglais se sont établis à Toulon, les clubistes deviennent
violents, exaspérés, faut-il leur attribuer le caractère
sanguinaire que prend la lutte ? Ne faut-il pas plutôt en
faire remonter la cause aux manoeuvres de leurs adversaires, qui ont oublié trop souvent qu'ils devaient être
Français avant tout, qui ont eu, les premiers, recours à la
violence ?
C'est ce qui ressortira, je crois, de ce travail sur la
formation de la société populaire de Sisteron.
Rappelons brièvement que les mots club ou société
populaire ont été employés comme synonymes. Le terme
de club avait été introduit par un courant d'anglomanie
et s'était appliqué aux cercles, aux salons, plusieurs
années avant la Révolution. La réunion formée par les
députés bretons fut la première société politique qui se
constitua au moment où se réunissait l'Assemblée nationale
; ce fut plus tard le club des Jacobins. D'autres
sociétés analogues ne tardèrent pas à se fonder, et, en avril
1791, au moment où, pour la première fois, il est question
d'établir un club à Sisteron, de nombreuses sociétés existent
déjà à Paris et dans les départements.
Dans les Basses-Alpes, les amis de la Constitution ou
les antipolitiques, c'est le nom qu'ont adopté en général
les membres des sociétés à cette époque, sont peu nombreux,
et aucun club n'est affilié aux antipolitiques d'Aix,
pourtant si influents alors. Quelques rares sociétés sont
éparses dans le département. Celle de Mane est formée dès
le mois d'août 1790. Plus tard, sont constituées celles de
Quinson, Riez, Sainte-Tulle, Digne (1).
(1) Seule, celle de Sainte-Tulle sera presque affiliée aux Jacobins, le 22 juin 1791.
II est, d'ailleurs, très difficile de connaîtrepar le détail la
vie de ces sociétés, qui, d'après le témoignage de Barras et
de Fréron, couvraient, en 1793, le département des Basses-Alpes. Soixante-dix clubs.existaient alors, tous correspondant
entre eux. C'est là une lacune regrettable, car leurs
registres nous permettraient de connaître de très près les
idées politiques et les moeurs du peuple à cette époque.
Mais ils devaient rappeler sans doute trop de souvenirs
redoutables, pour que, témoins souvent gênants d'un
passé trop révolutionnaire, ils n'aient pas disparu sous
l'empire et les régimes qui lui ont succédé,
Dans les archives départementales, cinq ou six registres
représentent seuls le fonds des sociétés populaires. Que
sont devenus ceux du club de Sisteron ? Aucun d'eux ne
nous est parvenu ; tout au plus pouvons-nous reconstituer
leur destinée, grâce aux déclarations consignées par le
comité de surveillance de cette ville. C'est ainsi que la
veille du jour où les sections furent créées, les chefs du
mouvement fédéraliste « descendirent aux archives et
prirent les papiers qu'ils voulurent ». Pendant le règne
des sections, les papiers du club furent en grande partie
brûlés. Plusieurs survécurent « au brûlement », et
en l'an III « l'orateur ordinaire de la société montagnarde
de Sisteron avait encore plusieurs registres chez lui ».
Pour suppléer à cette absence de sources directes, il faut
se livrer à des recherches longues et minutieuses dans les séries L 1, L 2, L 4 des archives. Les fonds communaux
sont certainement plus riches en renseignements ; mais,
parmi ceux que nous avons pu consulter, que de lacunes !
Heureusement, en ce qui concerne la société de Sisteron,
les archives communales renferment le procès-verbal de la
première tentative, en avril1791. Mais, s'il est très long, il
est en revanche fort vague et n'est qu'un plaidoyer, peu
habile d'ailleurs, en faveur de la conduite de la municipalité.
Les renseignements qu'il fournit pourront être, il
est vrai, complétés et éclaircis par un mémoire attribué à
Noël-Paul Hodoul, qui fut mêlé à tous les événements de
la Révolution à Sisteron et fut un des chefs du mouvement
fédéraliste. Il nous en a laissé un récit fort vivant, mais
suspect et malheureusement incomplet.
Grâce à cet ensemble de documents, il nous sera possible
de reconstituer en partie les conditions dans lesquelles fut
tenté l'établissement du club. Nous pourrons ainsi
connaître les résistances acharnées que rencontra cet
établissement et les influences qui présidèrent à sa
naissance.
Il fallut en effet, pour venir à bout de ces résistances,
une intervention énergique des commissaires de la société
patriotique de Marseille. C'est seulement au moment où
les Marseillais se seront mis résolument à la tête du
mouvement démocratique que la formation du club sera
possible à Sisteron. Depuis la Révolution surtout, la ville de Marseille n'a
pas tardé à prendre une influence considérable dans nos
Alpes. C'est la ville lumière vers laquelle se tournent
tous les regards. « Les Basses-Alpes sont dominées par
Marseille », écrivent, en 1793, les représentants en mission
au Comité de salut public. « Imitons les braves
Marseillais, dit le 29 janvier 1793, la municipalitéde Digne,
dans une adresse aux citoyens ; correspondons intimement
avec eux;.c'est le foyer dont les émanations doivent
échauffer les coeurs patriotes. » C'est à « Messieurs du
club, de Marseille » que le procureur général syndic
demande l'approbation de ses actes. De son côté,
Noël-Paul Hodoul, dans son mémoire, remarque avec
quelque tristesse que « Marseille a toujours été, en bien,
comme en mal, le boute-en-train de la Provence ».
Discrète d'abord en 1791, cette influence de Marseille
s'exercera plus ouvertement, avec brutalité même, en
1792 et 1793.
Mais si les Marseillais eurent à intervenir, c'est que
l'opposition contre le club prit un caractère de violence
qu'on ne retrouve pas dans un autre coin de nos Alpes. Si
le procureur général syndic et les administrateurs du
directoire, tout en déplorant la publicité donnée aux
dénonciations par les sociétés, leur sont cependant favorables,
parce que la loi est pour elles, les municipalités
leur sont nettement hostiles. C'est qu'il ne s'est pas produit
dans les Basses-Alpes ce mouvement communal à peu près général dans le reste de la France, qui a pour résultat de
porter insensiblement au pouvoir le parti démocratique (1).
(1) Ou du moins dans les petites localités seulement les paysans sont à la tête de la municipalité
C'est la bourgoisie qui occupe toutes les fonctions; c'est elle qui a profité du nouveau régime. Faut-il s'étonner si, dans un pays où le peuple est peu instruit, les hommes de loi, fortement armés dès le début de la Révolution, habitués aux affaires, possesseurs des meilleurs biens, sont hostiles à la formation d'un quatrième État. Grâce à la Révolution, ils espèrent se substituer aux nobles, au clergé, « dont la hauteur insultante les irritait (1) ».
(1) Mémoire Hodoul.
Mais il faut, pour cela, qu'elle ne les entraîne pas trop loin. « L'amélioration des finances, la réforme des grands abus, voilà quels étaient nos voeux et nos projets », dit Hodoul. Aussi voient-ils avec méfiance ces créations de sociétés, dont l'influence anéantirait peut-être celle de la municipalité et qui ne craindraient pas de surveiller étroitement les autorités. Voilà pourquoi, à Riez, si quelques habitants veulent établir un club, la municipalité attend un ordre formel du département pour autoriser cette création (21 mars 1791). A Entrevaux, le département doit, " tout en applaudissant au zèle de la municipalité", lui rappeler « que les citoyens ont le droit de s'assembler paisiblement (1) ».
(1) Archives départementales, L I, 142.
A Sisteron, les promoteurs de l'entreprise vont se
heurter à une opposition encore moins déguisée et plus
violente.
Il n'est pourtant pas de localité dans les Basses-Alpes,
où la Révolution ait été accueillie avec plus de joie par la
classe bourgeoise. Tous ont largement profité du nouveau régime ; leur patriotisme local exulte des avantages que
Sisteron a obtenus. Tandis que tant d'autres centres bas-alpins
chefs-lieu de viguerie, Seyne, Moustiers, Colmars,
Annot..., se sont vus dépouiller de leurs prérogatives,
la ville de Sisteron a joué un rôle important, si bien que
l'ambition de ses bourgeois est allée croissant. La municipalité
n'a-t-elle pas rêvé un moment de faire de Sisteron
le chef-lieu des deux départements des Hautes et des
Basses-Alpes.
Lors des élections aux Etats généraux, sur huit députés
envoyés par la sénéchaussée de Forcalquier, Sisteron en
avait eu quatre. « Aussi crut-on avoir remporté une grande
victoire; tous les électeurs du ressort de Sisteron se
parèrent d'une branche de laurier. »
Cependant l'Assemblée nationale s'est réunie; l'ancien
régime s'écroule ; la bourgeoisie y perd bien quelques
privilèges, mais que de compensations ! Que de places
nouvelles, pour les hommes de loi, avocats, procureurs,
notaires. Vienne la vente des biens nationaux, tous se
disposent à acheter. C'est la possession de la terre qui,
surtout en Provence, donne la considération et achemine
vers le pouvoir.
Mais ici la classe bourgeoise se heurte, aux paysans.
Si les questions politiques intéressent peu ces derniers,
s'ils ont vu s'établir sans protester le régime censitaire
qui éloigne beaucoup d'entre eux de la vie politique,
ils s'émeuvent dès qu'il s'agit de cette terre qu'ils
ont si longtemps cultivée pour les autres, qui forme pour
le moment tout leur horizon, où toutes leurs pensées se
matérialisent et sur laquelle ils peinent depuis tant de
générations. Les petites rivalités cessent; tous s'unissent, se coalisent ; si des étrangers veulent concourir à l'adjudication
des biens nationaux, ils deviennent furieux, recourent
à la violence. Cette terre doit leur revenir: ils
l'achèteront, sortiront pour cela leurs minces économies.
C'est à eux qu'il appartient de la féconder de leurs sueurs.
Mais avec quelle docilité ils se laissent mener, lorsqu'il
s'agit de toute autre question ! Comme ils ignorent
leurs intérêts les plus immédiats ! Comme les bourgeois
les dirigent à leur gré, les ont dans la main ! L'un d'eux
se vantait de les conduire par le bout du nez. Nous
allons voir qu'il n'exagérait pas. Mais ce qui est vrai
en 1791, le sera-t-il en 1793? Plus d'un fera la triste expérience
du contraire.
D'ailleurs, il est facile d'alarmer ces malheureux, qui ne
lisent rien, ne connaissent ce qui se passe en France que
par ceux qui ont intérêt à transformer les événements.
Or, la situation paraît mauvaise. Le blé est rare et cher;
les récoltes sont insuffisantes. Les prêtres du district,
sauf le curé, de Bevons, ont prêté serment à la Constitution
civile du clergé, mais les écrits de l'évêque
de Sisteron commencent à se répandre. En mars 1791,
des libellés circulent qui attaquent la constitution.
La confusion est grande. Les populations sont hantées
par la crainte d'une invasion, troublées par les menaces
des émigrés ; partout des troubles éclatent à l'occasion
de la levée de la milice, de l'élection des juges de paix, de
l'établissement des impôts.
Comme il sera facile de soulever ces paysans contre
ceux qui viendront leur parler d'innovations ! Comme on saura mettre en jeu tout ce qui peut les exciter, les lancer
contre « ces enragés » qui veulent créer un club !
Mais à Sisteron, comme ailleurs, c'est dans le sein de
cette bourgeoisie si frondeuse d'abord, si conservatrice
ensuite, que prendra naissance le parti démocratique. Des
froissements se produiront ; deux partis se formeront.
C'est l'un d'eux qui. donnera le signal de la marche en
avant. Dès le début de la Révolution, cette rupture peut se
prévoir ; l'union n'a pas été longue.
Depuis que les Etats de Provence ont été rétablis, le
pays semble renaître à la vie politique. Un cercle est même
fondé à Sisteron, en 1788. « Les individus du premier Etat
se, réunissent chez Jean-Pierre Imbert (1)» On y lit les
journaux, on y discute les affaires relative sà la Provence,
on y délibère même des discours qui seront prononcés
dans les assemblées générales de la communauté. Mais,
bientôt, une scission se produit. Le cercle établi chez
Imbert se transporte chez d'Eyraud, avocat du roi, et
dévient le cercle aristocratique qui s'intitule modestement :
« le Cercle des honnêtes gens (2). » Joseph-Marie Vincent (3) et Jean-Pierre Imbert en ont été rejetés. Ils forment un
nouveau club chez Vincent.
« Les deux partis se prononçaient alors parfaitement
(4). »
(1) Mémoire Hodoul.
(2) Mémoire Hodoul. — Archives départementales, L 2, 3, 8.
(3) Assassiné le 8 prairial an III.
(4) Mémoire Hodoul.
Ils furent aux prises au sujet de l'élection
de la municipalité, des juges du tribunal, du juge de paix.
Vincent réussit à être nommé procureur de la commune ;
mais, en définitive,.le parti des « modérés » l'emporta. La
lutte s'exaspère, lors de la constitution civile du clergé ; l'évêque Bovet est resté à Sisteron. On réclame une
instruction contre lui. La procédure prise par Hodoul ne
produit rien. C'est ce qui détermine, dit Hodoul, « les
meneurs, les enragés, à établir un club. Le cercle Vincent
devait en être le noyau ».
Le 16 avril 1791, au moment où « tous les corps adminisnistratifs que la ville de Sisteron a dans son sein » étaient
réunis dans la salle de l'hôtel de ville, prêts à partir pour
l'église paroissiale, afin d'assister à une messe de requiem
qui devait être chantée pour le repos de l'âme de Mirabeau,
Bonnard fils, soldat de la garde nationale, se leva et,
« après avoir jette quelques fleurs sur la tombe du
Démosthène françois », fit l'éloge des sociétés des amis de
la constitution et proposa « un plan d'association patriotique
auquel nombre de citoyens se sont empressés de
souscrire». Une liste est présentée au corps municipal ;
elle contient les signatures des membres du directoire du
district (1) « et de plusieurs citoyens recommandables par
leur patriotisme ».
(1) Ces membres sont Vincent, Borely, Hodoul et Roche, Réguis, proc. syndic. — L 2, 5, 7.
Chaque membre du corps municipal
crut devoir concourir à cet établissement, qui paraissait
n'annoncer qu'un plus grand bonheur pour les habitants
de cette ville.
Cependant le maire, Jean-Baptiste Plauche, avocat,
« jeune homme probe et honnête, n'ayant jamais connu
que la partie du bon ordre et de la justice », crut devoir
s'abstenir. A quels mobiles a-t-il obéi? Dans le procès-verbal
écrit le lendemain de l'échec de cette tentative, il déclare
que, « s'il eût voulu faire des prosedtiiles, sans doute, sa
signature sur la première liste eût produit cet effet, et que, voyant le peu d'empressement de ses concitoyens à se
ranger de cette société et prévoyant qu'elle pourrait être
désapprouvée, il doit s'applaudir d'avoir gardé la neutralité
». Faut-il croire ce qu'il avance ainsi? Il est plus que
probable que ses sympathies allaient aux « modérés »,
dont il connaissait les projets. Il ne pouvait que se réjouir
de l'échec de ses adversaires politiques: Vincent, élu
procureur de la commune en 1790, malgré l'opposition
« des modérés », et « le fameux Breissand », alors procureur
de la commune, qui était en désaccord avec lui.
Quoiqu'il en soit, il crut bien faire en se mettant du côté
des « gens sages et prudents » qui « n'osaient pas
s'engager dans cette société; ils prévoyaient qu'elle
pourrait n'être pas au gré de la généralité; ils attendaient
que le vent soufflât d'une manière favorable.
Et lorsque, faute d'adhérents, la liste disparut, « la municipalité
en fut charmée parce qu'elle avait conçu quelques
craintes. »
Mais les chefs du parti démocratique ne pouvaient
rester sur un pareil échec ; aussi, se remirent-ils en campagne.
« Voulant, manifester des intentions pures, la vivacité
de leur imagination leur prescrivit de ne pas céder si
facilement. » Le 15 mai 1791, ils ont réussi à obtenir un
certain nombre de signatures. Il ne leur manque qu'un
local favorable. Ils viennent donc demander à la municipalité
la clef de l'église des ci-devant capucins, acquise
par la commune. La première séance a lieu ; le bureau est
formé ; une députation de douze membres va saluer, de la
part de la société naissante, la municipalité et lui « demander
son approbation ». Les officiers municipaux les reçurent
avec haménïté et leur témoignèrentun vif « désir de leur voir opérer le bien ». Tout s'est passé sans bruit,
sans opposition.
Rien ne semblait donc faire prévoir l'orage qui devait
éclater bientôt. Mais la jeune société eût pu se développer,
devenir une force avec laquelle il eût fallu compter, et ce
n'était pas ce que désiraient les esprits hostiles à la Révolution.
Ils se mirent aussitôt en campagne. La crédulité des
paysans leur permettait de ne pas recourir à des raisons
bien fameuses. Les principaux membres du club furent
attaqués dans les cabarets. « On crut que leur but était de
s'emparer de l'administration ; on prétendit qu'ils disaient
ouvertement que les sociétés des amis de la Constitution
s'établissaient pour surveiller les corps administratifs
et pour leur forcer la main en cas de besoin. Les travailleurs
s'imaginèrent qu'ils voulaient leur faire une dure
loi, en fixant le prix de leur journée et les obligeant à
rester plus longtemps au travail afin de les réduire â
l'esclavage. On prétendait que des membres du club
avaient tenu des propos incendiaires sur la résistance
qu'on paraissait vouloir leur faire ; un imprudent, à ce
qu'on assure, annonça qu'il y aurait des chapeaux de
reste » Quelques membres du clergé se mêlèrent
sans doute à la lutte ; l'abbé Latour, prêtre missionnaire,
« aurait tenu des propos incendiaires contre le club à
l'épouse du cabaretier du fossé. Les clubistes étaient
mal intentionnés...; ils n'avaient en vue que d'opprimer
les travailleurs »
Il était impossible que la municipalité ne fût pas informée
de ce qui se préparait. Pourquoi ne prit-elle pas des
mesures pour défendre ceux qui s'assemblaient légalement
et n'avaient donné aucune raison de suspecter leurs intentions
? Pourquoi n'essaya-t-elle pas d'apaiser ces esprits en
lançant une adresse aux citoyens ? C'était là une mesure qui ne pouvait engager sa responsabilité. Sans doute, elle
était désarmée. Les deux cents hommes du régiment d'Enghien
qui formaient la garnison de Sisteron étaient partis
le 21 février; la seule force disponible était la garde
nationale, dont la plupart des membres étaient hostiles au
club et qui refusa de s'assembler au moment nécessaire ;
mais pourquoi ne pas avertir le district, le département,
demander un conseil ? La municipalité ne fit rien. Du
moins aucune trace de ses demandes n'est restée dans les
registres de la correspondance du district et du département.
Le procès-verbal fort équivoque qu'elle nous a
transmis sur les événements nous permet de croire qu'elle
fut heureuse de paraître avoir eu la main forcée. Il est
impossible de supposer qu'elle fut surprise par les événements,
comme elle le laisse entendre. Toute la semaine, le
club s'assemble sans être troublé; mais, dans les cabarets,
on s'en occupe beaucoup. Les meneurs sont pleins d'activité
; le mot d'ordre est donné ; le but est bien déterminé.
« Leur dessein était de forcer les membres du club à se
séparer le dimanche lorsqu'ils seraient assemblés. » Plusieurs
particuliers de Manosque, présents à Sisteron, ont
promis le secours de leurs concitoyens, qui n'ont pas voulu
permettre l'établissement d'un club chez eux. Peut-être
aussi quelques membres de la nouvelle société furent-ils
imprudents ; c'est ce que laisse entendre le procès-verbal
qui parle de démarches faites auprès de plusieurs travailleurs
pour leur offrir de l'argent, « pour les engager à
rester dans la ville et les dédommager par là de la perte
de leur journée, parce qu'on voulait les éclairer sur la
pureté des motifs qui avaient fait former à Sisteron une
société des amis de la constitution ». Rien, dans ces démarches,
ne paraît cependant blâmable; ils veulent faire
connaître la pureté de leurs principes, essayer de détruire la mauvaise opinion que leurs adversaires se sont plu à
inspirer aux paysans. Quoi de plus juste? Mais c'est
précisément ce que craignent les « modérés ». Ils se hâtent
de les prévenir. « Des méchants dont nous ignorons le nom,
mais que nous pourrions connaître un jour, ennemis d'un
établissement qui ne pouvait présager que d'heureux jours
dans notre ville, portèrent les plus entêtés à se montrer le
samedi soir et à donner la fuite dans les rues à tous ceux
qui seraient soupçonnés d'être du club. Les esprits sont
échauffés ; partout, dans la ville, des groupes se forment.
« Heureusement, ils parlaient à un peuple qui n'a jamais
trempé ses mains dans le sang. » La municipalité, enfin
inquiète, doit s'assembler le samedi 22 avril pour prendre
« des mesures convenables aux circonstances ». Il est trop
tard; réduite à ses propres forces, mal secondée par la
garde nationale, elle ne pourra être maîtresse du
mouvement qu'elle a laissé se former sans rien faire pour
s'y opposer. Elle va être impuissante, réduite à prêcher le
calme, à dissoudre le club ; mesure insuffisante, le parti
aristocratique réclamera des exécutions. Tandis qu'elle
délibère, des attroupements se forment sur la place ; un
tambour, « dont on ignore le nom », bat de sa caisse. Le
major de la garde nationale, Breissand fils, intervient,
l'arrête ; il est hué, menacé ; le valet de ville apporte la
caisse à l'hôtel de ville ; tout de suite, des particuliers
vinrent la réclamer; on fut forcé de la leur remettre
« parce qu'ils étaient furieux ». Le corps municipal
s'empresse alors de faire publier que le club est supprimé.
Les esprits commencent à se calmer, lorsque quelques
émeutiers viennent demander la liste des clubistes,
pour la brûler sur la place. Les officiers municipaux
interviennent, calment les mutins, mais doivent promettre
que la liste sera brûlée. Le valet de ville la
remet au maire ; elle lui est enlevée des mains « par
un particulier qui la mit dans sa poche et lui promit
de n'en faire aucun mauvais usage ». Le maire, impuissant, peut-être consentant, se borne à prêcher la
modération.
Les mutins n'ont plus rien à demander.; ils vont
se disperser, lorsqu'un incident se produit tout près
de là. Des enfants réunis devant la boutique «du sieur
Rostand, perruquier », se mettent à le huer, à lui
lancer des pierres; un citoyen qui se fait raser
sort furieux, une chaise à la main, défiant tout le monde.
Aussitôt, les pierres pleuvent, le sang coule. Affolée, .la
municipalité accourt, fait appel à la garde nationale.
« On lui fit pressentir que toute tentative à cet égard
serait vaine, que personne ne voudrait prendre les armes ».
Le maire est donc réduit à recommander le calme, à laisser
entendre qu'on fera sortir les étrangers qui paraissent
« les plus chaleureux pour le club » ; l'émotion se calme.
Le dimanche matin, cependant, à peine le maire et les
officiers municipaux sont-ils réunis à l'hôtel de ville, que
vingt citoyens se présentent, « escortant celui qui s'était
emparé de la liste du club ». Ils demandent qu'on la lise et
qu'on la brûle. Plus leste et plus avisé que la veille, le
maire la saisit, la brûle et parvient, « en pérorant, à
calmer les têtes exaltées ». Les mutins promettent qu'il n'y
aura plus de troubles. Mais il faut veiller à ce que deux
étrangers « qu'ils nommèrent » ne se présentent pas en
public; « leur bile pourrait être émue par leur
présence ».
Précisément, l'un d'entre eux, Michel Médail, régent du
collège, commet l'imprudence de se montrer sur la place.
Aussitôt, une grande rumeur se fait entendre, sa vie est
en danger. La municipalité, « dénuée de tout secours ,
car la garde nationale a refusé de marcher de nouveau, et
poussée par les membres du directoire du district, se
résout à lancer une proclamation; les attroupements sont
défendus ; des officiers -municipaux, suivis des valets de
ville qui portent les écharpes, sortent et parcourent la
ville. « Pour prévenir les effets que le vin pourrait produire dans la soirée, soixante-douze citoyens honnêtes de la
garde nationale» sont réquisitionnés.
Sans doute, le vin a produit son effet le soir, à 5 heures,
puisque les mêmes citoyens qui ont vu le maire brûler la
liste viennent témoigner le regret qu'ils ont de ne pas
avoir entendu la lecture de cette fameuse liste. Ils iront
prendre, « au lieu de l'assemblée du club », les chaises des
membres, « dans l'espoir de les trouver marquées par le
nom de leur propriétaire ». Ils reviennent sans avoir pu
les obtenir ; ils sont furieux, mais les officiers municipaux
réussissent à les calmer, « à les rendre doux comme des
agneaux .
L'émeute paraît terminée, tout s'est borné à des menaces ;
mais comme des placards ont été affichés dans la nuit du
dimanche au lundi, menaçant de mort plusieurs citoyens
« clubistes et non clubistes », le maire, sur la réquisition
de Breissand, procureur de la commune, se décide à faire
proclamer de nouveau la loi martiale. D'ailleurs, deux des
administrateurs du directoire et un juge,-visés plus directement
par les mutins, ont dû s'éloigner..
De son côté, l'administration du département, enfin
instruite de ce qui se passe, s'est hâtée d'intervenir pour
rappeler les citoyens au respect de la loi. Le 22 mai, les
administrateurs écrivent à la municipalité. Tout en
reconnaissant « le zèle et l'amour pour la chose publique »
des officiers municipaux, les membres du directoire ne
pouvaient approuver cette violation formelle de la loi.
« On l'a joué, ce peuple, d'une manière bien atroce,
lorsqu'on lui a représenté ses vrais amis comme des
monstres qui ne se rassemblaient que pour sa ruine. Vous
savez que la loi autorise les clubs et que les amis de la
constitution sont les amis du peuple. Le temps n'est pas éloigné où le peuple mieux instruit demandera
lui-même que la société se forme. »
Et, dans leur adresse aux citoyens de Sisteron, les
administrateurs du département rendaient hommage aux
intentions des chefs du parti démocratique. « On vous
trompe ; vos amis, vos vrais amis, vos protecteurs et vos
frères ont été dénoncés comme des méchants. Les amis de
la Constitution, citoyens, sont les amis du peuple. On
vous a dit que les amis de la Constitution ne se rassemblaient
en club ou Société que pour s'emparer de vos
biens communaux, que pour diminuer le prix de vos
journées, et vous avez cru ces hommes, et vous avez
dissipé ou mis en fuite vos guides et vos gardiens.
Citoyens, les amis de la Constitution ne se forment en club
ou société que pour maintenir et défendre les droits du
peuple. Leurs assemblées sont publiques ; vous êtes les
maîtres d'y assister ; chacun de vous peut en être membre ;
il est, dès lors, impossible qu'en votre présence et sous les
yeux du public entier il soit rien entrepris contre la chose
publique. »
Cette attitude ferme des autorités du département dut
faire comprendre aux chefs du mouvement hostile qu'ils
faisaient fausse route en recourant à l'émeute. Ils se
tinrent désormais tranquilles. De leur côté, démontés un
moment et effrayés par la violence de leurs adversaires,
« les enragés », soutenus par la municipalité et le département,
s'étaient remis de leurs alarmes et avaient fait appel
à leur amis des villages voisins. Certains, dès lors, de ne
plus être isolés, ils s'adressèrent au corps municipal
pour réclamer de lui la protection qui leur était due. Le
sieur Médail lui adressa une lettre « conçue d'un stille
un peu lest et rude », pour demander à reprendre ses
fonctions ; puis Feraud et Maïsse cadet, négociants, de Sisteron, vinrent, au nom d'un certain nombre de leurs
concitoyens, faire des représentations au maire, au sujet
du peu de protection qu'avait obtenu le sieur Médail. Ils
ajoutèrent : « Nous venons encore vous avertir que, si les
» paysans de la ville se permettent encore la moindre insurrection, cinq cents hommes seront à nos ordres prêts à
prendre les armes, pour venir fondre sur eux et les écharper. »
« Le bruit courait, ajoute le procès-verbal, que des
membres du club avaient écrit aux municipalités du canton
pour leur demander des secours, au cas qu'on se soulevât
contre eux à Sisteron. »
Cette intervention ne devait pas se produire cette année.
Satisfaits d'être arrivés à leurs fins, les chefs du parti
aristocratique évitèrent désormais d'employer la violence ;
mais la lutte entre les deux partis continua plus âpre,
plus acharnée que jamais, au fur et à mesure que se déroulaient
les événements.
A la fin de l'année 1791, les élections municipales les
mirent en présence. Breissand voulait être nommé maire,
mais « les gens honnêtes » firent choisir Laplane (1).
(1) Mémoire Hodoul.
Les « modérés » l'emportent donc ; ils font élire leurs
partisans à la Législative. Ils manoeuvrent si habilement
que le club ne peut être établi; les paysans, travaillés par
eux, sont toujours hostiles ; aussi, les chefs du parti
démocratique n'osent risquer une nouvelle tentative.
Mais peu à peu les idées nouvelles pénètrent les campagnes
; la ville va bientôt se trouver isolée, au milieu de
populations gagnées au nouveau régime.
Ce sera le moment d'essayer, avec succès cette fois,
l'établissement de la société populaire. Peut-être, en avril 1791, a-t-il manqué aux clubistes des chefs qui, par leur
situation, leurs fonctions, jouissent d'une grande autorité ;
les Breissand, Imbert, Bertrand ne sont pas assez en vue;
l'arrivée des constituants va donner une nouvelle impulsion
à la marche en avant du parti. Tandis que Latil et Burle,
« hommes sages, prudents et instruits », restent chez
eux, Mevolhon, « plus jeune, plus ardent», se montre
davantage. Le procureur syndic est gagné à la cause
démocratique. Ces deux chefs, poussés par Imbert, Breissand,
Borely et Bertrand, vont être amenés à prendre la
direction du mouvement, à réclamer l'intervention des
Marseillais. Une année après la première tentative, un
nouvel essai va être tenté.
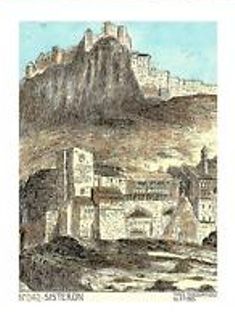
A cette époque, les circonstancesont changé. Si, dans la ville, les paysans paraissent toujours pour la plupart dominés par la classe bourgeoise, dans les campagnes, le peuple a pris conscience de ses droits, il réclame sa participation au gouvernement de la France. Mais la réaction n'a.pas désarmé; la lutte devient plus âpre, plus ardente, d'autant plus violente que les dangers intérieurs et extérieurs ne cessent de grandir. Le peuple est inquiet; les récoltes sont mauvaises ; le prix du blé augmente dans les Basses-Alpes d'une façon inquiétante (1).
(1) « Le 10 mai 1793, Barras et Fréron écrivent au Comité de salut public : « Au nom de la patrie et de l'humanité, venez au : secours des départements des Hautes et Basses-Alpes... Plusieurs communes ». ne se nourrissent que de pommes de terre et d'herbes...; il y a quatre ans qu'ils n'ont eu de récolte. » Aulard : Recueil des actes, du Comité de salut public, iv, page 92.
L'impôt ne rentre
pas. Les fonctionnaires ne sont pas payés depuis
janvier; les routes sont en mauvais état. La levée des
volontaires se fait avec lenteur, avec beaucoup de difficultés.
Les volontaires sont insubordonnés ; des rixes ont
lieu avec la population. A Entrevaux, ils sont journellement insultés; le maire, M.de Prats veut à toute
force les renvoyer. A Riez, Sisteron, la Municipalité, le
commandant d'armes réclament leur départ. Des discussions
ont éclaté, à Sisteron, entre grenadiers et volontaires;
le département a du les éloigner, avril 1792.
Enfin l'agitation religieuse prend des proportions
inquiétantes. Les rétractations de serment se multiplient
; les prêtres constitutionnels sont bafoués,
assaillis dans l'église, chez eux, à Volonne, Sault,
Castellane, Senez. De véritables émeutes éclatent
à Manosque, Sisteron, Saint-Paul, Riez, Oraison, Annot,
Valensole. Le départementa beau multiplier les arrêtés,
recourir à la sévérité, revenir à l'indulgence, il est
impuissant.
Les forces ennemies croissent aux frontières ; les armées
se massent, prêtes pour l'invasion; déjà plusieurs paniques
ont secoué le département; les places de la frontière
appellent l'ennemi; Entrevaux refuse de recevoir les
volontaires ; la population s'arme contre eux ; les officiers
municipaux sont à leur tête ; à Barcelonnette, l'état est
aussi alarmant.
Les administrateurs sont débordés ; ils ne peuvent
compter ni sur les volontaires, travaillés par le parti
aristocratique, mal équipés, mal armés, portés à la désertion,
ni sur la gendarmerie, dont les chefs sont hostiles,
refusent d'obéir aux ordres du département, l'attaquent
ouvertement. C'est pourquoi, au moment même où va se produire la
deuxième tentative, le procureur général syndic, alarmé
par les dangers que court le département, fait appel aux
procureurs syndics,des districts, les mande auprès de lui.
pour aviser aux mesures à prendre. Tout est à craindre :
si le roi de Sardaigne réussit à mettre la main sur Entrevaux, sur Sisteron, le département est perdu. Mais la ville de Marseille s'est décidément mise à la
tête du mouvement, démocratique. La société populaire est
puissante ; elle surveille ce qui sepasse en Provence ; elle
offre, d'intervenir, site besoin se fait sentir. Sous son
impulsion, en avril et en mai 1792, partout les sociétés populaires se multiplient, à Moustiers, Seyne, Céreste,
Vâlernes, Vaumeilh, Volonne,Villeneuve, Oraison,
Malijai, etc..., malgré les efforts des.municipalités ou avec
leur agrément. Les affiliations vont unir les sociétés
naissantes; leurs commissaires parcourront le département;
la lecture des journaux, des « papiers nouvelles »,
permettra au peuple de se rendre compte de ce qui se
passe. Les manoeuvres du parti hostile, à Sisteron, vont
hâter ce développement.
Mais l'agitation est grande ; la surexcitation des esprits
est effrayante. Les administrateurs, accablés de besogne,
laissés sans instructions précises, ne peuvent que multiplier
les exhortations, au calme. En présence des menaces de
coalition qui s'accentuent entre les ennemis de tout ordre,
qui s'agitent à l'intérieur, et les ennemis de la France, qui
guettent le moment favorable d'intervenir, que peuvent-ils
faire? Recourir aux sociétés populaires, qui commencent à être une force avec laquelle il faut compter ? C'est ce qu'ils
font (1).
(1) Lettre des administrateurs du département du 18 mars 1792 aux amis de la Constitution, à Castellane: « Des citoyens égarés inspirent des craintes : ils cherchent à séduire le peuple sur son véritable intérêt et à allumer dans le sein de l'empire une guerre civile... Si les citoyens s'oubliaient un moment sur les vrais principes, nous verrions les sociétés des amis de la Constitution, ce foyer de lumière et des principes, prendre tous les moyens possibles pour ramener les citoyens égarés. » Archives départementales, L 1, 188.
Quant au procureur général syndic Verdollin,
ancien constituant, dont on ne saurait trop admirer l'activité,
l'énergie, il est tout dévoué au peuple ; sa correspondance
en fait foi. Voici ce qu'il écrit à Bouche, ancien
constituant, en février 1792 :
« Le peuple ne se départira jamais de la suppression de
la dîme, de la gabelle, des droits féodaux personnels, de
l'encens, de l'eau bénite, de la pêche, de lâchasse, des
corvées et de tant de servitudes accablantes et avilissantes.
C'est à Versailles qu'il fallait étouffer le germe
de la Constitution. Si nos ennemis avaient été alors plus
osés, peut-être que le peuple, tremblant encore sous le
despotisme, incapable d'apprécier la grandeur et l'importance
de notre mission, aurait dissimulé les outrages qu'on
nous aurait faits ; avec des déclarations bien touchantes et
bien paternelles et quelques adoucissements momentanés
sur l'impôt, on l'aurait endormi pour mieux river ses
chaînes. Nous aurions été représentés comme des factieux
qui avaient outrepassé leurs pouvoirs et qui voulaient
attenter aux droits les plus sacrés. C'en était fait de notre
liberté »
Il est tout acquis à la cause des sociétés populaires. Dès
les premières nouvelles du mouvement, il se hâtera de
prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute
intervention étrangère, toute trahison. La présence d'un tel homme était nécessaire dans un pareil moment, où les
partis organisés étaient prêts à se jeter les uns sur les autres.
D'après le mémoire Hodoul, le mouvement démocratique
qui se produisit en mai 1792 à Sisteron et qui eut pour
résultat l'établissement définitif de la société populaire,
aurait été déterminé par l'appel des habitants de Valernes
aux Marseillais. Furieux de voir qu'une instruction était
dirigée contre eux à la suite du pillage du château de
Nibles, ils se seraient adressés à Marseille pour établir un
club à Valernes. Isoard et Tourneau, commissaires de la
société de Marseille, accompagnés de plusieurs députés
des sociétés voisines de Manosque, Pertuis, remontèrent
la Durance, organisant partout des clubs. Le parti avancé,
ayant alors à sa tête Mevolhon (1), qui depuis devait
être un fougeux fédéraliste, fit appel aux commissaires
marseillais.
(1) Archives de Sisteron, registre 123, 10 mai 1793: « Le conseil, considérant que Jean-Antoine Mevolhon, après avoir recouru lui-même, dans le mois de mai 1792,. au secours des Marseillais pour abattre l'aristocratie, qui étouffait alors les patriotes dans notre cité.... »
En même temps, ils demandaient au maire
Laplane la permission de former un club. Les « modérés »,
inquiets de voir les paysans leur échapper, agirent sur
Laplane et les officiers municipaux favorables à leur
cause, s'organisèrent sous le titre de « Confrairie du
Deus providebit » et obtinrent du maire qu'il refuserait
aux amis de la Constitution le droit de s'assembler et un
local, l'église des Capucins. Mais le procureur général syndic
intervint alors ; il écrivit à Laplane, le 10 mai 1792 : « Les
amis de la Constitution sont aussi ceux de la loi; elle leur
permet de s'assembler. » Le maire cède ; la réunion a
lieu, aux portes de la ville ; peu de paysans y assistent. Alors, accourt.le chef du parti avancé de Manosque, Baset,
accompagné de plusieurs fidèles ; ils parcourent la ville,
travaillent les paysans, qui arrivent peu.à peu et se rendent
au club. Mais, « les bons citoyens. » se sont émus; ils
envahissent la salle des,séances ; « les ennemis de l'ordre,
moins nombreux,, furent hués.. Ce fut une fort mauvaise
politique. Les commissaires marseillais étaient, encore dans
le département ; il aurait fallu se conduire avec plus
d'adresse et ne, pas pousser au désespoir des. êtres immoraux. » C'est alors que les « prétendus patriotes »
appellent à leurs secours Isoard et Tourneau, en ce
moment à Malijai. On convient que les commissaires se
porteront sur Sisteron, avec trois cents gardes nationaux.
Ils se rendent à Manosque, tandis que leurs émissaires se
répandent dans les communes voisines de Sisteron, On mouvement général a lieu; partout, les membres des
sociétés populaires prennent les armes.
L'administration, du département, avertie, aurait donné
dans le piège, d'après Hodoul, et envoyé Breissand à Manosque pour donner l'ordre à la garnison de Forcalquier
de se rendre à Sisteron, afin de favoriser l'incursion, des Marseillais. La vérité est que Verdollin est fort inquiet,
il craint que le parti aristocratique ne s'empare de la.
citadelle et ne la livre au roi de. Sardaigne. Heureusement, le 3e bataillon des volontaires des Basses Alpes
est complètement organisé. Cinq compagnies sont à Manosque,
quatre à Forcalquier ; ces dernières, sont placées
sous le commandement de M. Mourut lieutenant-colonel.
C'est aux quatre compagnies de Forcalquier que Verdollin s'adresse : il craint de dégarnir Manosque, où l'agitation
est grande. On attend cette troupe à Sisteron, le 27 mai.
Elle forcera la marche et arrivera le 16 mai, à 9 heures du
soir, de façon à s'établir immédiatement dans la citadelle. Les prévisions du procureur général syndic sont
justes ; ses craintes sont fondées. La confrérie du Deus
providebit s'agite ; les membres se rassemblent dans une
grotte près de la forteresse ; des prêtres réfractaires
prêchent. Ils décident de provoquer une réunion de tous
.les adhérents, le 17, jour de l'Ascension. « Le prospectus
d'un rassemblement est présenté à la municipalité, sous le
titre d'un banquet. On emploie le crieur public et le son
de la trompette pour avoir des souscripteurs. » Quels sont
les projets de cette association au nom bizarre? D'après le
procès-verbal des événements dressé par les autorités du
district, cette société voulait « arborer la cocarde blanche,
porter les travailleurs à l'insurrection, se livrer à d'exécrables
exécutions, fabriquer de faux assignats, diminuer
le salaire des ouvriers » Ils disaient que « les impositions
des patentes n'étaient que pour alimenter quelques
sangsues ». On s'y livrait, la nuit, à « des libations copieuses
». « C'était une association avec symbole, mot de gué. »
Mais le parti démocratique a sous la main les habitants
des villages voisins: ils sont prêts à se porter en foule à
Sisteron; «ils se méfient des chefs, des auteurs de cette
institution bizarre ».
Les deux partis vont se trouver en présence. Les membres
du directoire du district, les administrateurs, les
officiers municipaux sont en permanence, dès le 16 mai, à l'hôtel de ville. Quel parti prendre ? Sisteron a pour se
défendre cent-vingt gardes nationaux et ne peut compter
sur leur concours. Le lieutenant de gendarmerie, d'ailleurs
suspect, a déserté son poste, et l'on annonce l'arrivée de
quatre mille hommes armés. Aussi, le procureur syndic
s'est-il hâté de courir à Manosque, pour chercher des
troupes. Mais, déjà épouvantés, quelques habitants se sauvent.
Heureusement, vers les 9 heures, les quatre compagnies
du 3e bataillon des volontaires, forçant la marche, font
leur entrée dans la ville, occupent la citadelle. La troupe
est peu nombreuse ; mais, si les volontaires sont impuissants
à repousserla foule armée qui va se jeter dans la ville,
au moins toute crainte d'intervention étrangère disparaît.
Le commandant, M. Mouret, s'est mis à la disposition des
autorités ; ses volontaires nationaux sont actifs, zélés,
disciplinés ; ils contiendront le rassemblement, s'ils ne
peuvent le dissiper..
A peine les dernières dispositions sont-elles prises, le
17 mai, qu'on annonce l'arrivée d'un corps nombreux de
gardes nationaux de Manosque. Un officier, député par
le détachement de Marseille, se présente. Trois cents
hommes vont arriver ; ils sont chargés d'établir un véritable
club patriotique, « parce que celui qui a été formé en
dernier lieu n'est que l'effet de la cabale et un vrai
rassemblement aristocratique » ; ils veulent une réparation
authentique de l'insulte faite aux commissaires
marseillais et l'abandon du repas annoncé. Les autorités
assemblées leur envoient des députés ; « on recevra la
troupe comme frères et amis ». Mevolhon, Maïsse, Imbert,
Briançon vont « se concilier avec eux ». Le repas n'aura pas lieu : on établira un véritable club affilié à celui de
Marseille.
Tandis que les chefs se concertent, que les autorités
lancent une proclamation aux citoyens, envoient Vincent,
administrateur du directoire du district, comme député à
la société de Marseille, des détachements de gardes nationaux
des municipalités voisines ne cessent d'arriver. Des
commissaires les attendent, veillent au bon ordre. Hodoul,
. dans son mémoire, évalue leur nombre à 1,500 à midi, à
2,000 le soir. La ville en est remplie ; il faut les loger, les
nourrir, veiller à ce que des disputes ne s'élèvent pas
entre les habitants et ces hommes armés surexcités,
« exigeant, si l'on en croit Hodoul, du gibier, des
liqueurs, du café ». Il est vrai que les membres de « la
/confrérie du Deus providebit » se tiennent cois. Le maire,
fortement suspect, a donné sa démission ; les juges se sont
dispersés ; mais les officiers municipaux qui restent, les
administrateurs du district se multiplient, veillent à tout.
La nuit est bientôt là. Qu'arriverait-il si, dans cette foule
pressée, remuante, surexcitée par le bruit, le mouvement,
les libations, quelque attentat se commettait à la faveur
de l'obscurité? Ce serait le signal d'un bouleversement
général. Les autorités l'ont prévu ; le mot d'ordre est donné
sans bruit; tous les citoyens illuminent ; des patrouilles
parcourent les rues. La nuit est tranquille.
Le 18 mai, à 10 heures du matin, doit avoir lieu la
première réunion du club ; elle est renvoyée à 5 heures du
soir. Mais, déjà, les rues sont pleines de bruit, de mouvement
; à 8 heures, les gardes nationaux des différentes
municipalités sont disposés en bataille sur le Cours, hors
des portes de la ville : ils veulent « rendre leurs devoirs »
aux autorités, qui envoient une députation. Les tambours
battent aux champs ; les cris de : Vive la nation I Vive la
loi! éclatent; les chapeaux s'agitent au bout des
baïonnettes, en signe .d'allégresse ; on se jure mutuellement
assistance, amitié, union. Puis l'ordre du départ est donné, et, tambour battant, les divers détachements s'éloignent
de Sisteron. A midi, il ne reste plus que trois cents
hommes . Les administrateurs commencent à respirer.
A ce moment, d'ailleurs, arrivent Guigou et Chaudon,
commissaires du département. Ils mandent devant eux les
particuliers désignés comme les instigateurs et les admonestent
« fraternellement ».
Mais soudain l'alarme est donnée. On annonce l'arrivée
de cinq à six mille Marseillais armés. La frayeur s'empare
de tous. Comment résister? Le fort est en mauvais état; la
citadelle est presque démantelée d'un côté. D'ailleurs, des
disputes ont éclaté ; les détachements des Mées demandent
la punition de ceux qui les ont insultés.
Heureusement, les alarmes cessent, les discussions
s'apaisent. Au bruit des fanfares, un peuplier, orné du
bonnet de la liberté, est porté et planté par les gardes nationaux
sur la place publique ; puis une immense farandole,
où tous, étrangers et habitants, sont confondus, se déroule
sur la place, au milieu des chants et des cris.
Cependant, la première réunion de la société a lieu vers
les 5 heures, à la chapelle Saint-Martin ; tout se passe
« avec ordre et décence ». On apprend que le juge de
paix a donné sa démission ; les juges du tribunal ont quitté
la ville. Seul, Hodoul, président du tribunal du district,
vient rejoindre les corps constitués qui siègent à l'hôtel
de ville.
Grâce aux mesures prises, la nuit est tranquille.
Le 19, la cherté du blé est sur le point de provoquer des
complications, mais le calme renaît.
Pour célébrer l'union et le triomphe des patriotes, « un picnic » a lieu chez Bertrand, au Bras-d'Or ; soixante personnes
y assistent. « Les plats étaient ornés de petits
pavillons en soye et papier portant différentes devises,
notamment celles-cy,: « Guerre aux châteaux. Paix aux chaumières ! Vive les patriotes ! Point de quartier aux
aristocrates ! » Au dessert, arriva une douzaine d'artisans,
avec les tambours et musique ; ils présentèrent une
couronne civique à Isoard et Tourneau. » Puis le procureur
syndic se met à la tête de la farandole, portant la
couronne sur une pique ; on danse autour de l'arbre de la
liberté; on brûle plusieurs « de ces infâmes papiers aristocratiques
tirés du cercle composé de citoyens qui s'intitulent
les honnêtes gens ».
Et la troupe se disperse, si l'on en croit le procès-verbal
dressé par les administrateurs du district. Hodoul, au
contraire, déclare « qu'Isoard et autres, le bras nu, le
sabre au poing, rançonnent les habitants ». Il est difficile
de penser que les corps administratifs, en permanence
à l'hôtel de- ville, aient ignoré ou toléré des perquisitions
à main armée, La plupart des détachements ont
quitté la ville ; les volontaires occupent toujours la citadelle
; les commissaires envoyés par le département sont
encore à Sisteron. D'ailleurs, les malveillants s'agitent ; le
20, au matin, ils « déclarent qu'ils seront maîtres de la ville,
soit par eux-mêmes, soit par les Savoyards, qu'ils se vengeront
de leur humiliation; un invalide court les rues,
en proférant des blasphèmes contre les officiers municipaux ».
.D'autre part, la société s'est définitivement organisée ;
un Te Deum est chanté pour célébrer l'union des patriotes:
vingt-cinq prêtres égarés ont prêté serment; la démission du maire, du juge de paix, des juges est acceptée., dit le
procès-verbal du district, exigée, dit Hodoul.
Alors, seulement, « les gardes nationales étrangères »
qui restent encore à Sisteron partent, ayant à leur tête les
commissaires de Marseille et de Manosque ; la foule
accourt, les acclame.
Au dernier moment, ces commissaires ont-ils eu avec
Mevolhon une longue discussion ? Le mémoire Hodoul
l'affirme. Il semble, en effet, que quelque froissement dut
se produire, puisque Mevolhon, qui avait été le premier à
faire appel à leur concours, fut désormais tout à fait hostile
au parti populaire et devint un des promoteurs du
fédéralisme.
Quoi qu'il en soit, si la société populaire était désormais
fondée définitivement, les esprits étaient aigris. Le parti
aristocratique humilié ne renonçait pas à ses projets, il
se promettait seulement de saisir l'occasion favorable ; il
n'hésitera pas, au besoin, à donner la main à l'étranger (1).
(1) Mémoire Hodoul. — A la suite de l'élection de Breissand, à la place du procureur syndic, une farandole se déroule dans les rues. Mevolhon s'écrie : « Oui, oui, chantez ; le roi de Prusse s'avauce et vous fera bientôt faire une autre danse. »
Sans doute, il faut faire la part de l'exagération méridionale;
des actes aux paroles, il y a loin. Et cependant n'a-t-on pas
surpris, à Entrevaux, des gens qui correspondent avec
l'ennemi. « Le germe des discussions n'est pas étouffé; l'étincelle de la guerre civile couve sous la cendre. »
«Les coryphées de la confrérie du Deus providebit de
Sisteron ont dit que les Savoyards les vengeraient
bientôt. »
Si les patriotes sont victorieux, ils comprennent que leur
victoire n'est que temporaire. Pour venir à bout de la
coalition formée contre eux, ils ont dû faire appel à l'intervention
étrangère, employer des moyens violents. Sans
doute, le but est légal. Le décret du 13 novembre 1790 reconnaît
aux citoyens le droit de s'assembler paisiblement, de
former des sociétés populaires. L'Assemblée nationale l'a
formellement proclamé au sujet de la société de Dax. Les
administrateurs du département ont toujours déclaré aux
municipalités qu'elles ne pouvaient empêcher ces réunions.
Que reprocher, d'ailleurs, à ces sociétés populaires? Nulle
part, on ne trouve trace de motions incendiaires. Partout,
on prêche le respect des propriétés, la nécessité de payer
l'impôt, l'emploi des moyens de douceur. Sans cesse, les
empêchent les abus à propos des biens nationaux. Ne sont-elles
pas aussi absolument respectueuses des croyances
religieuses ? Il faut arriver à la réaction qui suivra le
fédéralisme, pour trouver la trace des mesures violentes.
Mais alors le roi a trahi; les ennemis du dedans donnent la
main aux émigrés, aux étrangers. La patrie est en danger.
L'exemple du recours à la violence ne leur a-t-il pas été
donné par leurs adversaires ? Si le parti aristocratique a
soulevé les paysans en 1791, peut-on reprocher aux clubistes
d'avoir fait appel à ces mêmes paysans, en 1792?
Poussés à bout par leurs adversaires ils avaient dû
appeler les Marseillais. Cette intervention, il est vrai, était fort regrettable. Désormais, les incursions de ces derniers
vont se multiplier dans nos Alpes, entraînant avec elles
les violences, les perquisitions domiciliaires, exaspérant
les animositês, poussant, à la révolte, au moment même
où les ennemis envahissent la France. A Manosque, en
août 1792, à Digne, en janvier 1793, les commissaires
marseillais reparaîtront, tranchants, violents, s'attribuant
le droit de juger les autorités et de lever des
contributions.
D'un autre côté, les paysans sont surexcités ; leurs
convoitises ,croissent ; alarmés par les résistances des
ennemis clé la Révolution, la cherté des grains, les levées
de volontaires, les menaces des émigrés, l'envahissement
de la France, l'exagération de l'agitation religieuse, ils
sortent de leur calme habituel, écoutent les meneurs,
s'insurgent ouvertement.
Partout, des troubles se produisent, à Manosque, Sainte-Tulle, Voix, Volonne, Nibles, Chàteauneuf-Val-Saint-Donat.
L'appel à la violence a porté ses fruits; la guerre civile
va commencer.
C. CAUVIN.
![]()
Quelques épisodes de la Contre Révolution à Sisteron en 1792. ICI
Un autre article des Annales des Basses Alpes, encore ICI